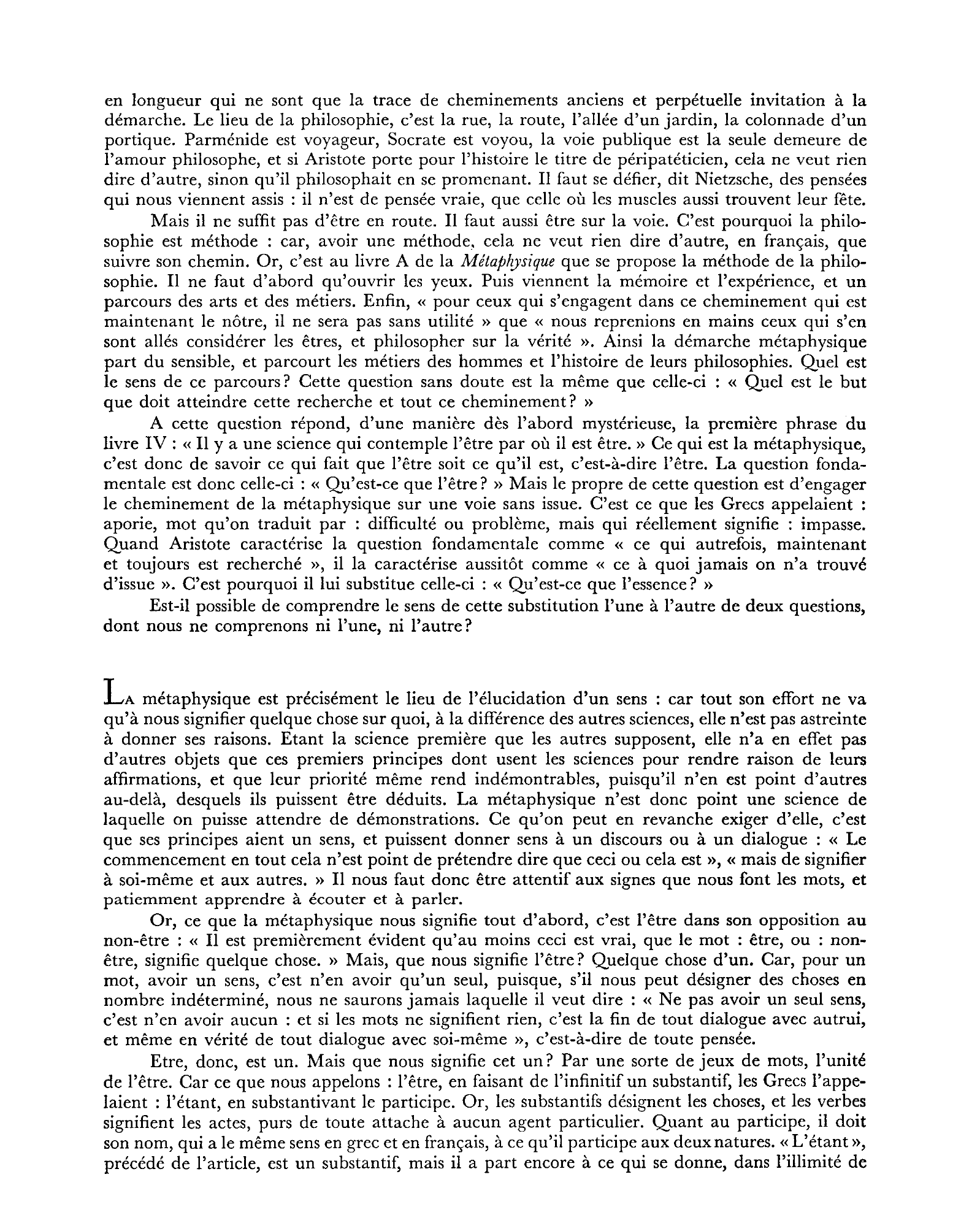Aristote: présentation de l'oeuvre du Stagirite
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
l
t
t
1
en longueur qui ne sont que la trace de cheminements anciens et perpétuelle invitation à la
démarche.
Le lieu de la philosophie, c'est la rue, la route, l'allée d'un jardin, la colonnade d'un
portique.
Parménide est voyageur, Socrate est voyou, la voie publique est la seule demeure de
l'amour philosophe, et si Aristote porte pour l'histoire le titre de péripatéticien, cela ne veut rien
dire d'autre, sinon qu'il philosophait en se promenant.
Il faut se défier, dit Nietzsche, des pensées
qui nous viennent assis : il n'est de pensée vraie, que celle où les muscles aussi trouvent leur fête.
Mais il ne suffit pas d'être en route.
Il faut aussi être sur la voie.
C'est pourquoi la philo
sophie est
méthode : car, avoir une méthode, cela ne veut rien dire d'autre, en français, que
suivre son chemin.
Or, c'est au livre A de la Métaphysique que se propose la méthode de la philo
sophie.
Il ne faut d'abord qu'ouvrir les yeux.
Puis viennent la mémoire et l'expérience, et un
parcours des arts et des métiers.
Enfin, « pour ceux qui s'engagent dans ce cheminement qui est
maintenant le nôtre, il ne sera pas sans utilité » que « nous reprenions en mains ceux qui s'en
sont allés considérer les êtres, et philosopher sur la vérité ».
Ainsi la démarche métaphysique
part du sensible, et parcourt les métiers des hommes et l'histoire de leurs philosophies.
Quel est
le sens
de ce parcours? Cette question sans doute est la même que celle-ci : « Quel est le but
que doit atteindre cette recherche et tout ce cheminement? »
A cette question répond, d'une manière dès l'abord mystérieuse, la première phrase du
livre IV : «Il y a une science qui contemple l'être par où il est être.» Ce qui est la métaphysique,
c'est
donc de savoir ce qui fait que l'être soit ce qu'il est, c'est-à-dire l'être.
La question fonda
mentale est donc celle-ci : « Qu'est-ce que l'être? » Mais le propre de cette question est d'engager
le cheminement de la métaphysique sur une voie sans issue.
C'est ce que les Grecs appelaient :
aporie,
mot qu'on traduit par : difficulté ou problème, mais qui réellement signifie : impasse.
Quand Aristote caractérise la question fondamentale comme « ce qui autrefois, maintenant
et toujours est recherché », il la caractérise aussitôt comme « ce à quoi jamais on n'a trouvé
d'issue ».
C'est pourquoi il lui substitue celle-ci : « Qu'est-ce que l'essence? »
Est-il possible de comprendre le sens de cette substitution l'une à l'autre de deux questions,
dont nous ne comprenons ni l'une, ni l'autre?
LA métaphysique est précisément le lieu de l'élucidation d'un sens : car tout son effort ne va
qu'à nous signifier quelque chose sur quoi, à la différence des autres sciences, elle n'est pas astreinte
à
donner ses raisons.
Etant la science première que les autres supposent, elle n'a en effet pas
d'autres objets que ces premiers principes dont usent les sciences pour rendre raison de leurs
affirmations,
et que leur priorité même rend indémontrables, puisqu'il n'en est point d'autres
au-delà, desquels ils puissent être déduits.
La métaphysique n'est donc point une science de
laquelle on puisse attendre de démonstrations.
Ce qu'on peut en revanche exiger d'elle, c'est
que ses principes aient un sens, et puissent donner sens à un discours ou à un dialogue : « Le
commencement en tout cela n'est point de prétendre dire que ceci ou cela est », « mais de signifier
à soi-même
et aux autres.
>> Il nous faut donc être attentif aux signes que nous font les mots, et
patiemment apprendre à écouter et à parler.
Or, ce que la métaphysique nous signifie tout d'abord, c'est l'être dans son opposition au
non-être : « Il est premièrement évident qu'au moins ceci est vrai, que le mot : être, ou : non
être, signifie quelque chose.
» Mais, que nous signifie l'être? Quelque chose d'un.
Car, pour un
mot, avoir un sens, c'est n'en avoir qu'un seul, puisque, s'il nous peut désigner des choses en
nombre indéterminé, nous ne saurons jamais laquelle il veut dire : « Ne pas avoir un seul sens,
c'est
n'en avoir aucun : et si les mots ne signifient rien, c'est la fin de tout dialogue avec autrui,
et même en vérité de tout dialogue avec soi-même », c'est-à-dire de toute pensée.
Etre, donc, est
un.
Mais que nous signifie cet un? Par une sorte de jeux de mots, l'unité
de l'être.
Car ce que nous appelons : l'être, en faisant de l'infinitif un substantif, les Grecs l'appe
laient : l'étant, en substantivant le participe.
Or, les substantifs désignent les choses, et les verbes
signifient les actes,
purs de toute attache à aucun agent particulier.
Quant au participe, il doit
son nom, qui a le même sens en grec et en français, à ce qu'il participe aux deux natures.« L'étant»,
précédé de l'article, est un substantif, mais il a part encore à ce qui se donne, dans l'illimité de
73
l ________ _.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Qui peut le plus peut le moins » ARISTOTE
- « L’amitié est une âme en deux corps » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- « Il n’y a point de génie sans un grain de folie » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- Méthode expérimentale; CHAPITRE 2 ARISTOTE : LOGIQUE ET RHÉTORIQUE
- commentaire Aristote Métaphysique