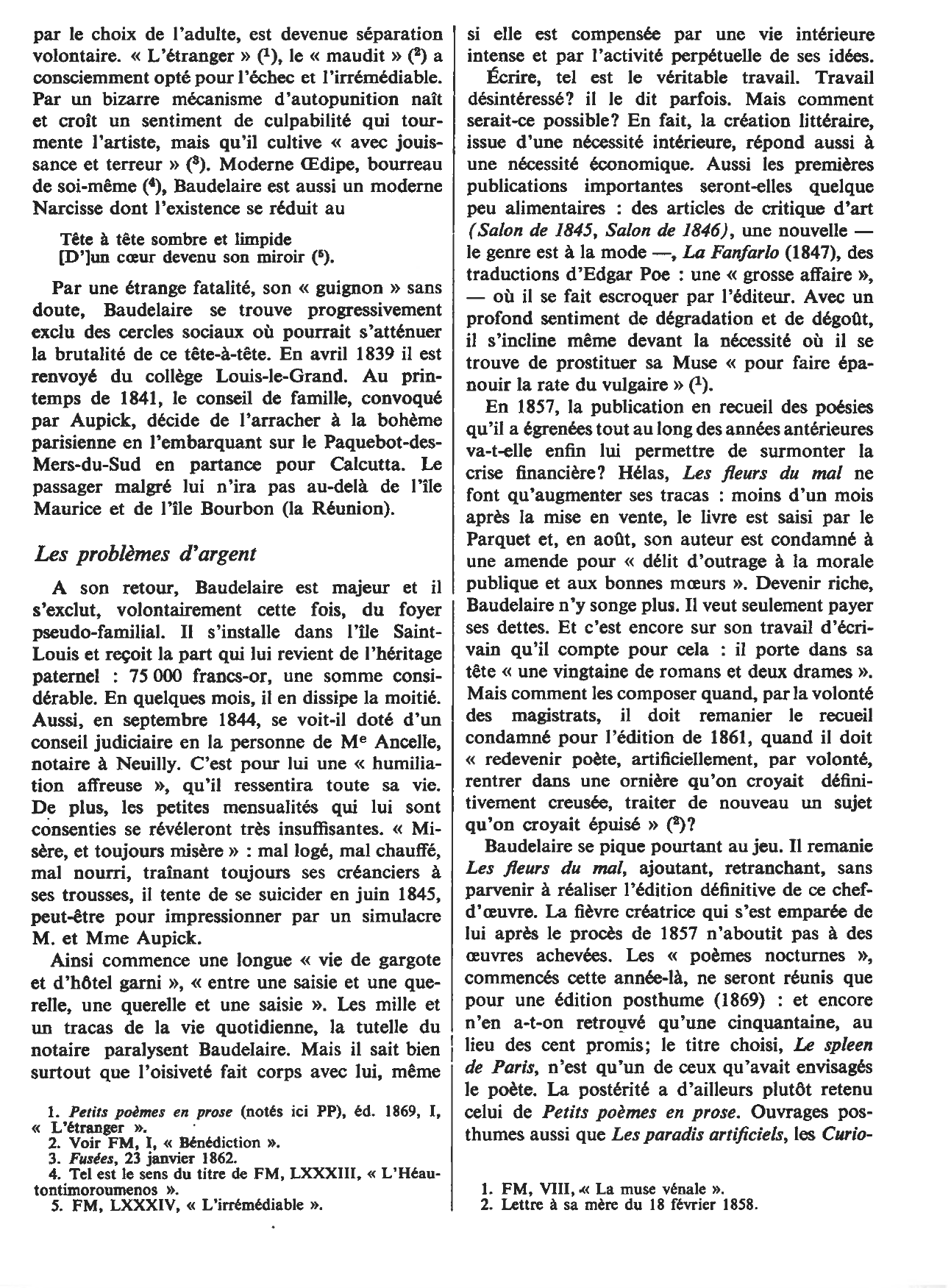Charles Baudelaire
Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Le poète français Charles Baudelaire (1821-1867) publie Les Fleurs du Mal, en 1857. Il sera condamné par la justice et six poèmes de ce recueil seront interdits dans les éditions suivantes. Pourtant, les thèmes qu'il explore – l'isolement, le péché et la mélancolie – font partie d'une quête d'ordre et de beauté dans cette société chaotique et décadente qui l'entoure. Musicaux et magnifiquement travaillés, ces poèmes représentent une étape décisive dans la littérature européenne.

«
par le choix de l'adulte, est devenue séparation
volontaire.
« L'étranger » (1 ), le « maudit » (2
) a
consciemment
opté pour l'échec et l 'irrémédiable .
Par un bizarre mécanisme d'autopunition naît
et croît un sentiment de culpabilité qui tour
mente l'artiste, mais qu'il cultive « avec jouis
sance
et terreur » (3).
Moderne Œdipe, bourreau
de soi-même ( 4), Baudelaire est aussi un moderne
Narcisse dont l'existence se réduit au
Tête à tête sombre et limpide
[D']un cœur devenu son miroir ( 6).
Par une étrange fatalité, son « guignon » sans
doute, Baudelaire se trouve progressivement
exclu des cercles sociaux
où pourrait s'atténuer
la brutalité de ce tête-à-tête.
En avril 1839 il est
renvoyé
du collège Louis-Je-Grand.
Au prin
temps de 1841, le conseil de famille, convoqué
par Aupick, décide de l'arracher à la bohème
parisienne en l'embarquant sur Je Paquebot-des
Mers-du-Sud en partance pour Calcutta.
Le
passager malgré lui
n'ira pas au-delà de l'île
Maurice et de l'ile Bourbon (la Réunion).
Les problèmes d'argent
A son retour, Baudelaire est majeur et il
s'exclut,
volontairement cette fois, du foyer
pseudo-familial.
Il s'installe dans 1 'ile Saint
Louis et reçoit la part qui lui revient de l'héritage
paternel :
75 000 francs-or, une somme consi
dérable.
En quelques mois, il en dissipe la moitié .
Aussi,
en septembre J 844, se voit-il doté d'un
conseil judiciaire en la personne de Me Ancelle,
notaire à Neuilly.
C'est pour lui une « humilia
tion affreuse », qu 'il ressentira toute sa vie.
De plus, les petites mensualités qui lui sont
consenties se révéleront très insuffisantes.
« Mi
sère,
et toujours misère » : mal logé, mal chauffé,
mal nourri, traînant toujours ses créanciers à
ses trousses,
il tente de se suicider en juin 1845,
peut-être pour impressionner par un simulacre
M.
et Mme Aupick.
Ainsi
commence une longue « vie de gargote
et d'hôtel garni », « entre une saisie et une que
relle,
une querelle et une saisie ».
Les mille et
un tracas de la vie quotidienne, la tutelle du
notaire paralysent Baudelaire.
Mais il sait bien
surtout que l'oisiveté fait corps avec lui, même
1.
Petits poèm es en prose (notés ici PP), éd.
1869, 1, « L'étranger ».
2.
Voir FM, 1, « Bénédiction ».
3.
Fusées , 23 janvier 1862.
4.
Tel est le sens du titre de FM, LXXXIII, « L'Héau tontimoroumenos ».
5.
FM , LXXXIV , « L'irrémédiable ».
si elle est compensée par une vie intérieure
i ntense
et par l 'activité perpétuelle de ses idées.
Écrire, tel
est le véritable travail.
Travail
désintéressé?
il le dit parfois.
Mais comment
serait-ce possible? En fait, la création littéraire,
issue
d'une nécessité intérieure, répond aussi à
une nécessité économique.
Aussi les premières
publications importantes seront -elles quelque
peu alimentaires : des articles de critique d'art
(Salon de 1845, Salon de 1846), une nouvelle -
le genre est à
la mode -, La Fanfarlo (1847), des
traductions d'Edgar Poe : une « grosse affaire »,
- où il se fait escroquer par l'éditeur.
Avec un
profond sentiment de dégradation et de dégoût,
il s'incline même devant la nécessité où il se
trouve de prostituer sa Muse « pour faire épa
nouir la rate du vulgaire » (1).
En 1857, la publication en recueil des poésies
qu 'il a égrenées tout au long des années antérieures
va-t-elle enfin lui
permettre de surmonter la
crise financière? Hélas, Les fleurs du mal ne
font qu 'augmenter ses tracas : moins d'un mois
après la mise en vente, le livre est saisi par le
Parquet et, en août , son auteur est condamné à
une amende pour « délit d'outrage à la morale
publique et aux bonnes mœurs ».
Devenir riche,
Baudelaire
n'y songe plus.
Il veut seulement payer
ses dettes .
Et c'est encore sur son travail d'écri
vain
qu'il compte pour cela : il porte dans sa
tête « une vingtaine de romans et deux drames ».
Mais comment les composer quand, par la volonté
des magistrats, il doit remanier le recueil
condamné pour l'édition de 1861, quand il doit
« redevenir poète, artificieJlement, par volonté,
rentrer dans une ornière qu 'on croyait défini
tivement creusée,
traiter de nouveau un sujet
qu'on croyait épuisé » (2)?
Baudelaire se pique pourtant au jeu.
Il remanie
Les fleurs du mal, ajoutant, retranchant, sans
parvenir à réaliser l'édition définitive de ce chef
d'œuvre.
La fièvre créatrice qui s'est emparée de
lui après le procès de 1857 n'aboutit pas à des
œuvres achevées.
Les
« poèmes nocturnes »,
commencés cette année-là, ne seront réunis que
pour une édition posthume (1869) : et encore
n'en a-t-on retrol}vé qu'une cinquantaine, au
lieu des cent promis; le titre choisi, Le spleen
de Paris,
n'est qu'un de ceux qu'avait envisagés
Je poète.
La postérité a d'ailleurs plutôt retenu
celui de Petits poèmes en prose.
Ouvrages pos
thumes aussi que Les paradis artificiels, les Curio-
1.
FM, VIII,~ < La mu se vénale».
2.
Lettre à sa mère du 18 février 1858..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Le poison, Charles Baudelaire
- LL3 Lecture linéaire Allégorie Charles Baudelaire
- Fiche de révision Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire (1857)
- Etude linéaire - Spleen et Idéal, Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire