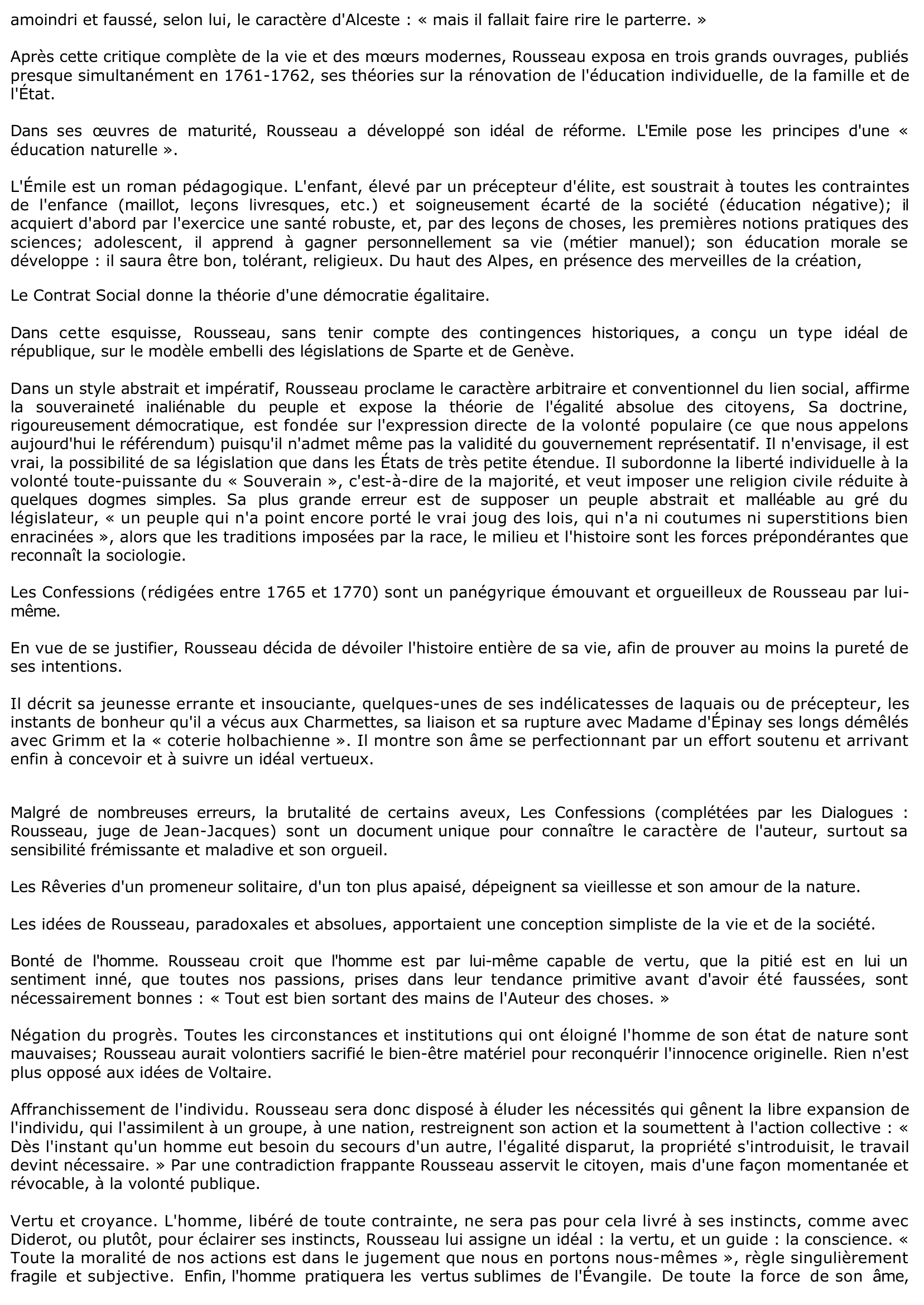Jean-Jacques Rousseau
Publié le 16/02/2011

Extrait du document


«
amoindri et faussé, selon lui, le caractère d'Alceste : « mais il fallait faire rire le parterre.
»
Après cette critique complète de la vie et des mœurs modernes, Rousseau exposa en trois grands ouvrages, publiéspresque simultanément en 1761-1762, ses théories sur la rénovation de l'éducation individuelle, de la famille et del'État.
Dans ses œuvres de maturité, Rousseau a développé son idéal de réforme.
L'Emile pose les principes d'une «éducation naturelle ».
L'Émile est un roman pédagogique.
L'enfant, élevé par un précepteur d'élite, est soustrait à toutes les contraintesde l'enfance (maillot, leçons livresques, etc.) et soigneusement écarté de la société (éducation négative); ilacquiert d'abord par l'exercice une santé robuste, et, par des leçons de choses, les premières notions pratiques dessciences; adolescent, il apprend à gagner personnellement sa vie (métier manuel); son éducation morale sedéveloppe : il saura être bon, tolérant, religieux.
Du haut des Alpes, en présence des merveilles de la création,
Le Contrat Social donne la théorie d'une démocratie égalitaire.
Dans cette esquisse, Rousseau, sans tenir compte des contingences historiques, a conçu un type idéal derépublique, sur le modèle embelli des législations de Sparte et de Genève.
Dans un style abstrait et impératif, Rousseau proclame le caractère arbitraire et conventionnel du lien social, affirmela souveraineté inaliénable du peuple et expose la théorie de l'égalité absolue des citoyens, Sa doctrine,rigoureusement démocratique, est fondée sur l'expression directe de la volonté populaire (ce que nous appelonsaujourd'hui le référendum) puisqu'il n'admet même pas la validité du gouvernement représentatif.
Il n'envisage, il estvrai, la possibilité de sa législation que dans les États de très petite étendue.
Il subordonne la liberté individuelle à lavolonté toute-puissante du « Souverain », c'est-à-dire de la majorité, et veut imposer une religion civile réduite àquelques dogmes simples.
Sa plus grande erreur est de supposer un peuple abstrait et malléable au gré dulégislateur, « un peuple qui n'a point encore porté le vrai joug des lois, qui n'a ni coutumes ni superstitions bienenracinées », alors que les traditions imposées par la race, le milieu et l'histoire sont les forces prépondérantes quereconnaît la sociologie.
Les Confessions (rédigées entre 1765 et 1770) sont un panégyrique émouvant et orgueilleux de Rousseau par lui-même.
En vue de se justifier, Rousseau décida de dévoiler l'histoire entière de sa vie, afin de prouver au moins la pureté deses intentions.
Il décrit sa jeunesse errante et insouciante, quelques-unes de ses indélicatesses de laquais ou de précepteur, lesinstants de bonheur qu'il a vécus aux Charmettes, sa liaison et sa rupture avec Madame d'Épinay ses longs démêlésavec Grimm et la « coterie holbachienne ».
Il montre son âme se perfectionnant par un effort soutenu et arrivantenfin à concevoir et à suivre un idéal vertueux.
Malgré de nombreuses erreurs, la brutalité de certains aveux, Les Confessions (complétées par les Dialogues :Rousseau, juge de Jean-Jacques) sont un document unique pour connaître le caractère de l'auteur, surtout sasensibilité frémissante et maladive et son orgueil.
Les Rêveries d'un promeneur solitaire, d'un ton plus apaisé, dépeignent sa vieillesse et son amour de la nature.
Les idées de Rousseau, paradoxales et absolues, apportaient une conception simpliste de la vie et de la société.
Bonté de l'homme.
Rousseau croit que l'homme est par lui-même capable de vertu, que la pitié est en lui unsentiment inné, que toutes nos passions, prises dans leur tendance primitive avant d'avoir été faussées, sontnécessairement bonnes : « Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses.
»
Négation du progrès.
Toutes les circonstances et institutions qui ont éloigné l'homme de son état de nature sontmauvaises; Rousseau aurait volontiers sacrifié le bien-être matériel pour reconquérir l'innocence originelle.
Rien n'estplus opposé aux idées de Voltaire.
Affranchissement de l'individu.
Rousseau sera donc disposé à éluder les nécessités qui gênent la libre expansion del'individu, qui l'assimilent à un groupe, à une nation, restreignent son action et la soumettent à l'action collective : «Dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travaildevint nécessaire.
» Par une contradiction frappante Rousseau asservit le citoyen, mais d'une façon momentanée etrévocable, à la volonté publique.
Vertu et croyance.
L'homme, libéré de toute contrainte, ne sera pas pour cela livré à ses instincts, comme avecDiderot, ou plutôt, pour éclairer ses instincts, Rousseau lui assigne un idéal : la vertu, et un guide : la conscience.
«Toute la moralité de nos actions est dans le jugement que nous en portons nous-mêmes », règle singulièrementfragile et subjective.
Enfin, l'homme pratiquera les vertus sublimes de l'Évangile.
De toute la force de son âme,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- Le due memorie di Jean-Jacques Rousseau
- Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau
- DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS, 1750. Jean-Jacques Rousseau - résumé de l'œuvre
- Confessions (les) de jean-Jacques Rousseau (résume et analyse complète)