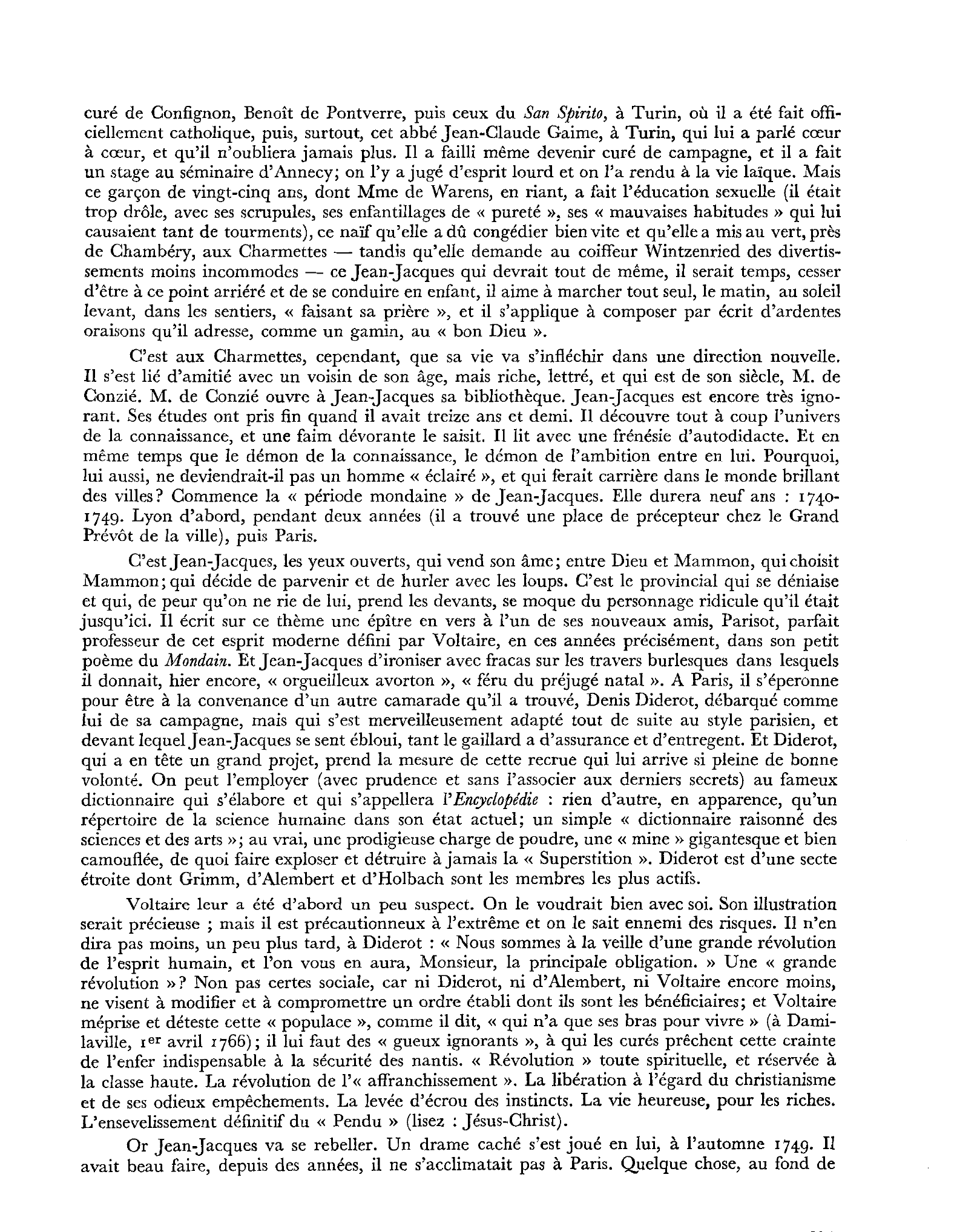JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Publié le 02/09/2013

Extrait du document


«
curé de Confignon, Benoît de Pontverre, puis ceux du San Spirito, à Turin, où il a été fait offi
ciellement catholique, puis, surtout,
cet abbé Jean-Claude Gaime, à Turin, qui lui a parlé cœur
à cœur, et qu'il n'oubliera jamais plus.
Il a failli même devenir curé de campagne, et il a fait
un stage au séminaire d'Annecy; on l'y a jugé d'esprit lourd et on l'a rendu à la vie laïque.
Mais
ce
garçon de vingt-cinq ans, dont Mme de Warens, en riant, a fait l'éducation sexuelle (il était
trop drôle, avec ses scrupules, ses enfantillages de « pureté », ses « mauvaises habitudes » qui lui
causaient
tant de tourments), ce naïf qu'elle a dû congédier bien vite et qu'elle a mis au vert, près
de Chambéry, aux Charmettes -tandis qu'elle demande au coiffeur Wintzenried des divertis
sements moins incommodes -ce
Jean-Jacques qui devrait tout de même, il serait temps, cesser
d'être à ce point arriéré et de se conduire en enfant, il aime à marcher tout seul, le matin, au soleil
levant, dans les sentiers,
« faisant sa prière », et il s'applique à composer par écrit d'ardentes
oraisons qu'il adresse, comme un gamin, au « bon Dieu ».
C'est aux Charmettes, cependant, que sa vie va s'infléchir dans une direction nouvelle.
Il s'est lié d'amitié avec un voisin de son âge, mais riche, lettré, et qui est de son siècle, M.
de
Conzié.
M.
de Conzié ouvre à Jean-Jacques sa bibliothèque.
Jean-Jacques est encore très igno
rant.
Ses études ont pris fin quand il avait treize ans et demi.
Il découvre tout à coup l'univers
de
la connaissance, et une faim dévorante le saisit.
Il lit avec une frénésie d'autodidacte.
Et en
même temps que le démon de la connaissance, le démon de l'ambition entre en lui.
Pourquoi,
lui aussi,
ne deviendrait-il pas un homme « éclairé », et qui ferait carrière dans le monde brillant
des villes? Commence la « période mondaine » de Jean-Jacques.
Elle durera neuf ans : r 740-
1749.
Lyon d'abord, pendant deux années (il a trouvé une place de précepteur chez le Grand
Prévôt de la ville), puis Paris.
C'est Jean-Jacques, les yeux ouverts, qui vend son âme; entre Dieu et Mammon, qui choisit
Mammon; qui décide de parvenir et de hurler avec les loups.
C'est le provincial qui se déniaise
et qui, de peur qu'on ne rie de lui, prend les devants, se moque du personnage ridicule qu'il était
jusqu'ici.
Il écrit sur ce thème une épître en vers à l'un de ses nouveaux amis, Parisot, parfait
professeur de cet esprit moderne défini par Voltaire, en ces années précisément, dans son petit
poème du Mondain.
Et Jean-Jacques d'ironiser avec fracas sur les travers burlesques dans lesquels
il donnait, hier encore, « orgueilleux avorton », « féru du préjugé natal ».
A Paris, il s'éperonne
pour être à la convenance d'un autre camarade qu'il a trouvé, Denis Diderot, débarqué comme
lui
de sa campagne, mais qui s'est merveilleusement adapté tout de suite au style parisien, et
devant lequel Jean-Jacques se sent ébloui, tant le gaillard a d'assurance et d'entregent.
Et Diderot,
qui a en tête un grand projet, prend la mesure de cette recrue qui lui arrive si pleine de bonne
volonté.
On peut l'employer (avec prudence et sans l'associer aux derniers secrets) au fameux
dictionnaire
qui s'élabore et qui s'appellera l' Encyclopédie : rien d'autre, en apparence, qu'un
répertoire de la science humaine dans son état actuel; un simple « dictionnaire raisonné des
sciences
et des arts »; au vrai, une prodigieuse charge de poudre, une « mine » gigantesque et bien
camouflée, de quoi faire exploser et détruire à jamais la « Superstition ».
Diderot est d'une secte
étroite
dont Grimm, d'Alembert et d'Holbach sont les membres les plus actifs.
Voltaire
leur a été d'abord un peu suspect.
On le voudrait bien avec soi.
Son illustration
serait précieuse ; mais il est
précautionneux à l'extrême et on le sait ennemi des risques.
Il n'en
dira pas moins, un peu plus tard, à Diderot : «Nous sommes à la veille d'une grande révolution
de l'esprit humain, et l'on vous en aura, Monsieur, la principale obligation.
» Une « grande
révolution »? Non pas certes sociale, car ni Diderot, ni d'Alembert, ni Voltaire encore moins,
ne visent à modifier et à compromettre un ordre établi dont ils sont les bénéficiaires; et Voltaire
méprise
et déteste cette« populace», comme il dit, «qui n'a que ses bras pour vivre» (à Dami
laville, 1er avril 1766); il lui faut des « gueux ignorants », à qui les curés prêchent cette crainte
de l'enfer indispensable à la sécurité des nantis.
« Révolution » toute spirituelle, et réservée à
la classe haute.
La révolution del'« affranchissement».
La libération à l'égard du christianisme
et de ses odieux empêchements.
La levée d'écrou des instincts.
La vie heureuse, pour les riches.
L'ensevelissement définitif
du « Pendu » (lisez : Jésus-Christ).
Or Jean-Jacques va se rebeller.
Un drame caché s'est joué en lui, à l'automne 1749.
Il
avait beau faire, depuis des années, il ne s'acclimatait pas à Paris.
Quelque chose, au fond de
221.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- Le due memorie di Jean-Jacques Rousseau
- Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau
- DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS, 1750. Jean-Jacques Rousseau - résumé de l'œuvre
- Confessions (les) de jean-Jacques Rousseau (résume et analyse complète)