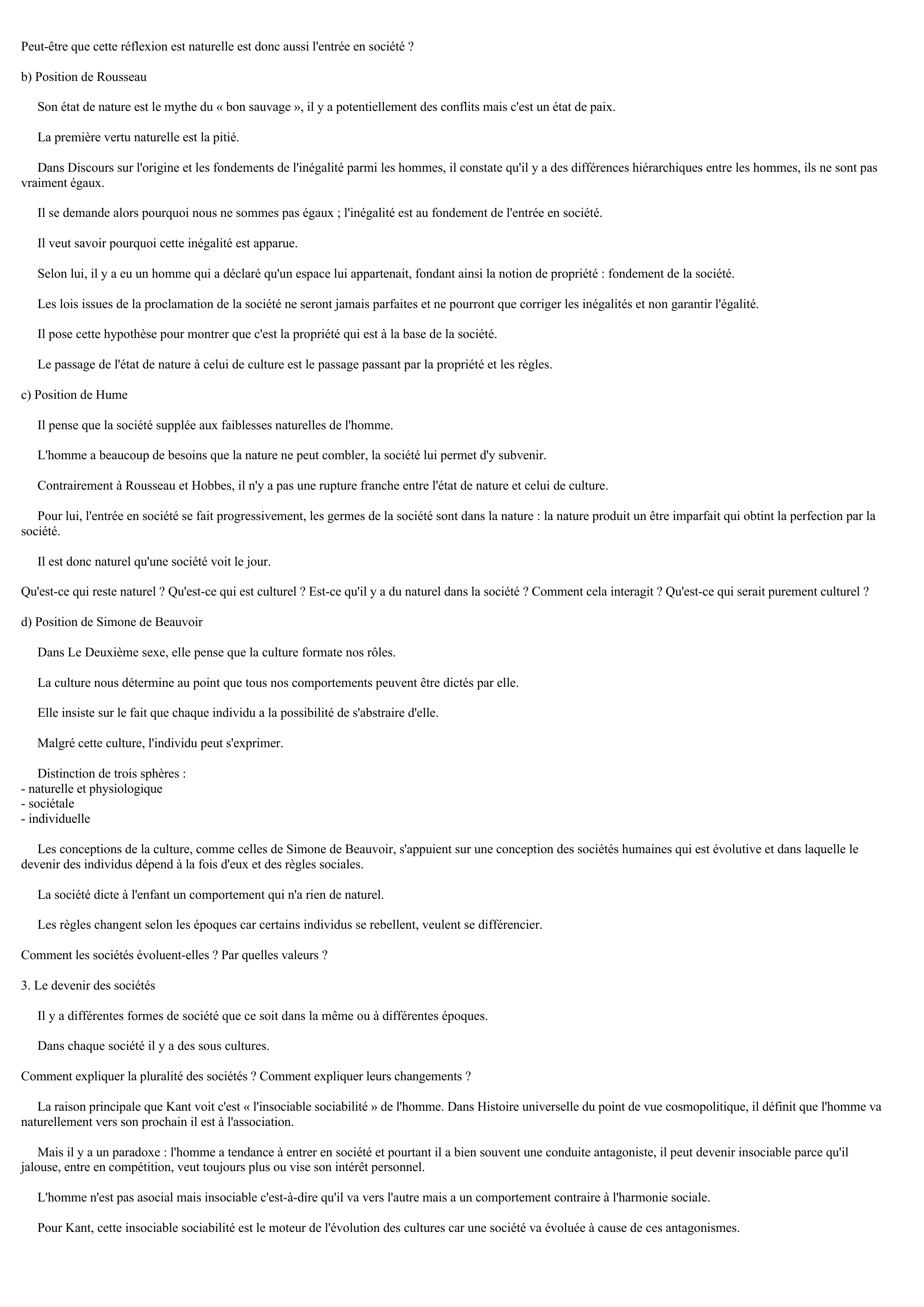Pourquoi des sociétés si complexes ?
Publié le 26/06/2012

Extrait du document
❖ Pour Kant, l'insociable sociabilité fait partie du plan de la nature . Les antagonismes qui en découlent participent au final à une réunion. ❖ On a ainsi deux conceptions de l'histoire: Kant et Hegel. ❖ On reproche à Hegel les systématismes: il serait systématique au point de déposséder les hommes de leurs libertés car si l'histoire évolue d'une manière mécanique avec une même dialectique, l'homme ne peut pas sortir de ce rythme. ❖ Marx pense que le travail donne à l'homme sa liberté et permet de faire l'histoire : l'homme est libre de s'inventer un futur nouveau. L'homme qui travaille produit, transforme le monde, se transforme lui-même. C'est grâce à cette capacité de (se) produire que l'homme obtient des outils pour s'inventer un avenir. ❖ On peut voir des processus logiques dans l'histoire mais il n'y a pas de systématisme car l'homme peut infléchir la courbe de l'histoire comme il le souhaite. ❖ Théorie de Marx dans l'idéologie allemande : « matérialisme historique «. ❖ Au final, pour Marx, l'histoire d'une société, c'est le déploiement du concept d'existence d'un être. ❖ Cela veut dire que le destin d'un peuple n'est pas écrit, mais on le connaîtra à la fin du déploiement de son concept. Il reste un problème dans l'histoire: comment peut-on savoir ce qui est objectif ou subjectif? 2. La connaissance historique ❖ On a l'une des premières tentatives de faire de l'histoire avec Homère dans L'Illiade.
«
Peut-être que cette réflexion est naturelle est donc aussi l'entrée en société ?
b) Position de Rousseau
Son état de nature est le mythe du « bon sauvage », il y a potentiellement des conflits mais c'est un état de paix.
La première vertu naturelle est la pitié.
Dans Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il constate qu'il y a des différences hiérarchiques entre les hommes, ils ne sont pasvraiment égaux.
Il se demande alors pourquoi nous ne sommes pas égaux ; l'inégalité est au fondement de l'entrée en société.
Il veut savoir pourquoi cette inégalité est apparue.
Selon lui, il y a eu un homme qui a déclaré qu'un espace lui appartenait, fondant ainsi la notion de propriété : fondement de la société.
Les lois issues de la proclamation de la société ne seront jamais parfaites et ne pourront que corriger les inégalités et non garantir l'égalité.
Il pose cette hypothèse pour montrer que c'est la propriété qui est à la base de la société.
Le passage de l'état de nature à celui de culture est le passage passant par la propriété et les règles.
c) Position de Hume
Il pense que la société supplée aux faiblesses naturelles de l'homme.
L'homme a beaucoup de besoins que la nature ne peut combler, la société lui permet d'y subvenir.
Contrairement à Rousseau et Hobbes, il n'y a pas une rupture franche entre l'état de nature et celui de culture.
Pour lui, l'entrée en société se fait progressivement, les germes de la société sont dans la nature : la nature produit un être imparfait qui obtint la perfection par lasociété.
Il est donc naturel qu'une société voit le jour.
Qu'est-ce qui reste naturel ? Qu'est-ce qui est culturel ? Est-ce qu'il y a du naturel dans la société ? Comment cela interagit ? Qu'est-ce qui serait purement culturel ?
d) Position de Simone de Beauvoir
Dans Le Deuxième sexe, elle pense que la culture formate nos rôles.
La culture nous détermine au point que tous nos comportements peuvent être dictés par elle.
Elle insiste sur le fait que chaque individu a la possibilité de s'abstraire d'elle.
Malgré cette culture, l'individu peut s'exprimer.
Distinction de trois sphères :- naturelle et physiologique- sociétale- individuelle
Les conceptions de la culture, comme celles de Simone de Beauvoir, s'appuient sur une conception des sociétés humaines qui est évolutive et dans laquelle ledevenir des individus dépend à la fois d'eux et des règles sociales.
La société dicte à l'enfant un comportement qui n'a rien de naturel.
Les règles changent selon les époques car certains individus se rebellent, veulent se différencier.
Comment les sociétés évoluent-elles ? Par quelles valeurs ?
3.
Le devenir des sociétés
Il y a différentes formes de société que ce soit dans la même ou à différentes époques.
Dans chaque société il y a des sous cultures.
Comment expliquer la pluralité des sociétés ? Comment expliquer leurs changements ?
La raison principale que Kant voit c'est « l'insociable sociabilité » de l'homme.
Dans Histoire universelle du point de vue cosmopolitique, il définit que l'homme vanaturellement vers son prochain il est à l'association.
Mais il y a un paradoxe : l'homme a tendance à entrer en société et pourtant il a bien souvent une conduite antagoniste, il peut devenir insociable parce qu'iljalouse, entre en compétition, veut toujours plus ou vise son intérêt personnel.
L'homme n'est pas asocial mais insociable c'est-à-dire qu'il va vers l'autre mais a un comportement contraire à l'harmonie sociale.
Pour Kant, cette insociable sociabilité est le moteur de l'évolution des cultures car une société va évoluée à cause de ces antagonismes..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Différence entre sociétés animales et humaines - DURKHEIM
- Droit des sociétés approfondi - DROIT SPECIAL DES SOCIÉTÉS
- Quels sont les effets des conquêtes européennes sur les sociétés amérindiennes ?
- dans quelles mesures les sociétés du 21 e s peuvent-elles voir se développer en France, des nouvelles formes de mouvements sociaux
- Ville et sociétés en Europe au XIXe siècle