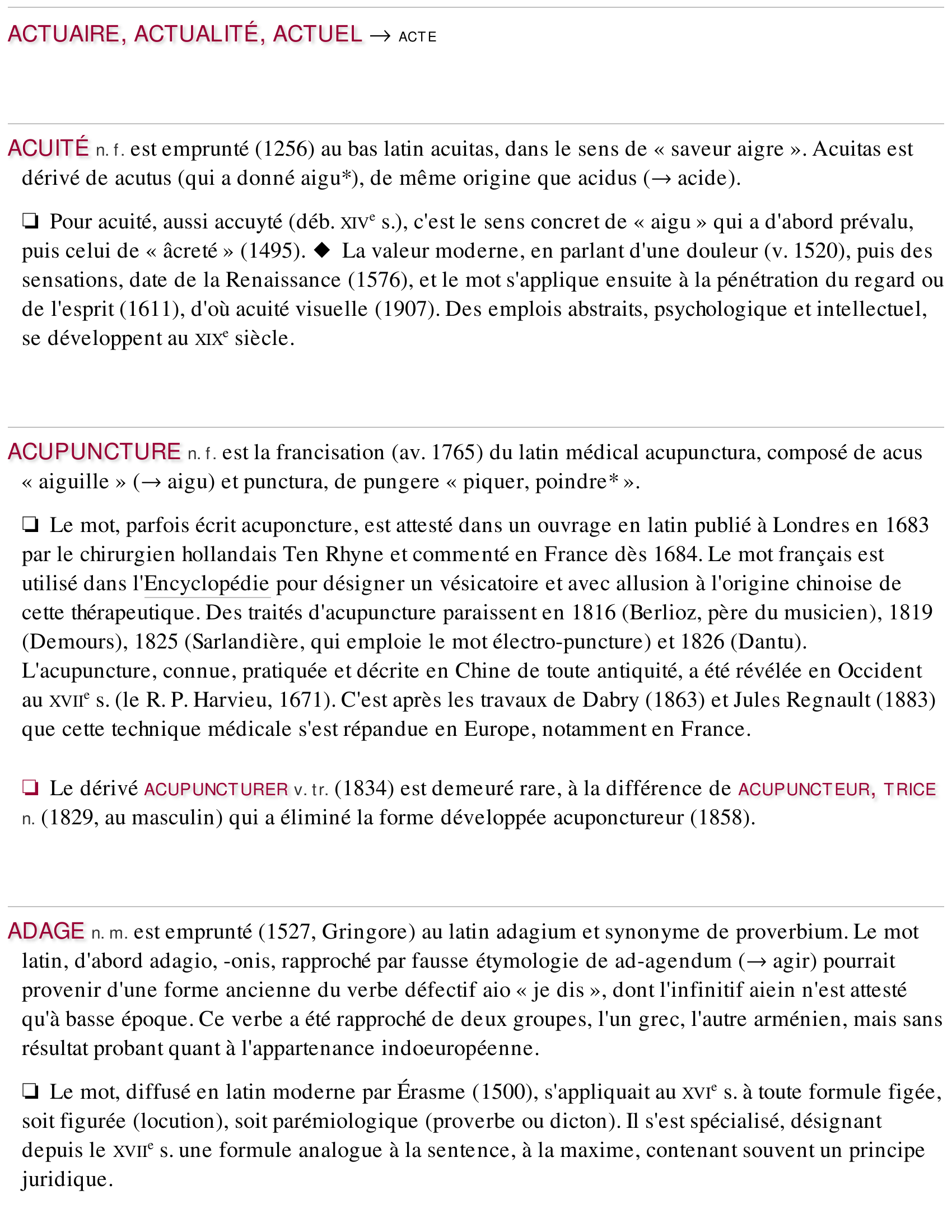? ACT ANT n.
Publié le 29/04/2014

Extrait du document
«
AC TU AIR E
,
AC TU ALIT É
,
AC TU EL
→
AC TE
AC U IT É
n.
f .
e st e m pru n té ( 1 256) a u b as l a ti n
acu ita s,
d an s l e s e n s d e « s a v eur a ig re » .
Acu ita s
e st
dériv é d e
acu tu s
( q ui a d on né
aig u*
), d e m êm e o rig in e q ue
acid us
(→ a cid e).
❏
P our
acu ité ,
a u ssi
accu yté
( d éb .
XIV
e
s .) , c 'e st l e s e n s c o n cre t d e « a ig u » q ui a d 'a b ord p ré v alu ,
puis c e lu i d e « â cre té » ( 1 495).
◆
L a v ale ur m od ern e, e n p arla n t d 'u n e d oule ur ( v .
1 520), p uis d es
se n sa ti o n s, d ate d e l a R en ais sa n ce ( 1 576), e t l e m ot s 'a p pliq ue e n su ite à l a p én étr a ti o n d u r e g ard o u
de l 'e sp rit ( 1 611), d 'o ù
acu ité v is u elle
( 1 907).
D es e m plo is a b str a its , p sy cho lo g iq ue e t i n te lle ctu el,
se d év elo ppen t a u
XIX
e
s iè cle .
AC U PU NCTU RE
n.
f .
e st l a f ra n cis a ti o n ( a v .
1 765) d u l a ti n m éd ic al
acu pun ctu ra ,
c o m posé d e
acu s
« a ig uille »
(→ a ig u)
e t
pun ctu ra ,
d e
pun gere
« p iq uer, p oin dre * » .
❏
L e m ot, p arfo is é crit
acu pon ctu re ,
e st a tte sté d an s u n o uvra g e e n l a ti n p ublié à L on dre s e n 1 683
par l e c hir u rg ie n h o lla n dais T en R hy n e e t c o m men té e n F ra n ce d ès 1 684.
L e m ot f ra n çais e st
uti lis é d an s l '
Ency clo péd ie
p our d ésig ner u n v ésic ato ir e e t a v ec a llu sio n à l 'o rig in e c hin ois e d e
ce tte th éra p euti q ue.
D es tr a ité s d 'a cu pun ctu re p ara is se n t e n 1 816 ( B erlio z, p ère d u m usic ie n ), 1 819
(D em ours ), 1 825 ( S arla n diè re , q ui e m plo ie l e m ot
éle ctr o -p un ctu re
) e t 1 826 ( D an tu ).
L'a cu pun ctu re , c o n nue, p ra ti q uée e t d écrite e n C hin e d e to ute a n ti q uité , a é té r é v élé e e n O ccid en t
au
XV II
e
s .
( le R .
P .
H arv ie u, 1 671).
C 'e st a p rè s l e s tr a v au x d e D ab ry ( 1 863) e t J u le s R eg nau lt ( 1 883)
que c e tte te chn iq ue m éd ic ale s 'e st r é p an due e n E uro pe, n ota m men t e n F ra n ce .
❏
L e d ériv é
AC UPUNC TURER
v.
t r.
( 1 834) e st d em euré r a re , à l a d if fé re n ce d e
AC UPUNC TEU R
,
TRIC E
n.
( 1 829, a u m asc u lin ) q ui a é lim in é l a f o rm e d év elo ppée
acu pon ctu re ur
( 1 858).
AD AG E
n.
m .
e st e m pru n té ( 1 527, G rin gore ) a u l a ti n
ad ag iu m
e t s y n on ym e d e
pro verb iu m .
L e m ot
la ti n , d 'a b ord
ad ag io , - o n is ,
r a p pro ché p ar f a u sse é ty m olo g ie d e
ad -a g en dum
(→ a g ir )
p ourra it
pro ven ir d 'u n e f o rm e a n cie n ne d u v erb e d éfe cti f
aio
« j e d is » , d on t l 'i n fin iti f
aie in
n 'e st a tte sté
qu'à b asse é p oq ue.
C e v erb e a é té r a p pro ché d e d eux g ro upes, l 'u n g re c, l 'a u tr e a rm én ie n , m ais s a n s
ré su lta t p ro ban t q uan t à l 'a p parte n an ce i n doeuro pée n ne.
❏
L e m ot, d if fu sé e n l a ti n m od ern e p ar É ra sm e ( 1 500), s 'a p pliq uait a u
XV I
e
s .
à to ute f o rm ule f ig ée ,
so it f ig uré e ( lo cu ti o n ), s o it p aré m io lo g iq ue ( p ro verb e o u d ic to n ).
I l s 'e st s p écia lis é , d ésig nan t
depuis l e
XV II
e
s .
u n e f o rm ule a n alo g ue à l a s e n te n ce , à l a m ax im e, c o n te n an t s o uven t u n p rin cip e
ju rid iq ue..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ACT 1 SCENE 1 TIRADE DE SABINE
- lecture analytque le mariage de figaro, scene 5, act III
- Commentaire ubu roi act 2 sc 3
- Commentaire linéaire de Phédre Act I scéne 1
- Civil Riight Act of 1957