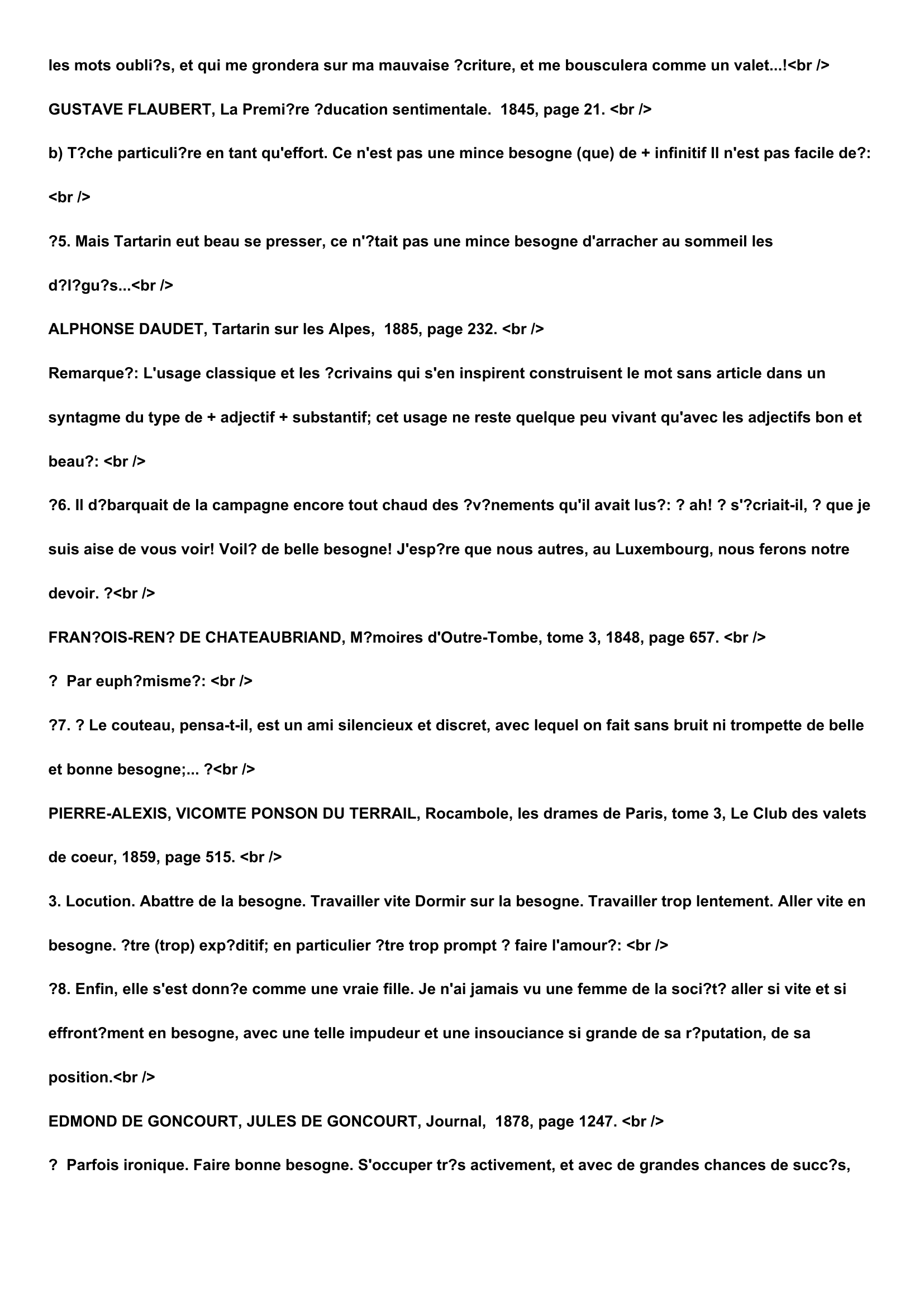Définition et usage du mot: BESOGNE, substantif féminin.
Publié le 03/11/2015

Extrait du document
«
les mots oubli?s, et qui me grondera sur ma mauvaise ?criture, et me bousculera comme un valet...!
GUSTAVE FLAUBERT, La Premi?re ?ducation sentimentale.
1845, page 21.
b) T?che particuli?re en tant qu'effort.
Ce n'est pas une mince besogne (que) de + infinitif Il n'est pas facile de?:
? 5.
Mais Tartarin eut beau se presser, ce n'?tait pas une mince besogne d'arracher au sommeil les
d?l?gu?s...
ALPHONSE DAUDET, Tartarin sur les Alpes, 1885, page 232.
Remarque?: L'usage classique et les ?crivains qui s'en inspirent construisent le mot sans article dans un
syntagme du type de + adjectif + substantif; cet usage ne reste quelque peu vivant qu'avec les adjectifs bon et
beau?:
? 6.
Il d?barquait de la campagne encore tout chaud des ?v?nements qu'il avait lus?: ? ah! ? s'?criait-il, ? que je
suis aise de vous voir! Voil? de belle besogne! J'esp?re que nous autres, au Luxembourg, nous ferons notre
devoir.
?
FRAN?OIS-REN? DE CHATEAUBRIAND, M?moires d'Outre-Tombe, tome 3, 1848, page 657.
? Par euph?misme?:
? 7.
? Le couteau, pensa-t-il, est un ami silencieux et discret, avec lequel on fait sans bruit ni trompette de belle
et bonne besogne;...
?
PIERRE-ALEXIS, VICOMTE PONSON DU TERRAIL, Rocambole, les drames de Paris, tome 3, Le Club des valets
de coeur, 1859, page 515.
3.
Locution.
Abattre de la besogne.
Travailler vite Dormir sur la besogne.
Travailler trop lentement.
Aller vite en
besogne.
?tre (trop) exp?ditif; en particulier ?tre trop prompt ? faire l'amour?:
? 8.
Enfin, elle s'est donn?e comme une vraie fille.
Je n'ai jamais vu une femme de la soci?t? aller si vite et si
effront?ment en besogne, avec une telle impudeur et une insouciance si grande de sa r?putation, de sa
position.
EDMOND DE GONCOURT, JULES DE GONCOURT, Journal, 1878, page 1247.
? Parfois ironique.
Faire bonne besogne.
S'occuper tr?s activement, et avec de grandes chances de succ?s,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Définition & usage: ARQUEBUSERIE, substantif féminin.
- Définition & usage: ARQUEBUSE, substantif féminin.
- Définition & usage: ARQUEBUSADE, substantif féminin.
- Définition & usage: ARPÈTE, ARPETTE, substantif féminin.
- Définition & usage: ARMADA, substantif féminin.