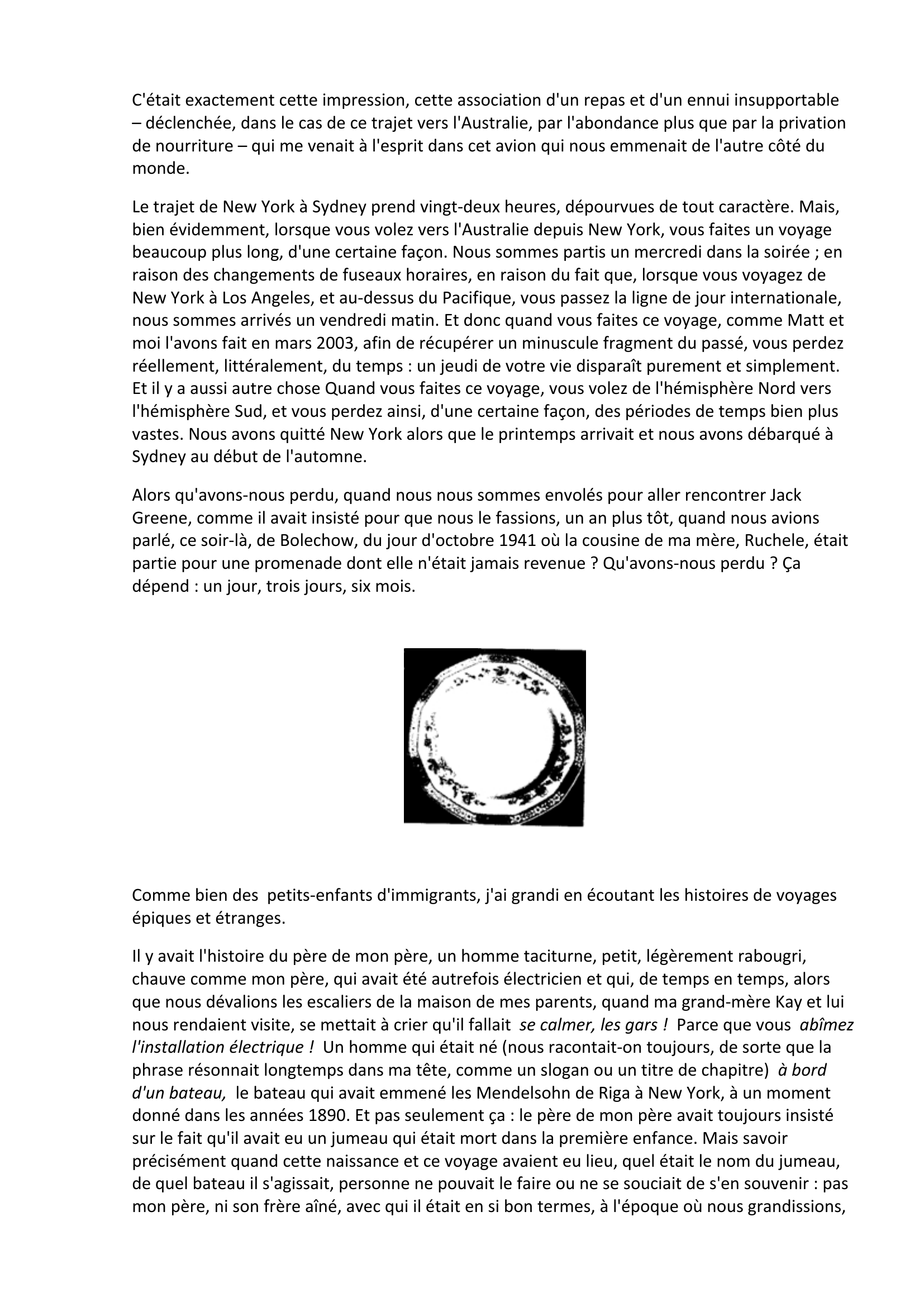mémoire une époque entièrement révolue. Car qui, aujourd'hui, se soucie vraiment de ces lavandes, de ces citrines, de ces turquoises, de ces ivoires, de ces sarcelles, de ces oranges ? Par conséquent, la famille de ma mère était, comme ils l'auraient dit eux-mêmes, frum, profondément religieuse. Mais la famille de mon père, comme je l'ai déjà mentionné, était tout aussi profondément irréligieuse. C'est parce que mon père avait grandi dans une maison qui était, par bien des aspects, diamétralement opposée à celle dans laquelle avait été élevée ma mère, une maison dépourvue des contraintes de la tradition, du judaïsme, de l'Europe, que nous n'observions pas les fêtes juives pendant mon enfance, dans les années 1960 et 1970, comme avait pu le faire ma mère pendant son enfance dans les années 1930 et 1940. Toutefois, Yom Kippour constituait une exception. Cela avait moins à voir avec le statut auguste de cette fête parmi les fêtes du calendrier juif qu'avec le fait que c'était la seule qui présentait un attrait intellectuel ou (comme je le soupçonne encore) esthétique pour mon père - un scientifique, après tout, un homme qui aime l'idée de la rigueur, de l'absolu, de la dureté même. L'autodénigrement, l'abnégation de Yom Kippour le réjouissait. Et il se trouvait donc que, tous les ans, alors qu'il ne mettait jamais les pieds dans l'étrange et minuscule synagogue où, pendant des années, ma mère nous avait emmenés mes frères, ma soeur et moi, la synagogue où, un jour, alors que nous nous rendions, elle et moi, au Yizkor, le service commémoratif qui a lieu vers la fin des cérémonies de Yom Kippour, elle m'avait dit que Oncle Shmiel avait quatre filles magnifiques qui avaient été violées avant d'être tuées par les nazis -- même si mon père ne mettait jamais les pieds dans cet endroit pour les services de Yom Kippour, il observait strictement le jeûne. En fait, il regardait attentivement la pendule pour s'assurer que personne ne rompît le jeûne avant que ne se fussent écoulées les vingt-quatre heures. La plupart de ces vingt-quatre heures à écoulement effroyablement long, je dois l'admettre, n'étaient pas habituellement passées par aucun de nous, y compris ma mère, dans la petite synagogue où nous allions. Et pourtant, en raison d'une obscure saveur d'étrangeté et d'angoisse légère qui s'attachait à ce jour de l'année dans notre famille (très probablement à cause des histoires sur cette journée que mon grand-père aimait raconter, celle du bûcheron, par exemple), les vingt-quatre heures de jeûne ne pouvaient être passées, c'était parfaitement clair, à faire quelque chose de « frivole ». S'amuser avec des jouets était considéré comme frivole. Regarder la télévision aussi. Allez lire, faites quelque chose de sérieux, nous disait ma mère, l'air un peu absente, alors qu'elle contrôlait, avec une parfaite maîtrise de soi (me semblait-il alors), les plats d'agneau et de poulet en train de cuire, les pommes de terre, l'énorme cafetière électrique, digne d'un hôtel, que tout le monde trouvait choquante, mais aimait secrètement quand on la voyait fonctionner (« tous ces gens, cette année ! »), les casseroles de nouilles un peu sucrées ou kugels si savoureuses, les plats de saumon fumé, de maquereau et de poisson blanc attendant l'assaut d'une trentaine ou d'une quarantaine d'invités qui, chaque année, se ruaient dans la maison sur deux niveaux de mes parents pour rompre le jeûne que la plupart d'entre eux, mais pas tous, avaient observé (une tante que j'adorais, petite, rousse, à la bouche pulpeuse, jolie comme une goy, disait tout le monde, s'asseyait sur le sofa de la salle de séjour et disait, Je bois juste un peu de café, parce que le café, ça ne compte pas !). Donc, nous, les enfants, nous allions faire quelque chose de sérieux. Mais entre le fait de ne pas pouvoir manger et le fait de ne pas pouvoir regarder nos programmes préférés de télévision après l'école, qui étaient les indications de temps les plus fiables de mon enfance, le jour de jeûne, cet unique jour de l'année, paraissait incroyablement long, sans le moindre caractère en dehors d'une sensation d'attente, un jour dépourvu de toutes les qualités reconnaissables qui, tous les autres jours, rendaient et rendent le passage du temps supportable. C'était exactement cette impression, cette association d'un repas et d'un ennui insupportable - déclenchée, dans le cas de ce trajet vers l'Australie, par l'abondance plus que par la privation de nourriture - qui me venait à l'esprit dans cet avion qui nous emmenait de l'autre côté du monde. Le trajet de New York à Sydney prend vingt-deux heures, dépourvues de tout caractère. Mais, bien évidemment, lorsque vous volez vers l'Australie depuis New York, vous faites un voyage beaucoup plus long, d'une certaine façon. Nous sommes partis un mercredi dans la soirée ; en raison des changements de fuseaux horaires, en raison du fait que, lorsque vous voyagez de New York à Los Angeles, et au-dessus du Pacifique, vous passez la ligne de jour internationale, nous sommes arrivés un vendredi matin. Et donc quand vous faites ce voyage, comme Matt et moi l'avons fait en mars 2003, afin de récupérer un minuscule fragment du passé, vous perdez réellement, littéralement, du temps : un jeudi de votre vie disparaît purement et simplement. Et il y a aussi autre chose Quand vous faites ce voyage, vous volez de l'hémisphère Nord vers l'hémisphère Sud, et vous perdez ainsi, d'une certaine façon, des périodes de temps bien plus vastes. Nous avons quitté New York alors que le printemps arrivait et nous avons débarqué à Sydney au début de l'automne. Alors qu'avons-nous perdu, quand nous nous sommes envolés pour aller rencontrer Jack Greene, comme il avait insisté pour que nous le fassions, un an plus tôt, quand nous avions parlé, ce soir-là, de Bolechow, du jour d'octobre 1941 où la cousine de ma mère, Ruchele, était partie pour une promenade dont elle n'était jamais revenue ? Qu'avons-nous perdu ? Ça dépend : un jour, trois jours, six mois. Comme bien des petits-enfants d'immigrants, j'ai grandi en écoutant les histoires de voyages épiques et étranges. Il y avait l'histoire du père de mon père, un homme taciturne, petit, légèrement rabougri, chauve comme mon père, qui avait été autrefois électricien et qui, de temps en temps, alors que nous dévalions les escaliers de la maison de mes parents, quand ma grand-mère Kay et lui nous rendaient visite, se mettait à crier qu'il fallait se calmer, les gars ! Parce que vous abîmez l'installation électrique ! Un homme qui était né (nous racontait-on toujours, de sorte que la phrase résonnait longtemps dans ma tête, comme un slogan ou un titre de chapitre) à bord d'un bateau, le bateau qui avait emmené les Mendelsohn de Riga à New York, à un moment donné dans les années 1890. Et pas seulement ça : le père de mon père avait toujours insisté sur le fait qu'il avait eu un jumeau qui était mort dans la première enfance. Mais savoir précisément quand cette naissance et ce voyage avaient eu lieu, quel était le nom du jumeau, de quel bateau il s'agissait, personne ne pouvait le faire ou ne se souciait de s'en souvenir : pas mon père, ni son frère aîné, avec qui il était en si bon termes, à l'époque où nous grandissions, ni l'autre frère auquel, pendant si longtemps, il ne voulait rien avoir affaire, mais dont il s'était par la suite rapproché, quand la polio était revenue, une dernière fois, pour mettre fin à cette conversation torturée de façon permanente. La famille de mon père m'avait toujours paru être une famille de silences, et le peu que j'avais réussi à apprendre d'eux, au cours du temps, m'avait aidé à expliquer pourquoi : le père de mon grand-père, le fabricant de violons qui, parce qu'il ne vendait pas assez de violons, fabriquait aussi des chaussures et ne gagnait pas assez non plus avec ça ; la mère qui allait mourir à trente-quatre ans, épuisée par ses dix grossesses, dont trois avaient donné naissance à des jumeaux ; les nombreux frères et soeurs qui n'avaient jamais grandi, tués dans la petite enfance, l'enfance ou l'adolescence par telle ou telle maladie, par la tuberculose, par la grande épidémie de grippe espagnole de 1918, laissant mon grandpère seul parvenir à l'âge adulte, un âge adulte au cours duquel il avait préféré ne jamais parler de ce passé appauvri. Une famille, par conséquent, élevée dans les silences, dont ces longues périodes vides et sinistres entre les frères, dont ces silences qui duraient des décennies n'étaient que les exemples les plus extrêmes. Parce qu'ils restaient silencieux pendant si longtemps - ils vivaient dans leur présent américain plutôt que dans leur passé européen -, il y a désormais moins d'histoires à raconter à leur sujet. C'est seulement par accident que j'ai appris, du fait que j'étais sur le saule pleureur du jardin de mes parents, un jour de 1972 quand les parents de mon père étaient venus de Miami pour une visite, et qu'on n'avait pas remarqué ma présence, que mon grand-père avait eu une femme avant d'épouser ma grand-mère Kay, et que notre famille existait uniquement parce que cette première épouse était morte dans l'épidémie de grippe espagnole ; et ou en effet mon père avait un frère beaucoup plus âgé à qui (pour des raisons que je n'ai pu découvrir que des années plus tard, au moment où mon grand-père Al agonisait) mon père n'avait plus parlé, depuis que ce demi-oncle égaré avait quitté la maison, des décennies plus tôt. Une fois de plus, il me revenait à l'esprit que notre lignage n'était que le résultat d'un accident, d'une mort prématurée ; une fois de plus me revenait à l'esprit la préférence de la Bible hébraïque pour les secondes épouses, pour les plus jeunes fils. Pourquoi, avais-je pensé à l'époque, n'avions-nous jamais entendu ce récit dramatique auparavant ? Mais ce même grand-père n'avait jamais songé à signaler à qui que ce fût, même après la naissance de ma soeur Jen en 1968, qu'il y avait eu une fille nommée Jenny parmi ses nombreux frères et soeurs morts. Quand j'étais petit, je regardais le père de mon père et puis je regardais le père de ma mère, et le contraste entre les deux est à l'origine de la formation, dans mon esprit d'enfant, d'une sortie de liste. Dans une colonne, il y avait ceci : Jaeger, judaïté, Europe, langues, histoires. Dans l'autre, il y avait ceci : Mendelsohn, athées, Amérique, anglais, silence. Je comparais et j'opposais ces colonnes, lorsque j'étais bien plus jeune et, même alors, je me demandais quel genre de présent on pouvait avoir sans connaître les histoires de son passé. Il y avait d'autres histoires de voyages difficiles dans ma famille. La mère de ma mère était la seule de mes grands-parents à être née aux Etats-Unis, mais sa propre mère, mon arrièregrand-mère Yetta, n'y était pas née. Yetta Cushman (ou Kutschmann ou encore Kuschman), qui sur la seule photo d'elle existante, prise peu de temps avant sa mort prématurée pendant l'été 1936 - pendant qu'elle cousait le cou d'un poulet, elle s'était piqué le doigt et elle était morte, quelques jours plus tard, d'un empoissonnement du sang, ce qui avait été la cause d'un choc émotionnel terrible qui, selon le père de ma mère, avait été à l'origine du diabète de sa jeune épouse - vous dévisage avec l'air triste d'une femme extrêmement simple, qui louche