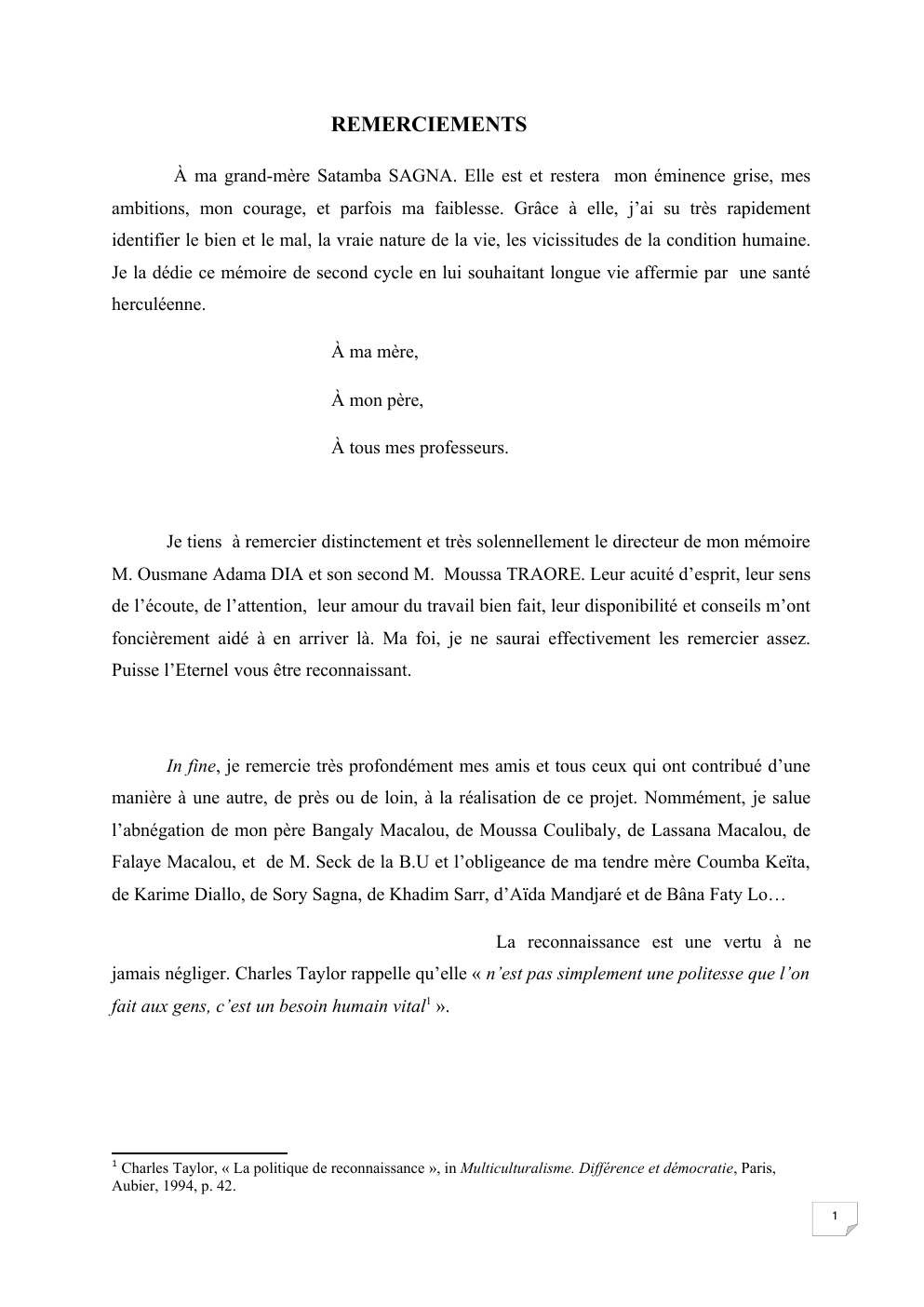SOMMAIRE : Remerciements………………………………………………………………………………...1 Introduction……………………………………………………………………………………5 PREMIERE PARTIE : DE LA VERTU MORALE A LA VERTU POLITIQUE………………………………………………..............................13 Chapitre I. La vertu morale………………………………………………………………..14 I.1. Le siège de la vertu : le cœur ou la raison……………………………………………….17 1. 1. La vertu de chasteté…………………………………………………………….20 1. 2. La vertu d’honneur……………………………………………………………..27 1. 3. La vertu et la religion…………………………………………………………..36 Chapitre II. La vertu politique……………………………………………………………46 II. 1. L’apologie de la vertu originelle………………………………………………………52 1. 1. L’état de nature contre l’état social…………………………………………..54 1. 2. L’utopie de la communauté vertueuse……………………………………….64 1. 3. Le mal dans la société non vertueuse………………………………………..74 DEUXIEME PARTIE : LES EPREUVES ET LE LANGAGE DE LA VERTU………………………………………………………………83 Chapitre III. Les épreuves de la vertu……………………………………………………83 1. La vertu de la résignation……………………………………………………….84 2. La sincérité à toute épreuve……………………………………………………..92 Chapitre IV. Le langage de la vertu……………………………………………………...99 1. L’élégie de la souffrance………………………………………………………..99 2. La communication transparente des cœurs sincères…………………………..107 CONCLUSION…………………………………………………………………………...114 3 BIBLIOGRAPHIE………………………………………………………………………117 4 INTRODUCTION 5 Doit-on s’aimer par-dessus tout ? Autre question : faut-il se préférer à tout, ou aimer par priorité quelque autre ? Ceux qui se préfèrent sont souvent blâmés et traités d’égoïstes. Et, c’est vrai, le méchant semble ne voir pour ainsi dire, que lui-même dans ce qu’il fait et se considère de façon d’autant plus égoïste qu’il est plus vicieux. Au contraire, l’homme de bien n’agit qu’en pensant à son ami. Plus il est vertueux, plus il a tendance à négliger son propre intérêt au profit de celui d’autrui2 . Au cours du 18ème siècle, des pratiques telles que l’abus du pouvoir, l’autoritarisme, la monarchie, le remous des inégalités sociales et bien d’autres dérives morales ont eu cours en Europe, notamment en France. À cet effet, des intellectuels, particulièrement des philosophes3 , ont, par leur plume, dénoncé avec vigueur ces faits. Par ailleurs, il est important de préciser que les procédés auxquels ces écrivains faisaient usage restent subtils et différents. D’aucuns écrivaient des essais politiques en l’occurrence « Montesquieu avec L’Esprit des lois (1748), Diderot et D’Alembert avec L’Encyclopédie4 (1751-1772) et Jean�Jacques Rousseau avec son Du Contrat social (1762) etc. Par contre Voltaire a écrit des contes philosophiques : Candide, (1759) » 5 et le même Rousseau ci-dessus a dressé un roman épistolaire qu’on pourrait appeler sans complaisance des « lettres philosophiques » : Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761). Dans cet ouvrage remarquablement étoffé d’idées philosophiques sur l’ « homme », le thème de la vertu revêt d’une importance incommensurable et d’une omniprésence irrécusable. Du reste, c’est pourquoi Eléonore Zimmermann souligne nettement, en parlant de Rousseau, que : « dans sa préface déjà, l’auteur nous avertit que le roman doit déplaire à : ceux qui ne croit pas à la vertu6 ». D’où 2 Aristote, traduit par François Stirn, Ethique à Nicomaque, livre VIII et IX, Paris, Hatier, 2001, p. 57. 3 D’une manière générale, on désigne sous le nom de philosophe tout homme qui réfléchit sur les grands problèmes métaphysiques (origine, nature, destinée du monde ou des êtres vivants) et qui cherche à les résoudre en un système universel. Cependant, au temps de Montesquieu, de Diderot, de Rousseau et de Voltaire, le terme a pris une valeur particulière. Beaucoup de ceux qu’on appelle philosophe condamnent la métaphysique et pense qu’il est vain de méditer sur l’inconnaissable ; tous, en revanche, s’intéressent aux questions d’ordre politique, social, moral ou religieux dont dépend le bonheur de l’homme sur terre. 4 L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est une encyclopédie française, éditée de 1751 à 1772 sous la direction de Diderot et d’Alembert. C’est un ouvrage majeur du 18ème siècle et la première encyclopédie française. Par la synthèse des connaissances du temps qu’elle contient, elle représente un travail rédactionnel et éditorial considérable pour cette époque et fut menée par des encyclopédistes constitués en « société de gens de lettres ». 5 Denis Labourait, André Meunier, Les Méthodes du français au lycée 2nde, 1ère, Paris, Bordas, 1995, p. 122. 6 Eléonore Zimmermann, « Vertu » dans La Nouvelle Héloïse, Paris, PUF, 1961, p. 3. 6 la nécessite de son étude puisque ces dires tentants et prometteurs convoquent la curiosité de ceux qui veulent la connaître et la cultiver. Au regard des travaux qui ont été menés sur elle dans l’œuvre qui nous concerne, nous constatons qu’elle a fait couler beaucoup d’encre. Plusieurs critiques se sont acharnés à son étude, et ce, par diverses analyses qui, nous semble-t-il, laissent des pistes de réflexions aussi importantes que variées. Parmi eux, Eléonore Zimmermann l’examine à travers une étude basée sur les différentes acceptions qu’elle peut avoir dans l’œuvre et dans l’ère des Lumières afin d’en déduire les différents sens que le Genevois lui donne. En ces termes, il précise qu’ : En examinant de près le roman de Rousseau, on peut tout d’abord constater que l’auteur s’est, à cet égard, conformé à l’usage de son temps : vertu, dans La Nouvelle Héloïse, c’est, les trois quarts du temps, chasteté. Dans ce sens il l’emploie parallèlement à innocence, pureté, honnêteté7 . Puis, Daniel Mornet, en se consacrant à son étude, trouve qu’elle n’est que partiellement présente dans l’œuvre, qu’elle est prisée et recherchée mais pas autant qu’on en vit avec. Il dit assez clairement que : « Les vertus, c’était l’amour de la vertu ou, du moins, d’une certaine vertu, le désintéressement, le mépris de l’argent, l’élan du cœur ; les défauts, la timidité, la paresse, ou plutôt la crainte des réalités, la lassitude des soins trop assidu8 ». Manifestement, nous voyons que l’analyse de Mornet met l’accent sur les différentes sortes de qualités que Rousseau exhorte aux hommes et quelques défauts à mépriser. Ensuite, Artur Chuquet confesse, quant à lui, que la vertu dans La Nouvelle Héloïse n’est qu’une fausse sensibilité outrée, c’est-à-dire qu’elle est mue par un avilissement de mœurs. Du coup, il stipule avec fermeté que : «Rousseau y a remplacé raison et vertu par le culte de la sensiblerie, y libère « ses ardeurs et ses ravissements érotiques » s’y complait à de lascifs tableaux qui ne cède en rien à ceux de l’Arétin9 ». Au demeurant, la peinture amoureuse ou sentimentale n’est-elle pas un tremplin que Rousseau a mis en place pour mieux subjuguer ceux à qui il s’adresse ? Si il y figure de délicats, les péchés n’en sont point à plaindre ; ces fautes sont inhérentes chez l’homme en tant qu’être humain. Du reste, ce réalisme a aussi sa justification. L’imperfection est dans la nature de l’homme, et n’était-ce pas dans le mal comme le dit Rousseau lui-même que l’on répare le « mal ». Force est de reconnaître que 7 Eléonore Zimmermann, « Vertu » dans La Nouvelle Héloïse, op. cit. p. 3. 8 Daniel Mornet, Professeur à la Sorbonne, La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, Etudes et Analyses, Paris, Mellotée, 1950, p. 32. 9 Henri Beaudouin, La Vie et les œuvres de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Lamulle & Poisson, 1891, p. 188. 7 Jean Starobinski a parfaitement éclairer cette vision rousseauiste. Ainsi, il cite : « Selon Rousseau le mal offre lui-même le remède au dommage qu’il cause, en matière de corruption notamment10 ». Enfin, Anne Tilleul a analysé, dans son essai11 sur « La Nouvelle Héloïse », la mise en relation de la vertu avec le beau, mais surtout avec la raison et la sensibilité12. Cela étant dit, nous nous proposons d’étudier, à l’instar de ces critiques ci-dessus, l’entreprise morale et politique de la vertu, qui plus est, inéluctablement rattaché à un certain code de l’expression du dire et du faire des enjeux de l’amour: le langage de la vertu. Cependant, cette représentation de la vertu politico-morale n’est-elle pas un projet de régénération de l’espèce humaine qui aspire à une réconciliation du plaisir et de la vertu, ou du moins n’est-elle pas l’illumination des esprits exempts de tout jugement conforme à la loi de la nature, donc de la transparence des cœurs et de l’esprit ? Voilà véritablement la problématique qui est au cœur de notre projet de recherche. Par conséquent, il est judicieux de passer au crible cette vertu à travers laquelle l’homme serait en mesure de faire coexister passion et devoir. Et outre cette perspective, nous verrons également que la sève nourricière de la vertu dans la conduite morale de l’individu passe irréversiblement par un élan du cœur et une inclination spirituelle. En d’autres termes, la « raison13 » (cartésienne) qui, jusque-là a été le blason des écrivains de cette époque, surtout dans la première moitié du siècle, se sent menacée dans la seconde moitié dudit siècle par le gout sentimental, un penchant naturel du cœur. Cette doctrine rousseauiste est aussi incarnée par d’autres figures emblématiques telles que Sade, Laclos et Condillac14 qui n’ont point perdu de vue à mettre en avant-garde, dans leurs textes, le culte de la sensibilité. De surcroît, le Genevois presque toujours en contradiction avec les encyclopédistes (les rationalistes et les progressistes)15, démontre avec une subtilité d’esprit et une virtuosité artistique encore enviable que, l’idée selon laquelle la raison seule peut illuminer l’homme 10 Jean Starobinski, Le Remède dans le Mal, Critique et légitimation de l’artifice à l’âge des Lumières, Paris, Gallimard, 1989, pp.165-206. 11 Anne Tilleul, La vertu du beau. Essai sur « La Nouvelle Héloïse », Montréal, Humanitas Nouvelle optique, 1989, 161 p. 12 Ibid. 13 Certains écrivains du 18ème siècle, pour ne pas dire la plupart, et surtout dans la première partie dudit siècle, estiment non sans fermeté, que la raison est le seul moyen de faire sortir l’homme de l’obscurantisme dans tous ses états. Et cette doctrine a pour fondateur : René Descartes. 14 La doctrine sensualiste se base sur l’idée que toutes nos connaissances sont dérivées des sensations. Condillac précise la psychologie de John Locke et cherche à démontrer que nos facultés se forment sous l’effet des sensations et de l’expérience. Le Littré de 1812-1877 est le premier dictionnaire qui fait mention du terme en le définissant comme : « Terme de philosophie. Doctrine dans laquelle on attribue, dans la génération des idées, tout à l’action des sens externes ». 15 Ces encyclopédistes prônaient le progrès de l’homme à travers la recherche scientifique alors que Rousseau pointe du doigt ce pseudo-progrès qui, selon lui est la source des malheurs de l’homme. 8 est une supercherie et que le sentiment, est plus que jamais une matière indispensable pour mieux discerner le bien du mal : il s’agit de la dichotomie ou tout au moins de la complémentarité entre la raison et la sensibilité. Puis, nous tenterons d’examiner avec attention le hiatus établi par Rousseau dans ces deux types d’univers : la campagne et la ville. En effet, cette étape de notre étude mettra l’accent à la fois sur le mode de vie mondain et rustique, tant dans le milieu familial qu’élargi, puis nous permettra de réfléchir sur ce thème profondément important sur la réflexion rousseauiste : qui est celui de l’importance vouée à l’état de nature au préjudice de l’état social. Par ailleurs, pourquoi ce choix de roman par lettres16 ? On peut sans doute admettre que la réponse est large, mais au-delà de sa répugnance pour le roman balzacien17 et de ses inclinations personnelles, il y a un souci, peut-être latent, d’authenticité à l’égard du lecteur. C’est logiquement ce qui fait dire Claude Duchet à propos du texte littéraire que : « c’est parce qu’il est langage, et travail sur le langage, que le texte littéraire dit le socia1. Il ne le fait pas seulement à partir de sa thématique, mais aussi à travers ses façons de dire, de moduler le discours social, d’orienter le regard du lecteur sur le réel 18 ». Toutefois, son dessein idéal des relations humaines et de vie saine de l’homme ne manque pas de nous présenter le contraire : c’est son projet utopique. Partant de cette dynamique, le penseur met à nu toutes ses connaissances les plus approfondies de la vie urbaine ainsi que celles de ses aventures campagnardes. Enfin, nous analyserons cet aspect immanent de l’amour impossible voire contrarié par des préjugés qui, logiquement, abouti à une effervescence des états d’âmes partagées par les protagonistes en question. Rousseau dresse une peinture à la fois lamentable et pathétique de ces deux jeunes qui souffrent, mais endurent et obéissent, a bien des égards, à la fatale loi de la nature : celle de l’authenticité du cœur. Au demeurant, la devise de l’autodidacte n’est pas fortuit, s’il laisse entendre qu’il consacre sa vie à la vérité « Vitam empendero vero19 », il est sans aucun doute imbu de vérité et, du coup il fait fi à tout ce qui peut l’entraver. A posteriori, ce sujet mérite d’être posé nous semble-t-il, au regard des problèmes éthiques et moraux qui interpellent rigoureusement la conscience collective sur le sort de 16 Bien que le roman épistolaire soit en vogue à cette époque, ce choix n’est sans doute pas fortuit. Rousseau semble être, par le choix de ce genre, aux liminaires de son projet littéraire. 17 Par référence aux romans écrits sous le contrôle de certaines règles établies à l’image de ceux produisent par H. de Balzac. 18 Claude Duchet, La Sociocritique, Paris, Nathan, 1979, pp. 115-134. 19 « Vitam empendero vero » est la devise de Jean-Jacques Rousseau (en latin) et signifie, consacrer sa vie à la vérité. 9 l’homme. La résurgence de ces questions de psychologie et de caractère fait de cette problématique un sujet d’actualité. Partant de la complexité de la définition même du terme « vertu », l’on se rencontre de l’importance du travail artistique littéraire mais philosophique de Rousseau, dans le dessein de lever le voile et de frayer le bon chemin par une rhétorique subtile de celle-ci. C’est pourquoi Alexis Philonenco, dans La Pensée du Malheur, souligne que Rousseau découvre après Paul et Luther et avant Kant que : « L’humanité est affligée du pire des maux, le Mal20 ». Mais il est judicieux pour nous, avant de parler de notre revue critique, d’élucider les contours de ces deux notions qui fondent notre analyse : La rhétorique et la vertu. Que veut dire rhétorique ? Et qu’est-ce que la vertu ? Les origines de la rhétorique remontent à la Grèce antique. Plus précisément, la rhétorique naît au Ve siècle avant J-C en Sicile qui est une colonie grecque. Elle voit le jour dans un contexte judiciaire. Les tyrans qui régnaient sur la Sicile avait en effet exproprié un certain nombre de propriétaires au cours de leur règne. Lorsque les tyrans furent chassés, ces propriétaires eurent à faire valoir leurs droits. C’est alors qu’un élève du philosophe Empédocle nommé Corax mis au point une technique destiner à venir en aide aux justiciables. Il en publia les principes, accompagnés d’exemples concrets, dans un traité d’art oratoire. À cet effet, le concept se vulgarise et prend de plus de plus d’ampleur dans les écrits de bon nombre de penseurs appelés le plus souvent « rhéteurs ». Chez Cicéron par exemple, la rhétorique est considérée comme une adaptation au plus juste, de l’efficacité de la parole persuasive aux réalités et aux valeurs de la société. C’est dans cette logique justement qu’il énonce ces propos on ne peut plus vrai : Ni toutes les conditions, ni toutes les dignités, ni toutes les autorités, tous les âges, ni même tous les lieux, les temps, les auditoires, ne doivent être traités avec la même sorte de mots ou d’idées, et toujours dans chaque partie d’un discours comme de la vie il faut considérer ce qui est séant21 . De là, on peut dire que la rhétorique est conçue comme une énigme de la persuasion, un art qui vise non seulement à comprendre, à produire mais à réguler la persuasion afin de 20 Fatou Kiné Niakhaté, Jean-Jacques Rousseau ou la hantise de la vertu dans La Nouvelle Héloïse et Emile, Thèse de doctorat de troisième cycle en Littérature francophone, française et comparée, 2005-2006, p.12 21 Jacques-Emmanuel Bernard, « Rhetorique et société chez Cicéron », Modeles linguistiques, n 58, 2008, pp. 47-63. 10 répondre à ce phénomène qui consiste à expliquer ou à amener autrui, sans contrainte apparente, à penser quelque chose qu’il ne pensait pas auparavant. Au demeurant, chez son disciple Quintilien examinant la fin de l’éloquence, se demande si la rhétorique lui est extérieure ou si elle réside en elle-même. Dans un premier temps, il stipule que la rhétorique est l’ « art de persuader » et dans un second, de « bien parler » 22. La première définition se réfère expressément à la tradition cicéronienne, profondément éprise d’efficacité dans l’action. La seconde s’appuie sur l’autorité de Chrysippe : Quintilien déclare expressément qu’il l’adopte et c’est elle qu’il place à la fin de son exposé. C’est pourquoi Fleury martèle ainsi : Cicéron voudra donner une définition généralisant d’une rhétorique idéale, centrée sur l’hetos de l’orateur. Quant à Quintilien, fort conscient des problèmes qu’entraine la définition, il en fait une discussion approfondie au livre II ; sa tentative de systématisation en vue de donner à la rhétorique une unité aboutit toutefois à une définition trop vague : « la science du bien dire », avec un sens à la fois esthétique et éthique, qui ne satisfait pas les rhéteurs postérieurs23 . Bref, la rhétorique est perçue comme l’art de persuader par des facettes oratoires ingénieuses et convaincantes. De facto, elle est une arme susceptible de véhiculer une idéologie vis-à-vis des lecteurs, comme il en est avec la vertu dans La Nouvelle Héloïse. Et cette dernière revêt de multiples définitions qui laisseraient entendre que chaque auteur la conçoit selon ses appréhensions expérimentales de la vie. Certes, les conceptions diffèrent mais elles appellent tous au « bien » voire au « bonheur ». D’aucuns pensent que l’homme vertueux est un être qui se sent faible mais qui par son amour de la vertu essaie de triompher dans son combat contre le vice. D’ailleurs toute la morale cornélienne repose sur ce principe, et la vertu témoignerait d’une grandeur d’âme qui ne cède point à la faiblesse, qui concède donc la victoire de la vertu sur les passions. Jean Lacroix ne raisonne pas autrement lorsqu’il affirme que: « La vertu est, en quelque sorte, l’effort de l’être vers une moralité toujours plus haute24». Par ailleurs, d’autres imaginent que la vertu se confond avec la foi en « Dieu ». Spinoza n’hésitera pas de dire que : « Le bien suprême de ceux qui suivent la vertu est de connaître Dieu, c’est-à-dire un bien est commun à tous les hommes25 ». Mais dans 22 23 Pascale Fleury, « Réflexions sur le rôle de la rhétorique chez les rhéteurs latins tardifs : les définitions de la discipline », Cahiers des études anciennes, L, 2013, pp. 161-177. 24 Jean Lacroix, Spinoza et le problème du salut, Paris, P.U.F, 1970, p. 278. 25 Voir Georges Pascal, Les grands textes de la philosophie, Paris, Bordas, 1967, p. 124. 11 l’Antiquité, la vertu était beaucoup plus proche de la « beauté morale » du cœur, de la justice en « soi » d’abord et envers les autres ensuite, en un mot elle était moralement « divine ». Car Platon nous dit dans l’Euthyphron qu’ : « Une chose n’est pas sainte ou juste parce qu’elle est divine, mais une chose est divine parce qu’elle est sainte et juste26». Et c’est cette vertu qui a valu à Socrate sa renommée d’homme de conscience et de justice. Selon ce directeur de l’ « âme27», repris par Platon, la vertu est la capacité de vivre un certain nombre de principes et de valeurs dans la vie quotidienne dont la pratique permet de mener une vie morale, c'est-à-dire d'agir en conformité avec ce qu'on pense. C'est un savoir pratique composé de cinq qualités, orientées en croix à la façon des quatre points cardinaux, autour d'un centre occupé par la sagesse : le courage, la tempérance ou modération, la justice ou probité, la piété ou dévotion. Platon évoquant la vertu dans le Menon28 rappelle que pour Socrate, l'inexistence de maîtres de vertu lui prouve que celle-ci n'est pas une science, car elle ne peut s'enseigner; la vertu est alors tenue comme une opinion vraie. Elle proviendrait d'une sorte de grâce divine, d'une inspiration qui permet de bien agir29. Alors qu’au 18éme siècle, la vertu se confondait avec les notions d’humanisme et d’altruisme, telle est la définition donnée par certains dans le dictionnaire philosophique. Ainsi Voltaire s’écrira : « Qu’est-ce que la vertu ? Bienfaisance envers le prochain 30 ». Dans cette même veine d’Holbach dira : « La vertu n’est réellement que la sociabilité 31 ». Du coup, nous pouvons dire que pendant le siècle des « Lumières », elle était surtout identifiée du point de vue avec les autres, elle est une aptitude de désintéressement, un dessaisissement de soi au profit des autres. Pour une meilleure prise en charge de notre sujet, nous allons, à partir de la sociocritique32, se fonder sur les pensées de Lucien Goldmann, de Georg Lukács et de Pierre Zima33 dans l’élaboration de notre analyse. Reste à reconnaître que nous allons étudier d’abord, dans notre argumentaire, les différents aspects que recouvre la vertu politico-morale ainsi que son lien avec la religion, puis nous aborderons l’un des principes phares de Rousseau qui est celui de mettre en avant 26 Platon, Apologie de Socrate, Paris, Librairie Générale Française, 1997, p. 27. 27 Ibid., p. 12. 28 Menon est un ouvrage dialogué de Platon, dans lequel Menon et Socrate essaient de trouver la définition de la vertu, sa nature, afin de savoir si elle s’enseigne ou, sinon de quelle façon elle est obtenue. 29 Voir Platon, Menon ou de La Vertu, Paris, Culture Commune, 2013. 30 Robert Mauzi, L’Idée du bonheur dans la littérature et la pensée française du 18 ème siècle, Paris, Armand Colin,4e éd,1969, p. 606. 31 Ibid., p. 580. 32 Le mot « sociocritique » a été créé en 1971 par Claude Duchet. C’est une réflexion critique inaugurée par ce dernier qui, avec ses collègues poursuivent l’ancienne quête des rapports et des médiations entre le social et le littéraire. 33 Ce sont des critiques qui font usage de la sociocritique dans leur analyse textuelle et partant, formulent des théories référentielles. 12 l’état de nature au détriment de l’état social ou encore, de retracer les mérites de la vie en campagne contre les turpitudes de la vie en société, et enfin nous essayerons de scruter méticuleusement l’expression des vicissitudes de l’amour, en rapport à la vertu dans ce « monument des âmes pures » du Genevois. 13 PREMIERE PARTIE : DE LA VERTU MORALE À LA VERTU POLITIQUE Chapitre I : La vertu morale 14 Longtemps considérée comme substantielle dans la vie, la palette morale sur laquelle repose certaines qualités humaines d’alors et d’aujourd’hui reste l’une des préoccupations fondamentale de Rousseau. En effet, elle s’étend, en filigrane, tout le long du roman. Et l’on n’est pas sans savoir que le solitaire, dans tous ses écrits où tout au plus, dans toute sa philosophie théorique, témoigne d’une affectivité ineffable à l’égard du commun des mortels. Cet aspect socratique fait de lui selon Mostafai, « un directeur de conscience, un guide, le prophète d’une régénération morale34 ». Au fait, c’est par le biais de l’observation naturellement, et de celui du langage artistique que l’auteur de l’Emile ou De l’Education entend encore une fois, à travers La Nouvelle Héloïse, d’être le messie, le sauveur de l’humanité, voire même le redresseur de torts d’un monde en proie au désespoir. D’ailleurs, à travers son personnage Saint-Preux, il stipule son gout de connaître parfaitement son semblable dans ces divers états. Ainsi proclame son porte-parole : « Mon objet est de connaître l’homme et ma méthode de l’étudier dans ses relations35 ». Par conséquent, ce roman que beaucoup considère comme une simple représentation amoureuse de deux amants au pied des Alpes36 comme laisse voir le sous-titre de l’ouvrage, ou encore une simple élucubration philosophique, est aussi et surtout le spectacle inouï des grandes valeurs telles que la modestie, la tempérance, la chasteté, l’honneur et la dévotion. Qui plus est, la dimension expérimentale de la vertu morale dans le roman s’articule autour de la relation intrinsèque de l’être avec soi-même d’abord, c’est-à-dire la lucidité avec laquelle sa propre conscience dans ses faits et gestes n’enjambe point les normes et règles de la bienséance, puis avec sa famille, en l’occurrence ses enfants, son époux ou épouse, mais surtout et enfin avec ses voisins ou concitoyens. Toutefois, une question pertinente se pose et laisse le choix à qui veut admettre son équivocité réflexive : La vertu est-elle le fruit d’une réflexion cartésienne ou celui d’un penchant naturel du cœur ? Voilà une perspective litigieuse sur laquelle Rousseau a beaucoup réfléchi et a tenté du coup, de donner par des arguments solides et variés une réponse. Selon le Genevois, la vertu ou du moins le culte de la vertu passe inéluctablement d’abord par les propensions naturelles du cœur, par cet accord de la voie du bonheur à la nature, par un écho des organes de sens à l’âme. C’est précisément cette originalité qui a fait dire Manuel de Dieguez que : « Rousseau a inventé les mythes 34 Ourida Mostefai, « La Nouvelle Héloïse devant la critique et l’histoire littéraire au 19ème siècle », Pensée n°4, Canada, Ottawa, 1993, p. 11. 35 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 2ème partie/ L. XVI, Paris, Librairie Générale Française, 2002, p. 301. 36 C’est d’ailleurs le titre originel du roman, que Rousseau a substitué à celui qu’il porte. 15 modernes37 ». Reconnaître et prouver l’importance de la bonté du cœur et de celle de la préciosité de la nature pour le bonheur de l’homme, n’était pas qu’une simple idéologie chez Rousseau, c’était aussi un dispositif convaincant qui lui permet de justifier les infortunes de la société française. Son caractère sensible que l’on peut voir en Julie d’Etange, est une source intarissable qui alimente le culte de la vertu. À ce propos, Jules Lemaître affirme que : « C’est l’homme sensible qui fera du sentiment le fondement de la morale et qui écrira la plus grande partie de la Nouvelle Héloïse et de l’Emile38 ». Mais il est conséquent de préciser aussi que le discours moral que le Genevois entreprend dans ce roman avec le personnage de Julie apparaît comme doublement problématique, parce que si l’on sort du cadre de l’action héroïque vertueuse qui suppose une dialectique du dépassement morale, sa transcription évènementielle pose la question de la représentation du permanent déséquilibre qui s’instaure entre le désir et le devoir ; déséquilibre qui est le quotidien de Mme de Wolmar. Et l’on sait qu’en matière de vertu, il n’y a pas de modèles d’action autre que ceux fondés sur la valeur et la générosité des êtres (hors pairs) qui les accomplissent. Or, Julie a toujours manifesté son recul vis-à-vis des pulsions vives du désir et partant, sa magnanimité envers tous ceux qui l’entourent. Ses aspirations pour le bien prennent leur source dans son innocence, son caractère obligeant ainsi que dans ses inclinations pour la vertu, mais aussi et surtout dans son impassibilité. En ces termes, Saint�Preux retrace l’exemplarité de sa personne : « Quel prodige du ciel es-tu donc, inconcevable Julie? Et par quel art, connu de toi seule, peux-tu rassembler dans un cœur tant de mouvements incompatibles? Ivre d'amour et de volupté, le mien nage dans la tristesse… 39 ». Du reste, il est judicieux de dire que cette vertu morale qui balise la voie du bonheur et dont le Genevois nous présente dans La Nouvelle Héloïse se retrouve peu ou prou dans ce tendre et innocent personnage. À cet effet, Rousseau conçoit l’homme vertueux selon ses aptitudes morales à l’épreuve des règles et normes établies par ses semblables, tout en acceptant, tant bien que mal, l’imperfection de l’espèce humaine. Et depuis, la véritable équation que l’individu imbu de sagesse et animé de bonnes volonté s’entête et essaye de démystifier pour le bien commun, dans une quête inlassable du bonheur, a été celle de connaître et de cultiver la vertu. Mais comment ? Question grave certes, mais le Genevois, à travers une mise en scène consommée des vicissitudes de la passion éprouvée par des personnages épris de 37 Manuel de Dieguez, « Rousseau a inventé les mythes modernes » à l’occasion du 250éme anniversaire de la naissance de Rousseau. Consulter : http://rousseaustudies.free.fr/articleManuelDieguez.html. 38 Jules Lemaître, Jean-Jacques Rousseau, Paris, Calman Levy, 1907, p. 16. 39 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 1ére partie/ L. XXXI, op. cit. p. 153. 16 qualités humaines, laisse apercevoir des pistes probantes pouvant servir à une société en proie au vice. 17 I.1. LE SIEGE DE LA VERTU : le cœur ou la raison. Partant de la fatale relation amoureuse de Julie et Saint-Preux, de son caractère à la fois tacite et illicite d’un point de vue des règles traditionnelles établies et auxquelles M. d’Etange, père de la jeune fille, voue une considération dogmatique, la problématique morale de la vertu de ces deux jeunes gens se dresse et cristallise du coup leur affection pour cette dernière. En effet, c’est le début d’un combat interne entre le désir et le devoir à l’issue duquel, on saura mesurer la force ou la faiblesse morale en matière de vertu. Puisque Rousseau, dans une de ses lettres adressée à M. de Franquières, affirme qu’ « il n’y a point de vertu sans combat, il n’y en a point sans victoire. La vertu ne consiste pas seulement à être juste, mais à l’être en triomphant de ses passions, en régnant sur son propre cœur 40 ». Voilà une telle conception de la vertu qui accrédite cette pensée religieuse (musulmane) qui considèrerait le « cœur » comme garant de la bonne ou mauvaise attitude de l’homme41. Dans La Nouvelle Héloïse justement, c’est le cœur qui jauge l’intensité de la bonne ou mauvaise action tout en obéissant aux principes fondamentaux de la nature. Et c’est de là à juste titre que l’on assiste à une nouvelle sorte de vertu différente de celle de la tradition, une vertu fondée sur la transparence et la pureté du cœur. Allant dans la même perspective, Frauke Annegret, dans son article, retrace l’importance du cœur dans notre ouvrage ainsi : La sincérité du cœur et sa faillibilité sont les aspects majeurs qui se détachent des conceptions de la vertu tour à tour discutées dans le roman. Mais sincérité et faillibilité ne se rapportent pas aux vertus : elles sont elles-mêmes des aspects du cœur, qu’elles permettent justement d’identifier comme principe de libre arbitre42 . Et s’il y a d’aucuns, en l’occurrence les adeptes de Descartes43 qui affichent leur mépris vis-à�vis de cette conception, tout en accordant à la raison froide (cartésienne) une prééminence démesurée qui laisse entendre que c’est en elle que l’homme peut accéder à la vertu et au bonheur, l’auteur du Contrat social ne l’exclut non plus mais privilégie, à plus d’un titre, la 40 Voir, Pierre-Maurice Masson, La Religion de Jean-Jacques Rousseau, Genève, Slatkine Reprints, 1970, p. 188. 41 Voir le Coran (Sourate 22, verset 53). 42 Frauke Annegret Kurbacher-Schönborn, « Le reniement du cœur. Quelques réflexions philosophiques sur la liaison dangereuse entre l'amour sensible et l'individualité (Watteau et Rousseau) », Littératures classiques (N° 69)2009/2, p. 16. 43 Philosophe et savant français, Descartes refuse l’usage dogmatique de l’autorité et n’admet en science que la raison ; une telle exigence le fait rompre avec la scolastique. Persuadé que les longues chaines de raison des géomètres pourraient servir à la connaissance de toutes choses, il formula une méthode d’inspiration mathématique : conduire par ordre ses pensées pour atteindre la vérité, grâce à l’intuition du vrai et raisonnement déductif. 18 voix du cœur qu’est le sentiment. Quant on parle de sentiment, l’on pourrait à priori penser à l’amour-passion fondée sur le désir charnel. Mais il s’agit bien évidemment pour Rousseau d’un sentiment fondé sur l’amour naturel et transparent du cœur : c’est, cet amour filial qui a permis à Julie d’Etange de ne pas abandonner ses parents après la lancinante tentative de fuite que Milord Edouard lui a proposée dans les Îles britanniques44 malgré la pureté de son inclination pour Saint-Preux. Ce même amour, sous le sceau de la vertu, a su amener les amants à passer d’une relation passionnelle à une relation purement amicale et d’une certaine façon à renoncer au désir au profit du devoir. D’ailleurs, le Genevois fait dire à Mme de Wolmar que si le philosophe prétend à quelque connaissance qu’elle puisse être, l’homme sensible demeure à ces yeux le plus vertueux. En substance, elle rappelle à Saint-Preux son insensibilité primaire et la valeur de cette dernière dans la conduite morale. En ces termes, elle stipule : « En nous apprenant à penser, vous avez appris de nous à être sensible; et, quoi qu'en dise votre philosophe anglais, cette éducation vaut bien l'autre; si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit45 ». Cette précision de l’ex-amante, dans l’intention de clarifier toutes ses décisions prises, au préjudice de Saint-Preux, corrobore effectivement à cette idée de Frauke Annegret qui mentionne que la décision du cœur en tant qu’insigne de la vertu n’est pas qu’exhortation à la séparation mais aptitude compréhensive de soi dans tous ses états, et de l’un envers l’autre. Autrement dit, le cœur érigé en instance de jugement46, permet non seulement à l’homme de cultiver la vertu en s’obstinant à la reconnaissance et à la bienveillance de son prochain, mais en ne laissant aucune trace de haine ou de mépris dans les intentions. C’est exactement la raison pour laquelle cette réflexion cartésienne (froide) que se munit Saint-Preux dans ses actions et prises de décisions outrepasse quelque fois la valeur morale cardinale d’une famille qui se respecte, fût-il traditionnelle et révèle du coup son insensibilité à l’égard de la jeune fille sujette à une injonction paternelle. Parlant de la vertu du cœur et de la résignation, Frauke mentionne ceci : Si le cœur permet de reconnaître la vertu et si deux vertus exclusives l’une de l’autre s’y retrouvent, le point névralgique n’est pas l’exclusion réciproque, mais plutôt la conception d’une individualité qui comprend son déni, son renoncement et sa négation comme autant de marques de distinction et de nécessité47 . 44 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 2éme partie/L.III, op.cit., p, 256. 45 Ibid., 3éme partie/L.VII p. 381. 46 Frauke Annegret Kurbacher-Schönborn, « Le reniement du cœur. Quelques réflexions philosophiques sur la liaison dangereuse entre l'amour sensible et l'individualité (Watteau et Rousseau) », op., cit., p. 152. 47 Ibid., p. 156. 19 Voilà ce qu’a été l’objet de ces êtres du promeneur solitaire, conçus selon « son cœur » ; l’un parvient, à travers son abnégation, sa force morale mais surtout sa sentimentalité parentale, à renier les flammes de la passion alors que l’autre, imbu de raison, peine à vaincre cette fureur de son penchant. En fait, Rousseau retranscrit, à travers son personnage Saint-Preux la défaillance de cette réflexion cartésienne qui a déjà fait l’objet d’une méconnaissance des prouesses de la sensation du cœur, particulièrement dans la première moitié du 18eme siècle. Dans les confessions, il fait un résumé du roman, qu'il présente comme une alternative virtuelle à sa vie quotidienne. En ces mots, il confesse : L'impossibilité d'atteindre aux êtres réels me jeta dans le pays des chimères, et ne voyant rien d'existant qui fut digne de mon délire, je le nourris dans un monde idéal que mon imagination créatrice eut bientôt peuplé d'êtres selon mon cœur... je me figurais l'amour, l'amitié, les deux idoles de mon cœur sous les plus ravissantes images...J'imaginais deux amies...je les douais de deux caractères analogues, mais différents; de deux figures non pas parfaites mais de mon goût, qu'animait la bienveillance et la sensibilité. Je fis l'une brune et l'autre blonde, l'une vive et l'autre douce, l'une sage et l'autre faible, mais d'une si touchante faiblesse que la vertu semblait y gagner. Je donnai à l'une un amant dont l'autre fut la tendre amie, et même quelque chose de plus...Epris de mes deux charmants modèles, je m'identifiai avec l'amant et l'ami le plus qu'il m'était possible; mais je le fis aimable et jeune, lui donnant au surplus les vertus et les défauts que je me sentais48 . Ainsi, son entreprise créatrice se conçoit et met en place ses théories philosophiques centrées sur le sentiment contre celles des autres écrivains, notamment les encyclopédistes. Pourtant, il ne manque pas de faire dire à son présupposé philosophe dans La Nouvelle Héloïse que les sentiments ont un attrait inimaginable pour la paix de l’âme, fût-il lui-même insensible jusqu’alors à cette merveille de la nature. Passant d’un état exclusivement cadré sur la raison à celui du sentiment par occasion, sinon subjugué par l’état d’âme ou plutôt par la valeur morale surprenante dont Julie fait preuve par sa sensibilité perfectible, Saint-Preux vante les mérites de la nature, des montagnes du Valais et exalte surtout cette impression de la sensation. Avec délicatesse, il professe : J’admirais l’empire qu’on sur nos passions les plus vives les êtres les plus insensibles, et méprisais la philosophie de ne pouvoir pas même autant sur 48 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, éd. Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2005, p. 517. 20 l’âme qu’une suite d’objets inanimés. Ce fut là que je démêlai sensiblement dans la pureté de l’air ou je me trouvais la véritable cause du changement de mon humeur, et du retour de cette paix intérieure que j’avais perdu depuis si longtemps. Les méditations y prennent je ne sais quel caractère grand et sublime, proportionné aux objets qui frappent49 . A priori, si nous regardons de près ces différentes théories rousseauistes sur la vertu du cœur, l’on constate non sans émerveillement que le Genevois reconstruit la vision morale de l’homme qui aspire à illuminer et son âme et sa destinée. D’ailleurs, la contribution saillante de Rousseau à la psychologie au siècle des Lumières était son insistance sur le rôle de la sensibilité et de l’émotion dans la formation du caractère humain. Ainsi, il dote ses êtres imaginaires des valeurs fondées sur la sensibilité et qui mènent au bonheur. I.1. La vertu de chasteté : Rousseau a très tôt fait l’expérience de culpabilité car il coûta la vie à sa mère. En effet, celle-ci mourut en lui donnant naissance. Aussi, une éducation mal dirigée le fit certains vices qui l'ont poussé à commettre des fautes. Il se mettra à exalter l'état d'innocence et de pureté comme un idéal auquel il aspire. Cet amour exquis de l'innocence et de la pureté explique sa nostalgie des origines. Il admet qu’à sa création, l’homme était pur et innocent. Les livres saints tels que la bible qu'il lisait lui aurait appris que la corruption de l'homme serait survenue après qu'il eut cédé à la tentation de Satan. C'est avec le péché, c'est-à-dire après avoir goûté aux fruits de l'arbre interdit, que l'homme a commencé à éprouver des désirs charnels et à les satisfaire. C'est cette innocence primitive qui était le propre de l'homme que Rousseau va essayer de cultiver chez ses personnages, dans les relations amoureuses. Dans La Nouvelle Héloïse, au-delà de la peinture sarcastique des vicissitudes de l’instruction, Rousseau dresse un tableau sur lequel ces protagonistes passent au crible l’importance de l’innocence et du devoir pour acquérir le bonheur. En outre, il met fin à ce foisonnement de romans d’amour dans lesquelles la passion destructrice prend le pas sur la vertu avec la foi et l’ardeur d’un apôtre50, l’auteur des Confessions n’abolit pas la passion mais le fait ressuscité auprès de la vertu : passion et vertu coexistent désormais, mais celle-là 49 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 4éme partie/L. XI, op.cit., p. 533. 50 Gustave Lanson, Lettres Choisies des XVIIéme et XVIIIéme siècles, Paris, Librairie Hachette, 1932, p. 340. 21 change de perception. Elle n’est plus charnelle mais plutôt platonique puisqu’elle réconcilie volupté et innocence, sans éventuelle chute dans le crime. D’ailleurs, Robert Mauzi a bien perçu cette révolution des relations sentimentales dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. Il précise que : « Cette complicité entre la volupté et la bonne conscience atteint, dans la littérature sentimentale de la seconde moitié du siècle (18eme siècle), un tel degré de certitude mystique que le bonheur devient le signe irrécusable de l’innocence51 ». Dans cette quête inlassable du bonheur, l’on se rencontre que le Calviniste a mis en place une nouvelle perception de l’amour dans le temps. Une sorte de perpétuité de l’amour dans l’innocence, qui devient du coup une gageure puisqu’on doit s’aimer quelques soient les obstacles, selon Rousseau. C’est une loi de la nature que de s’éprendre et de se le dire, mais le respect des codes moraux exclu vigoureusement certaine manière de vivre qui fait oublier la Vk2ertu. Raison de plus pour cet auteur du Promeneur solitaire de représenter pour ses lecteurs, un amour exempt de crime charnel qui, à y regarder de près est le point idéal d’une relation amoureuse fondée sur la pureté des sentiments. À ce propos, Martin Rueff explique que dans La Nouvelle Héloïse : L’amour fait passer le temps autrement : il ouvre une nouvelle temporalité qui est faite de fidélité à l’évènement de la rencontre et qui se heurte au temps de la vie. Qu’est-ce que cela veut dire qu’aimer les gens à tout prix, quels que soient les obstacles, quelle que soit l’impossibilité ? On est deux, on veut faire un, mais pour faire un, il faut être deux. La Nouvelle Héloïse montre comment on peut vivre cette impossibilité dans le temps. C’est un immense roman sur la vie affective comme ouverture au temps. Chateaubriand, Proust ont vu en Rousseau un maître qui travaillait sur l’existence temporelle des sentiments. 52 De surplus, cette symbolique du mariage, quasiment inattendue par Julie et Saint�Preux, est attestée par bon nombre d’exégètes et de critiques littéraires du siècle des Lumières, comme régulateur social voire le socle de la tranquillité de l’âme. Dans La Nouvelle Héloïse notamment, le mariage de Julie a été sans commune mesure, le signe avant-coureur de la rupture passionnelle et celui d’une honnêteté conjugale ahurissante. Un tel constat poussera Raymond Trousson de marteler, en parlant de cet ouvrage que : C’est assurément un roman d’amour, irrésistible et fatal, conçu comme une totalité, sens et sentiment, le premier transcendé par le second. Les héros vivent de cette sensibilité qui fera aussi leur tourment. Passion donc, mais 51 Robert Mauzi, L’idée du bonheur dans la pensée et la littérature du XVIIIéme siècle, op., cit., p. 148. 52 Eléonore Sulser, « La Nouvelle Héloïse » invente une nouvelle manière de dire l’amour, Mars 2012 à 20h 08. 22 Rousseau se proposait encore un objet de mœurs et d’honnêteté conjugale, et l’œuvre se transformait dans la troisième partie lorsque, sur le point d’épouser Wolmar mais résolue à demeurer la maitresse de Saint-Preux ; quoi de surprenant dans ce 18éme siècle accoutumé aux mariages de convenances ; Julie découvre dans la solennité du lieu, l’exigence de la fidélité à elle-même et que l’amour véritable est inconcevable sans la vertu. La conscience a retrouvé sa rectitude et rejette les vains sophismes d’une raison qui ne s’appuie que sur elle-même. Elle ne cessera pas d’aimer Saint-Preux, mais il ne sera que l’amant de son âme. L’amour n’a pas aboli, il a changé de nature et l’œuvre d’orientation : à la peinture de la passion destructrice succède l’apologie inattendue du mariage, symbole de repos et de stabilité53 . Cette réflexion de Trousson, campe toute la problématique tournant autour de la dialectique du désir et du devoir : la pudeur. Précepteur, Saint-Preux est celui à qui l’éducation de Julie d’Etange est permise, sous la demande de Mme d’Etange. Séduit par les charmes de son élève, il déclare son amour et installe du coup un climat tendu entre lui et la famille de Julie. Mais cette dernière avait a priori refusé jusqu’à ce que Saint-Preux entreprenne de se suicider. Voilà le début d’une relation passionnelle que redoute Julie déjà sachant son caractère innocent, sa ferveur religieuse ainsi que son hérédité (mentale) : Si vous pouviez comprendre avec quel effroi j'éprouvai les premières atteintes du sentiment qui m'unit à vous, vous jugeriez du trouble qu'il dut me causer: j'ai été élevée dans des maximes si sévères, que l'amour le plus pur me paraissait le comble du déshonneur. Tout m'apprenait ou me faisait croire qu'une fille sensible était perdue au premier mot tendre échappé de sa bouche; mon imagination troublée confondait le crime avec l'aveu de la passion; et j'avais une si affreuse idée de ce premier pas(…)54 . Curieusement, la fortune fait que Julie également s’éprend de Saint-Preux d’un amour sincère et pur. Et par cette fureur amoureuse, elle cède aux éventuelles tentations du feu de l’amour, sans mesurer la suite de cette aporie passionnelle qui hantera leur esprit et âme au fil du temps. D’autant plus que le mariage ne peut être consommé entre eux du fait que M. d’Etange n’admet pas une mésalliance, le roturier se voit privé d’un amour naturel et s’évertue, par toutes les astuces et virtuosités du langage, à reconquérir son amante. Mais il se trouve que M. d’Etange noue déjà un pacte de mariage entre sa fille et M. de Wolmar qui fut pour lui un estimable ami et riche négociant, qui lui a également sauvé la vie. Du reste, Julie, imbue de vertu morale, somme Saint-Preux de mettre fin à leur relation pour se soumettre aux 53 Voir, Trousson, Raymond (https : //francearchives.fr/fr/agent/56867) 54 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 1ére partie/L.IX op., cit., p. 101. 23 injonctions de son père. C’est de là que commence effectivement le combat entre le désir et le devoir. Il va sans dire que les deux jeunes gens éprouvent, d’une manière à une autre, le regret de ne pas franchir le premier pas qui, inexorablement, sera la source de leur souffrance. Au demeurant, à différentes reprises, Julie a tenté de stopper cette fureur amoureuse qu’elle a pour Saint-Preux, mais en vain. Maintenant, il reste à savoir si elle pourra vivre avec elle dans l’innocence, c’est-à-dire, sans tomber dans le péché. Cependant, elle professe le malheur de ne pas pouvoir résister à la force des sentiments : Je n'ai rien négligé pour arrêter le progrès de cette passion funeste. Dans l'impuissance de résister, j'ai voulu me garantir d'être attaquée; tes poursuites ont trompé ma vaine prudence... Tout fomente l'ardeur qui me dévore; tout m'abandonne à moi-même, ou plutôt tout me livre à toi55… Mais la réalité en est autre, ces êtres de Rousseau vont ébranler voire supplanter cette manière courante de considérer une relation amoureuse. D’ailleurs, parmi ses nombreuses aventures passionnelles qu'il raconte dans ses Confessions, il raconte que celles qui lui ont procuré plus de plaisirs sont celles qui se sont déroulées seulement dans la communion des cœurs, donc sans qu'il ait cédé à la tentation de la chair. Avec ce goût de l'innocence dans la passion, il va essayer de le transposer en fiction romanesque. Pour preuve, Martin Rueff rappelle qu’ : Avant La Nouvelle Héloïse, le roman, dans les années 1750, est dominé par le roman libertinage : Crébillon publie son Sopha en 1742, Diderot Les Bijoux indiscret en 1748, la même année que Thérèse Philosophe de Boyer d’Argens. S’il est difficile de résumer d’une formule le projet du roman libertin, on peut hasarder que la vie affective s’y trouve subordonnée à la conquête sexuelle de l’autre. Le libertin se libère de l’amour. Le projet de Rousseau est autre : il s’agit de se libérer dans l’amour56 . Outre son indignation contre les romans de libertinage où la passion conduit inéluctablement au péché, Rousseau tient en haleine ses contemporains par une mise en place d’un amour tempéré qui exalte dorénavant le triomphe de la vertu auprès de la passion. Partagée entre le besoin d’amour et la crainte du péché, Julie essaye de résoudre ce dilemme. Pour prévenir ce qu’elle entrevoyait comme la source de son infortune, elle décide de revêtir son amour pour Saint-Preux un voile d’innocence. Cette posture de son inclination lui 55 Ibid., 1ére partie/L.IV, op., cit., pp. 89-90. 56 Eléonore Sulser, « La Nouvelle Héloïse » invente une nouvelle manière de dire l’amour, Paris, Le Temps, 16 mars 2012 à 20 : 08. 24 permettra d’aimer sans s’égarer, sans faire de péché charnel. Par cet amour de la vertu, elle se différencie de Manon Lescot57, personnage éponyme de l’Abbé Prévost qui s’est laissé entrainer par le libertinage qui la classe du coup parmi les filles de mauvaises mœurs. Par contre, Julie parvient à tenir le coup et s’en félicite en ces termes : « Jugez, vous qui avez la vertu, avec quelle joie je fis cette heureuse découverte. Sortie de cette profonde ignominie où mes terreurs m’avait plongée, je goûte le plaisir d’aimer purement…Et l’accord de l’amour et de l’innocence semble être le paradis sur la terre58 ». Certes elle parvient à se convaincre, mais elle est dans l’obligation d’amener celui pour qui elle éprouve ce sentiment à avoir un même état d’esprit, le persuader que l’on ne peut savourer le véritable amour que dans l’inaccomplissement de ce dernier. Serait-il facile de redresser un cœur déjà saupoudré de désir ? Ce n’est surement pas une sinécure, mais c’est la meilleure voire la seule méthode d’exorciser ce mysticisme amoureux. Dans une première entreprise, Julie échoue et est stupéfaite de l’attitude de son amant en proie à un scandale du feu de l’amour. Saint-Preux, au lieu d’acquiescer à la tempérance de Julie, s’emporte et manifeste son indignation par un langage éperdument dénué de sens : De quoi me sert l’abstinence éternelle et volontaire de ce qu’il y a de plus doux au monde, si celle qui l’exige ne m’en sait aucun gré…Enfin, quoi qu’il en soit de mon sort, je sens que j’ai pris une charge au-dessus de mes forces. Julie, reprenez la garde de vous-même ; je vous rends un dépôt trop dangereux pour la fidélité du dépositaire59… En dépit de ce refus, l’héroïne, à travers l’acuité de son esprit, la lucidité de ses sermons et son sens de la tempérance, arrive à convaincre son amant. Tout ceci révèle à quel point elle veut éviter le péché. Ce qui apparaît chez Rousseau comme l’expression de son obsession, de son rêve de pureté. Alors, Saint-Preux se rencontre que Julie n’aspire qu’à leur bien, sachant que leur amour est sans issue réelle. Donc créer ou du moins retracer un nouveau lien devient une nécessité pour sauvegarder ce que Jean Starobinski appelle la transparence et la communication des cœurs dans son fameux ouvrage : La Transparence et l’obstacle. Dès 57 L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, aujourd’hui plus souvent appelé Manon Lescaut, est un roman faisant partie des Mémoires et Aventures d’un homme de qualité qui s’est retiré du monde (7 volumes, rédigés de 1728 à 1731. Le livre a été jugé scandaleux à deux reprises en 1733 et 1735, et saisi et condamné à être brûlé. En 1753, l’auteur publie une nouvelle édition de Manon Lescaut revue, corrigée et augmentée d’un épisode important. 58 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 1 ére partie/L. IX, op., cit, p. 102. 59 Ibid., 1ére partie/L.V, p. 93. 25 lors, l’amour-passion fait place à l’amour tendresse et à l’amour innocence fondé sur l’amitié. Et Saint-Preux découvre avec étonnement cet amour qui apaise l’âme et dont Julie fut la source : « Que vous avez raison, ma Julie, de dire que je ne vous connais pas encore !... Quelle femme jamais comme vous associa la tendresse à la vertu, et, tempérant l'une par l'autre, les rendit toutes deux plus charmantes60 ? » Cependant, il est important de souligner que Saint-Preux reconnaît ou encore approuve à plus d’un égard une telle relation, mais il se trouve que sa raison froide obsessionnelle peine à s’y maintenir. Fut-il une entreprise du Genevois qui illustre les mérites du sentiment ? En tout état de cause, Saint-Preux, présenté comme un personnage raisonnable, fait l’apologie de Julie qui l’incite à faire vœu de chasteté, à suivre le droit chemin menant vers le destructeur des plaisirs mondains61. De surcroît, il aspire à ces qualités dont Julie fait montre et les compare à celles d’un ange céleste, comme qui entendrait Ronsard chanté sa Marie avec sublimation : Il n'en est pas ainsi de vous, céleste Julie ; vous vous contentez de charmer nos sens, et n’êtes point en guerre avec les vôtres. Il semble que des passions humaines soient au-dessous d'une âme si sublime: et comme vous avez la beauté des anges, vous en n’avez la pureté. O pureté que je respecte en murmurant, que ne puis-je ou vous rabaisser ou m’élever jusqu’à vous62 ! Mais il ira au-delà des louanges pour manifester son respect à l’égard des désirs et remontrances de Julie, qu’il considère comme des leçons de vertu. À présent, Saint-Preux se laisse guider par sa maîtresse à la recherche de la pureté et de l’innocence pour un salut réciproque. Leur objectif se voit être désormais le maintien de l’amour dans l’innocence. Quelle entreprise dans un siècle où l’honneur est à la passion ? Du reste, cela ne laisse pas indiffèrent Saint-Preux qui est déjà hors d’haleine de voir en Julie de si pur sentiments d’innocence et promet de s’y accommoder : Ah! c’est de vous qu’il faut apprendre tout ce qui peut entrer de bon, d’honnête dans une âme humaine, et surtout, ce divin accord de la vertu, de 60 Ibid., 1ére partie/L.X, p. 103. 61 Dieu ; la lumière divine. 62 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 1 ére partie/L. X, op. cit, p. 104. 26 l'amour et de la nature, qui ne se trouve jamais qu'en vous. Non, il n’y a point d’affection saine qui n’ait sa place dans votre cœur, qui ne s’y distingue par la sensibilité qui vous est propre... Non, je respecterai vos plaisirs, et pour eux�mêmes qui sont si purs, et pour vous qui les représentez63 . Rousseau écarte ses personnages du péché, en faisant valoir cet état primitif dans leur cœur, et dans lequel Adam et Eve se trouvaient avant le péché originel. Selon les théologiens, le couple mythique est venu au monde sans aucune impulsion charnelle. Autrement, Adam et Eve n’éprouvaient aucun désir corporel réciproque; mais ils ont été fourvoyés par Satan, l’ennemi déclaré de l’homme. Ce dernier leur aurait fait croire que l’arbre auquel Dieu leur a préservé de toucher encore moins de manger était l’objet mythique par lequel l’on peut acquérir et le savoir et le pouvoir. C’est delà qu’ils ont transcendé les règles divines et commencé du coup, à éprouver des gouts réciproques charnels et à les satisfaire. D’où l’importance pour Rousseau de se remémorer de cette première étape de l’homme pur, naturel et d’en faire une leçon de morale. En dépit de cette dynamique noble du Genevois, certains auteurs tels que Chateaubriand laisse ces personnages se faire guider par la passion à telle enseigne que leur vie soit compromise et la seule issue qui se présente à eux pour se préserver du péché reste la mort. Chactas et Atala, s’étant mis à l’évidence de leurs sentiments l’un pour l’autre, ont sombré dans la passivité. Ils n'ont pas eu le courage des personnages rousseauistes pour accepter leurs sentiments tout en essayant de les contrôler. De ce fait, Atala convoque la mort sous la pression des fureurs de l’amour passion. Cette mort d’Atala est différente de celle de Julie. Le premier est mort pour ne pas succomber au péché alors que le second essayait de sauver son fils noyé, même si elle ne fut pas contre cette mort qu’elle juge de mettre fin à sa vie tumultueuse et pleine de péripéties. Au fait, le solitaire a réussi, quant à lui, de les montrer le chemin de la chasteté tout en sauvegardant la réciprocité de leur sentiment qui retrouve maintenant sa place idéale dans la tendre amitié, l’union des cœurs et non des corps et dans la fusion de leur âme. 1.1. La vertu d’Honneur : 63 Ibid., 1 ére partie/L.XXI, p. 125. 27 Je [Saint-Preux] distingue dans ce qu’on appelle honneur, celui qui se tire de l’opinion publique, et celui qui dérive de l’estime de soi-même. Le premier consiste en vains préjugés plus mobiles qu’une onde agitée ; le second a sa base dans les vérités éternelles de la morale64 . Depuis l’Antiquité, ou du moins depuis que l’homme a retrouvé et reconnu son importance parmi toute la création divine, l’honneur, autrement dit l’estime que l’on a de soi ou celle qu’autrui nous porte, est considéré comme une valeur de dignité humaine sans commune mesure. Selon Rousseau, on ne peut s’épanouir pleinement que par le regard que porte sur nous l’opinion. Mais cette opinion, cette vision d’autrui sur notre estime, notre valeur personnelle, voire notre notoriété, semble être forcément liée à certaines qualités dont nous faisons preuve et qui peuvent d’ailleurs sortir du commun. Néanmoins, ce qu’il faut surtout connaître, c’est la conception rousseauiste de l’honneur, qui semble braver l’ancienne acception que l’on a d’elle. Dans son article, Manuela Giordano essaye de donner une définition approximative à ce que l’individu pourrait considérer comme un « honneur ». D’emblée, reconnaissant son équivocité, il martèle que : L’honneur est un concept très difficile à saisir et on est loin de s’accorder sur sa définition. Loin de vouloir épuiser ici les questions connexes à l’articulation de ce concept complexe, on rappellera brièvement que l’honneur peut être considéré d’une part comme un code moral, paritaire et égalitaire qui vise à défendre des normes éthiques et le statut d’une famille ou d’un individu, et s’exprime notamment dans la défense des femmes et de leur virginité en tant que dépositaires de la lignée. D’autre part, dans une approche différente mais complémentaire, l’honneur peut se définir comme une idéologie de défense du patrimoine et du groupe familial65 . Partant de cette définition, on voit nettement dans les idées de Rousseau, particulièrement dans celles qui se liguent dans La Nouvelle Héloïse, une dénonciation du point d’honneur ou du moins, du faux point d’honneur. Tout ce dont il aspire n’est pas visiblement vécu dans la société française du siècle des Lumières en termes de qualités morales. Donc, faire ressortir certains travers comme la manie de se faire valoir par n’importe qu’elle moyen, resterait digne d’être combattue dans la société. Par ailleurs, le fondement principal du point d’honneur est le duel, et ce depuis l’Antiquité. C’est du reste ce qui approuve cette vision de Giordano quand il parle d’ « honneur » chez les Grecs : 64 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 2 éme partie/ L XI, op., cit., pp. 248-366. 65 Manuela Giordano, « Injure, honneur et vengeance en Grèce ancienne », Cahiers des Mondes anciens [En ligne], 5 | 2014, mis en ligne le 14 février 2014, consulté le 01 octobre 2016. URL : http:// mondesanciens.revues.org/1238 ; DOI : 10.4000/mondesanciens.1238, p. 2. 28 Chez les Grecs, je dirais, de façon sommaire et même grossière, que la timè (l’honneur) n’est pas un concept unitaire, mais un système qui articule la valeur personnelle à d’autres éléments, et au don en particulier, connexion qui efface la distinction entre un niveau « matériel » et un niveau « éthique »(…) La célèbre querelle entre Agamemnon et Achille, au premier chant de l’Iliade, se déroule autour de la contestation implicite ou explicite de la timè réciproque des deux rois, provoquée par l’attribution-soustraction du geras de Chryseis-Briséis 66 . Et précisons que ce duel peut être suscité par la vengeance aussi bien que par un sentiment outragé, boulimique du mérite. Et c’est dans ce même ordre d’idées que Rousseau par le biais de son personnage Julie, stipule que le point d’honneur ne répond pas à la justice, mais seulement à l’esprit de vengeance ; il ne témoigne d’aucun véritable courage, mais de la lâcheté de n’avoir pas su braver le blâme de ses pairs ni s’opposer aux préjugés du siècle. Réduit à sa véritable expression, le duel n’est qu’une tentative plus ou moins réussie d’«homicide volontaire », dont l’agent est un homme «sanguinaire et dépravé », oublieux de ce qu’il doit aux lois et à sa patrie, voire à l’humanité tout entière. A postériori, on ne peut s’empêcher de dire que c’est un fait qui amoindrit sinon compromet la faculté d’impassibilité que tout homme devrait cultiver ; une maitrise de soi, de ses impulsions dans toutes ses actions deviennent plus que nécessaire pour ne pas se voir incarné par cet « amour-propre » amoral dont Florent Guenard récuse les effets : La recherche d’une valorisation de soi coupe l’individu de ce qu’il peut (et ainsi le plonge dans un état de faiblesse). Mais ce sont alors les conditions du respect de soi qui sont définitivement écartées. Car outre le fait que l’on se prive radicalement de liberté, vivre hors de soi, dans la représentation de soi, conduit à ne jamais avoir « un bon témoignage de soi »: l’amour-propre est toujours mécontent, parce que l’orgueilleux voudrait qu’on le préférât à tout. C’est bien d’ailleurs pour cette raison qu’il devient méchant — la méchanceté est un effet de la mésestime de soi67 . Au 16émesiècle également, l’honneur s’érige comme source de duel, cette fois-ci hiérarchique que Marco Cavina précise en ces termes : « exceptio inferioris dignitatis68 ». 66 Ibid. 67 Florent Guenard, « Amour de soi et estime de soi : Walzer, Rawls, Rousseau », Lumières, n°15 (« Modernités de Rousseau »), sous la direction de C. Spector, 2010, pp. 113-129. 68 Hervé Drévillon Diego Venturino, Penser et vivre l'honneur à l'époque moderne, Paris, PUF, 2012, p. 1. 29 Autrement dit, dans ledit siècle, l’on considère que l’injure, pour blesser l’honneur, doit venir d’un égal. En effet, les offenses de nobles appartenant à un rang plus haut ne portent pas atteintes à l’honneur mais sont subies comme des vexations tandis que les offenses d’un individu moins noble ne doivent pas provoquer de duel mais aboutir à la bastonnade de leur auteur. Il en résulte alors un double mécanisme d’exclusion et d’identification : l’exclusion des autres ordres du duel et l’identification d’une hiérarchie au sein même de la noblesse. À cet effet, Hervé Drévillon Diego Venturino mentionne l’attitude réactionnaire de certaines figures du siècle médiévale, à l’instar du Genevois, afin de sonner le glas à cette tendance : Céline Spector se penche sur la place spécifique de Rousseau dans la littérature dénonçant le point d’honneur et le duel. En inventant l’idéal moderne d’égale dignité qui se substitue à la logique aristocratique de l’honneur, le philosophe intègre l’aspiration primordiale à l’estime publique au modèle républicain et la rend compatible avec l’abolition des privilèges. La gloire républicaine se substitue à l’honneur aristocratique69 . Alors qu’au 18éme siècle, l’honneur se manifestait sous le signe du suicide. Pourtant, interdit par les lois religieuses et les lois civiles, le suicide devient un sujet d’interrogation pour les auteurs des Lumières, un fait social et un phénomène culturel. « L’homicide contre soi-même », pour reprendre la terminologie judiciaire de l’époque, constitue une source de déshonneur pour la famille en ce que celle-ci ne peut donner de sépulture chrétienne au proche. À ce propos Hervé nous éclaire : Un procès peut être intenté contre le mort et aboutir à l’exécution d’un cérémonial infamant sur le modèle du supplice d’un condamné vivant : en place publique, le corps mort est pendu la tête en bas ce qui, dans la symbolique chrétienne, est signe de damnation. L’objectif premier est donc bien de déshonorer le suicidé70 . Mais il se trouve que l’honneur occupe une place de choix dans les motifs de leur suicide. Abattus, ces gens ne voient aucune issue pouvant leur servir de cuirasse contre toute déshonneur hormis le suicide, il abrège du coup leur vie au nom de l’honneur. Dominique Godineau souligne ainsi que : 69 Ibid., p. 2. 70 Hervé Drévillon Diego Venturino, Penser et vivre l'honneur à l'époque moderne, op. cit, p. 3 30 Le suicide peut parfois s’intégrer dans un code de l’honneur qui s’apparenterait à celui du héros vaincu, à celui du condamné qui échappe à l’infamie du supplice. Plongeant ses racines dans la Rome antique étudiée par les philosophes des Lumières, l'idée du sacrifice de soi apparaît alors comme l’ultime expression de la liberté d’un individu pour échapper au déshonneur et à l’impasse d’une situation aliénante, comme l’avait par ailleurs montré Maurice Pinguet dans La mort volontaire au Japon71 . Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse, non seulement condamne le point d’honneur dans sa conception communément connue mais démontre ou encore met en place des stratégies consistantes et assez humanitaires afin d’attirer l’attention de l’opinion sans qu’il y ait écoulement de sang ni sentiment de mépris, même dans un duel. Dans une admirable lettre à Saint-Preux, Julie tient le discours de la raison72 sur la question du point d’honneur. La question initiale est de fait, avant d’être de droit. Milord Edouard ivre a-t-il déshonoré Julie en disant que Saint-Preux était son amant, et ce risque de déshonneur appelle-t-il, pour réparer la faute, que Saint-Preux croise le fer pour elle ? La réponse est subtile, parce que le Genevois représente ici un cas très singulier : il ne s’agit ni de calomnies, ni de contre-vérité mais de vérité puisqu’il est tout à fait son amant. Que signifie qu’il faille se battre pour combattre la vérité ? C’est pertinemment pour révéler l’absurdité du point d’honneur qui, justement, fait sortir l’homme de ses gonds même quand il s’agit d’une réalité qui menace notre amour-propre ou celui d’un proche. À cet égard, l’auteur du Promeneur Solitaire précise que « l’amour-propre est toujours irrité ou mécontent, parce qu’il voudrait que chacun nous préférât à tout et à lui-même, ce qui ne se peut73 ». À cet effet, Rousseau alloue à Julie la rhétorique de l’honneur dans sa lettre édifiante pour dissuader Saint-Preux de ne pas se rebeller contre Milord Edouard. À première vue, Julie, selon les réalités de cette époque, fait savoir à Saint-Preux qu’elle est plus offensée; son rang social et sa lignée n’en seront que tachés d’opprobre. Toutefois, elle martèle à l’égard de Saint-Preux sa vision de ce que peut engendrer une vengeance par la violence. En ces termes, elle stipule : 71 Ibid. 72 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 1ere partie/L. IV, op. cit, p. 89. On notera que Sade, avec une ironie féroce, reprendra pour les pervertir les arguments les plus classiques des censeurs du combat d’épée, et en particulier de Rousseau (Histoire de Juliette, ou les Prospérités du vice, Paris, Pauvert, 1987, t. II, p. 345-350). 73 Jean-Jacques Rousseau, Rousseau Juge de Jean-Jacques, Dialogues, Genève, in Collection complète des œuvres, 1782, p. 806. 31 Vous avez été insulté, je l'avoue, mais après avoir commencé vous�même par une insulte atroce; et moi, dont la famille est pleine de militaires, et qui ait tant oui débattre ces horribles questions, je n'ignore pas qu'un outrage en réponse à un autre ne l'efface point, et que le premier qu'on insulte demeure le seul offensé: c'est le même cas d'un combat imprévu, où l'agresseur est le seul criminel, et où celui qui tue ou blesse en se défendant n'est point coupable de meurtre 74 . De là, nous voyons que le calviniste envisage une démocratisation de l’honneur qui conduira à une révolution politique des mentalités dans la société française du 18éme siècle. Une société où cette vision de l’amour-propre, dans les trois quarts du temps, aboutit au narcissisme. Terminologie que Paul Denis définie comme : Une fatuité, un renflement du Moi, cette envie de parler de soi, uniquement de soi, cette inflation autour de sa propre personne et de ses prouesses jamais suffisamment détaillées, sont les marques de reconnaissance du Narcisse contemporain75 . Au demeurant, ce vice était le quotidien de bon nombre de gens qui tirent les ficelles dans la société et avec sa littérature de subversion, l’auteur du Contrat Social étale sa philosophie sur ce que doit être une société aspirant au respect de l’opinion publique. Figure emblématique de cette réforme, Charles Taylor nous suggère que : Dans l’abondante littérature du 18e siècle dénonçant le point d’honneur, et son expression privilégiée, le duel, l’œuvre de J.-J. Rousseau occupe une place singulière. Sans surprise, elle comprend d'abord une condamnation radicale du préjugé extravagant et barbare, au nom de la justice, au nom de la morale, au nom de la raison. La philosophie de Rousseau signe, l’invention de l’idéal moderne d’égale dignité qui se substitue à la logique aristocratique de l’honneur76 . Or, dans La Nouvelle Héloïse justement, la représentation du roturier réclamant son honneur est symbolique, c’est la perception large de la notion qui se vulgarise et change du 74 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 1 ére partie/L. LVII, op. cit, pp. 207-208. 75 Paul Denis, Le Narcissisme, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? », 2012, p. 11. 76 Voir : Hervé Drevillon et Diegué Venturino, Penser et Vivre l’honneur à l’époque modernes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, 388 p. 32 coup de cadre. Au surplus, Julie, issue de la noblesse, l’en dissuade de ne pas se laisser emporter par l’orgueil et de faire vœu de passivité : cette dynamique rousseauiste est très significative d’un point de vue satirique à l’égard de ceux qui font usage de cette mégalomanie maladive. Elle rappelle d’ailleurs l’importance de distinguer ce que Saint-Preux lui-même appelle : honneur réel et honneur apparent : Vous souvient-il d'une distinction que vous me fîtes autrefois, dans une occasion importante, entre l'honneur réel et l'honneur apparent? Dans laquelle des deux classes mettrons-nous celui dont il s'agit aujourd'hui? Pour moi, je ne vois pas comment cela peut même faire une question. Qu'y a-t-il de commun entre la gloire d'égorger un homme et le témoignage d'une âme droite, et quelle prise peut avoir la vaine opinion d'autrui sur l'honneur véritable dont toutes les racines sont au fond du cœur? Quoi! Les vertus qu'on a réellement périssent�elles sous les mensonges d'un calomniateur? Les injures d'un homme ivre prouvent-elles qu'on les mérite, et l'honneur du sage serait-il à la merci du premier brutal qu'il peut rencontrer? Me direz-vous qu'un duel témoigne qu'on a du cœur, et que cela suffit pour effacer la honte ou le reproche de tous les autres vices77 . Le Genevois, à travers les leçons magistrales que Julie inculque à son précepteur sur l’honneur, nous rappelle qu’elle n’est véritable que lorsqu’elle n’incite pas à la brutalité, au mépris, ou à la violence par les armes. Il exalte la maitrise de soi, l’humilité, l’acceptation de la vérité venant de l’ordre de la nature fut-il au grand dam de notre notoriété, de notre gloire ou encore de notre lignée. Tandis que dans cette représentation de Rousseau, l’offensé ou encore le plus offensé, maîtrise mieux ses impulsions que celui qu’en est le moins, et ce dernier était tenté d’ailleurs en cette occasion de manifester son orgueil pour une officieuse réputation : c’est révéler, encore une fois, l’absurdité du faux point d’honneur. À cet effet, la fille de M. d’Etange, intelligente qu’elle est, lui rappelle que l’honneur d’un homme de sagesse ne peut être atteint par une injure venant d’un ivre, faisant allusion à Milord E. Bomston. Par des interrogations oratoires, elle formule que : Les injures d'un homme ivre prouvent-elles qu'on les mérite, et l'honneur du sage serait-il à la merci du premier brutal qu'il peut rencontrer? Me direz-vous qu'un duel témoigne qu'on a du cœur, et que cela suffit pour effacer la honte ou le reproche de tous les autres vices? Je vous demanderai quel honneur peut dicter une pareille décision, et quelle raison peut la justifier. À ce compte, un fripon n'a 77 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse 1ére partie/L. LVII, op. cit, pp. 208-209. 33 qu'à se battre pour cesser d'être un fripon; les discours d'un menteur deviennent des vérités sitôt qu'ils sont soutenus à la pointe de l'épée; et si l'on vous accusait d'avoir tué un homme, vous en iriez tuer un second pour prouver que cela n'est pas vrai78 . Au terme de cet argumentaire, Julie a donc montré que l’utilisation de la voie des armes n’est ni juste, ni raisonnable, ni permise ; elle a renversé par-là même la conclusion des strophes du Cid de Corneille79. Au fait, elle défend sa vision de l’héroïsme contre l’erreur de Rodrigue. Concrètement, le Solitaire semble surtout reprocher à Corneille d’avoir légitimer la violence. Ainsi se justifient de tels propos : « On a peine à ne pas excuser Syphax, empoisonnant sa femme, le jeune Horace poignardant sa sœur80 . Cette initiative très intéressante pour Rousseau, l’a conduit à une réécriture de cette pièce au cœur de son roman, qui, évidemment, contient quelques modifications, mais inéluctablement, supprimerait le duel. En substance, il avance ses intuitions représentatives de la scène : Qu’on y met un sage sans préjugés, qui ayant reçu un affront d’un spadassin refuse d’aller se faire égorger par l’offenseur, et qu’on épuise tout l’art du théâtre pour rendre ses personnages intéressants comme le Cid au peuple français ; j’aurai tort si l’on réussit81 . Ainsi, la leçon très édifiante que l’auteur de l’Emile ou De l’Education nous a fournie dans cette rhétorique inédite de l’honneur est de montrer à quel point il est sage, honorable et humanitaire, quel que soit le rang social que l’on occupe, de reconnaître ses fautes et de se les faire pardonner, de la plus belle des manières. Milord Edouard, à qui M. d’Orbe a fait parvenir la précédente lettre de Julie, est en effet atteint dans sa conscience et son sens de l’honneur ; il élabore alors une mise en scène en présence de témoins, qui, au lieu d’être seconds du duel, assistent au pardon qu'il accorde à Saint-Preux. La force de ce pardon accordé par un grand aristocrate à un roturier est soulignée par une gravure de Gravelot82 commentée par Rousseau : 78 Ibid., 1 ére partie/L. LVII, p. 209. 79 Pierre Corneille (1606-1684), aussi appelé « Le Grand Corneille » ou « Corneille l’aîné » est un dramaturge et poète français du 17éme siècle. Il est l’auteur de cette œuvre tragique (Le Cid), qui fut d’ailleurs un triomphe, malgré les critiques de ses rivaux et des théoriciens. Dans cette œuvre magistrale classique justement, la violence, l’horreur et le sang hantent le quotidien des personnages et suscitent du coup chez Rousseau un sentiment d’indignation. 80 Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1995, p. 30. 81 Ibid., p. 20. 82 H. Gravelot est un ouvrier sculpteur français du 18éme siècle qui intitula l’acte honorable de Milord Edouard auprès de Saint-Preux : « L’Héroïsme de la valeur ». 34 La posture humble de l’Anglais, écrit-il, ne doit rien avoir de honteux ni de timide. Au contraire, il règne sur son visage une fierté sans arrogance, une hauteur de courage ; non pour braver celui devant lequel il s’humilie, mais à cause de l’honneur qu’il se rend à lui�même de faire une belle action pour un motif de justice et non de crainte83 . Mais au-delà de cette représentation pittoresque, Rousseau prête à son personnage un langage remarquablement admirable dont les effets n’en ont pas étaient moins indifférents à l’égard de Saint-Preux avec qui il devait se battre. Au fait, Milord Edouard considère son emportement comme une erreur inopinément inattentive et vient rétracter du coup ses propos injurieux au nom de la vertu et du sens de l’honneur. Cette instruction rousseauiste n’est pas une sinécure, d’autant plus qu’elle nécessite, à bien des égards, une ouverture d’esprit inouïe et mieux une grandeur d’âme incommensurable. C’est justement cette valeur morale qui, sans orgueil ni vanité, amènerait l’homme à retrouver son honneur en lui ainsi qu’aux yeux de l’opinion : la représentation de ces trois témoins de Milord Edouard n’est pas fortuite, c’est le sceau de sa bravoure spirituelle qui est exalté. Ainsi, l’honneur au-quelle Milord Edouard aspire est celui dont Julie eut déjà fait l’apologie dans sa lettre dissuasive adressée à Saint-Preux. Dans une attitude agenouillée, l’Anglais conjure le roturier en ces termes : Je viens, monsieur, rétracter hautement les discours injurieux que l'ivresse m'a fait tenir en votre présence: leur injustice les rend plus offensants pour moi que pour vous, et je m'en dois l'authentique désaveu. Je me soumets à toute la punition que vous voudrez m'imposer, et je ne croirai mon honneur rétabli que quand ma faute sera réparée. A quelque prix que ce soit, accordez-moi le pardon que je vous demande, et me rendez votre amitié84 . Cet acte honorifique de Milord est admirablement salué par Saint-Preux qui voit en lui une grandeur d’âme inestimable sinon enviable. Lui qui croyait férocement au duel, à la vengeance, se voit abattue par l’attitude à la fois émotionnelle et édifiante de l’Anglais. C’est à juste titre que le Genevois met en place cette rhétorique du duel qui, dans les trois quarts du temps ne fait que noircir l’image de l’homme et dont il en donne ici le remède. Un honneur 83 C’est alors l’homme à genoux qui, paradoxalement, inspire le respect. Comme le souligne M. Delon, la planche s’intitule «L’héroïsme de la valeur », ce qui n’est pas moins significatif («Honneur », Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, Raymond Trousson et S. Eigeldinger éds. Paris, Champion, 1996, p. 419) 84 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 1ére partie/L. LX, op., cit., p. 219. 35 qui « ne craint pas le vice85 » et qui vulgarise, puis légitime la violence, le barbarisme et le meurtre est vigoureusement dénoncer par Julie, ce chef-d’œuvre unique de la nature86 . En interrogeant l’histoire à propos de Rome, le berceau des trois religions révélées, elle précise à Saint-Preux que : Si les peuples les plus éclairés, les plus braves, les plus vertueux de la terre n'ont point connu le duel, je dis qu'il n'est pas une institution de l'honneur, mais une mode affreuse et barbare, digne de sa féroce origine. Reste à savoir si, quand il s'agit de sa vie ou de celle d'autrui, l'honnête homme se règle sur la mode, et s'il n'y a pas alors plus de vrai courage à la braver qu'à la suivre. Que ferait, à votre avis, celui qui s'y veut asservir, dans les lieux où règne un usage contraire87 ? La conclusion de ce réquisitoire est claire : si honneur il y a, il ne s’identifie, ni plus ni moins, à la vertu. À cet égard, il existe bien un « solide honneur », qui « ne dépend ni des temps, ni des lieux, ni des préjugés ». L’honneur véritable, aux yeux de Julie, est la source des devoirs et de la justice, au point de s’identifier, purement et simplement, à la conscience : c’est l’honneur de l’honnête homme88, qui ne se règle ni sur la mode ni sur le préjugé. La subversion est accomplie : loin de s’illustrer dans le duel, le véritable courage fait ses preuves dans la résistance à une coutume barbare et à une opinion vaine. À l’opinion vulgaire et à ses faux critères, il faut savoir préférer l’estime de soi et l'estime publique, récompenses légitimes de la vertu. À cet effet, Julie rappelle encore une fois à Saint-Preux l’importance du respect des lois de sa patrie ainsi que le rôle d’un bon citoyen contre les préjugés de l’opinion vulgaire : Avez-vous oublié que le citoyen doit sa vie à la patrie, et n'a pas le droit d'en disposer sans le congé des lois, à plus forte raison contre leur défense? O mon ami! Si vous aimez sincèrement la vertu, apprenez à la servir à sa mode, et non à la mode des hommes. Je veux qu'il en puisse résulter quelque inconvénient : ce mot de vertu n'est-il donc pour vous qu'un vain nom, et ne serez-vous vertueux et quand il n’en coûtera rien de l'être? (…) Si le philosophe et le sage se règlent dans les plus grandes affaires de la vie sur les discours insensés de la 85 Ibid., 1ére partie/L. LX, pp. 219-222. 86 Ibid., 1ére partie/L. LV, p. 203. 87 Ibid., 1ére partie/L. LVII, p. 210. 88 L’honnête homme est un être de contrastes et d’équilibre. Il incarne une tension qui résulte de cette recherche d’équilibre entre le corps et l'âme, entre les exigences de la vie et celles de la pensée, entre les vertus antiques et les vertus chrétiennes. Il lui faut fuir les excès, même dans le bien. En un mot, il est un idéal de modération et d'équilibre dans l'usage de toutes les facultés. Voir : (Jean-Marie Domenach, Ce qu'il faut enseigner, Paris, Seuil, 1989, p. 19.) 36 multitude, que sert tout cet appareil d'études, pour n'être au fond qu'un homme vulgaire89 ? De facto, cette conception rousseauiste de l’honneur dans La Nouvelle Héloïse, tente, à bien des égards, de sonner le glas à celle de la société aristocratique, celle qui n’a cure ni de la justice, ni des normes et règles religieuses : c’est l’unique voie de sauver l’humanité contre ce délire mégalomaniaque. À y regarder de près l’élaboration de cette thématique de l’honneur, nous constatons que Rousseau a très tôt mesurer la gravité de cette pathologie psychique qui ne faisait que prendre de l’ampleur au moment où le principal voire l’unique objectif des intellectuels était de sortir le peuple français des ténèbres abyssaux de l’accoutumance et du dogme traditionnel. C’est justement l’enjecu de cette « psychothérapie philosophique » qu’est La Nouvelle Héloïse. I.3 La vertu et la religion : J’invoquai l’Etre (…) qui soutient ou détruit quand il lui plait par nos propres forces la liberté qu’il nous donne. Je veux, lui dis-je, le bien que tu veux, et dont toi seul est la source. Je veux aimer l’époux que tu m’as donné. Je veux être fidèle, parce que c’est le premier devoir qui lie toute la famille et la société90 . Face à un recul ou plutôt à un manque crucial d’humanisme et d’autocritique sur la vie des Français du siècle des Lumières, aux abus de certains droits humains tels que la liberté de pensées et mieux encore la tendance asservissante de la religion au compte de la monarchie, les autorités religieux sont ciblés et la religion chrétienne est bafouée par un certain nombre de penseurs qui, à tort ou à raison, prêchent une nouvelle religion qui exclut foncièrement l’existence d’un intermédiaire entre l’homme et son créateur : le théisme. Par conséquent, cette subversion fera l’objet de plusieurs questionnements aussi bien sur l’existence de Dieu que sur la question de l’intermédiaire entre la divinité et l’humain. C’est justement, ce qui justifie l’attitude de Rousseau ; d’abord calviniste, puis converti au catholicisme, il rejette enfin les religions révélées pour adopter une religion intime, sincère et personnelle sans 89 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 1ére partie/L. LVII, op. cit, p. 211. 90 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 3éme partie/L. XVIII, op., cit., pp. 356-357. 37 intermédiaire d’église officielle et de dogmes. Mais il est judicieux de préciser qu’il voue une importance démesurée à cette religion sans laquelle selon l’auteur de la Profession de foi du Vicaire Savoyard, il n’aurait point de vertu dans la conduite humaine : c’est la religion naturelle. Au demeurant, cette religion rousseauiste est définie dans la bible ainsi : Religion naturelle : c’est celle qui est inscrite par Dieu au cœur de l’homme, indépendamment de toute révélation extérieure. Cette religion comporte la connaissance de l’existence de Dieu, la notion de ses perfections et l’idée de devoir à lui rendre91 . En tout état de cause, le choix de cette religion n’est pas fortuit, il est par contre un recours sans appel à la justice, et Rousseau par-là même renouvelle la conception de la foi et du dogme religieux sous le sceau de la vertu. Voilà pourquoi il affirme dans sa lettre à D’Alembert de tels propos : « Je n’entends pas qu’on puisse être vertueux sans religion ; j’eus longtemps cette opinion trompeuse dont je suis trop désabusé92 ». Dans une perspective très élaborée de manifester son attachement à la religion, Rousseau la défend à plus d’un titre dans un siècle où elle fut farouchement combattue par les rationalistes et les utilitaristes.93 Imbu d’une morale religieuse dès son bas-âge, le calviniste a fait figure d’adepte voire de messie au cours d’un siècle où, trois quart des intellectuels sapent rudement les fondements canoniques de la religion. Pour preuve, il est vu par certains critiques comme un prophète si l’on se confie aux propos suivants de Pierre Burgelin : « Le philosophe, dans ses écrits romanesques, philosophiques et politiques apparait au critique comme un « inspiré qui puise à la source intérieur jaillissante la force d’avertir son temps, comme les anciens prophètes juifs94 . » C’est pertinemment ce que l’on constate quand on est plongé dans la lecture de La Nouvelle Héloïse. Du reste, il ne manque pas non plus à réprimander même en dehors de ses œuvres, celles ou ceux qui blasphèment ou outrepassent, d’une manière à une autre, les règles de base d’une religion naturellement sacrée, fondée sur la vertu. Un jour qu’il était avec ses amis, le Genevois constata dans leur discussion, de la médisance caractérisée et du coup, il 91 Fulcran Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, Paris, Letouzey et Ané, 1912, Vol. 5, p. 1235. 92 Pierre Burgelin, La philosophie de l’existence de Rousseau, Paris, Vrin, 2005, p. 451. 93 Ibid., p. 35. 94 On appelle utilitaristes, ceux qui font de l'utile, de ce qui sert à la vie ou au bonheur, le principe de toutes les valeurs dans le domaine de la connaissance comme dans celui de l'action. Selon Proudhon, On appelle utilitarisme : « le système qui consiste à ramener la notion du juste à celle de l'utile, par conséquent à faire de l'intérêt le principe du droit et de la morale ».( Proudhon, Justiceds Lal. 1968.) 38 professa ainsi son courroux contre une telle attitude : « Si c’est une lâcheté de souffrir qu’on dise du mal de son ami absent, c’est un crime que de souffrir qu’on dise du mal de son Dieu qui est présent. Et moi, messieurs, je crois en Dieu ! Je sors si vous dites un mot de plus95 ». En outre, il est important de reconnaitre que Rousseau, dans toute sa théorie philosophique sur le bonheur de l’homme et la paix de l’âme, consacre la foi, autrement dit il considère celle-ci comme la matrice de toute bonne action humaine et la sève nourricière de toute vertu. Dans l’Emile ou De l’Education, Rousseau laisse entendre que : « Sans la foi nulle véritable vertu n’existe96 ». Dans La Nouvelle Héloïse, la religion ou encore la foi en un Dieu puissant, constitue le soubassement de certaines qualités auxquelles Julie d’Etange a fait preuve pour sauvegarder le statu quo de ses intentions qui se révélaient être : fuir son mal et chercher son bien97, c’est-à-dire, s’abstenir de tout commerce charnel illicite malgré la faute commise dans le bosquet et d’être fidèle à son mari pour l’éternité. D’ailleurs, si l’on examine minutieusement la double situation dans laquelle Julie d’Etange est confrontée dans sa vie, on peut en déduire que c’est la lumière de la foi qui a authentifier voir sceller sa vertu. À la fleur de l’âge ou tout au plus à la méconnaissance des dangers liés à la perversion, elle sombre dans le péché et y demeure momentanément, tout en ayant profondément le reproche de ses actes. Ainsi, Julie précise : « A force de vouloir étouffer le reproche sans renoncer au crime, il m’arrive à ce qui arrive à toute âme honnête qui s’égare et qui se plait dans son égarement98 ». Mais après qu’elle eut en conscience que l’homme est naturellement faible surtout quand il est à l’épreuve d’une tentation charnelle, et que celles ou ceux qui parviennent parfois à surmonter certains écueils contingentes de la vie n’y parviennent que par la main cachée de Dieu, à posteriori, elle fit recours à des invocations vers l’éternel pourvoyeur de bien : O mon Souverain Maître, j’emploierai ma vie à vous servir, à obéir à vos lois, et à remplir mes devoirs : j’implore vos bénédictions sur ces résolutions, que je forme de tout mon cœur et avec un ferme propos de les exécuter, sachant par une triste expérience que, sans le secours de votre grâce, les plus fermes projets s’évanouissent, mais que vous ne la refuser jamais à ceux qui vous la demande du cœur, et avec humilité et ferveur99 . 95 Pierre Maurice Masson, La Formation religieuse de Rousseau, Paris, Hachette, 1916, p. 184. 96 Jean-Jacques Rousseau, L’Emile ou De l’Education, op., cit., p. 632. 97 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 3éme partie/ L. XXI, Paris, G-Flammarion, 1967, p. 279. 98 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse (2002), 3éme partie/ L. XVIII, op., cit., p. 253. 99 Citée par Pierre Burgelin, La philosophie de l’existence de Rousseau, op., cit., p. 123. 39 Et de facto, on peut dire que ses invocations ont été exaucées puisqu’elle est parvenue, malgré le prurit des passions délétères et après le mariage consommé avec M. de Wolmar, à préserver sa fidélité conjugale et d’y inciter celui pour qui elle a tant éprouvé cet amour clandestin. À y regarder de près, ces propos que font dire le Genevois à Julie quand elle écrit à Saint-Preux, on peut constater sans ambiguïté le haut degré d’importance qu’il voue à Dieu, à son omniscience et son omnipotence et la reconnaissance de la bassesse de l’homme quand celui-ci se replie sur lui-même, c’est-à-dire quand il pense résoudre ou comprendre certains aléas de la vie qui sont hors de la portée humaine. C’est dans ce registre magistral qu’elle essaye de faire comprendre à Saint-Preux que pour sortir des schémas tordus que nous indique Satan, il faut invoquer le détenteur du trône suprême d’où l’importance de la prière comme gage de la délivrance. En ces termes, elle martèle : « Esclave par notre faiblesse, nous sommes libres par la prière ; car il dépend de nous de demander et d’obtenir la force qu’il ne dépend pas de nous d’avoir par nous-même ».100 Au demeurant, ce changement de Julie qui est passée d’une fille pècheresse à une femme vertueuse attire considérablement l’attention de bon nombre de critique. La force de la religion rousseauiste contrôle et sauvegarde la vertu qui balise la voie qui mène à l’obéissance de Dieu et à la purification instantanée de l’âme. Fort de ce constat, Gustave Lanson précise que : Julie se sauve par la conscience appuyée sur la religion. Elle établit dans sa vie une loyauté, la franchise par le renoncement. D’innocente fille, elle devient femme vertueuse, et à défaut du bonheur, elle retrouve la paix. Au lieu des ivresses des passions, elle goute des affections douces et profondes dans la fidélité conjugale et dans la maternité. Voilà comment l’individu peut résister au mal social qui s’insinue en lui ; voilà comment il peut restaurer en lui l’équivalent de l’innocence et du bonheur naturel101 . Et, ce qu’il faut par ailleurs préciser sur la conception rousseauiste du péché ou du mal en général est qu’aucun mortel n’est impeccable au sens étymologique du mot, c’est-à-dire, l’homme, dans sa substance même, est fait pour commettre des péchés mais auxquels il faut, au jour le jour, remédier, se les faire pardonner par le seul vrai juge102 (Dieu) et, mieux encore, lutter contre ces passions sataniques afin de s’en épurer définitivement parce que la 100 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 6éme partie/ L. VI, op., cit., pp.510-513. 101 Gustave Lanson, « L’Unité de la pensée de Rousseau », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, t. 8, 1912, p. 35. 102 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 3éme partie, L. XVIII, op., cit., p. 266. 40 lumière divine délivre quand on la trouve, à bien des égard, à certains turpitudes de la vie. Ainsi, en même temps que Dieu préserve du péché, il fait aimer la vertu selon l’auteur du Promeneur Solitaire. C’est la raison pour laquelle, même s’il lui arrive de défendre la raison, Rousseau reconnaît qu’elle demeure, par ailleurs, un guide peu sûr, car elle s’égare dans de vains sophismes, surtout dans l’état actuel de la société. Il distingue à ce propos la saine raison ou « raison raisonnable » et la raison corrompue ou « raison raisonnante ». Pour preuve, Julie, voulant inculquer à Saint-Preux l’horreur du crime et l’exhorter à la vertu, lui déclare que le vice ne peut être réfuté que par la saine raison, or celle-ci tire ses lumières de la foi. Considérant les arguments de ceux qui légitiment l’adultère conjugal, elle écrit à Saint�Preux ceci : Défions-nous d’une philosophie en parole ; défions-nous d’une fausse vertu qui sape toutes vertus, et s’applique à justifier tous les vices pour s’autoriser à les avoir tous. Le meilleur moyen de trouver ce qui est bien est de le chercher sincèrement ; et l’on ne peut longtemps le chercher ainsi sans remonter à l’auteur de tout bien103 . Par ailleurs, il est judicieux de souligner ici que Rousseau étudie a priori la religion de l’homme qui, en quête d’authenticité, s’arrache aux perversions de la société contre nature ; cet homme est bon, juste, moral, il mérite d’être heureux selon l’auteur de l’Emile, et d’un bonheur lié à la bonne conscience et qui ne peut être goûté sans entrave que dans l’au-delà. C’est fort de ce constat que Christian Jacquet nous parle ainsi de la nécessité de suivre la religion de Rousseau. Dans son article, il stipule qu’ : Il faut revenir à la religion essentielle, à la religion naturelle, où Dieu parle directement à notre cœur et nous enseigne la vertu. Elle est limitée à quelques articles : existence d’un Dieu intelligent et très bon, liberté et immortalité de l’âme ; elle concilie l’exigence de la raison et l’intuition du sentiment104 . Toujours en se penchant sur le changement à la fois inattendu et ahurissant de Julie, du point de vue existentiel des relations humaines et des respects des lois de la nature, on analyse que la religion naturelle plus que tout autre religion, renvoie au salut de l’âme, 103 Ibid., 3éme partie/L. XVIII, pp. 266-267. 104 Christian Jacquet, « La pensée religieuse de Jean-Jacques Rousseau » in : Revue philosophique de Louvain, 4 e série, t. 74, n 21, 1976, pp. 137-139. 41 autrement dit, elle contribue à plus d’un titre à la chute ou à la rédemption des vives impulsions néfastes qui surnagent dans les intentions. Cet aspect irréductiblement important de la religion naturelle dans la conduite de la vertu salutaire, ne passe pas inaperçu sous la plume de Burgelin qui, en parlant encore une fois des vertus de cette philosophie de vie de l’auteur du Contrat Social déclame que : Morale et religion vont naitre du désarroi ou se trouve l’homme qui change de condition. Il est d’abord véritablement perdu : lui qui n’avait qu’à s’abandonner doit assumer maintenant une histoire. Or il a échoué ; dès lors nous retrouvons les schémas de toutes les religions de salut : chute, rédemption, espérance d’un rétablissement final105 . Puis, ce qui est édifiant dans cette étude de la foi dans la Nouvelle Héloïse, est que le Calviniste retrace avec ardeur, la distinction entre la foi naturelle (foi en un Dieu unique) et celle de la société (foi conventionnelle), c’est-à-dire, celle qui est érigée sur la base des conventions sociales. Et cette dernière, soutient-il, est le fruit de ce qu’il appelle les philosophes à son époque. Manifestement, Rousseau déclare que cette croyance de la société est à l’origine de la dégradation de certaines valeurs humaines fondées sur l’éthique et la vertu. Par une ingénieuse intoxication d’une doctrine à la fois prosélyte et inique, ces défenseurs de la foi sociale ou conventionnelle légitiment voire légifère des règles et lois ignominieuses dans la société. Et partant de cette expérience, l’auteur des Confessions témoigne à travers Julie : Considèrerons de sang-froid les discours de vos philosophes, dignes apologistes du crime, qui ne séduisirent jamais que des cœurs déjà corrompus. Ne dirait-on pas qu’en s’attaquant directement au plus saint et au plus solennel des engagements, ces dangereux raisonneurs ont résolu d’anéantir d’un seul coup la société humaine, qui n’est fondée que sur la foi des conventions ? Mais voyez, je vous prie, comme ils disculpent un adultère secret. C’est disent-ils, qu’il n’en résulte aucun mal, pas même pour l’époux qui l’ignore : comme s’ils pouvaient être surs qu’il l’ignorera toujours ! Comme s’il suffisait, pour autoriser le parjure et l’infidélité, qu’ils ne nuisissent pas à autrui106… 105 Pierre Burgelin, La philosophie de l’existence de Rousseau, op., cit., p. 240. 106 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 3éme partie/L. XVIII, op., cit., p. 420. 42 Dans cet énoncé, Rousseau reconnaît le mariage comme un contrat (social) sacré et il remet en cause tout ce qui peut entraver la stabilité et la confiance dans cette union qui, pour le Genevois, est le fondement substantiel d’une communauté. En effet, il montre l’importance de faire la différence entre le crime prémédité et son contraire, c’est-à-dire celui que l’on commet par inadvertance, sans y prêter attention. Au fait, le péché, fut-il commis en secret, reste toujours un péché pourvu qu’il soit prémédité puisque celui qui incite à s’en départir est à la fois omniprésent et omniscient. Donc selon Rousseau, il est inutile de se cacher et l’homme vertueux aurait connu naturellement, sans qu’on ne lui en suggère, que la saine conduite morale doit toujours sa source à la vertu, soutenue par la foi. D’ailleurs, la gravité d’une telle attitude l’a poussé à mentionner par des interrogations orales ceci : N’est-ce donc faire aucun mal, à votre avis, que d’anéantir ou troubler par un sang étranger cette union naturelle, et d’altérer dans son principe l’affection mutuelle qui doit lier entre eux tous les membres d’une famille ? Y a-t-il au monde un honnête homme qui n’eût horreur de changer l’enfant d’un autre en nourrice, et le crime est-il moindre de le changer dans le sein de la nature107 . La Nouvelle Héloïse, par ces réquisitoires, montre que la vertu, sous la houlette de la foi en un Dieu unique sans intermédiaire, est la seule et unique voie qui conduit au salut, dans cette vie ainsi que dans l’au-delà. Qui plus est, la représentation romanesque du couple Wolmar est assez significative dans l’analyse profonde de la conception religieuse de la vertu. Mariée de force à M. Wolmar qui se révèle être un athée, Julie retrouve la paix intérieur au moment où elle proclame fidélité à ce dernier au sein de l’église. Elle ne sombre pas dans ce que Kierkegaard appelle « l'état continu de péché », elle a su qu’un souffle divin épure par admiration, toutes ses intentions obscènes qui l’empêche d’être elle-même, c’est-à-dire, une vertueuse bien qu’elle s’en éprend avec effusion. C’est justement ce qu’elle essaye d’expliquer à Saint-Preux quand elle stipule ainsi que : La voix secrète qui ne cessait de murmurer au fond de mon cœur s’élève et tonne avec plus de force au moment où j’étais prête à périr. L’auteur de toute vérité n’a point souffert que je sortisse de sa 107 Ibid., 4 éme partie/L. XXVI, p. 421. 43 présence, coupable d’un vil parjure ; et, prévenant mon crime par mes remords, il m’a montré l’abîme où j’allais me précipiter108 . Puis, par un art consommé de la rhétorique, Kierkegaard explicite avec clarté le processus par lequel une personne peut sombrer dans le péché. En ces termes, il martèle que : Le pécheur, au contraire, est si bien au pouvoir du péché que, n'en soupçonnant la portée, il ne sait même pas que sa vie tout entière est sur la voie de la perdition. Il ne cote que chaque nouveau péché, qui lui donne comme un nouvel élan sur la même route, comme si, l'instant d'avant, il n'allait pas déjà vers elle de toute la vitesse des péchés antérieurs. Le péché lui est devenu si naturel ou si bien une seconde nature, qu'il n'aperçoit rien que de normal au train de chaque jour et n'a de bref recul qu'au moment de recevoir de chaque nouveau péché comme un nouvel élan. Dans cette perdition, au lieu de la continuité véritable de l'éternité, celle du croyant qui se sait devant Dieu, il ne voit pas celle de sa propre vie… la continuité du péché109 . Le dicton dira qu’il est humain de pécher mais satanique d’y persévérer. À la lueur de cet appel à la pureté par Dieu, une nouvelle vie commence pour Julie, une vie fondée sur la vertu et celle-ci scellée par la foi. Mais ce qui est curieux dans sa conversion est qu’elle est appelée à épouser un athée, (M. de Wolmar) qui, sans foi religieuse, se présente toujours comme un mari idéal. Rousseau veut-il montrer qu’on peut être vertueux sans la foi ? Ou met-il en exergue que pour être en conformité avec la religion naturelle dont il prône, il suffit de l’être avec la nature? A posteriori, il n’est pas inconséquent de dire que la bonté naturelle de Wolmar est guidée par la foi au « bien », c’est-à-dire ses facultés et son innocence primitive ne sont pas altérées par la société. Donc, il fait le bien non pas parce qu’il est vertueux au sens religieux ou disons au pied de la lettre, mais parce qu’il ne connaît pas le mal pour ainsi dire, il est naturellement bon. Voilà quelques attestations de sa femme sur son attitude lorsqu’elle écrit à Saint-Preux : Je ne l’ai jamais vu ni gai ni triste, mais toujours content ; jamais il ne parle de lui, rarement de moi ; il ne me cherche pas, mais il n’est pas fâché que je le cherche, et me quitte peu volontiers. Il ne rit point ; il est sérieux sans donner envie de l’être ; (…) Le plus grand goût de M. de Wolmar est d’observer. Il aime à juger des caractères des 108 Ibid., 3éme partie/ L. XVIII, p. 262. 109 Soren Kierkegaard, Traité du désespoir, Paris, Gallimard, 1949, p. 208. 44 hommes et des actions qu’il voit faire. Il en juge avec une profonde sagesse et la plus parfaite impartialité. Si un ennemi lui faisait du mal, il en discuterait les motifs et les moyens aussi paisiblement que s’il s’agissait d’une chose indifférente110 . D’ailleurs, Christian Jaquet atteste ainsi que : « Monsieur de Wolmar est moins vertueux que naturellement bon, son incroyance n’a rien d’agressif et s’inverse en conversion à la fin de la Nouvelle Héloïse111 ». In fine, on dira que l’auteur du Promeneur solitaire révèle dans La Nouvelle Héloïse que la pratique du bien passe, irréversiblement par la jonction de la vertu à la foi. Du reste, même Robert Mauzi soutient cette thèse lorsqu’il affirme que : « C’est en Dieu que la vertu trouve sa caution suprême ».112 En outre, selon le Genevois, c’est dans cette union que l’homme trouve son intérêt véritable et attend de Dieu son réconciliation parfaite du bonheur et de la vertu ; celle-ci est, pour ainsi dire, marquée par l’effort pour se libérer de l’esclavage des passions et de la société, elle reconduit l’homme à sa nature véritable et elle est puissamment soutenue par la croyance en Dieu, à la fois modèle de toute perfection, garant du bonheur final du juste et témoin encourageant de son loyal combat pour la justice. Et Madame de Wolmar illustre merveilleusement cette heureuse alliance de la vertu et de la religion. À cet égard, elle ne cesse de remercier celui par qui elle est parvenue à une telle pureté de l’âme et exhorte Saint-Preux à boire avec elle à la santé de Dieu, sans qui ils auraient commis l’irréparable erreur puisque la tentative de la fuite dans le duché d’York113 établie par Milord Edouard, fut à leur portée. En ces termes, elle martèle : Aurions-nous jamais fait ce progrès par nos seules forces ? Jamais, jamais, mon ami ; le tenter même étais une témérité. Nous fuir même étais pour nous la première loi du devoir, que rien ne nous eût permis d’enfreindre (…) Payons de nos vertus celles de notre bienfaiteur ; voilà tout ce que nous lui devons. Il a fait assez pour nous et pour lui s’il nous a rendu à nous-même. Absents ou présents, vivants ou morts, nous porterons partout un témoignage qui ne sera perdu pour aucun des trois114 . 110 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 3éme partie/L. XX, op., cit., p. 431. 111 Christian Jacquet, « La pensée religieuse de Jean-Jacques Rousseau », in : Revue philosophique de Louvain, 4 e série, n° 21, 1976, pp. 137-169. 112 Robert Mauzi, L’idée du bonheur dans la littérature et la pensée française du 18éme siècle, op., cit, p. 633. 113 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 2 éme partie/ L. III, p. 137. 114 Ibid., 6éme partie/ L. VI, op., cit., p. 729. 45 Rousseau a remarquablement montré avec délicatesse sinon avec enthousiasme que, dans La Nouvelle Héloïse, la vertu est indissociable à la religion, l’une ne peut aller sans l’autre. Cette union est la marque même de l’exemplarité et de la probité dans les relations humaines, puisque les actes et les propos seront mesurés et ce, même à l’abri des regards humains ; c’est en cela que l’on reconnait effectivement la vrai valeur de l’homme, il ne fait de bons actes que parce que son cœur est imbu de bonté naturelle et non parce qu’il craint l’opprobre et l’humiliation devant ses concitoyens. Donc, selon le genevois, la vertu véritable est celle qui est soutenue par la foi. La Nouvelle Héloïse encore une fois, par la représentation époustouflante et édifiante de Julie, illustre, à bien des égards, cette alliance qui, nécessairement, a abouti au culte du bien. De facto, dans La Nouvelle Héloïse, l’auteur du Contrat social rappelle vivement à la société française, que l’homme n’acquiert la paix de l’âme et partant, celle dans sa société qu’en s’astreignant à certaines valeurs morales irréfutables au chemin du salut terrestre et dans l’au-delà. De surcroît, ces valeurs morales auxquelles l’homme est appelé à suivre sont, selon le Genevois, le propre de la vertu (stoïque) scellée par la foi en un Dieu unique, sans intermédiaire. À en croire Rousseau, la vertu seule, sans appuie sur le sublime créateur, ne tiendrait plus longtemps aux contingentes tentations sataniques. D’ailleurs, d’un point de vue purement ontologique, l’imperfection de l’homme commence par ses inéluctables erreurs, une faiblesse qui est la substance intrinsèque de l’être même. De ce fait, pour que l’être puisse pourvoir à certains de ces défaillances morales, il faudrait nécessairement qu’il fasse appel aux inépuisables grâces de Dieu sans quoi il y aurait une dégénérescence de la société qui aboutit selon Rousseau à un rétrécissement de l’esprit humain. En ces termes, il laisse entendre que : « (…) l’esprit (humain) s’étrécit à mesure que son âme se corrompt115 ». Par conséquent, de l’être humain, autrement dit, du bonheur individuel, Rousseau pense au bonheur collectif, à une organisation sociale juste et équitable à la lumière de l’Age d’or primitif de l’humanité. Chapitre II: La vertu politique : Quelques penseurs solitaires s'efforcèrent dans le courant et vers la fin du 17éme siècle de ressusciter les maximes du droit naturel. Leibniz conçoit l’État comme une grande société 115 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 2éme partie/ L. XXVII, op., cit. p. 364. 46 dont le but est la sûreté commune. Grotius et même Pufendorf prétendent fonder le droit sur la loi naturelle. Ils ne tirèrent de là que des conclusions timides. C'est d'Angleterre que partit le grand mouvement de pensée d’où sortit la philosophie du 18éme siècle. Et il en partit parce que des raisons d'ordre pratique y poussèrent les esprits à envisager différemment le droit politique. La première révolution de 1640 avait déjà orienté les esprits vers des idées démocratiques. Tandis que Hobbes ou Filmer faisaient l'apologie de la monarchie absolue, Milton traçait le plan d'une république autoritaire, Harrington esquissait sa singulière utopie d’Oceana, Sydney réfutait Filmer, au profit des doctrines libérales. C'est cependant le nom de Locke qui, à la fin du 17éme siècle, personnifie la conception nouvelle de l'Etat. Son influence fut considérable en France ; on peut dire qu'elle domina toute la philosophie politique anglaise au 18éme siècle et même au début du 20éme siècle. Pour justifier l'avènement de Guillaume III, il fallait adopter une notion nouvelle, opposée aux idées courantes du 17éme siècle, de l'Etat, du citoyen et de la politique. Ce fut Locke qui la constitua, en empruntant les éléments à Aristote, à Cicéron, et aux publicistes libéraux des deux derniers siècles. Selon sa théorie, il faut admettre, avant toute société, un état de nature où les humains ont vécu, non pas uniquement dans les luttes et la barbarie, mais en observant certains principes innés en eux, d'où sont sortis plus tard naturellement ceux qui régissent la cité politique. Le droit de défense, le droit de punir, le droit de propriété qui dérive du travail et de la liberté, sont antérieurs à toute convention. Tous les humains sont libres et égaux. L'esclavage ne saurait se justifier. Le pouvoir paternel ne va pas jusqu'au despotisme. La méchanceté et la faiblesse des humains ont rendu nécessaire l'établissement d'une société civile et politique. Elle est caractérisée par ce fait que les particuliers se dépouillent en faveur de l'Etat de leur droit de punir. Mais ils gardent leurs autres droits, et l’Etat n’est institué que par le consentement commun et pour les maintenir, les assurer, ou les développer. Toute forme de gouvernement est bonne, pourvu qu'elle repose sur ce principe fondamental. Le pouvoir législatif est institué par le peuple qui garde le droit de juger et de contrôler son œuvre, de même que la conduite du pouvoir exécutif. Dans les cas d'abus manifestes, le peuple a le droit de se révolter ou de changer la constitution. Cette doctrine, très visiblement imposée par les événements de 1688, est absolument opposée au despotisme de l'Etat. Elle fut, en somme, celle du 18éme siècle anglais ou l'individualisme se développa librement. Mais elle ne reçut guère en Angleterre de complément philosophique intéressant. C'est en France que, sous son influence combinée avec la tradition absolutiste, héritée du 18éme siècle, se dessina le grand mouvement de pensée qui finit par aboutir à la Révolution française. Le socialisme d’Etat, la toute-puissance du pouvoir central étaient des dogmes trop universellement acceptés pour que, même ceux qui 47 prétendaient parler au nom de la raison pure s'en affranchissent complètement. Un grand nombre d'auteurs n'ont fait que transférer le pouvoir souverain du roi à l'Etat et remplacer le droit divin par la raison d'Etat ou le droit naturel. C'est bien plutôt la théorie du pouvoir que le pouvoir lui-même que l'on attaque; et c'est l'absolutisme royal, non celui de l'Etat que l'on arrive le plus souvent à mettre en cause. C'est plutôt pour la collectivité que pour l'individu que l'on réclame des garanties; et les droits naturels ne sont exaltés que pour être de nouveau immolés devant l'Etat, des tendances d'aspect à demi-socialiste et qui viennent de la vieille tradition monarchique se retrouvent dans la plus grande partie de la philosophie politique au 18éme siècle. Un rapide coup d'œil sur les représentants principaux en fait preuve. Le libéralisme de Fénelon, que l'on oppose à Bossuet, est encore absolutiste. Sans doute, il souhaite une royauté tempérée par des soucis moraux et par quelques institutions assez mal décrites, mais, s'il veut le roi moins despotique, il admet, dans son Télémaque, la toute�puissance de l'Etat, et Salente, la cité idéale, est renouvelée de Platon. Vauban et l'abbé de Saint-Pierre protestent contre le despotisme, sans préciser les bases d'un régime nouveau. Ce dernier semble avoir voulu une sorte de régime parlementaire. Mais la plupart ne tirent du droit naturel d'autre conclusion que la demande d'un despotisme éclairé il se justifie amplement par des considérations d'utilité publique, en prenant soin du peuple et en respectant dans une certaine mesure, quelques libertés individuelles. Tel est le vœu de Voltaire, qui eut quelque libéralisme en matières religieuses, mais ne songea pas à innover en politique. La plupart des docteurs de l’Encyclopédie, y compris les plus avancés, pensèrent de même. Diderot, qui déclama si furieusement contre tant de traditions, fut le courtisan de Catherine Il. D'Holbach rédigea en quelque sorte le manuel du despotisme éclairé. En dehors de France, Bielefeld, Hume, Beccaria, Filangieri et d'autres l'acceptèrent également. Il fait partie de la théorie des physiocrates. Sans doute, toutes ces philosophies offrent des différences notables. Elles ont ceci de commun que, tout en admettant un droit naturel, elles déclarent que, au nom de l'utilité générale, l'humain a fait abdication de ses droits en faveur d'un bon souverain qui s'engage en échange à consulter la raison, à le rendre le plus heureux possible, sans que d'ailleurs il reconnaisse à l'individu des droits bien positifs. L'intérêt bien entendu doit faire accepter la royauté, bien qu'elle n'existe pas en droit naturel. D'autres écrivains cependant, surtout au point de vue théorique, ont été plus hardis. Il est à remarquer que presque toujours ils ont atténué les conséquences pratiques qu'il était possible de tirer de leurs doctrines et qu'il n'y a souvent pas dans leurs écrits tout ce que leurs commentateurs, disciples ou critiques, ont prétendu y voir. Mais leur pensée, bien ou mal comprise, eut une grande influence et éloigna violemment ou graduellement les esprits des anciennes maximes. 48 C'est ainsi que Montesquieu s'efforça de donner la théorie de la liberté politique. Elle existe seulement, selon lui, dans les régimes modérés où se combinent les divers principes essentiels à chaque forme de gouvernement et où aucun corps constitué ne peut se considérer comme représentant unique de l'Etat. L'Etat a le devoir d'assurer la sûreté et la liberté morale de chacun. Nul n'a fait plus âprement que Montesquieu la critique de l'esclavage. La législation doit se conformer aux dispositions des individus et à leur nature. On doit l'accommoder différemment selon le climat et l'histoire. Le législateur se méfiera de ses propres passions et n'agira qu'avec prudence et modération. L'Etat est d'ailleurs en droit, malgré toutes ces recommandations, d’établir le régime qui lui semble le plus convenable; il ne faut pas oublier que Montesquieu regarde comme également légitime, selon les lieux et les temps, le Communisme ou un régime égalitaire. Il donne des observations critiques, des conseils et des indications beaucoup plutôt qu'il ne formule une théorie politique proprement dite, et il comprit fort mal, en somme, la constitution anglaise pour laquelle il marqua une préférence. Son trait caractéristique est d'avoir appliqué aux faits politiques et sociaux un esprit scientifique et impartial et d'avoir tenu compte des circonstances et des événements historiques. Cependant, les écoles les plus opposées se sont réclamées de Rousseau et, à vrai dire, ses contradictions et ses sophismes l'expliquent. Il ne faudrait cependant pas les exagérer, et il est légitime de distinguer soigneusement de la théorie pure les restrictions dont il l'a entourée et les conséquences pratiques qu’il en a tirées. Il a entrepris de rechercher les vrais principes du pouvoir politique et ses limites. Pour lui, la souveraineté appartient à la personne publique qui s'est trouvée formée, par l'union des personnes particulières, le jour où, renonçant à l'état de nature, les humains ont conclu entre eux le contrat social. Peu importe comment s'est formée historiquement la société. Il importe de savoir comment elle existe aux yeux de la raison. Réfutant avec énergie les systèmes qui établissent sur la force ou sur le droit divin l'empire de quelques privilégiés, Rousseau développe puissamment la théorie du contrat social qui donne pour origine au pouvoir politique et social : « L'aliénation totale de chaque associé avec tous les droits de la communauté ». Rousseau transfère donc au peuple la souveraineté absolue que l'on n'accordait jadis qu'à la personne royale. Sans doute, malgré les efforts qu'il tente pour montrer comment le citoyen demeure libre, l'Etat ainsi constitué a des pouvoirs aussi redoutables que ceux de l'absolutisme monarchique. Théoriquement, on l'a justement remarqué la différence est grande. Les sacrifices que le citoyen fait pour l'Etat apparaissent comme faits pour lui-même. Il a droit à sa liberté individuelle, est partie intégrante du souverain, ne peut être esclave. La convention politique est égale pour tous. La justice doit 49 régner entre tous. La liberté morale est absolue. Il y a là, malgré tout, un grand relèvement de l'individu à l'égard de l'État. Rousseau a rapproché de la morale la politique que l'ancienne théorie tendait à en isoler. Il a rapproché l'idée de l'Etat de celle de droit et de justice. Il faut que l'Etat soit fort, mais il faut aussi qu'il soit juste. Sans doute, le socialisme, à certains égards, peut se réclamer de lui, mais l'individualisme lui doit peut-être plus encore, surtout lorsqu'on veut bien se souvenir par quelles atténuations il prétendait corriger celles de ces maximes qui semblaient encourager une république démocratique et sociale. Son influence fut énorme et sa pensée domina toute la seconde moitié du 18éme siècle. On retrouve chez ses disciples les deux principes qui le caractérisent : relèvement de l'homme moral et du citoyen et souveraineté populaire. Les uns accroissent le rôle de l’Etat jusqu'à prêcher le Communisme, comme Morelly, le fameux auteur du Code de la Nature; d'autres se contentent de prôner des systèmes égalitaires ou un socialisme d'Etat plus ou moins étendu; d'autres, plus libéraux, veulent, comme Condorcet, que l'art social serve surtout « à garantir la conservation des droits naturels avec la plus entière égalité dans la plus grande étendue ». Sans doute, les décisions de la majorité doivent lier le citoyen, mais seulement à la condition de ne jamais abolir les droits naturels. Les hommes de la Révolution devaient traduire d'une manière plus précise les tendances diverses de tous ces systèmes philosophiques. Dans La Nouvelle Héloïse, la pensée politique de Rousseau, à travers ses théories remarquablement philosophiques, littéraires mais subversives, a fait de lui un acteur phare voire le plus illustre dans le combat mené pour la Révolution française de 1789. À l’instar de la vertu morale chez le Genevois, la vertu politique occupe une part considérable dans toutes ses idées subversives de l’état socio-politique de son époque en France. Eu égard de ce constat, Pierre Serna n’est pas resté indifférent, il nous éclaire ainsi sur l’apport monumental de l’auteur de la Profession de foi du vicaire Savoyard à la construction de l’édifice républicain du peuple français au 18éme siècle. Par ces mots, il stipule : L’orateur ne manque pas de rappeler que la génération qui a fait la Révolution a grandi et a été formée par la pensée de Rousseau « pour ainsi dire élevée par lui. » Il n’est que trop juste dans ces conditions, que la République entière appelle celui qui fut le père spirituel des acteurs de 1789 et de 1792 à entrer dans son temple116 . 116 Pierre Serna, « Politiques de Rousseau et politiques de Robespierre : faux semblants et vrais miroirs déformés », in La Révolution française, 16 Novembre 2015, p. 4. Ibidem. 50 Ce père spirituel des acteurs de la Révolution était, il faut bien le rappeler, un homme très spécifique de par ses convictions religieuses, morales, sociales, philosophiques et politiques. Qui plus est, la profondeur de ses pensées et l’ingéniosité de ses talents littéraires font à la fois la marque édifiante, la saveur et la splendeur de ses textes. En écoutant parler Serna à propos de Rousseau, l’on ne serait pas inconséquent de penser être soumis à un panégyrique d’un prophète ou d’un ange qui, comme un envoyé de Dieu, s’entête à une restauration de l’ordre dans les rapports socio-politiques. Avec admiration, il martèle que : (…) Rousseau a vécu dans l’ombre, le silence, la solitude, détruisit le préjugé de la noblesse(…) Il nous apprit à honorer le travail, la pauvreté, le malheur, à chercher dans l’humble atelier ou dans la chaumière obscure les vertus, les mœurs, la véritable dignité, comme le vrai bonheur117 . En effet, Rousseau avait non seulement le matériau intellectuel qui lui permettait de s’ingérer dans les affaires de la vie politique et sociale, mais il avait surtout la maturité expérimentale dans quasiment tous les domaines de la cité. D’ailleurs, l’une de ses particularités parmi les écrivains de la littérature subversive est le fait qu’au-delà de la dénonciation théorique, il propose des solutions, des pistes de réflexion, des issues prometteuses même si d’aucuns les jugent, impraticables. Dans La Nouvelle Héloïse, c’est justement ce que l’on constate quand on analyse la mise en scène symbolique de la communauté de Clarens. Le Solitaire montre dans ce microcosme, un modèle de gouvernement auquel toutes et tous vivraient l’Age d’or d’autrefois. Au demeurant, il soutient très fortement la thèse suivant laquelle, pour qu’il y ait une vie paisible et réconfortante dans une communauté, il faut impérativement le culte de la vertu dans la conduite quotidienne des politiques de cette cité. En guise d’illustration, Robert Darnton mentionne : Figure emblématique et complexe à la fois, Rousseau présente différentes facettes qui rendent aisées les projections de tous ceux qui, à des degrés différents, souffrent, se considèrent comme des inférieurs, en cette fin de siècle où la victimologie est bien en place avec toute cette immense frustration que les blocages de la société 117 Pierre Serna, « Politiques de Rousseau et politiques de Robespierre : faux semblants et vrais miroirs déformés », op., cit., p. 6. 51 d’Ancien Régime rendent insupportables, et tout particulièrement pour les jeunes hommes plein de talents mais ne pouvant pleinement l’exprimer118 . La pertinence de cette idée n’est pas à démontrer, elle atteste d’elle-même, c’est du reste un truisme. Puisqu’un politique est celui qui est appelé à s’occuper des affaires (vitales) du peuple, il doit, par devoir et par respect patriotique, privilégier l’intérêt général aux dépens de ses intérêts exclusifs sans quoi, il serait à l’origine des maux et tourments de tout un peuple. À cet égard, l’épistolier comprend très tôt la nécessité d’agir sur la condition humaine, puis il incite les hommes à ouvrir les yeux sur l’iniquité sociale et sa condition d’exploitée. Au demeurant, le Genevois s’interroge sur la question de la légitimité d’une autorité qui s’avère, somme toute, lourde de conséquence, puisque sa réflexion consiste à savoir, si aucun homme n’a sur son semblable une autorité naturelle, ni la monarchie ni l’oligarchie, où trouver et comment fonder la légitimité de quelque autorité que ce soit ? La seule autorité légitime, selon Rousseau, est celle de la volonté générale et distinguera du coup, entre la volonté générale et la volonté de tous : la volonté générale c’est l’accord naturel, instinctif de toutes les volontés vers le bien car le philosophe n’a jamais renoncé à penser qu’au fond de chaque individu il y a une orientation spontanée vers le bien ; en revanche, la volonté de tous, qui n’est que l’accumulation de volontés individuelles divergentes, est contraire à la volonté générale, d’autant plus que si le nombre sanctifie (la majorité), il n’est en aucun cas le garant du bien. C’est effectivement ce qui le conduit à faire appel à la nature primitive de l’homme, à ses valeurs naissantes et à ses sens innocents afin de faire resurgir la vertu originelle à travers laquelle, l’homme pourra regagner cet Age d’or de l’humanité. C’est là véritablement le sens voire la clef de toutes les théories de Rousseau sur le développement licencieux de la société. En substance, on peut dire que selon l’auteur du Contrat social, la faiblesse humaine est disproportionnée au progrès humain. II.1 L’apologie de la vertu originelle : Contempteur du progrès scientifique et de l’évolution de la civilisation humaine, Rousseau ne sait jamais démenti dans ses œuvres. Dans toutes ses théories philosophiques et littéraires, le genevois défend sans complaisance et avec vigueur la thèse selon laquelle l’homme primitif est meilleur, notamment d’un point de vue spirituel et éthique, que l’homme civilisé. Ce 118 Robert DARNTON, « Dans la France prérévolutionnaire : des philosophes des Lumières aux « Rousseaux des ruisseaux », Bohème littéraire et révolution, Paris, Gallimard, 1983, pp. 7-42. 52 dernier a perdu les bienfaits que lui a prodigués la nature ; et son innocence et son âme sont altérées par d’inconséquentes conventions sociales. À ce propos, Joël Dubosclrad stipule que dans son premier Discours : Rousseau Soutient un paradoxe provocateur : il démontre que les sciences et les arts, synonyme de culture et de civilisation ont corrompu la moralité originelle. Les peuples fidèles à l’ignorance primitive ont conservé la vertu et le bonheur, tandis que les sociétés cultivées les ont perdus119 . Par conséquent, l’auteur de l’Emile ou De l’Education invite ou plutôt exhorte, avec des arguments solides, tous ceux qui sont en proie au progrès, aux conventions sociales et à l’évolution des mentalités, à retrouver la vertu primitive de l’homme par un retour empirique et spirituel des sens et des goûts. Cela ne pourra se faire par ailleurs, qu’avec une inclination inclusive de chaque sujet à la nature ou tout au plus aux bienfaits que nous a procuré celle-ci. Au fait, ce sont véritablement, les vicissitudes de la vie sociale et politique de son époque en France qui ont fait de lui un combattant intellectuel sans commune mesure, sa personne et sa dignité spirituelle ne pouvaient souffrir des iniquités pareilles à celles de la société française du 18éme siècle. Partant de l’indifférence de Rousseau à sa détermination à vouloir mettre de l’ordre dans la société, Jean Jaurès explique ce processus ainsi : À vouloir réformer le monde, refaire les gouvernements, bouleverser la société, il aurait fallu y penser sans cesse, et il les fuyait. – Ah ! Certes, il y avait pourtant dans une pareille existence, continuée cinquante ans en plein XVIIIe siècle, un germe, un commencement de réforme politique et sociale. Il était impossible à Rousseau vivant en communion de cœur avec la nature et Dieu, la liberté et la joie, de ne pas protester contre l’existence misérable, factice et servile que les gouvernements faisaient aux hommes, privés de tout par la folie des uns et la frivolité des autres, et succombant sous l’excès d’un travail malsain. Il était impossible à Jean-Jacques, lorsqu’il observait les gouvernements et les sociétés avec son esprit de vie libre, de ne pas constater qu’ils ne reposaient plus sur leurs bases120 . 119 Joël Dubosclard, Les Confessions (1765-1770), Paris, Hatier, 1983, p. 1. 120 Ana Maria Triano, Utopie, une histoire, Paris, éd. Hazan, 1992, p. 8. 53 Cet esprit subversif du genevois n’est pas que spéculatif, il est aussi réformateur et pratique ; Rousseau propose à ses concitoyens de se retourner vers la vie primitive de l’homme. Le progrès humain est à l’origine de tous les maux de la société et la seule issue favorable est selon Rousseau, un ressaisissement du passé de l’humanité et partant, faire recours à une réadaptation de certaines valeurs humaines et humanitaires que la nature nous a prodigué. En effet, cette apologie de la vie primitive constitue la pierre angulaire des études théoriques de Rousseau sur la dénaturation de l’homme ou plus tôt, sur la corruption des mœurs dans la société. D’ailleurs, dans son traité sur l’éducation, il rappelle que : « Tout est bien sortant des mains de l’auteur des choses ; tout dégénère entre les mains de l’homme121 ». Ce goût de la nature et de l’origine des choses n’est pas que pur théories philosophiques chez Rousseau, c’est aussi et surtout un épisode décisif de sa vie à Paris durant laquelle il avait senti en son for intérieur, une incorporation de certaines valeurs délétères à l’âme saine comme le souligne Michel Duchet, c’est : « sa valeur existentielle de l’expérience extérieure122 ». Au demeurant, ce processus par lequel l’âme se corrompt à mesure qu’elle s’associe à la vie en société passe en filigrane dans quasiment toutes ses œuvres anthropologiques comme dans le Discours sur les sciences et les Arts, le Discours sur le fondement et l’origine de l’inégalité parmi les hommes et La Nouvelle Héloïse qui est, quoi que l’on puisse dire d’après Gérard Namer, plus sociologique qu’anthropologique123 . 1. 1. L’état de nature contre l’état social : J’avais d’abord résolu de lui accorder tout ce qu'il demanderait, persuadée que les premiers mouvements de la nature sont bons et salutaires. Mais je n’ai pas tardé de connaître qu’en se faisant un droit d’être obéis, les enfants sortaient de l’état de nature presque en naissant, et contractaient nos vices par notre exemple, les leurs par notre indiscrétion124 . Partant d’une expérience sociologique et phénoménologique, l’auteur des Rêveries du promeneur solitaire aborde la question de la méchanceté et du péché au cœur des préoccupations communes des intellectuels du siècle des Lumières. Selon Rousseau, 121Jean Jacques Rousseau, l’Emile ou De l’Education, op., cit., p. 245. 122Michel Duchet, Le colloque « Rousseau » au collège de France, Annales, 1963, n°18- t.1, p. 149-155. 123 Gérard Namer, « Rousseau : de la science de l’homme à la sociologie », L’homme et la société, 1977, N° 45- 46, pp. 231-240. 124 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 5éme partie/ L. III, op., cit. p. 635. 54 l’homme est par nature bon et ne saurait faire du mal en restant dans cet état primitif. Donc, la source de la dépravation des mœurs, de la corruption de l’âme et de l’injustice sociale provient de la civilisation, du progrès et de l’évolution des mentalités. En effet, pour être vertueux, il faut faire preuve de simplicité, de modestie et de bonté naturelle alors que la vie sociale (dans les grandes villes) n’est affectée que par l’artificialité, la mégalomanie et la boulimie du pouvoir. À cet égard, Rousseau souligne l’importance de l’instinct dans l’accomplissement de bons actes comme aurait voulu la loi de la nature, au détriment de la réflexion foncièrement cartésienne dans la recherche sempiternelle du bien menant à la vertu. Par ces mots, il s’interroge : O vertus ! Science sublime des âmes simples, faut-il donc tant de peines et d'appareils pour te connaître ? Tes principes ne sont-ils pas gravés dans tous les cœurs ? Et ne suffit-il pas pour apprendre tes lois de rentrer en soi-même et d'écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions125 ? Par ailleurs, beaucoup d’autres intellectuels approuvent l’importance de repenser l’origine de l’humanité dans toutes ses excitations naissantes et son évolution psychologique afin de retrouver la béatitude originelle de l’homme. C’est justement cette évolution ou plutôt ce processus d’évolution de l’homme qui fera l’objet d’un ressaisissement par le biais des études scientifiques et phénoménologiques de l’être humain qui, naturellement n’avait aucune impulsion pour le mal. C’est effectivement dans cette lancée que Michel Duchet s’est battue pour que l’on reconnaisse le statut « historiques » des sociétés primitives, afin de mieux les connaitre et les approuver. Selon lui : « Reconnaître l’historicité du monde dit sauvage, l’est pour nous la seule façon de la reconnaître pleinement comme nôtre, même s’il faut pour cela repenser ce qu’on appelle Histoire126 ». En vertu des richesses de cette histoire de la vie primitive de l’homme, Rousseau élabore avec une acuité d’esprit incomparable le processus par lequel l’homme est sorti de son statut naturel pour devenir, c’est le moins qu’on puisse dire, artificiel sinon aliéné. En tout état de cause, des objections parfois sarcastiques ont abondées contre ses conjectures. La plus connue est celle de Voltaire127 qui est du reste burlesque puisqu’il met en garde le genevois de ne point condescendre à marcher à quatre pattes. Mais d’aucuns ont su par analyse profonde des dires de l’auteur des Confessions, extirpé l’idée substantielle avancée. Évoquant la pertinence du patrimoine idéologique et 125 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, op., cit., p. 51. 126 Michel Duchet, « Les sociétés dites « sans histoires » devant l’histoire », in Pour Léon Poliakov. Racisme, Mythes et Sciences, Bruxelles, Ed. Complexe, 1981, p. 586. 127 Voir Voltaire, Lettre publiée par David Hume, Londres, 1966. 55 philosophique de Rousseau, Dubosclard récuse les propos de Voltaire128 vis-à-vis de l’état de nature rousseauiste en reconnaissant par là même son apport incontestable à la recherche sociologique et anthropologique de certains penseurs contemporains. Par ces mots, il laisse entendre que : Voltaire en tout cas ne voulut y lire, à tort, qu’une apologie du retour à l’état sauvage(…) Mais, au siècle suivant, le philosophe Hegel puis Marx tireront du texte de Rousseau le concept fondamental d’aliénation de l’homme par la société : ils saluerons en Rousseau le grand précurseur qui a montrer comment l’homme a été victime des conquêtes même de l’humanité129 . Dans La Nouvelle Héloïse justement, les préjugés sociaux et les croyances purement superstitieuses ont été à l’origine d’une mésaventure amoureuse entre Julie et Saint-Preux et, pire encore, ont causé la destruction de la famille d’Etange. Comprenons que la mort de Mme d’Etange est survenue après qu’elle eut découvert les différentes correspondances que sa fille et son précepteur se transmettaient en catimini ; et cette mort, au-delà des raisons liées à une tumeur aqueuse de la poitrine130 (une hydropisie de poitrine) qui n’est que l’expression de sa perplexité devant un mari en proie aux conventions sociales strictes, est liée à cette influence sociale dont M. d’ Etange fait preuve à plus d’un titre. D’ailleurs, Rousseau transmet ce message à travers Claire qui passe en revue certains émouvants épisodes des derniers moments de Mme d’Etange à Saint-Preux : S’il faut attribuer sa perte au chagrin, ce chagrin vient de plus loin, et c’est à son époux seul qu’il peut s’en prendre. Longtemps inconstant et volage, il prodigua les feux de sa jeunesse à mille objets moins dignes de plaire que sa vertueuse compagne et quand l’âge le lui eut ramené, il conserve près d’elle cette rudesse inflexible dont les mains infidèles ont accoutumés d’aggraver leurs torts131 . Donc, l’attitude contre-nature et amoral du vieux d’Etange qui fait toujours fi des lois de la nature est irréversiblement la raison de la mort de sa femme, des infortunes sempiternelles de 128 Voltaire considère cette théorie de Rousseau comme un retour de l’homme à l’état sauvage. 129 Joël Dubosclard, Les Confessions (1765-1770), op., cit., p. 8. 130 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 3éme partie/ L. VII, op., cit., p. 383. 131 Ibid., 3éme partie/ L. VII, op., cit., p. 384. 56 sa fille et de la vie vagabonde et désespéré du roturier qui, fut-il autre qu’un membre de la famille, a toujours eu un sentiment de commisération à l’égard de celle-ci. D’ailleurs, il manifeste avec regret cette mort qu’il pense être le résultat du crime qu’il a commis avec Julie, et tiens à ce propos un discours à la fois grave et blasphématoire du reste: Déchirez-moi le cœur si je suis coupable, si la douleur de nos fautes l’a fait descendre au tombeau, nous sommes deux monstres indignes de vivre ; c’est un crime de songer à des lieux si funestes, c’en est un de voir le jour. Non j’ose le croire, un feu si pur n’a point produit de si noirs effets. L’amour nous inspire des sentiments trop nobles pour en tirer les forfaits des âmes dénaturées. Le ciel, le ciel serait-il injuste, et celle qui sut immoler son bonheur aux auteurs de ses jours méritait-elle de leur coûter la vie132 . Un homme imbu de sentiment naturel et de volonté d’égalité entre les hommes aurait pu éviter de telles erreurs irréparables. Parce qu’effectivement, à chaque fois que l’homme s’évertue de régler son comportement, ses actions et sa vie conformément à ceux de l’homme originel, il peut se féliciter de préserver ses vertus selon le Genevois. À cet égard, Rousseau pointe du doigt l’opinion au grand dam de l’instinct qui exprime la volonté du cœur et partant, celle de la nature. Donc, comme à l’accoutumé, faisant fi de toute réflexion purement cartésienne, le solitaire de Genève élabore une réelle dichotomie entre l’homme naturel et celui de la société sinon de l’opinion quant il précise que : « L’homme sensuel est l’homme de la nature ; l’homme réfléchi est celui de l’opinion ; c’est celui-ci qui est dangereux. L’autre ne peut jamais l’être quand même il tomberait dans l’excès133 ». À ce niveau, il est judicieux de stipuler que l’état de nature dont le genevois nous parle n’est pas la période la plus primitive du développement humain. Le meilleur état, ce n’est pas suivant ses explications, le pur état de nature, il nous parle de la société naissante. C’est lorsque les hommes ont déjà inventé le langage, fondé la famille, assurer la stabilité du foyer, lorsque l’agriculture, les travaux de la terre ont nécessité la construction de la propriété individuelle, lorsque que les hommes prouveront finalement leur humanité. Au demeurant, c’est ce qui fait dire à Teresa Souza Fernandes que : « Jean-Jacques Rousseau est communément considéré comme idéologue de la modernité et comme précurseur des sciences sociales134 ». Avec justesse, sa plume contourne certaines pensées prématurément et sottement admises à tort, 132 Ibid., 3éme partie/ L. VI, p. 380. 133 Jean-Jacques Rousseau, Rousseau Juge de Jean-Jacques, 1ér dialogue, op., cit., pp. 688-689. 134 Teresa Souza Fernandes, Pouvoir féminin et ordre social : les paradoxes de l’inégalité dans l’œuvre de J.-J. Rousseau, in L’homme et la société, N° 103, 1992, pp. 131-144. 57 d’autant plus qu’elles atrophient et le genre humain et le vrai sens de la vie. Du coup, Rousseau propose avec subtilité une naturalisation de l’éducation pour amener tous les membres de la société à comprendre la vraie valeur de l’état primitif des facultés humaines, et à s’y accommoder convenablement. Au fait, il s’agit d’éduquer un être destiné à vivre en société. Par ce constat, Michel Grogiez atteste sans ambiguïté que : Rousseau, contrairement, à tant d’autres, n’utilise pas le paradoxe pour faire passer une idée de force. Il est rare qu’il ne prépare pas le paradoxe par des arguments et des démonstrations afin de le rendre tout à fait plausible, voire indiscutable, et quoi que l’on ait pu dire de son éloquence captieuse et entrainante, il ne procède pas en « illusionniste ». Le critère d’efficacité ne permet pas donc à lui seul de justifier la récurrence de cette figure Notre hypothèse est que la tentation du paradoxe chez l’auteur de l’Emile découle du caractère lui-meme paradoxal de son programme qui est naturaliser l’éducation afin d’éduquer selon la nature un être destiné à vivre en société135 . Donc, il faut comprendre que Rousseau ne prétend pas, comme certains l’ont dit, que l’homme n’est pas fait pour vivre en société. La société est naturelle à l’homme, explique-il, comme la vieillesse à l’individu. Les facultés humaines ne pouvaient se développer qu’à la faveur d’un commerce, d’une mise en relation des hommes, d’une possibilité de se comparer. Mais le progrès des hommes est aussi la source de tous les malheurs à cause de l’usage qu’ils font de leurs qualités naturelles. Le philosophe célèbre d’ailleurs les avantages de l’état civil qui, « d’un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme136», mais il montre en même temps la facilité avec laquelle cet état se corrompt, rejetant l’homme dans une condition plus misérable que celle qu’il avait auparavant. Par conséquent, le Genevois s’évertue de savoir comment l’avilissement des qualités naturelles de l’homme a produit les vices qu’on tient à tort pour des éléments originels. La malveillance résulte de la société par transformation de l’essence intime de l’homme : l’amour de soi qui, par l’instinct de conservation s’est mué en amour-propre, désir de reconnaissance sur fond de réalité sur des choses mondaines, et même le goût de l’imitation, qui est naturellement bon, s’est dégradé. Il s’est dégénéré en vice dans la société parce que l’homme n’imite plus pour s’améliorer mais par désir de se transporter hors de soi. Fort de ce constat, Rousseau exhorte aux gens de faire 135 Michel Grogiez, Rousseau et le paradoxe, Paris, Genève, 1997, p. 378. 136 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du droit politique, Amsterdam, Gérard Mairet, 1762, Chapitre VIII : De l’état civil, p. 15. 58 preuve d’humanité afin de vivre en conformité avec la nature qui, quoi que l’on puisse dire, est la plus enclin au bonheur de l’homme. Par ces mots, il précise que : Si vous voulez donc être homme en effet, apprenez à redescendre. L’humanité coule comme une eau pure et salutaire, et va fertiliser les lieux bas ; elle cherche toujours le niveau ; elle laisse à sec ces roches qui menacent la campagne, et ne donne qu’une ombre nuisible pour écraser les voisins137 . Pour Rousseau, la nature ou plutôt l’inclination que l’homme peut avoir envers celle-ci, ne fait que resurgir ses facultés primitives. C’est peut-être même ce que le père de la philosophie qui n’est autre que le célèbre Socrate appelle : la « réminiscence138 », immatériel chez ce dernier mais matériel chez le Genevois d’un point de vue apodictiquement sémantique, puisqu’il est, cette fois-ci, un fait éblouissant de résurgence de la nature substantielle de ses organes et de ses habitudes. En tout état de cause, dans La Nouvelle Héloïse, Rousseau dresse avec enthousiasme une image pittoresque du comportement ou tout au plus de la vie pour ainsi dire, de l’homme à l’état de nature. La représentation symbolique de M. de Wolmar, tout de même athée, mais inconditionnellement naturel, en est l’illustration parfaite ; autrement dit il n’a jamais été en contact direct avec le monde civilisé, celui par lequel l’homme perd sa béatitude originelle. Cela dit, M. de Wolmar est l’incarnation même des qualités de l’homme altruiste, politique et économe de son entourage. Cet aspect revalorisant de l’homme à l’état de nature est au-delà de la morale théorique et politique, il est aussi promoteur d’une réhabilitation sociale, c’est-à-dire qu’il est une sorte de leçon inaugurale de restauration des valeurs et de l’ordre social. C’est sans doute ce qui poussera Michel Launay de préciser que : 137 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 4éme partie/ L. XI, op., cit., p. 364. La théorie de la réminiscence est exprimée par Platon dans le Ménon (ouvrage sur la vertu). Cette théorie affirme que notre connaissance de la vérité est le souvenir d’un état ancien où, avant d’être incarnée dans un corps, notre âme vivait au contact immédiat des pures idées dans le monde intelligible. 138 59 Si La Nouvelle Héloïse a eu un succès incomparablement plus grand que les Discours ou le Contrat social, c’est précisément parce qu’on y trouvait autres choses que des réflexions politiques. Mais il est impossible d’envisager La Nouvelle Héloïse comme un roman pur et simple. Les premiers émois du cœur apaisé, le citoyen se ressaisit, et selon une attitude qui lui est familière, il entend tirer du mal même un bien, et du poison un remède139 . Au fait, dans La Nouvelle Héloïse, nous retrouvons, à bien des égard, le portrait parfait de l’homme à l’état de nature, le « bon sauvage » dont la vie tout entière est administrée par la voix de la nature. C’est d’ailleurs ce qui pousse Rousseau de mettre au point un diptyque à la fois conséquente et très édifiante pour faire ressortier les revers ignominieux, latents ou tacites, de l’homme à l’état social mais aussi et surtout, sous le sceau de l’incitation bien sûr, conduire ses concitoyens qui vont le lire à admirer l’état primitif de nos ancêtres. C’est pourquoi il évoque, sous la plume de l’être le plus naturel Julie, la gravité de l’artificialité de ces conduites malsaines et conventionnelles de l’homme social. À la lueur de ce fait, Julie met en garde Saint-Preux qui, sans circonspection effective, est mené en bateau dans ces lieux dépravés de la société. Enivré, il se réveille dans les bras des certaines maitresses. Ces propos en attestent : (…) Si cette erreur ne vous mène pas chez des prostituées, j’ai bien peur qu’elle ne continue à vous égarer vous-même. Ah ! Si vous voulez être méprisable, soyez-le au moins sans prétexte, et n’ajouter point le mensonge à la crapule. Tous ces prétendus besoins n’ont point leur source dans la nature, mais dans la volontaire dépravation des sens. Les illusions même de l’amour se purifient dans un cœur chaste, et ne corrompent jamais qu’un cœur déjà corrompu : au contraire la pureté se soutient par elle-même ; les désirs toujours réprimés s’accoutume à ne plus renaitre, et les tentations ne se multiplient que par l’habitude d’y succomber140 . Après analyse profonde, on constate que Saint-Preux a succombé à cette mascarade festive parce qu’il fait trop usage de sa raison que son instinct, lequel, selon le Genevois, est la faculté naturelle la plus fiable dans toutes les circonstances. Par le biais de l’instinct, l’homme parvient à esquiver sans complaisance le souffle satanique du mal. Fort de ce 139 Jean-Jacques Rousseau, Introduction à Julie ou La Nouvelle Héloïse, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, p. XIV. 140 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 2éme partie/L. XXVII, op., cit., p. 361. 60 constat, parlant de la magnificence de l’homme à l’état de nature chez l’auteur du Devin du village, Jean Terasse reconnaît l’éminence de de celui-ci ou tout au plus de toutes les facultés naturelles de l’être humain à plus d’un titre : Le sauvage ni le paysan ne raisonnent, ils n’en sont point capables, et surtout n’en ont pas le loisir. Ils ne s’interrogent point sur le sens des devoirs, car ils mettent en pratique, ni sur les fondements de leurs actes car ils agissent. Ils sentent d’instinct ce que le philosophe découvre (s’il y parvient) par déduction141 . Qui plus est, il est très judicieux de rappeler que Rousseau, à travers ses être conçus selon son cœur, reconstitue l’histoire humaine pour identifier le moment fatal, celui où les hommes abandonnent l’état de nature et découvre la vie en société. Subséquemment, il nous dresse le portrait de l’homme originel (le bon sauvage) qui vit en symbiose avec la nature, et qui va être pris par la spirale infernale de l’agriculture et de la métallurgie. Agissant en sociologue et anthropologue, pour Rousseau, ces étapes décisives dans le développement de l’homme vont attiser les passions nocives et la violence, de même que le droit de propriété d’où découlent ces inégalités. Donc l’homme moderne est victime du perfectionnement des facultés et des progrès de la vie en société. Très explicitement du reste, le Genevois fait dire à Saint-Preux comment la société, synonyme d’avilissement, peut métamorphoser négativement l’être humain à l’état de nature : Or, de mille sujets qui sortent du village, il n’y en a pas dix qui n’aillent se perdre à la ville ou qui n’en portent les vices plus loin dont ils les ont appris. Ceux qui réussissent et font fortune la font presque tous par les voies déshonnêtes qui y mènent. Les malheureux qu’elle n’a point favorisés ne reprennent plus leur ancien état, et se font mendiants ou voleurs plutôt que de redevenir paysan142 . Au demeurant, cette conception rousseauiste de la société révèle avec véhémence la pertinence analytique de ce qu’il appelle l’ « âge d’or primitif ». Cette pensée ou tout au moins, cette dynamique philosophique de Rousseau s’inscrit en contradiction au bouillonnement intellectuel et matériel dans la société française au Grand siècle de Louis XV. Au regard de cette idéologie subversive à bien des égards « Rousseau évoque avec la 141 Jean Terasse, Jean-Jacques Rousseau et la quête de l’âge d’or, Bruxelles, Palais des Académies, 1970, p. 196. 142 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 5éme partie/ L. II, op., cit., p. 6. 61 certitude enthousiaste d’un visionnaire les séductions d’un âge d’or qu’a pu connaître l’humanité dès ses origines les plus lointains143 ». Naturellement, tout point de vue est réfuté par d’aucun, à tort ou à raison. Voltaire récuse cette de pensée de Rousseau avec ardeur et pousse ses arguments à la limite de la contradiction sophistique. Selon lui, la vertu est vue sous l’angle de la réflexion cartésienne, des modes vies conventionnels pour ne pas dire sous l’angle de la cavillation. À Rousseau, il s’adresse par un ton pas moins alambiqué que sarcastique : La vertu, voyez-vous, suppose des lumières, des réflexions, de la philosophie, quoique selon vous tout homme qui réfléchit soit un animal dépravé ; d’où il s’en suivait en bonne logique que la vertu est impossible. Un ignorant, un sot complet, n’est pas susceptible de vertu qu’un cheval ou qu’un singe. Vous n’avez jamais certes jamais vu cheval vertueux, ni singe vertueux144 . A posteriori on peut stipuler que dans toutes les œuvres du Genevois, la nature ou encore l’étoffe de l’état primitif sont au centre de ses idéologies, donc le fait qu’il attribue une telle considération à cette thèse n’est pas fortuite, loin s’en faut ; il confirme avec vigueur cette pensée dans la vie admirablement enviable de ses êtres livresques dans La Nouvelle Héloïse, notamment dans son microcosme campagnard, loin des vues et des mœurs sociales. Leurs caractères traduisent la pureté des mœurs « du bon sauvage », et Julie est l’adepte même du naturel quand elle fait savoir les effets de ses impulsions instinctives : « Je me suis souvent trouvée en faute pour mes raisonnements, jamais sur les mouvements secrets qui me les inspirent, et cela fait que j’ai plus confiance à mon instinct qu’à ma raison145 . » L’instinct est naturel selon Rousseau mais non la réflexion puisqu’elle prend son essor avec la civilisation. Seul le naturel peut pousser au bien et tout ce qui relève des conventions sociales, c’est-à-dire tous ce que l’homme substitue aux normes de la nature constituent un mal, immédiat ou futur, pour la régénérescence du genre humain. Par ailleurs, Julie l’a très bien compris lorsqu’elle certifie qu’ « on ne sort point de son naturel impunément146 ». C’est pourquoi Rousseau établit une nette et adéquate différence entre l’homme naturel qui vit en conformité avec les lois immanentes de la nature et l’homme civilisé qui, au contraire, est sous une influence 143 Xavier Darcos et Bernard Tartayre, Le 18ème siècle en littérature, Paris, Hachette, collection « Perspectives et confrontations », 1987, p. 237. 144 Voltaire, Lettre publiée par David Hume, Londres, 1966. 145 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 2 éme partie/ L. XVIII, op., cit., p. 183. 146 Ibid., 3éme partie/ L. XVII, p. 402. 62 saugrenue de la turpitude sociale. Ce dernier a subi une intoxication psychique et parfois morphologique de la société et, du coup il se recroqueville dans une aliénation délirante en accusant la nature aux vus et à l’épreuve des infortunes qui s’abattent autour de lui, à tort évidemment. Ainsi peut-on dire que l’homme social est inconscient de sa condition d’aliénée ou plutôt ignore-t-il l’origine véritable de ses malheurs. Ce qui est sûr, c’est que le genevois prétend que l’homme social est à l’origine de ses propres mésaventures et, pour qu’il s’en détache il faut, d’une manière à une autre, qu’il se soumet aux règles de la nature, qui sont somme toute, immanentes de l’existence humaine. Qui plus est, il l’exhorte à s’investir dans la recherche du temps de l’âge d’or primitif perdu et c’est à ce niveau justement que les prémisses du bonheur primitif se révèlent parfaitement émouvants même si par ailleurs l’objectif premier du genevois est « moins dans l’espoir de résoudre la question que dans l’intention de l’éclaircir et de la réduire à son véritable état147 ». En ces termes, Rousseau confirme cette thèse suivant laquelle l’homme est à l’origine de ses malheurs : (…) Tout le reste du jour, enfoncé dans la forêt, j’y cherchais, j’y trouvais l’image des premiers temps, dont je traçais fièrement l’histoire ; je faisais main basse sur les petits mensonges des hommes. J’osais dévoiler à nu leur nature, suivre le progrès du temps et des choses qui l’ont défigurée, et comparant l’homme de l’homme avec l’homme naturel, leur montrer dans son perfectionnement prétendu la véritable source de ses misères. Mon âme, exaltée par ces contemplations sublimes, s’élevait auprès de la Divinité, et voyant de là mes semblables suivre, dans l’aveugle route de leur préjugés, celle de leurs erreurs, de leurs malheurs, de leurs crimes, je leur criais d’une faible voix qu’ils ne pouvaient entendre : Insensés qui vous plaignez sans cesse de la nature, apprenez que tous vos maux vous viennent de vous148 . Au demeurant, dans La Nouvelle Héloïse, le philosophe genevois transcrit les différentes caractéristiques que l’on peut observer, tant dans le comportement que dans les propos chez l’homme à l’état de nature. Pour Rousseau, la vigueur physique, la solitude, la bonté naturelle et la modeste parure constituent la pierre de touche de l’homme naturel. Qui plus est, quoique supérieur aux animaux, par sa liberté et sa perfectibilité, l’homme naturel ne peut faire de progrès, source de dépravation des mœurs, mais sauvegarde tout de même sa bonté naturelle et reste toujours heureux. Cet effet de félicité intérieur est le fruit de « l’instinct de 147 Gaston Meyer, Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, Paris, Bordas, 1985, p. 15. 148 Ibid., p. 9. 63 conservation » dont Rousseau valorise sinon ressuscite, à bien des égards, les merveilles naturelles qui en proviennent, et auxquelles l’homme social mésestime. Pensant substituer certaines facultés naturelles immanentes du reste au bon agir de l’homme, par des œuvres humaines, conventionnelles pour ainsi dire, l’homme civilisé ignore, selon le Genevois, la délicatesse immuable des largesses de la nature. Sur ce, Rousseau, à travers Milord Edouard Bomston qui amadoue le courroux de son ami en désespoir, loue encore une fois les vertus irréprochables de la nature : Considéré un moment le progrès naturel des maux de l’âme directement opposé aux progrès des maux du corps, comme les substances sont opposées par leur nature. Ceux-ci s’invétèrent, s’empirent en vieillissant, et détruisent enfin cette machine mortelle. Les autres, au contraire, altérations externes et passagères d’un être immortel et simple, s’effacent insensiblement et laissent dans sa forme originelle que rien ne saurait changer. La tristesse, l’ennui, les regrets, le désespoir, sont des douleurs peu durables qui ne s’enracinent jamais dans l’âme ; et l’expérience demeure toujours ce sentiment d’amertume qui nous fait regarder nos peines comme éternelles149 . Ramené à la raison par ces propos aussi édifiants qu’authentiques, Saint-Preux fut victime d’un délaissement plus ou moins remarquable, c’est le moins qu’on puisse dire, à la faculté instinctive au préjudice de la réflexion qui l’aurait dû conduire irrémédiablement au suicide. Or, ce qui l’y mène, la cause de son infortune est le propre même des préjugés, donc des conventions sociales. Cela dit, Rousseau propose un remède aux maux causés par ces travers sociaux qui s’incrustèrent dans le quotidien de la société française au 18éme siècle. Qui plus est, il propose un idéal de société dans laquelle, l’inégalité sociale se réduirait ou tout au plus s’effacerait, l’homme et la femme aussi bien que l’enfant se respecteraient mutuellement, où la bonté naturelle se trouve être l’incarnation même des caractères et où l’image de la famille renvoie à celle d’un prototype d’état. 2. L’utopie de la communauté vertueuse : 149 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Heloise, 3éme partie/L. XXII, op., cit., p. 449. 64 La pensée accomplit son acte philosophique le plus haut lorsqu’elle s’élève jusqu’à l’idéalité pure afin de penser, en une démarche réflexive, ce qu’aurait dû ou pu être l’État conforme à la nature originaire de l’homme en deçà de toutes les perversions par lesquelles elle s’est laissé assaillir150 . Longtemps considéré par d’aucuns comme une fable idyllique151, l’utopie au 18éme siècle renvoie à une réflexion théorique accrue tendant à remettre en cause l’ordre établi. En fait, pour mieux saisir le sens profond de la terminologie avant la lettre et avant son cadre générique, on interroge l’histoire à travers l’œuvre de l’humaniste de la Renaissance, Thomas More. Londonien en mission diplomatique au Pays-Bas, il écrit tout au début du 16éme siècle un ouvrage intitulé Utopia (1516) et qui a pour sous-titre, « Le traité de la meilleur forme de gouvernement ». Et selon lui, le mot « utopie » dont il est le créateur, signifie littéralement le non-lieu, autrement dit, lieu qui n’est dans aucun lieu. De là More suggère que l’homme, en inventant des « mondes utopiques », exprime l’impossibilité de se situer dans un espace donné qui serait le lieu privilégié du rêve, de l’abondance, de la perfection, sinon d’un inaccessible paradis. C’est pourquoi, il met en scène dans cet ouvrage un explorateur portugais qui, lors d’un voyage en Amérique, fait la découverte d’une île : l’île d’Utopie. Par ailleurs, nous jugeons judicieux de préciser que More s’est inspiré de La République de Platon dans l’Antiquité grecque. Ouvrage dans lequel, le disciple de Socrate décrit le fonctionnement d’une cité idéalement organisée. En tout état de cause, l’imagination créatrice de More est moins artistique que subversive, révolutionnaire pourrait-on dire. Au fait, il remettait en cause le système « d’iniquité sociale » en Angleterre qui avait comme principe fondamental, l’appropriation indue et inique des terres par les nobles au préjudice des autres citoyens. À en croire Ana Maria Triano, Thomas More décrit : Son île bienheureuse Utopia, alors que l’occident est à l’aube de son expansion, après la découverte du Nouveau Monde. Il semble chercher dans la tolérance religieuse qui règne parmi les utopiens un apaisement à la déchirure spirituelle de l’Occident en ces temps troublés où les chrétiens s’entre-déchirent. More dénonce également le goût pour la guerre en critiquant l’armée de métier à travers la mise en scène des Achorions qui renonce la terre qu’il avait conquis plutôt 150 Simone Goyard-Fabre, Politique et philosophie dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, Paris, P.U.F, coll. Thémis Philosophie, 2001, p. 31. 151 Hartig Irmgard, Soboul Albert, « Notes pour une histoire de l'utopie en France au XVIIIéme siècle », in Annales historiques de la Révolution française, n° 224, 1976, pp. 161-179. 65 que subir des maux plus grands que les avantages qu’il aurait pu y gagner152 . Raison pour laquelle, dans son œuvre, les habitants de cette île, les utopiens donc, selon Raphaël l’explorateur, ont formé une société idéale. Une île qui reflète l’image d’une société agraire incommensurable dans la gestion que dans le partage ; et mieux encore, une île où la misère est bannie. Fort de ce constat, Jean Fabre, parlant de l’utopie chez Rousseau précise qu’en : S’inscrivant dans l’histoire, l’utopie naît de la mise en question de l’état présent des choses, elle part de la critique de la société actuelle. De là, elle projette dans l’avenir la cité idéale, mais sans se soucier des moyens d’y parvenir. Là n’est pas son propos153 . D’ailleurs, si l’on se fie aux propos de Fabre et d’Ernst Bloch, l’utopie naît du « principe Espoir », du « rêve en avant » 154 des hommes qui aspirent à un monde meilleur, à un avenir plus supportable que l’existence présente. Au demeurant, cette aspiration à un monde meilleur se trouve être le caractère invariant de la pensée utopique et Hartig et Soboul l’ont bien compris s’ils mentionnent que : L’utopie participe ainsi à la conscience anticipatrice, non du regret d’un monde à jamais perdu. Elle aiguise la conscience, travaille à la disparition de ce qui existe encore. (…) L’utopie est dans l’histoire, quand bien même elle entend la devancer. Phénomène historique, l’utopie, paradoxalement, fut toujours d’un temps et d’un lieu155 . C’est dans cette même logique que s’inscrit la communauté utopique de Clarens dans La Nouvelle Héloïse. Elle est à la fois une société idéale où l’individu vit en harmonie avec la nature, où la raison perfectible règne au-dessus de l’intolérance, des préjugés, des différences entre les hommes, mais également elle est une idéalisation anticipatrice de l’ordre bourgeois 152 Ana Maria Triano, Utopie, une histoire, op., cit., p. 104. 153 Jean Fabre, « Réalité et Utopie dans la pensée politique de Rousseau » in Annales Jean-Jacques Rousseau, Genève, t. XXXV, 1959, pp, 181-182. 154 Ibidem 155 Hartig Irmgard, Soboul Albert, « Notes pour une histoire de l'utopie en France au XVIIIéme siècle », op., cit., pp. 161-179. 66 qu’allait instaurer la Révolution française de 1789. De facto, la pensée de Rousseau repose sur une idée de la dignité humaine, sur des sentiments éthiques mais aussi et surtout sur une idée de la justice menant à l’épanouissement de toutes et de tous dans la vie. Et pour y parvenir, il fallait, pour le Genevois ainsi que pour tant d’autres écrivains des Lumières, retracer des voies probantes qui serviraient de tremplin à la société notamment aux gouvernants qui ne respectent quasiment jamais ceux qu’ils gouvernent. La raison ? Et qu’est-ce qu’il faut pour que cela change ? Peut-on espérer avoir de meilleurs administrateurs politiques dont le seul but serait de promouvoir l’égalité des chances et d’instaurer la justice, non pas celle des lois institutionnelles ou celles des conventions sociales traditionnelles, mais celle de la nature, celle de la Providence ? Telles sont les interrogations auxquelles l’utopie rousseauiste se permet de répondre puisqu’au 18éme siècle remarquablement, le leitmotiv des discussions était : « On dit qu’à présent quelque chose va être fait par de grands personnages pour nous, pauvre gens, mais elle ne savait pas qui, ni comment ; mais que Dieu nous envoie quelque chose de meilleur, car les tailles et les droits nous écrasent156 ». Cela dit, le peuple français, ou tout au plus les gouvernés, aspirèrent en un moment donné au changement, à une nouvelle vie qui leur permettent de mieux vivre pleinement afin de retrouver leur humanité propre. Jean-Jacques Rousseau a compris plus que quiconque que la phase de la transition, du changement des mentalités et la réhabilitation des valeurs politico-morales doivent être mis au point dans l’intérêt collectif. Après avoir vécu et constaté les affres de la vie politico-sociales et parfois même les impertinences de certains actes de la société civile, Rousseau élabore un projet de restructuration aussi bien dans le cadre politique qu’économique. Sous cet angle, il met en place un idéale de société dans laquelle la simplicité, la modestie et le partage sont à l’honneur. Par ailleurs, il fait savoir dans les Confessions les raisons d’un tel dessein, autrement dit le pourquoi de la représentation fictive d’une idéologie réformatrice mais enchanteresse : « L’impossibilité d’atteindre aux êtres réels me jeta dans le pays des chimères, et ne voyant rien d’existant qui fut digne de mon délire, je le nourris dans un monde idéal que mon imagination créatrice eut bientôt peuplé d’êtres selon mon cœur157 ». Dans La Nouvelle Héloïse justement, le Genevois met en scène une microsociété où tous les Hommes se servent dans le respect et la convivialité, où la relation entre subordonné et chef est quasiment indistinct malgré le caractère naturel de cette loi de la nature, mais où les droits de l’enfant se font le plus entendre : c’est la société de Clarens. Pourtant, il est 156 Artur Young, Voyage en France en 1787, 1788 et 1789, traduction de H. Sée, Paris, Alcan, 1930, p. 329. 157 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Paris, Candide et Cyrano, 2012, pp. 587-589. 67 judicieux de rappeler que d’aucuns, parmi les contemporains de l’auteur du Contrat social retracent certains traits du philosophe genevois qui, du coup, révèle son penchant pour la simplicité et la modestie. À ce propos, nous avons Bernardin de Saint-Pierre qui atteste qu’ « il y avait dans son petit ménage un air de propreté, de paix et de simplicité, qui faisait plaisir… Tout son extérieur était modeste, mais fort propre, comme on le dit de celui de Socrate158 ». Or, chez les Wolmar précisément, la mesure et la simplicité dans la gestion et l’usage des appareils domestiques font bon ménage. Dans cette maison, même les objets les plus banals ont une prise en charge régulière dans le but d’instaurer une commodité de ceux�ci aux instances de ceux qui en font usage. Le luxe et la pompe y sont bannis ; tout se fait sous le sceau de la simplicité, de la modestie et du partage. Ce fait on ne peut plus remarquable dans cette concession des Wolmar est souligné par Saint-Preux : Depuis que les maîtres de cette maison y ont fixé leur demeure, ils ont mis à leur usage tout ce qui ne servait qu’à l’ornement ; ce n’est plus une maison faite pour être vue, mais pour être habitée. Ils ont touché de longues enfilades pour changer des portes mal situées ; ils ont coupés de trop grandes pièces pour avoir des logements mieux distribués ; à des meubles anciens et riches, ils en ont substitué de simples et de commodes. Tout y est agréable et riant, tout y respire l’abondance et la propreté, rien n’y sent la richesse et le luxe : il n’y a pas une chambre où l’on ne se reconnaisse à la campagne, et où l’on ne retrouve toutes les commodités de la ville. Les mêmes changements se font remarquer au-dehors : la basse-cour a été agrandie aux dépens des remises159 . Il est très pertinent par ailleurs de rappeler que ce goût de la simplicité et de la modestie chez Rousseau s’explique d’une part, par le fait que pendant ses années de bohème, il a vu de tout près des vies humbles et modestes, pour ne pas dire qu’il a côtoyé voire vécu la misère. D’autre part, le Genevois a toujours considéré la simplicité et la modestie comme des vertus relevant de la nature primitive de l’homme. Par instinct naturel, l’homme de la nature était attaché à l’amour de soi, ses désirs et ses ambitions étaient limités à la conservation de soi et il se complaisait dans cette situation car ne connaissant d’autres états, Rousseau affirmera que : 158 Bernardin de Saint-Pierre, La vie de Jean-Jacques Rousseau, in Rousseau, Œuvres Complètes, Paris, Seuil, 1967, pp. 24-25. 159 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 4éme partie/ L. X, op., cit., p. 54. 68 L’homme sauvage sujet à peu de passion et se suffisant à lui-meme, n’avait que les sentiments et les lumières propres à cet état, qu’il ne sentait que ses vrais besoins, ne regardait que ce qu’il croyait avoir intérêt de voir, et que son intelligence ne faisait pas plus de progrès que sa vanité160 . Dans cette logique justement, Rousseau subjugue ces lecteurs voire ces concitoyens à la vie valaisanne qui est régularisée sur la règle, l’ordre et la justice. Dans une dynamique de traduction des merveilles de la nature, de la solitude et de l’isolement, l’on constate la pertinence de la nécessité novatrice de cette microsociété qui reflète d’une part le génie réformateur de Rousseau, autrement dit le refus du conformisme social qui implique logiquement une quête d’un nouveau monde ou plutôt la nostalgie du passé, de l’âge d’or primitif. D’autre part, c’est l’image de l’administration domestique, social, économique et politique de la cité qui est remis en cause, la famille Wolmar serait l’état, le pouvoir qui établit une règle de conduite aussi bien pour les domestiques que pour eux-mêmes, et ceux-là seraient le peuple. Dans la lettre dix de la quatrième partie, l’anglais Milord Edouard Bomston nous renseigne que : Cette règle est si connue et si bien établie, qu’on entend jamais un domestique de cette maison parler d’un de ses camarades absent ; car ils savent tous que c’est le moyen de passer pour lâche ou menteur. Lorsqu’un d’entre eux en accuse un autre, c’est ouvertement, franchement, et non seulement en sa présence, mais en celle de tous leurs camarades, afin d’avoir dans les témoins de ses discours des garants de sa bonne foi. Quant il est questions des querelles personnelles, elles s’accommodent presque toujours par médiateurs sans importuner monsieur ni madame ; mais quand il s’agit de l’intérêt sacré du maître, l’affaire ne saurait demeurait secrète ; il faut que le coupable s’accuse ou qu’il ait un accusateur161 . Et pourtant ces règles ne constituent en aucune manière une pierre d’achoppement à leur épanouissement, ni à l’accomplissement parfait du service auquel ils sont responsabilisés. Ce qui est assez remarquable ici, c’est que ces domestiques ne sentent quasiment jamais être sous le rouleau de l’asservissement, c’est peut-être parce qu’ils « ne voient jamais rien faire à leur maître qui ne soit droit, juste, équitable, ils ne regardent point la justice comme le tribut du pauvre, comme le joug du malheureux, comme une des misères de leur état162 ». Au fait, 160 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’inégalité parmi les hommes, op., cit, p.103. 161 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 4éme partie/ L. X, op., cit., pp. 527-528. 162 Ibid., 4éme partie/L. X, p. 531. 69 ils sont considérés comme des membres de la famille où M. et Mme de Wolmar seraient leurs procréateurs : « Ils continuent de travailler comme ils faisaient dans la maison paternelle ; ils n’ont fait, pour ainsi dire, que changer de père et de mère163 ». Pour assurer la concorde entre les domestiques, tout est fait dans cette maison pour qu’ils s’y sentent comme des frères : « Ils doivent la regarder comme la maison paternelle où tout n’est qu’une famille. » De surcroît, dans cette maison de paix, « l’union des membres y paraît venir de leur attachement aux chefs164 ». En dépit de cette faible dichotomie que l’on pourrait établir entre le domestique et le politique, à Clarens, comme dans le haut Valais, il va sans dire que : « la famille est à l’image de l’état165 ». En effet, ce criterium substantiel des valeurs de la famille est admirablement remarqué par leur voisinage qui, à leur tour, leur confie l’éducation de leurs enfants parce qu’au-delà du fait que la maison des Wolmar soit « l’école de la modestie et des bonnes mœurs », se révèle aussi et surtout comme une concession où les tâches sont bien distinctes entre M. de Wolmar, « représentant la raison organisatrice » et son épouse Julie qui fait preuve d’une « sensibilité agissante166 ». Par ailleurs, cette marque caractéristique de l’ordre et de la paix chez les Wolmar à attirer a plus d’un titre l’attention de Saint-Preux. Raison pour laquelle il stipule auprès de son ami de tels propos : Milord, que c’est un spectacle agréable et touchant que celui d’une maison simple et bien réglée où règne l’ordre, la paix, l’innocence ; où l’on voit réuni sans appareil, sans éclat, tout ce qui répond à la véritable destination de l’homme. À des meubles anciens et riches, ils ont substitué de simples et de commodes. Tout y est agréable et riant, tout y respire l’abondance et la propreté, rien n’y sent la richesse et le luxe167 . Cet aspect revalorisant de la commodité, de l’humilité, de l’ordre, de la paix mais aussi et surtout de la vie rustique fait de La Nouvelle Héloïse, le temple des âmes vertueuses. Adepte de la vertu socratique, Rousseau a toujours soutenu l’idée suivant laquelle le bonheur de l’homme ne saurait résulter que de la simplicité et l’isolement de l’être. Quoi que l’on puisse avancer, la mise en scène de la société de Clarens en dit long sur l’attachement et par là 163 Ibid., 3éme partie/ L. XXI, p. 445. 164 Ibid., 4éme partie/ L. X, p. 346. 165 Ibid., 4éme partie/L. XV, pp. 574-575. 166 Flora Champy, « Les relations de pouvoir à Clarens : un équilibre voué à l’échec ? », in Dix-huitième siècle, 2012/1, n° 44, pp. 519-543. 167 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 4éme partie/L. X, op., cit, pp. 329-330. 70 l’importance que le genevois affecte à l’égard de la nature au pied de la lettre. Charles Dedéyan, quant à lui, parle de la société idyllique du pays de Vaud en témoignage de la prééminence accordée à la nature par l’auteur du Promeneur Solitaire. On y retrouve dit-il : Cette peinture de la noblesse campagnarde, du pays de Vaud, de ses paysans, de ses habitants du Valais, cette satire de la vie parisienne correspondant à un retour à la vie rurale, à l’éclosion du sentiment de la nature qu’a si bien étudié M. Daniel Mornet tant dans sa thèse sur le sentiment de la nature au 18éme siècle que dans son introduction à l’édition critique de La Nouvelle Héloïse168 . A posteriori, nous constatons, a bien des égard que l’auteur du Contrat Social tire l’idéologie de ses êtres et partant, l’administration de son peuple utopique au détour des règles institutionnalisées des régimes en place, en Suisse comme en France. À Clarens par exemple, l’économie est essentiellement basée sur l’agriculture, la subsistance de toutes et de tous est assurée par la vie autarcique des familles et la relation entre domestique et maître se retraduit par le respect réciproque des uns aux autres. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle certains se demandent : Qui détient véritablement le pouvoir à Clarens ? De quel pouvoir s’agit-il, dans ce microcosme où toutes les relations hiérarchiques se trouvent volontairement dissimulées ? Il faut également interroger toutes les dimensions de ce pouvoir composite : dans quelle mesure et pourquoi la société de Clarens constitue-t-elle une communauté politique169 ? Pour répondre à ces questions conséquentes tout de même, mais complexes pourrait-on dire, nous partons du fait qu’au-delà de la confrontation du texte de Rousseau avec celui des philosophes antiques (Platon, Aristote, les Stoïciens et même Sénèque) qui ont abordé aussi la relation du pouvoir domestique et du pouvoir politique, que Clarens est essentiellement régie par Wolmar, le maître des grandes décisions, mais il est soutenu à plus d’un titre par sa femme Julie, sans laquelle d’ailleurs, Clarens serait une communauté où le travail et le 168 Charles Dedeyan, La Nouvelle Héloïse, op., cit., p. 54. 169 Flora Champy, « Les relations de pouvoir à Clarens : un équilibre voué à l’échec ? », in Dix-huitième siècle, op., cit. pp. 519-543. 71 dynamisme seraient toujours à l’œuvre certes, mais elle en serait une où l’éthique du respect de son prochain, de l’amour du service collectif et le partage seront méconnus. À ce titre, Flora Champy souligne que Si Julie n’assiste au rassemblent d’émulation masculine, il est à noter que c’est elle surtout qui permet de conserver la cohésion de la communauté, en maintenant cette fixité des conditions, et ce même lorsque ce sont son mari et son époux qui agissent. Dans les deux cas, elle est désignée comme épouse de Wolmar ; mais pour expliquer la force de sa présence, Saint-Preux la désigne par son prénom170 . En ce qui concerne cette dissimulation de la hiérarchie sociale à Clarens, Rousseau instaure une nouvelle conception de gouvernance qui consiste à réduire sinon à effacer les écarts non négligeables de l’inégalité sociale parmi les membres d’une même communauté. Convaincu de la recrudescence de cette pandémie sociale, le Genevois soulève la question de la condition de vie des ouvriers et des retraités à travers une mise en scène symbolique, mais apodictique de cette microsociété dans La Nouvelle Héloïse. Clarens est alors un lieu où l’homme n’est jamais un moyen mais une fin en soi, sa valeur substantielle, ses droits pour ne pas dire son humanité s’affirment avec la philosophie commune de la liberté et de l’équité à travers les principes canoniques du vivre ensemble et du respect de son prochain. Remarquablement frappé par un tel système égalitaire, Saint-Preux laisse entendre qu’ En commençant leur établissement, ils ont cherché quel nombre de domestique ils pouvaient entretenir dans une maison montée selon leur état, et ils ont trouvés que ce nombre allait à quinze ou seize : pour être mieux servit, ils l’ont réduit à la moitié ; de sorte qu’avec moins d’appareil leur service est beaucoup plus exact. (…) Un domestique en entrant chez eux reçoit le gage ordinaire ; mais ce gage augmente tous les ans d’un vingtième ; au bout de vingt ans il serait ainsi plus que doublé, et l’entretien des domestiques serait à peu près alors en raison du moyen des maîtres. (…) Vous sentez bien Mylord, que c’est un expédient sûr pour augmenter incessamment le soin des domestique et de se les attacher à mesure qu’on s’attache à eux. Il n’y a pas seulement de la prudence. Il y’a même de l’équité dans un pareil établissement171 . 170 Ibidem. 171 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 4 éme partie/ L. X, op, cit, p. 61. 72 Qui plus est, dans La Nouvelle Héloïse, les lettres qui portent sur Clarens doivent être considérées comme relevant d’un statut particulier qu’elles tiennent notamment de leur intégration à un roman. Le genre de l’utopie, qui connaît un développement important au 18éme siècle, leur ont fourni une référence générique. En effet, la situation géographique de Clarens est présentée par Rousseau lui-meme dans la seconde préface de façon transparente : le Clarens réel ne correspond pas au Clarens littéraire, textuel du roman : N. Mais enfin, vous connaissez les lieux ? Vous avez été à Vevey, dans le pays de Vaud ? R. Plusieurs fois, et je vous déclare que je n’y ai point ouï parler du baron d’Etange ni de sa fille ; le nom de M. Wolmar n’y est même pas connu. J’ai été à Clarens ; je n’y ai jamais vu de semblable à la maison décrite dans ces lettres. (…) Enfin, autant que je puis me rappeler de la situation du pays, j’ai remarqué dans ces lettres des transpositions de lieux et des erreurs de topographies172 . De plus, si Rousseau a pu se rendre au Clarens réel, le Clarens littéraire, si l’on se confie aux différentes correspondances qui passent au crible l’aspect géographique du lieu, est beaucoup plus fermés aux étrangers, on y a peu de communication avec l’extérieur, si bien que Saint�Preux finit par assimiler Clarens à une ile. Mais la caractéristique la plus manifeste est son parfait monologisme, autrement dit l’hetos conformiste de toute la communauté, tant d’un point de vue moral, éthique que social : il y a pourrait-on dire, une incorporation de la nature dans la vie des hommes. Au demeurant, c’est ce qui explique cette uniformisation des valeurs humaines positives tout au long de ces lettres de Saint-Preux qui ne cesse de louer l’harmonie et la beauté de la communauté de Clarens. De surcroît, malgré la forme épistolaire, faite pour donner à entendre plusieurs voix et connaître plusieurs point de vue, les lettres de Saint-Preux témoignent d’une totale communion d’esprit avec Wolmar et Julie ce qui se marque sans rupture de style majeure de paroles rapportées qui ont été prononcées par l’un ou par l’autre. Lorsque Saint-Preux est en désaccord avec ces deux plénipotentiaires, il lui suffit de quelques explications pour être convaincu. Ainsi toutes les descriptions de Clarens proviennent d’une seule voix, comme l’écrit Saint-Preux. « En fréquentant les heureux époux, leur ascendant me gagne et me touche insensiblement, et mon cœur se met par degrés à l’unisson des leurs, comme la voix prend sans qu’on y songe, le ton des gens avec qui l’on 172 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Heloise, « Préface ou Entretiens sur les romans », op., cit., p. 75. 73 parle173 ». Fort de ce constant Jean Terrasse stipule que Saint-Preux réintègre ainsi la classe sociale de la manière qui lui soit permise par la soumission filiale. Cependant, cette intégration de l’ordre social existant semble être également une réconciliation avec le monde réel en dehors de l’imagination. Clarens constitue en effet une communauté politique construite par Wolmar selon un plan philosophique, mais appliqué au réel à partir du réel lui�même : le pouvoir considérable du mari sur sa femme et du père sur ses enfants lui donne, par rapport à l’amant et précepteur, un pouvoir quasi divin. Sous un même angle, nous relevons que Julie sous la direction de son époux, fait en sorte que ses enfants ne connaissent rien qui sentit l’empire et l’autorité, non plus que la dangereuse image du pouvoir et de la servitude ; mais ils n’ont ainsi aucune idée de ce qu’est un pouvoir conventionnel et arbitraire, ils éprouvent fortement le pouvoir de la nature qui les rend à leur âge dépendant de leur parents : ainsi le joug de la « discipline », inefficace parce qu’arbitraire, est remplacé par un joug bien plus inflexible, celui de la « nécessité ». C’est Wolmar qui prononce ces dernières paroles, retrouvant ainsi son rôle de théoricien. Le principe de l’efficacité de toute autorité, comme souligne Jean Terrasse, c’est de s’accorder avec la nature, de ne s’identifier qu’avec la force des choses. À Clarens comme dans le haut Valet, la vie est une ascension de l’âme vers le bien, l’homme n’est que ce que ses actes et ses propos font voir et entendre sous la houlette de la vertu, sa vie n’est que le reflet de la nature substantielle des âmes bien heureuses. Rousseau, dans ce microcosme, étale à sa guise mais à bien des égards, une nouvelle conception de la vie fondée sur des valeurs cardinales menant vers le bonheur de tous. Cette idée subversive de l’administration politique, sociale et économique de son époque trouve ses remèdes dans cette communauté où on est loin de tous ce qui a trait à l’injustice et à l’infamie comme dans la vie des sociétés non vertueuses. 1. 3. Le mal dans la société non vertueuse : En matière de morale, il n’y a point, selon moi, de lecture utile aux gens du monde. Premièrement, parce que la multitude des livres nouveaux qu’ils parcourent, et qui disent tour à tour le pour et le contre, détruit l’effet de l’un par l’autre, et rend le tout comme non avenu. Les livres choisis qu’on relit ne 173 Ibid., 5 éme partie/ L. II, p. 591. 74 font point d’effet encore : s’ils soutiennent les maximes du monde, ils sont superflus ; et s’ils les combattent, ils sont inutiles : ils trouvent ceux qui les lisent liés aux vices de la société par des chaines qu’ils ne peuvent rompre174 . À l’instar de plusieurs de ses contemporains tels que Montesquieu et Marivaux, l’auteur du Discours de l’inégalité parmi les hommes, passe au crible l’artificialité et la nullité de la vie dans les grandes villes, notamment à Paris. Usant du genre le plus approprié pour étudier l’ailleurs, l’autre et ses coutumes, Rousseau pointe du doigt avec congruence l’origine du malheur, des infortunes et déconvenues de l’homme civilisé. À la différence des Lettres Persanes (1721) de Montesquieu ou encore du Paysan Parvenu (1735) de Marivaux, La Nouvelle Héloïse va au-delà de la simple description des mœurs, c’est aussi la cure pour ainsi dire, de cet espèce de pandémie des mœurs dans la société. Le philosophe trace des voies subtiles à travers une argumentation incommensurable qui permettrait l’homme du grand monde à retrouver la félicité de l’âme même s’il n’est « pas facile, pour le philosophe, de dialoguer si l’interlocuteur met en cause sa doctrine tout en refusant de parler philosophie175 ! » Cet aspect récalcitrant de l’interlocuteur connut de tous les grands moralistes, pousse le Genevois à proférer de tels propos : « Mon cœur voudrait parler, il sent qu’il n’est point écouté ; il voudrait répondre, on ne lui dit rien qui puisse aller jusqu’à lui. Je n’entends point la langue du pays, et personne ici n’entend la mienne 176 ». Au demeurant, Saint-Preux dénonce cette inconscience collective des habitants de Paris chez qui, le paraître a déjà pris le dessus sur les valeurs propres de l’être originel. Par une expression antiphrastique, il professe à Julie ceci : « J’entre avec une secrète horreur dans le vaste désert du monde177 ». Paris serait alors un désert puisque les bienfaits substantiels dont l’homme de la nature a été gratifié par le Souverain juge y sont imperceptibles. L’amour du prochain, le partage, la reconnaissance des mérites d’autrui, l’amour du travail, la bienfaisance, l’honnêteté et tous leurs corolaires sont mépris dans cette macro société. Selon le philosophe genevois, « le français est naturellement bon, ouvert, hospitalier, bienfaisant », mais l’influence sociale à réduit à néant ces qualités, pour ne pas dire qu’elle les a converti progressivement et malicieusement en vice. Partant des constatations discursives de Saint�Preux dans les salons et quelques lieux publiques intellectuels, l’on voit non sans émerveillement, l’inconséquence de ces discussions d’assemblée : 174 « Préface ou Entretien sur les romans » de Julie ou La Nouvelle Héloïse, op. cit, pp. 62-63. 175 Préface d’Arlette Elkhaim, Jean-Paul Sartre, l’Existentialisme est un humanisme, Ed. Gallimard, 1996, p. 15. 176 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 3éme partie/ L. XIV, op., cit., p. 289. 177 Idem. 75 Mais au fond, que penses-tu qu’on apprenne dans ces conversations si charmantes ? À juger sainement des choses du monde ? À bien user de la société ? À connaitre au moins les gens avec qui l’on vit ? Rien de tout cela, ma Julie. On y apprend à plaider avec art la cause du mensonge, à ébranler à force de philosophie tous les principes de la vertu, et à colorer de sophismes subtils ses passions et ses préjugés, et à donner à l’erreur un certain tour à la mode selon les maximes du jour178 . Qui plus est, dans les grandes agglomérations, surtout à Paris l’hypocrisie pour ne pas dire la tartufferie est quotidiennement de mise. Et, ce qui marque le plus l’esprit dans cette mode de vie insidieuse et infâme, c’est la banalité de ces actes sempiternels ou encore l’approbation consciente ou inconsciente de tels faits quand bien même, toutes et tous aspirèrent au bonheur qui ne passe que par la vertu. Paradoxe ? On pose en général le bonheur comme le but suprême de l'existence humaine. Il serait la fin en soi vis-à-vis de laquelle tous nos autres buts seraient secondaires. L'homme a besoin de rechercher le bonheur; il est dans une quête continue, mais quelque fois, il confond le bonheur avec la satisfaction des désirs matériels seulement pour se détourner de sa condition malheureuse. Le bonheur n'est pas une chose à laquelle l'homme peut arriver avec le désir. Le bonheur est d'abord une condition intérieure. Pour Épicure, seulement une vie pleine de plaisirs pourrait conduire à la tranquillité de l'âme. Rousseau, dans Les rêveries du promeneur solitaire se propose de vivre agréablement le présent au contact de la nature. Mais dans ce monument de la vertu, on remarque comment, avec une vie simple et pleine, on peut aboutir au bonheur. Au fait, la morale collective n’imposait-elle pas à celles ou ceux qui veulent s’immiscer dans les affaires importantes de la cité de s’y accommoder ? En tout état de cause, Saint-Preux notifie qu’à Paris : L’honnête homme d’une maison est un fripon dans la maison voisine : le bon, le mauvais, le beau, le lait, la vérité, la vertu, n’ont qu’une exigence locale et circonscrite. Quiconque aime à se répandre et fréquente plusieurs société doit être plus flexible qu’Alcibiade 179 , Changer de principes comme d’assemblées, modifier son projet pour ainsi dire à chaque pas, et mesurer ses maximes à la toise : il faut qu’à chaque visite qu’il change en entrant son âme, s’il en a une ; qu’il en 178 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, 3éme partie/ L. XIV, op., cit., p. 291. 179 Alcibiade (450-404) Av. J.-C, fut général athénien sans scrupules, intelligent, élève de Socrate, décida en 415 l’expédition de Sicile, dut s’exiler et fut rappelé par ses compatriotes.