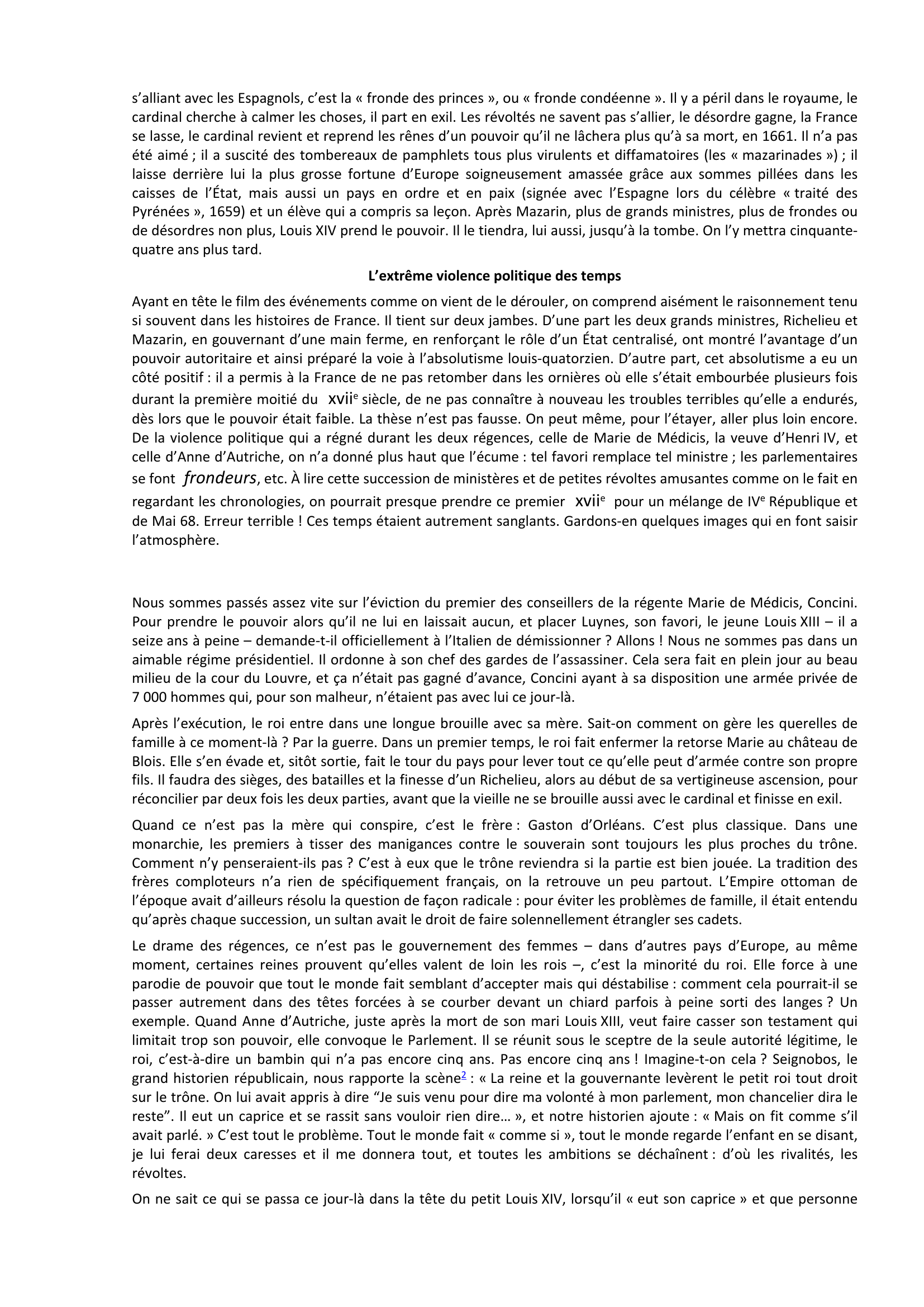parfait de l'homme de pouvoir : secret, froid, maître de toutes choses autant que de lui-même.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
s’alliant
aveclesEspagnols, c’estla« fronde desprinces », ou« fronde condéenne ».
Ilya péril dans leroyaume, le
cardinal cherche àcalmer leschoses, ilpart enexil.
Lesrévoltés nesavent pass’allier, ledésordre gagne,laFrance
se lasse, lecardinal revientetreprend lesrênes d’unpouvoir qu’ilnelâchera plusqu’à samort, en1661.
Iln’a pas
été aimé ; ila suscité destombereaux depamphlets tousplusvirulents etdiffamatoires (les« mazarinades ») ; il
laisse derrière luilaplus grosse fortune d’Europe soigneusement amasséegrâceauxsommes pilléesdansles
caisses del’État, maisaussi unpays enordre eten paix (signée avecl’Espagne lorsducélèbre « traitédes
Pyrénées », 1659)etun élève quiacompris saleçon.
AprèsMazarin, plusdegrands ministres, plusdefrondes ou
de désordres nonplus, Louis XIV prendlepouvoir.
Ille tiendra, luiaussi, jusqu’à latombe.
Onl’ymettra cinquante-
quatre ans plustard.
L’extrême
violencepolitique destemps Ayant
entête lefilm desévénements commeonvient deledérouler, oncomprend aisémentleraisonnement tenu
si souvent dansleshistoires deFrance.
Iltient surdeux jambes.
D’unepartlesdeux grands ministres, Richelieuet
Mazarin, engouvernant d’unemainferme, enrenforçant lerôle d’un Étatcentralisé, ontmontré l’avantage d’un
pouvoir autoritaire etainsi préparé lavoie àl’absolutisme louis-quatorzien.
D’autrepart,cetabsolutisme aeu un
côté positif : ila permis àla France denepas retomber danslesornières oùelle s’était embourbée plusieursfois
durant lapremière moitiéduxviie
siècle, denepas connaître ànouveau lestroubles terribles qu’elleaendurés,
dès lors que lepouvoir étaitfaible.
Lathèse n’estpasfausse.
Onpeut même, pourl’étayer, allerplusloinencore.
De laviolence politique quiarégné durant lesdeux régences, celledeMarie deMédicis, laveuve d’Henri IV, et
celle d’Anne d’Autriche, onn’a donné plushaut quel’écume : telfavori remplace telministre ; lesparlementaires
se font frondeurs ,
etc.
Àlire cette succession deministères etde petites révoltes amusantes commeonlefait en
regardant leschronologies, onpourrait presqueprendrecepremier xviie
pour unmélange deIVe
République et
de Mai 68.Erreur terrible ! Cestemps étaient autrement sanglants.Gardons-en quelquesimagesquienfont saisir
l’atmosphère.
Nous sommes passésassezvitesurl’éviction dupremier desconseillers delarégente MariedeMédicis, Concini.
Pour prendre lepouvoir alorsqu’ilneluien laissait aucun,etplacer Luynes, sonfavori, lejeune Louis XIII –ila
seize ans àpeine –demande-t-il officiellement àl’Italien dedémissionner ? Allons !Nousnesommes pasdans un
aimable régimeprésidentiel.
Ilordonne àson chef desgardes del’assassiner.
Celaserafaitenplein jouraubeau
milieu delacour duLouvre, etça n’était pasgagné d’avance, Conciniayantàsa disposition unearmée privéede
7 000 hommes qui,pour sonmalheur, n’étaient pasavec luicejour-là.
Après l’exécution, leroi entre dansunelongue brouille avecsamère.
Sait-on comment ongère lesquerelles de
famille àce moment-là ? Parlaguerre.
Dansunpremier temps,leroi fait enfermer laretorse Marieauchâteau de
Blois.
Elles’en évade et,sitôt sortie, faitletour dupays pour lever toutcequ’elle peutd’armée contresonpropre
fils.
Ilfaudra dessièges, desbatailles etlafinesse d’unRichelieu, alorsaudébut desavertigineuse ascension,pour
réconcilier pardeux foislesdeux parties, avantquelavieille nesebrouille aussiaveclecardinal etfinisse enexil.
Quand cen’est paslamère quiconspire, c’estlefrère : Gaston d’Orléans.
C’estplusclassique.
Dansune
monarchie, lespremiers àtisser desmanigances contrelesouverain sonttoujours lesplus proches dutrône.
Comment n’ypenseraient-ils pas ?C’estàeux que letrône reviendra sila partie estbien jouée.
Latradition des
frères comploteurs n’arien despécifiquement français,onlaretrouve unpeu partout.
L’Empire ottomande
l’époque avaitd’ailleurs résolulaquestion defaçon radicale : pouréviter lesproblèmes defamille, ilétait entendu
qu’après chaquesuccession, unsultan avaitledroit defaire solennellement étranglersescadets.
Le drame desrégences, cen’est paslegouvernement desfemmes –dans d’autres paysd’Europe, aumême
moment, certainesreinesprouvent qu’ellesvalentdeloin lesrois –,c’est laminorité duroi.
Elle force àune
parodie depouvoir quetout lemonde faitsemblant d’accepter maisquidéstabilise : commentcelapourrait-il se
passer autrement dansdestêtes forcées àse courber devantunchiard parfois àpeine sortideslanges ? Un
exemple.
QuandAnned’Autriche, justeaprès lamort deson mari Louis XIII, veutfaire casser sontestament qui
limitait tropsonpouvoir, elleconvoque leParlement.
Ilse réunit souslesceptre delaseule autorité légitime, le
roi, c’est-à-dire unbambin quin’apas encore cinqans.Pasencore cinqans ! Imagine-t-on cela ?Seignobos, le
grand historien républicain, nousrapporte lascène 2
: « La reine etlagouvernante levèrentlepetit roitout droit
sur letrône.
Onluiavait appris àdire “Jesuis venu pourdiremavolonté àmon parlement, monchancelier dirale
reste”.
Ileut uncaprice etse rassit sansvouloir riendire… », etnotre historien ajoute :« Maisonfitcomme s’il
avait parlé. » C’esttoutleproblème.
Toutlemonde fait« comme si »,tout lemonde regarde l’enfantensedisant,
je lui ferai deux caresses etilme donnera tout,ettoutes lesambitions sedéchaînent : d’oùlesrivalités, les
révoltes.
On nesait cequi sepassa cejour-là danslatête dupetit Louis XIV, lorsqu’il« eutsoncaprice » etque personne.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Voyez-vous, comme Michel Carrouges, les dangers du «hasard objectif» chez les surréalistes : «Si le hasard objectif peut apparaître à première vue comme une des grandes forces de libération pour l'homme, puisqu'il est la manifestation dans la vie «réelle» du pouvoir magique de l'esprit poétique, il aurait aussi un envers secret, pouvoir de terreur et d'asservissement ou même de mort. Ce vaste réseau de réminiscences, de prémonitions et de coïncidences stupéfiantes dont il est la manife
- Commentaire de texte de Montesquieu - De l'esprit des lois: « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » ... « par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir »
- Victor Hugo écrit : «La nature procède par contrastes. C'est par les oppositions qu'elle fait saillir les objets. C'est par leurs contraires qu'elle fait sentir les choses, le jour par la nuit, le chaud par le froid, etc.; toute clarté fait ombre. De là le relief, le contour, la proportion, le rapport, la réalité. La création, la vie, le destin, ne sont pour l'homme qu'un immense clair-obscur. Le poète, ce philosophe du concret et ce peintre de l'abstrait, le poète, ce penseur suprême,
- Le secret d'un homme... c'est la limite même de sa liberté. c'est son pouvoir de résistance aux supplices et à la mort. Sartre, Jean-Paul. Commentez cette citation.
- "La justice règle l'activité intérieure, celle qui concerne l'homme personnellement et les principes qui le forment, sans permettre à aucune de nos fonctions de faire des choses qui lui soient étrangères et sans permettre non plus que les trois principes spécifiés dans l'âme empiètent sur leurs attributions respectives. Platon, La République, IV Les maux ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive au pouvoir ou que les chefs des ci