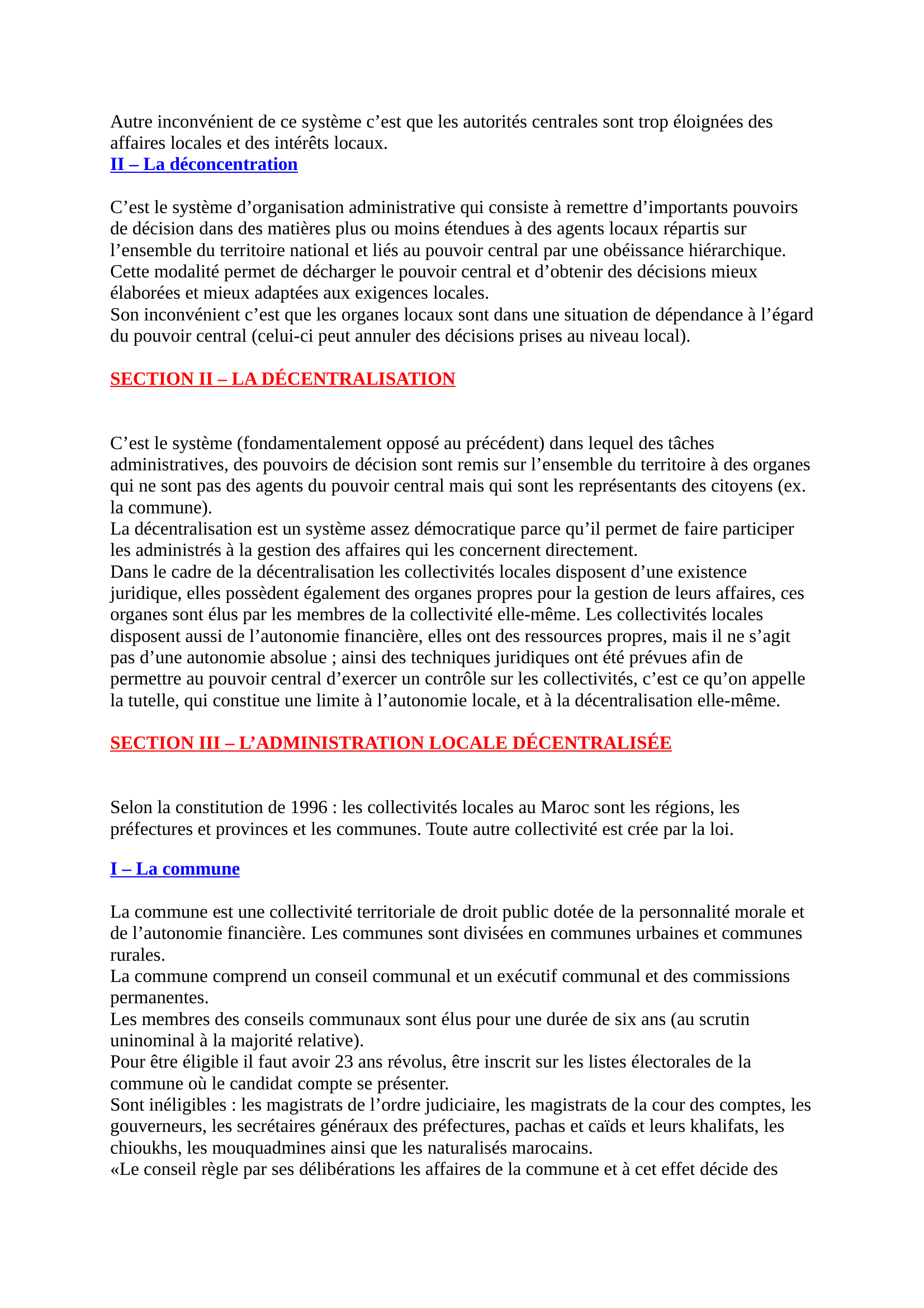Droit administratif
Publié le 30/12/2013

Extrait du document


«
Autre inconvénient de ce système c’est que les autorités centrales sont trop éloignées des
affaires locales et des intérêts locaux.
II – La déconcentration
C’est le système d’organisation administrative qui consiste à remettre d’importants pouvoirs
de décision dans des matières plus ou moins étendues à des agents locaux répartis sur
l’ensemble du territoire national et liés au pouvoir central par une obéissance hiérarchique.
Cette modalité permet de décharger le pouvoir central et d’obtenir des décisions mieux
élaborées et mieux adaptées aux exigences locales.
Son inconvénient c’est que les organes locaux sont dans une situation de dépendance à l’égard
du pouvoir central (celui-ci peut annuler des décisions prises au niveau local).
SECTION II – LA DÉCENTRALISATION
C’est le système (fondamentalement opposé au précédent) dans lequel des tâches
administratives, des pouvoirs de décision sont remis sur l’ensemble du territoire à des organes
qui ne sont pas des agents du pouvoir central mais qui sont les représentants des citoyens (ex.
la commune).
La décentralisation est un système assez démocratique parce qu’il permet de faire participer
les administrés à la gestion des affaires qui les concernent directement.
Dans le cadre de la décentralisation les collectivités locales disposent d’une existence
juridique, elles possèdent également des organes propres pour la gestion de leurs affaires, ces
organes sont élus par les membres de la collectivité elle-même.
Les collectivités locales
disposent aussi de l’autonomie financière, elles ont des ressources propres, mais il ne s’agit
pas d’une autonomie absolue ; ainsi des techniques juridiques ont été prévues afin de
permettre au pouvoir central d’exercer un contrôle sur les collectivités, c’est ce qu’on appelle
la tutelle, qui constitue une limite à l’autonomie locale, et à la décentralisation elle-même.
SECTION III – L’ADMINISTRATION LOCALE DÉCENTRALISÉE
Selon la constitution de 1996 : les collectivités locales au Maroc sont les régions, les
préfectures et provinces et les communes.
Toute autre collectivité est crée par la loi.
I – La commune
La commune est une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale et
de l’autonomie financière.
Les communes sont divisées en communes urbaines et communes
rurales.
La commune comprend un conseil communal et un exécutif communal et des commissions
permanentes.
Les membres des conseils communaux sont élus pour une durée de six ans (au scrutin
uninominal à la majorité relative).
Pour être éligible il faut avoir 23 ans révolus, être inscrit sur les listes électorales de la
commune où le candidat compte se présenter.
Sont inéligibles : les magistrats de l’ordre judiciaire, les magistrats de la cour des comptes, les
gouverneurs, les secrétaires généraux des préfectures, pachas et caïds et leurs khalifats, les
chioukhs, les mouquadmines ainsi que les naturalisés marocains.
«Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune et à cet effet décide des.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DROIT ADMINISTRATIF - cours complet
- Droit administratif: le service public
- droit administratif: Les actes juridiques de l’administration sont-ils toujours unilatéraux ?
- 3 exo de droit administratif corrigés
- l'acte détachable et la nullité du contrat en droit administratif