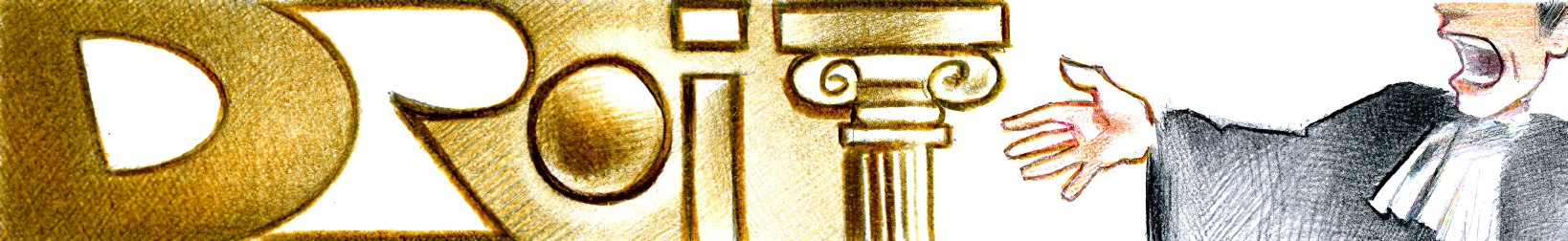Droit administratif
Publié le 02/03/2021

Extrait du document

Droit administratif Droit administratif 27 e édition 2018 Jean Waline Professeur émérite de l'Université Robert-Schuman de Strasbourg Ancien président de l'Université MENTIONS LÉGALES 31-35 rue Froidevaux, 75685 Paris cedex 14 Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes de l’article L. 122-5, 2° et 3° a), d’une part, que les copies ou reproductions « strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et d’autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, tout comme le fait de la stocker ou de la transmettre sur quelque support que ce soit, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée pénalement par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. © Éditions Dalloz-2018 ISBN numérique : 978-2-247-18448-4 ISBN papier : 978-2-247-17917-6 Ce document numérique a été réalisé par JOUVE. www.editions-dalloz.fr TABLE DES MATIÈRES ABRÉVIATIONS PRÉFACE DE LA 22E ÉDITION PRÉLIMINAIRES A. B. C. D. E. F. G. H. I. BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE Traités et précis Répertoires et collections Mélanges Revues Jurisprudence Textes Avis Droit administratif européen Bases de données juridiques INTRODUCTION GÉNÉRALE Section 1. § 1. § 2. § 3. DÉFINITIONS ET NOTIONS DE BASE Section 2. LA FORMATION HISTORIQUE DU RÉGIME ADMINISTRATIF FRANÇAIS L'œuvre de l'an VIII Les facteurs d'évolution Les résultats de l'évolution § 1. § 2. § 3. Section 3. L'Administration Le droit administratif La science administrative LES CLÉS DU DROIT ADMINISTRATIF § 1. § 2. Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire La dérogation au droit commun § 3. § 4. Le principe de légalité Le contrôle de l'Administration PREMIÈRE PARTIE SOUS-PARTIE 1 CHAPITRE 1 LES ORGANES DE L'ACTION ADMINISTRATIVE LES ORGANES DE DROIT PUBLIC LES NOTIONS FONDAMENTALES DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section 1. ÉTAT UNITAIRE ET ÉTAT FÉDÉRAL Section 2. CENTRALISATION ET DÉCENTRALISATION Section 3. LA DÉCONCENTRATION Section 4. LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER CHAPITRE 2 THÉORIE GÉNÉRALE DES PERSONNES PUBLIQUES Section 1. LA PERSONNALITÉ MORALE Section 2. LA DISTINCTION DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT PRIVÉ Les personnes morales de droit privé Les personnes morales de droit public § 1. § 2. Section 3. § 1. § 2. TITRE 1 CHAPITRE 1 Section 1. L'ÉVOLUTION DE LA DISTINCTION ENTRE PERSONNES MORALES PUBLIQUES ET PRIVÉES L'évolution des personnes morales de droit privé L'évolution des personnes morales de droit public L'ADMINISTRATION D'ÉTAT L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ÉTAT LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE § 1. § 2. L'évolution des rôles respectifs du président de la République et du chef du Gouvernement Les attributions administratives § 3. Les services de la Présidence de la République Section 2. § 1. § 2. LE PREMIER MINISTRE Section 3. § 1. § 2. LES MINISTRES Section 4. LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET LES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES La vogue des Autorités administratives indépendantes Les pouvoirs des Autorités administratives indépendantes Le contrôle des Autorités administratives indépendantes § 1. § 2. § 3. Les attributions administratives Les services du Premier ministre Les attributions administratives L'organisation-type d'un ministère Section 5. LES AGENCES Section 6. LA COORDINATION DE L'ACTION DES AUTORITÉS CENTRALES CHAPITRE 2 L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT Section 1. L'ESSOR DE LA DÉCONCENTRATION Section 2. § 1. LES SERVICES RÉGIONAUX DE L'ÉTAT § 2. § 3. Section 3. § 1. § 2. La résolution des problèmes posés par la loi du 16 janvier 2015 Les organes de la circonscription régionale Les compétences de la circonscription régionale LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉTAT Le préfet Les services du préfet Section 4. L'ARRONDISSEMENT Section 5. LA COMMUNE CONCLUSION TITRE 2 SOUS-TITRE 1 CHAPITRE 1 LA RÉFORME DE L'ÉTAT LES PERSONNES ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES L'ÉVOLUTION DE LA DÉCENTRALISATION DEPUIS 1958 Section 1. LA DÉCENTRALISATION DANS LA CONSTITUTION DE 1958 Section 2. § 1. § 2. LA DÉCENTRALISATION DANS LA LOI DU 2 MARS 1982 § 3. Section 3. § 1. § 2. § 3. Le volet organique et fonctionnel La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales Le statut de la fonction publique territoriale LA RÉFORME OPÉRÉE À PARTIR DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DU 28 MARS 2003 La codification du système existant Les innovations de la loi du 28 mars 2003 La loi du 13 août 2004 Section 4. LE RAPPORT BALLADUR ET LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 2010 Section 5. § 1. § 2. § 3. LES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT AYRAULT Section 6. LES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT VALLS CHAPITRE 2 Section 1. La loi organique et la loi du 17 mai 2013 La loi du 27 janvier 2014 La loi organique et la loi du 14 février 2014 LA COMMUNE ÉVOLUTION DU RÉGIME DES COMMUNES Section 2. LE CONSEIL MUNICIPAL § 1. § 2. 1. Composition Élection Communes de moins de 1 000 habitants 2. § 3. § 4. § 5. § 6. Communes de 1 000 habitants et plus Section 3. § 1. § 2. CHAPITRE 3 Durée du mandat Statut des élus municipaux Fonctionnement Attributions LE MAIRE Statut Attributions LE DÉPARTEMENT Section 1. § 1. § 2. § 3. § 4. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL Section 2. § 1. § 2. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL Section 3. § 1. § 2. LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER CHAPITRE 4 Section 1. § 1. § 2. Évolution du mode d'élection du Conseil Le système de la loi du 17 mai 2013 Fonctionnement Attributions Élection Attributions Le système antérieur à la loi du 28 mars 2003 Les innovations de la loi du 28 mars 2003 LA RÉGION L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME RÉGIONAL Les premières ébauches La réforme de 1964 § 3. § 4. § 5. § 6. Le projet de réforme de 1969 La réforme de 1972 La loi du 2 mars 1982 La loi du 16 janvier 2015 Section 2. § 1. § 2. LES ASSEMBLÉES RÉGIONALES Section 3. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL Section 4. § 1. § 2. LES RÉGIONS À STATUT PARTICULIER CHAPITRE 5 Le Conseil régional Le Conseil économique, social et environnemental régional La Corse Les régions d'Outre-Mer LES COLLECTIVITÉS À STATUT PARTICULIER Section 1. § 1. § 2. § 3. § 4. PARIS ET LA RÉGION D'ÎLE DE FRANCE Section 2. § 1. § 2. § 3. LES RÈGLES COMMUNES À PARIS, LYON ET MARSEILLE CHAPITRE 6 § 1. § 2. SOUS-TITRE 2 CHAPITRE 1 Section 1. L'évolution Les collectivités de la région parisienne Le régime de Paris L'administration régionale Les organes de l'arrondissement Les moyens de l'arrondissement Le régime électoral applicable à Paris, Lyon et Marseille LE CONTRÔLE DE L'ÉTAT SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les contrôles administratifs Le contrôle financier LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SECTORIELS ÉVOLUTION Section 2. § 1. § 2. § 3. Section 3. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. CHAPITRE 2 L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC CLASSIQUE Caractères généraux Régime juridique Modalités ÉTABLISSEMENT PUBLIC ET ENTREPRISE PUBLIQUE La notion d'entreprise publique Origines L'opération de nationalisation L'opération de privatisation L'économie des entreprises publiques Le régime juridique de l'entreprise La distinction des entreprises publiques, personnes publiques ou personnes privées LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX Section 1. LA FUSION DE COMMUNES ET LES COMMUNES NOUVELLES Section 2. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. LA COOPÉRATION ENTRE LES COMMUNES Section 3. § 1. § 2. § 3. LES TROIS MÉTROPOLES Section 4. LES RÈGLES COMMUNES À TOUS LES EPCI Le syndicat de communes La communauté urbaine La communauté de communes La communauté d'agglomération Les métropoles Le Pôle Métropolitain La Métropole du Grand Paris La Métropole de Lyon La Métropole Aix-Marseille-Provence Section 5. LA COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE Section 6. LA COOPÉRATION INTERRÉGIONALE Section 7. LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE SOUS-TITRE 3 LES AUTRES PERSONNES PUBLIQUES SPÉCIALISÉES Section 1. LA BANQUE DE FRANCE Section 2. LES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC Section 3. L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS SOUS-PARTIE 2 CHAPITRE 1 LES ORGANES DE DROIT PRIVÉ LES ORGANISMES PRIVÉS GÉRANT UN SERVICE PUBLIC Section 1. L'INVESTITURE CONTRACTUELLE Section 2. § 1. § 2. L'INVESTITURE LÉGALE OU RÉGLEMENTAIRE § 3. Section 3. CHAPITRE 2 L'apparition du phénomène Les catégories de personnes privées assumant le service public Régime juridique L'AIDE DE L'ADMINISTRATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL LES ENTREPRISES PUBLIQUES EN FORME DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES Section 1. LES SOCIÉTÉS NATIONALES Section 2. LES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE CHAPITRE 3 DEUXIÈME PARTIE LES ORDRES PROFESSIONNELS L'ACTION DE L'ADMINISTRATION TITRE 1 CHAPITRE 1 Section 1. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. A. B. C. § 7. § 8. A. B. § 9. Section 2. § 1. § 2. § 3. CHAPITRE 2 Section 1. § 1. § 2. § 3. LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ LA LÉGALITÉ EN PÉRIODE ORDINAIRE LES DIFFÉRENTES SOURCES DE LA LÉGALITÉ La Constitution Les lois organiques Les traités internationaux Les règles communautaires européennes La Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales La loi et le règlement Le domaine de la loi avant 1958 La distinction de la loi et du règlement dans la Constitution de 1958 La codification des lois et règlements Les ordonnances de l'article 38 La règle jurisprudentielle et les principes généraux du droit La jurisprudence Les principes généraux du droit Le pouvoir réglementaire LA HIÉRARCHISATION DES SOURCES DE LA LÉGALITÉ Le contrôle de la conformité des traités internationaux et du droit communautaire à la Constitution Le contrôle de la constitutionnalité des lois Le contrôle de la conformité de la loi aux traités internationaux LA LÉGALITÉ DANS LES PÉRIODES EXCEPTIONNELLES LA LÉGALITÉ DE CRISE ORGANISÉE PAR UN TEXTE L'article 16 de la Constitution L'état de siège L'état d'urgence Section 2. CHAPITRE 3 Section 1. § 1. § 2. Section 2. § 1. § 2. TITRE 2 LA THÉORIE JURISPRUDENTIELLE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LE PROBLÈME DES ACTES DE GOUVERNEMENT L'ÉVOLUTION DE LA CATÉGORIE DES ACTES DE GOUVERNEMENT Le mobile politique La liste des actes de Gouvernement L'INTERPRÉTATION DE CES SOLUTIONS L'introuvable acte de gouvernement L'acte de gouvernement exercice de la fonction gouvernementale LES MISSIONS DE L'ADMINISTRATION SOUS-TITRE 1 § 1. § 2. § 3. § 4. LA POLICE ADMINISTRATIVE Les buts de la police administrative Les procédés de police L'aménagement du pouvoir de police Les limites du pouvoir de police SOUS-TITRE 2 LE SERVICE PUBLIC CHAPITRE 1 THÉORIE GÉNÉRALE DU SERVICE PUBLIC Section 1. § 1. § 2. § 3. DÉFINITION Section 2. § 1. LE RÉGIME JURIDIQUE DES SERVICES PUBLICS § 2. Les diverses acceptions reçues Le service public et l'intérêt général Le service public relève d'une personne publique La remise en question de la définition du service public par la gestion publique Les principes fondamentaux du service public Section 3. SERVICES PUBLICS ET DROIT COMMUNAUTAIRE CHAPITRE 2 LES MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS Section 1. LES SERVICES EN RÉGIE Section 2. LES CONTRATS DE CONCESSION Section 3. LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. TITRE 3 CHAPITRE 1 Caractères généraux L'acte de concession Les obligations du concessionnaire Les droits du concessionnaire Le contentieux de la concession La fin de la concession LES ACTES DE L'ADMINISTRATION LA DÉCISION EXÉCUTOIRE Section 1. § 1. § 2. LA NOTION DE DÉCISION EXÉCUTOIRE Section 2. LA CLASSIFICATION DES DÉCISIONS EXÉCUTOIRES Section 3. LA SAISINE DE L'ADMINISTRATION Section 4. § 1. § 2. L'ÉLABORATION DE LA DÉCISION EXÉCUTOIRE Section 5. § 1. § 2. § 3. § 4. L'APPLICATION DE LA DÉCISION EXÉCUTOIRE Section 6. LA FIN DE LA DÉCISION EXÉCUTOIRE Actes juridiques, opérations matérielles et actes décisoires L'acte d'une autorité publique administrative La compétence La procédure d'élaboration de la décision L'entrée en vigueur L'accès aux documents administratifs L'absence de rétroactivité Les effets de la décision exécutoire Section 7. § 1. § 2. CHAPITRE 2 Section 1. § 1. § 2. LA VALIDITÉ DES DÉCISIONS EXÉCUTOIRES Les degrés dans l'invalidité La constatation de l'invalidité LES CONTRATS ADMINISTRATIFS CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS Critères du contrat administratif Le régime du contrat administratif Section 2. § 1. § 2. LA FORMATION DU CONTRAT ADMINISTRATIF Section 3. § 1. § 2. L'EXÉCUTION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS Section 4. § 1. § 2. LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Section 5. LA FIN DU CONTRAT ADMINISTRATIF TITRE 4 CHAPITRE 1 Les limitations apportées à la liberté contractuelle Les atteintes à l'égalité des contractants Les prérogatives de l'administration Le principe de l'équilibre financier du contrat La responsabilité contractuelle pour faute La responsabilité contractuelle sans faute LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE L'ÉVOLUTION DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Section 1. LA SITUATION INITIALE : L'IRRESPONSABILITÉ Section 2. L'ABANDON DE L'IRRESPONSABILITÉ Section 3. LA SUBSTITUTION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT À CELLE DE SON AGENT Section 4. L'AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ CHAPITRE 2 LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES PUBLIQUES Section 1. LE DOMMAGE Section 2. L'IMPUTABILITÉ CHAPITRE 3 LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE Section 1. LA FAUTE DU SERVICE Section 2. LE DEGRÉ DE GRAVITÉ DE LA FAUTE : LE PROBLÈME DE LA FAUTE LOURDE Section 3. LA PREUVE DE LA FAUTE CHAPITRE 4 LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE Section 1. LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE Section 2. LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE D'ORIGINE JURISPRUDENTIELLE Section 3. LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE D'ORIGINE LÉGISLATIVE Section 4. L'INDEMNISATION DES VICTIMES DU SIDA Section 5. L'AVENIR DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE Section 6. L'INDEMNISATION DE L'ALÉA THÉRAPEUTIQUE CHAPITRE 5 LA RESPONSABILITÉ DES AGENTS POUR FAUTE PERSONNELLE Section 1. LA FAUTE PERSONNELLE Section 2. LES MODALITÉS DE L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT CHAPITRE 6 LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT EN DEHORS DE L'ACTION DU POUVOIR EXÉCUTIF Section 1. RESPONSABILITÉ À RAISON DES ACTES DU POUVOIR LÉGISLATIF Section 2. RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE TROISIÈME PARTIE TITRE 1 LE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION LE CONTRÔLE NON JURIDICTIONNEL DE L'ADMINISTRATION Section 1. § 1. § 2. § 3. LE CONTRÔLE INTERNE À L'ADMINISTRATION Section 2. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. LE DÉFENSEUR DES DROITS Section 3. LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DE L'ADMINISTRATION TITRE 2 LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L'ADMINISTRATION Les recours administratifs Les corps d'inspection La mise en jeu de la responsabilité disciplinaire Nomination et statut Organisation Compétence Saisine Pouvoirs du Défenseur Appréciation CHAPITRE 1 LA DUALITÉ DES ORDRES DE JURIDICTION Section 1. L'ORIGINE DE LA DUALITÉ DES ORDRES DE JURIDICTION Section 2. § 1. § 2. § 3. LE TRIBUNAL DES CONFLITS Section 3. LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION Composition Fonctionnement Compétences Sous-section 1. Sous-section 2. § 1. § 2. CHAPITRE 2 Les règles législatives Les règles jurisprudentielles L'évolution du critère de compétence Le système actuel de répartition des compétences LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Section 1. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. L'ÉVOLUTION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE Section 2. LES TRAITS GÉNÉRAUX DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE Séparation des juges administratifs et des administrateurs actifs Compétence consultative des juridictions administratives Caractère constitutionnel de la juridiction administrative § 1. § 2. § 3. La réforme de 1953 La réforme de 1987 Les réformes de 1995 Les réformes de 2016 Les problèmes actuels La prévention du contentieux Section 3. § 1. § 2. § 3. LE CONSEIL D'ÉTAT Section 4. § 1. § 2. § 3. § 4. LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Section 5. § 1. LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS La composition du Conseil d'État L'organisation du Conseil d'État Les attributions du Conseil d'État Composition et organisation Recrutement Carrière et statut Compétence Organisation § 2. § 3. CHAPITRE 3 Recrutement et statut Attributions LES RECOURS CONTENTIEUX Section 1. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES RECOURS CONTENTIEUX Section 2. LES DIVERS TYPES DE RECOURS CONTENTIEUX Section 3. Sous-section 1. Sous-section 2. § 1. § 2. § 3. § 4. Sous-section 3. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. Sous-section 4. § 1. § 2. § 3. CHAPITRE 4 Section 1. § 1. § 2. LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR Développement et caractères Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir La nature de l'acte La personne du requérant Procédure, formes, délais Absence de recours parallèle Les cas d'annulation Généralités L'incompétence Le vice de forme Le détournement de pouvoir La violation de la loi Le jugement du recours Les particularités de la procédure Contenu et effets du jugement Les voies de recours LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES TRAITS GÉNÉRAUX Les principes Caractères généraux Section 2. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. Section 3. LES GRANDES LIGNES DE L'INSTANCE La règle de la décision préalable L'introduction de l'instance Les mesures d'urgence : les référés L'instruction de l'affaire Le jugement LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CONCLUSION GÉNÉRALE INDEX ALPHABÉTIQUE ABRÉVIATIONS AJDA C. marchés CRPA CAA Cons. const. CE CEDH CGCT Chron. CJA CJEG CJCE CJUE D. Dr. adm. Dr. soc. DS EDCE GACA GAJA Gaz. Pal. GDCC JCP JO LPA Nouv. cah. CC PFRLR RD publ. Rec. Rev. adm. RFAP RFDC RFDA RID comp. RISA RPDA Actualité juridique, Droit administratif Code des marchés publics Code des relations entre le public et l'administration Cour administrative d'appel Conseil constitutionnel Conseil d'État Cour européenne des droits de l'homme Code général des collectivités territoriales chronique Code de justice administrative Cahiers juridiques électricité-gaz Cour de justice des Communautés européennes Cour de justice de l'Union européenne Recueil Dalloz Droit administratif Droit social Recueil Dalloz-Sirey Études et documents du Conseil d'État Les grands arrêts du contentieux administratif Les grands arrêts de la jurisprudence administrative Gazette du Palais Les grandes décisions du Conseil constitutionnel J.-Cl. périodique Journal officiel de la République française Les Petites Affiches Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République Revue du droit public Recueil des arrêts du Conseil d'État (Lebon) Revue administrative Revue française d'administration publique Revue française de droit constitutionnel Revue française de droit administratif Revue internationale de droit comparé Revue internationale des sciences administratives Revue pratique de droit administratif RRJ RTD com. RTD eur. S. Revue de la recherche juridique – Droit prospectif Revue trimestrielle de droit commercial Revue trimestrielle de droit européen Recueil Sirey TA T. confl. Tribunal administratif Tribunal des conflits PRÉFACE DE LA 22 ÉDITION E Cette 22 édition du Précis Dalloz de Droit administratif se situe dans la continuité de l'ouvrage de Jean Rivero. Selon le vœu qu'il avait lui-même formulé celui-ci a été refondu afin de suivre au plus près les évolutions qui ont marqué le droit administratif au cours des dernières décennies et selon un plan d'exposé le plus simple possible. Cette nouvelle édition s'efforce donc de rester fidèle à la méthode didactique à laquelle Jean Rivero était si passionnément attaché : s'en tenir à l'essentiel, insister sur les notions fondamentales – même si cela devient de plus en plus difficile compte tenu de l'évolution de notre système administratif – mais aussi, suivre au plus près les mutations profondes que connaît actuellement le droit administratif français. Ainsi, cet ouvrage doit beaucoup à Jean Rivero qui y reste très présent tant par la pensée que par l'écriture, et s'efforce de rester fidèle au grand juriste et à l'Homme qu'il a été. Mais, les années ayant passé, il n'est plus possible de le mentionner expressément en tant qu'auteur, ce qui conduirait à lui imputer des positions sur lesquelles, par la force des choses, il n'a pas pu se prononcer. e 1 Jean Waline PRÉLIMINAIRES I. – Le présent volume correspond à l'enseignement du droit administratif général tel qu'il est programmé en deuxième année de DEUG dans les Facultés de Droit. La plupart des concours administratifs ne s'en écartent guère mais en raison de ceux-ci, une place importante a été donnée à la description de l'organisation administrative française. II. – Il n'y a, pour l'exposé d'une matière, qu'un bon plan : celui dans lequel chaque chapitre s'appuie sur les connaissances acquises dans les chapitres antérieurs, et n'anticipe pas sur les développements suivants. Il est malheureusement impossible de présenter le droit administratif selon cette méthode : l'allusion à ce qui ne sera analysé que plus tard y est, dès le début, fréquente et inévitable. C'est pourquoi une longue introduction, destinée à initier le lecteur, dès l'abord, aux notions fondamentales, a paru nécessaire ; les étudiants sont parfois portés à négliger ces préliminaires : c'est vouloir entrer dans une maison tout en en refusant les clefs ; on peut y parvenir, mais cela demande beaucoup plus d'efforts. Cette présentation synthétique des grands principes qui fondent le droit administratif, que l'on trouvera dans l'introduction générale, est, pour cette raison, intitulée « Les clefs du droit administratif ». III. – L'ouvrage étudiera, en trois parties, les organes de l'action administrative, puis les règles qui commandent l'action de l'Administration et, enfin, le contrôle de l'Administration. IV. – Dès les premières pages de tout ouvrage de droit administratif, on est amené à citer des arrêts de jurisprudence. Il faut donc avertir le lecteur non initié que la jurisprudence joue, en droit administratif, un rôle plus créateur qu'en droit privé. V. – Dans la plupart des universités les questions relatives aux personnes et aux biens que l'administration utilise pour son action font l'objet d'un enseignement distinct et plus tardif, dispensé pendant les troisième et quatrième années des études juridiques. Mais la théorie générale à laquelle est consacré cet ouvrage ne peut éviter les allusions à ces questions. Que le lecteur soit donc averti : 1 que l'action de l'administration est exercée par des personnes physiques, les agents publics, régis par des statuts assez divers, les principaux d'entre eux o ayant la qualité de fonctionnaires publics soumis au Statut Général de la Fonction publique. 2 que cette action requiert une masse considérable de biens de toute nature, dont les plus importants constituent le domaine public. Les immeubles qui en font partie peuvent être acquis par le procédé autoritaire de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Leur aménagement et leur entretien constituent des travaux publics soumis à un régime particulier. VI. – Cet ouvrage a été rédigé avec le parti pris de s'en tenir à l'essentiel, même si cela devient de plus en plus difficile en raison de la complexité croissante de notre système administratif. On juge inutile, dans un « Précis », d'embarrasser les étudiants en leur proposant à la fois des détails de réglementation ou de jurisprudence appelés à de fréquents changements, et des notions fondamentales qui, elles, évoluent beaucoup plus lentement. C'est de celles-ci, et d'elles seules, que cet ouvrage voudrait faciliter la compréhension, car c'est à partir d'elles que peuvent se comprendre les réformes incessantes et profondes qui affectent aujourd'hui la discipline. VII. – Depuis maintenant beaucoup plus d'une décennie, en effet, les réformes ne cessent de se multiplier. Tout d'abord en raison d'une véritable boulimie législative qui accumule des textes trop souvent pointillistes et mal rédigés. Mais aussi en raison du développement du droit communautaire qui devient une source de plus en plus importante du droit administratif. C'est une raison de plus pour maintenir la ligne de conduite définie plus haut, et s'attacher, plutôt qu'aux réglementations qui passent, aux notions fondamentales dont la connaissance seule permet de prendre la mesure des réformes qui peuvent les mettre en cause. o BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE On signalera, à propos des diverses questions, les principaux ouvrages ou articles qui leur sont consacrés. On se bornera à indiquer ici les livres qui traitent du droit administratif dans son ensemble, et les revues ou recueils qui constituent les instruments de base de tout travail en ce domaine. A. Traités et précis 1 Ouvrages récents ou régulièrement mis à jour : – Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, Tome I (Théorie générale), 16 éd., 2001 ; T. II, 14 éd., 2011 ; T. III, A. de Laubadère et J.C. Venezia, 6 éd., 1997 ; T. V, 11 éd. L'ensemble forme le tableau le plus complet du droit administratif français. Droit administratif, LGDJ, 21 éd., 2015 – G. Braibant et B. Stirn, Le Droit administratif français, 7 éd., 2005. – R. Chapus, Droit administratif général, T. I, 15 éd., 2001 (le tome II, 15 éd., 2001 porte sur le programme de III année). – J. Morand-Deviller, Cours de droit administratif, 2017. – Ch. Debbasch et Fr. Colin, Droit administratif, 9 éd., 2010. – G. Dupuis, M.-J. Guédon et P. Chrétien, Droit administratif, 10 éd. 2007. – M. Rougevin-Baville, R. Denoix de Saint-Marc, D. Labetoulle, Leçons de droit administratif, 1989. – J.-M. de Forges, Droit administratif, 4 éd., 1998. – Ch. Guettier, Droit administratif, 3 éd., 2009. – J.F. Lachaume, H. Pauliat, S. Braconnier et C. Deffigier, Droit administratif, 17 éd. 2017. J.F. Lachaume, H. Pouliat, C. Boiteau, C. Deffigier, Droit des services publics, 2 éd. 2015 – M. Lombard, G. Dumont et J. Sirinelli, Droit administratif, 12 éd. 2017. – B. Plessix, Droit administratif général, 2016. – J.-Cl. Ricci, Droit administratif général, 5 éd. 2013 – J. L. Autin et C. Ribot, Droit administratif général, 4 éd. 2005. – P. L. Frier et J. Petit, Précis de droit administratif, LGDJ, 2017, 11 éd. – Gonod, Melleray et Yolka, Traité de droit administratif, Dalloz, 2011. – B. Seiller, Droit administratif, 2016. o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e – M. C. Rouault, Droit administratif, 2013. – D. Truchet, Droit administratif, 2017. Le volume de la Collection « Que sais-je ? », n 1152 consacré au Droit administratif par P. Weil et D. Pouyaud est une excellente introduction à la matière (2017). Dans le même esprit : Pierre Delvolvé, Le droit administratif, 6 éd. 2014, et B. Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, 8 éd. 2015. On consultera aussi, en raison de l'étroite liaison entre la théorie générale et le contentieux administratif, les ouvrages suivants : – R. Odent, Cours de contentieux administratif, 6 fascicules, 1981. – J.-M. Auby et R. Drago, Traité de contentieux administratif, 2 vol., 3 éd., 1984. – J.-M. Auby et R. Drago, Traité des recours en matière administrative, 1992. – R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13 éd., 2008. – Ch. Debbasch et J.-C. Ricci, Contentieux administratif, 8 éd. – O. Gohin, Contentieux administratif, 9 éd., 2017. – B. Pacteau, Traité de contentieux administratif, 2008. – B. Pacteau, Contentieux administratif, 7 éd. 2005. – D. Turpin, Contentieux administratif, 5 éd., 2010. – J. Lemasurier, Le contentieux administratif en droit comparé, 2001. – G. Darcy et M. Paillet, Contentieux administratif, 2001. – M. Guyomar et B. Seiller, Contentieux administratif, 2017. – A. Courrèges et S. Daël, Contentieux administratif, 4 éd. 2013. – C. Broyelle, Contentieux administratif, 2017. – J.-Cl. Ricci, Contentieux administratif, 2016. Il faut attirer l'attention des étudiants sur la nécessité de travailler sur la plus récente édition d'un ouvrage : la très grande rapidité de l'évolution jurisprudentielle et législative imposant de constantes mises à jour. 2 Parmi les traités ou précis qui ne sont plus à jour, ceux qui sont cités ici conservent une grande importance, par la valeur de leurs analyses juridiques, qui gardent leur actualité. Ce sont, d'après l'ordre chronologique de leur dernière édition : – É. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, 2 vol., 1896. – L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 5 vol., 1921, 1928 (l'ouvrage fait une large place au droit administratif). – M. Hauriou, Précis de droit administratif, 12 éd., 1933. – G. Jèze, Principes généraux du droit administratif, 6 vol., 1925-1936. – H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, 13 éd., 1933, complété par : H. Berthélemy et Jean Rivero, Cinq ans de réformes o e e e e e e e e e o e e administratives, 1933-1938. – R. Bonnard, Précis de droit administratif, 4 éd., 1943. – P. Duez et G. Debeyre, Précis de droit administratif, 1952, mise à jour 1954. – L. Rolland, Précis de droit administratif 11 éd., 1957. – M. Waline, Droit administratif, Sirey, 9 éd., 1963 ; Précis de droit administratif, T. I, 1969 ; T. II, 1970. – F.-P. Bénoit, Le droit administratif français, 1968. – J. Moreau, Droit administratif, 1989. – G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, 12 éd., 1992, 2 vol. 3 On consultera avec profit les Cours polycopiés de doctorat de droit administratif de la Faculté de Droit de Paris. Ceux de Ch. Eisenmann (1948 à 1973) ont été réunis et publiés en 2 volumes, 1982. 4 A. Van Lang, G. Gondouin et V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 7 éd. 2015 – C. Guettier, Droit administratif (sous forme de dictionnaire), 6 éd., 2011. e e e e o o e e B. Répertoires et collections Les principaux répertoires sont le Répertoire de droit public et administratif (2 vol.), dans le cadre de l'Encyclopédie juridique Dalloz, le Répertoire Dalloz de contentieux administratif, sous la direction de MM. Gazier et Drago, le Répertoire Dalloz des collectivités locales, sous la direction de M. Bénoit, le Répertoire Dalloz de la responsabilité de la puissance publique, le J.-Cl. administratif (10 vol.) et le J.-Cl. Collectivités Territoriales. La « Bibliothèque de droit public » est une collection qui publie les principales thèses de droit administratif depuis 1956. C. Mélanges On désigne sous ce nom des recueils collectifs d'études publiés en hommage à un maître ou à une institution, et qui abordent, dans la discipline à laquelle ils se sont consacrés, des sujets très variés. Pour le droit administratif, les principaux sont : Livre jubilaire pour le 150 anniversaire du Conseil d'État, 1952 ; L'évolution du droit public, Mélanges Achille Mestre, 1956 ; Mélanges Louis Trotabas, 1970 ; Mélanges Michel Stassinopoulos, 1974 ; Mélanges Marcel Waline, 2 vol., 1974 ; Mélanges Charles Eisenmann, 1975 ; Mélanges Paul Couzinet, 1975 ; Mélanges Georges Burdeau, 1977 ; Mélanges Robert Pelloux, 1980 ; Mélanges Robert Charlier, 1981 ; Mélanges Claude-Albert e Colliard, 1984 ; Mélanges Paul-Marie Gaudemet, 1984 ; Mélanges Georges Péquignot, 1984 ; Mélanges Jean Boulouis, 1991 ; Mélanges René Chapus, 1992 ; Mélanges Jean-Marie Auby, 1992 ; Mélanges Guy Braibant, 1996 ; Mélanges Roland Drago, 1996 ; Mélanges Georges Dupuis, 1997 ; Mélanges Gustave Peiser, 1995 ; Mélanges Jacques Robert, 1998 ; Mélanges Pierre Sandevoir, 2000 ; Mélanges Jean Waline, 2002 ; Mélanges Louis Dubouis, 2002 ; Mélanges Benoît Jeanneau, 2002 ; Mélanges Jacques Moreau, 2003 ; Mélanges Franck Moderne, 2004 ; Mélanges Paul Amselek, 2005 ; Mélanges Gérard Timsit, 2004 ; Mélanges Michel Guibal (contrats publics), 2006 ; Mélanges Daniel Labetoulle, 2007 ; Mélanges Jean-François Lachaume, 2007 ; Mélanges Michel Prieur, 2007 ; Mélanges Jacqueline MorandDeviller, 2008 ; Mélanges Yves Jégouzo, 2009 ; Mélanges Jean-Arnaud Mazeres, 2009 ; Mélanges Jean-Paul Costa, 2011 ; Mélanges Étienne Fatôme ; 2011 ; Mélanges Laurent Richer, 2013 ; Mélanges Marceau Long, 2016. Les principaux articles publiés par les professeurs de Laubadère, Mathiot, Rivero et Vedel ont été réunis sous le titre Pages de Doctrine, 1980. D. Revues Les principales publications périodiques exclusivement consacrées au droit administratif sont l'Actualité juridique (droit administratif) qui donne chaque semaine, outre des articles de doctrine, le texte des principaux arrêts et une vue d'ensemble de l'évolution législative et jurisprudentielle en matière administrative et, depuis 1984, la Revue française de droit administratif, bimestrielle. D'autre part, l'importante Revue du droit public et de la science politique fait au droit administratif une large place. La Revue administrative, la Revue internationale des sciences administratives, la Revue française d'administration publique s'orientent plutôt vers les méthodes et l'organisation des administrations, sans négliger pour autant leurs aspects juridiques. Droit social, la Revue internationale de droit comparé, LPA, Les Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz, publient également des articles de droit administratif. Cf. aussi les chroniques du Recueil Dalloz, qui lui sont parfois consacrées. Enfin, le Conseil d'État, depuis 1947, publie, sous le titre Études et documents, un recueil annuel qui est une source précieuse de doctrine et d'informations. De même paraissent, sous l'égide du Conseil constitutionnel, les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel (Dalloz). E. Jurisprudence L'étude des arrêts est fondamentale pour le droit administratif. Le Lebon paraît sous l'autorité du Conseil d'État mais seules les décisions les plus importantes du Conseil d'État y sont désormais publiées ainsi que les décisions du Tribunal des conflits (1 vol. par an). Le Recueil des décisions du Conseil constitutionnel paraît chaque année. Les recueils de jurisprudence publient, à un rythme plus rapide, des décisions importantes, accompagnées en général, soit des conclusions du Rapporteur public, soit d'une note doctrinale : Recueil Dalloz, Recueil Sirey (fusionnés depuis 1965), Semaine juridique (dite aussi Jurisclasseur périodique), Gazette du Palais. Cf. surtout les arrêts commentés, et les analyses de jurisprudence, de l'Actualité juridique (Droit administratif) et de la Revue française de droit administratif, et aussi ceux de la Revue du droit public et de la science politique. Le meilleur commentaire de la jurisprudence entre 1889 et 1926 est constitué par les notes d'arrêts d'Hauriou, recueillies en 3 volumes sous le titre : La jurisprudence administrative. Les notes d'arrêt de Marcel Waline ont été publiées par les éditions Dalloz en trois volumes (avec une préface de Daniel Labetoulle). Enfin, les arrêts les plus importants sont réunis et commentés dans l'ouvrage de MM. Long, Weil, Braibant, Delvolvé et Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 21 éd., 2017, qui constitue, pour les étudiants, le complément nécessaire du cours ou du manuel. C'est à la dernière édition de cet ouvrage que renvoient les références données dans ce précis pour ceux des arrêts cités qui y sont rapportés sous le numéro qui leur est attribué. Dans la même collection, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est présentée dans un ouvrage créé par MM. Favoreu et Philipp, par P. Gaïa, R. Chevontian, F. Mélin– Soucramanien, E. Oliva et A. Roux, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 18 éd. 2016. Voir également, L. Touvet, J. Ferstenbert et C. Cornet, Les grands arrêts du droit de la décentralisation, 2 éd., 2001 ; C. Franck, Les grandes décisions de la jurisprudence, droit constitutionnel, 2 éd., 2001 ; B. Genevois, La jurisprudence du Conseil constitutionnel, Principes directeurs, STH, 1988 ; J.-Cl. Bonichot, P. Cassia et B. Poujade, Les grands arrêts du contentieux administratif, 6 éd. 2018 ; C. Chamard-Heim, F. Melleray, R. Noguellou et Ph. Yolka : Les grandes décisions du droit administratif, 2013. e e e e e F. Textes La Librairie Dalloz publie régulièrement un « Code administratif » (37 éd., 2014) qui contient les principaux textes législatifs et réglementaires concernant e le droit administratif accompagnés d'un commentaire fort complet. – J. M. et Y. B. Auby, Code de droit public, 1985. – B. Stirn et S. Formery, Code de l'Administration commenté, Litec, 3 éd. 2008. – Th. S. Renoux et M. de Villiers, Code constitutionnel, Litec, 1994. – M. Lascombe, Code constitutionnel et des droits fondamentaux, 1 éd., 2012. e re G. Avis – Y. Gaudemet, B. Stirn, Th. Dal Farra, F. Rolin, Les grands avis du Conseil d'État, Dalloz, 3 éd., 2008. e H. Droit administratif européen – J.-B. Auby et J. Dutheil de la Rochère, Droit administratif européen, Bruylant, 2 éd., 2014. – M. Fromont, Droit administratif des États européens, 1 éd., 2006. – B. Stirn, Vers un droit public européen, 2 éd. LGDJ, « Clefs ». – B. Stirn et Y. Aguila, Droit public français et européen, 2 éd., Sciences Po Les Presses. e re e e I. Bases de données juridiques Depuis 1984 le service public des bases de données juridiques est chargé de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatiques la production jurisprudentielle et normative française et communautaire. Le site Internet Legifrance a vocation à diffuser gratuitement les données juridiques publiques (www. legifrance. gouv. fr). Ce site permet d'accéder, notamment à : – www.journal-officiel.gouv.fr – www.conseil-etat.fr – www.service-public.fr – www.conseil-constitutionnel.fr La librairie Dalloz a mis en place le site : – www.dalloz.fr INTRODUCTION GÉNÉRALE Le droit administratif, dont on entreprend l'exposé dans le présent ouvrage, n'est qu'une partie – même si celle-ci est particulièrement importante – du droit public français qui avec le droit privé, constitue le système juridique de notre Pays. Encore faut-il préciser, comme l'a relevé Ch. Eisenmann que cette distinction classique du droit public et du droit privé n'est qu'une division d'objets d'étude ou d'enseignement dépourvue de prétention scientifique . Mais il faut immédiatement souligner avec force que le contexte dans lequel se développe le système juridique français qui les réunit connaît depuis plusieurs décennies une très profonde mutation dont on ne soulignera jamais assez l'importance. En effet selon un système bien établi l'ensemble de nos règles de droit intervenait dans le cadre d'un État souverain. Pour reprendre la formule de Carré de Malberg : « Quand on dit que l'État est souverain, il faut entendre par là que, dans la sphère où son autorité est appelée à s'exercer, il détient une puissance qui ne relève d'aucun autre pouvoir et qui ne peut être égalée par aucun autre pouvoir ». Le propre de l'État était donc d'être souverain ce qu'affirmaient déjà les anciens juristes français, à l'instar, par exemple, de Loyseau au début du XVII siècle : « La souveraineté de l'État est du tout inséparable de l'État ». Or, la construction européenne a mis fin à ce système séculaire ; pour n'en donner qu'un seul exemple, sur la base du Traité de Maastricht l'euro, monnaie unique se substituant au franc, est entré en vigueur en France à compter du 1 janvier 1999, alors que l'un des attributs les plus caractéristiques de la souveraineté de l'État est précisément le droit de battre monnaie. Ainsi, pour reprendre l'expression citée par J.-Cl. Groshens , nous assistons à la « désouverainisation » de l'État. De plus en plus souvent le droit administratif – comme d'ailleurs les autres branches du droit – se trouve soumis à des règles qui s'imposent à nous de l'extérieur et qui ne sont que la conséquence des abandons de souveraineté consentis au profit de l'Union européenne (v. ss 320 s.). Cela modifie profondément l'esprit et les règles de l'ensemble du droit administratif français. 2 3 e er 4 SECTION 1. DÉFINITIONS ET NOTIONS DE BASE Le droit administratif apparaît, de prime abord, comme la branche du droit public qui régit l'administration. Mais cette formule approximative doit être précisée ; pour ce faire, il est indispensable de définir l'administration et l'évolution de cette notion (§ 1), et d'analyser les rapports entre l'administration et le droit (§ 2). § 1. L'Administration 1 Les acceptions courantes du mot ◊ Dans la langue courante, le mot désigne tantôt une activité – le fait d'administrer, c'est-à-dire de gérer une affaire – tantôt l'organe – ou les organes – qui exercent cette activité. On dit : « la bonne administration de telle entreprise », et aussi « il est entré dans l'administration des Finances ». Dans ces deux sens – dont le premier est dit « matériel », le second « organique » – le mot s'emploie aussi bien pour les affaires privées que pour les affaires publiques : l'un des organes directeurs des sociétés anonymes porte le nom de « Conseil d'administration ». Mais, en un sens plus étroit, et aussi plus courant, c'est à l'administration publique seule que ce mot se rapporte : quand on parle en France de « l'Administration » tout court, avec une majuscule, on entend désigner un ensemble d'organes par lesquels sont conduites et exécutées des tâches publiques. Dans cette perspective, l'administration est conçue tout à la fois comme essentiellement différente de l'activité des particuliers et comme distincte de certaines autres formes de l'activité publique : la législation, l'exercice de la Justice. C'est dans ces deux directions – par rapport à l'action des particuliers, par rapport aux autres activités publiques – qu'il faut préciser le concept d'administration. 2 A. Administration et action des particuliers ◊ Comme toute activité humaine, l'une ou l'autre poursuivent un but en mettant en œuvre certains moyens : mais, sur ces deux terrains, leurs différences s'accusent, même si l'on admet de plus en plus souvent que le but poursuivi par l'administration publique, et les moyens nécessaires à leur réalisation, peuvent être confiés à des particuliers. 3 1 Le but de l'administration : l'intérêt public ◊ Être social, l'homme o 5 ne peut se suffire à lui-même. Le libre jeu des initiatives privées lui permet de pourvoir à certains de ses besoins, grâce à la division du travail et aux échanges, mais il en est d'autres, et des plus essentiels, qui ne peuvent recevoir satisfaction par cette voie soit que, communs à tous les membres de la collectivité, ils excèdent par leur ampleur les possibilités de n'importe quel particulier – ainsi du besoin de défense nationale – soit que leur satisfaction soit par nature exclusive de tout profit, de telle sorte que nul ne s'offrira à l'assurer. Ces nécessités auxquelles l'initiative privée ne peut répondre, et qui sont vitales pour la communauté tout entière et pour chacun de ses membres, constituent le domaine propre de l'administration, c'est la sphère de l'intérêt public. Le moteur normal de l'action des particuliers est la poursuite d'un avantage personnel – profit matériel, réussite humaine, ou, chez les plus désintéressés, mise en accord de leurs actes avec un idéal –. Souvent, il y a coïncidence entre le but ainsi poursuivi et le bien de tous. Mais la coïncidence n'est nullement nécessaire, et elle ne saurait masquer le caractère personnel de l'entreprise privée : le boulanger assure la satisfaction du besoin de pain qui est important dans la collectivité française, mais ce n'est pas le souci désintéressé de nourrir les affamés qui a dicté sa vocation, c'est l'intention – d'ailleurs entièrement légitime – de gagner sa vie en vendant du pain. Le moteur de l'action administrative, au contraire, est essentiellement désintéressé : c'est la poursuite de l'intérêt général, ou encore de l'utilité publique, ou, dans une perspective plus philosophique, du bien commun. L'intérêt général n'est donc pas l'intérêt de la communauté, considérée comme une entité distincte de ceux qui la composent et supérieure à eux. C'est, plus simplement, un ensemble de nécessités humaines – celles auxquelles le jeu des libertés ne pourvoit pas de façon adéquate, et dont la satisfaction conditionne pourtant l'accomplissement des destinées individuelles. La délimitation de ce qui entre dans l'intérêt général varie avec les époques, les formes sociales, les données psychologiques, les techniques ; pourtant, si le contenu varie, le but reste le même : l'action administrative tend à la satisfaction de l'intérêt général . Mais ce but n'exclut pas la recherche d'une gestion attentive à la rentabilité et même au profit là où il est possible. Il y a aujourd'hui une tendance à inclure dans la poursuite de l'intérêt général une préoccupation d'ordre économique qui entraîne un certain rapprochement avec les activités privées. 6 4 2 Les moyens de l'action administrative : les prérogatives de puissance publique ◊ À la différence des buts correspond une différence o des moyens. Les relations entre particuliers sont fondées sur le postulat de l'égalité juridique. Nulle volonté privée n'est, par essence, supérieure à une autre, de telle sorte qu'elle puisse s'imposer à elle contre son gré. C'est pourquoi l'acte qui caractérise les rapports privés est le contrat, c'est-à-dire l'accord des volontés. L'administration, elle, doit satisfaire à l'intérêt général. Dans les rapports entre l'Administration et les particuliers il y a donc en présence l'intérêt général – incarné par l'Administration – et des intérêts particuliers – ceux des administrés. Cette fois-ci le principe ne peut plus être celui de l'égalité car il faut, bien sûr, faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers, aussi honorables que ceux-ci puissent être. Si, par exemple, l'Administration a absolument besoin d'un terrain appartenant à un particulier pour construire un ouvrage qui servira à l'ensemble de la collectivité, et que son propriétaire refuse de le vendre à l'amiable, il faut donner à l'Administration les moyens de contraindre le particulier à le lui céder, dans des conditions donnant toutes les garanties nécessaires au propriétaire. L'Administration a donc reçu le pouvoir de vaincre les résistances des particuliers au moyen d'un certain nombre de prérogatives de puissance publique c'est-à-dire de privilèges qu'on lui reconnaît pour faire prévaloir l'intérêt général lorsqu'il se trouve en conflit avec des intérêts particuliers (v. ss 37). Pour n'en citer qu'un seul ici, l'Administration a le privilège de la décision exécutoire c'est-à-dire le pouvoir de prendre unilatéralement des décisions qui s'imposent aux particuliers même sans leur consentement (v. ss 426 s.). Mais le recours à des procédés autoritaires n'est pas toujours nécessaire. Lorsque, dans la poursuite de l'intérêt général, la volonté de l'administration rencontre celle des particuliers, elle peut utiliser la technique du contrat, ce qui se produit de plus en plus souvent. L'Administration doit donc réduire au strict minimum nécessaire le recours aux procédés de puissance publique. 7 5 3 L'évolution de la notion d'administration publique ◊ Traditionnellement les tâches d'administration publique, c'est-ào 8 dire les activités visant à la satisfaction des besoins d'intérêt public, étaient confiées à des personnes publiques, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics (v. ss 237). C'était la conception organique de l'Administration qui permettait aisément de la distinguer des personnes de droit privé. Mais, de plus en plus souvent, on en est venu à confier des tâches d'administration publique à des personnes morales de droit privé, ou à de simples particuliers. C'est l'abandon du critère organique : il y a des « tâches administratives » et celles-ci peuvent être confiées soit à des personnes publiques – ce qui naturellement reste l'hypothèse de base – soit à des personnes privées . 9 10 La description de l'administration publique englobe donc l'étude des personnes de droit public et de droit privé qui en ont la charge. 6 B. L'administration dans l'ensemble des activités publiques ◊ Si l'on reprend la célèbre trilogie de Locke et Montesquieu, il y a dans l'État trois pouvoirs – le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif – correspondant aux trois missions qui lui incombent : légiférer, juger, gouverner. L'administration doit donc être distinguée de la législation, de la juridiction, et au sein du pouvoir exécutif du gouvernement. a) Légiférer, c'est poser des règles générales et impersonnelles qui régissent dans la communauté nationale l'ensemble des activités, privées ou publiques ; le législateur a achevé son œuvre lorsque la loi entre en application, c'est-àdire lorsqu'elle a été promulguée. Dans les régimes parlementaires, fondés sur une séparation nuancée des pouvoirs, c'est l'exécutif, et plus spécialement le gouvernement, qui est placé à la tête de l'administration. Mais le Parlement joue pourtant dans la vie administrative un rôle essentiel : son action législative s'étend aux lois proprement administratives, qui donnent à l'administration sa structure, ses buts et ses moyens. Son rôle budgétaire lui assure la maîtrise des crédits qui commandent chaque année l'action administrative ; enfin, le contrôle qu'il exerce sur le gouvernement et sur l'Administration s'étend à la façon dont ceux-ci conduisent leur action. b) Juger, c'est appliquer le droit à la solution des litiges. C'est dire que le juge n'intervient qu'en cas de contestation, et que son rôle est terminé lorsqu'il a rappelé la règle applicable au cas litigieux et énoncé les conséquences qui en résultent dans l'espèce. Ainsi, il intervient indirectement dans l'administration, par le jugement des litiges qu'elle suscite. En France, l'existence d'une juridiction spécialisée dans les litiges administratifs aboutit à conférer à cette action du juge à l'égard de l'administration une influence primordiale. c) Gouverner est la mission qui revient au pouvoir exécutif. Malheureusement il est assez difficile de marquer la limite exacte entre gouvernement et administration. Gouverner c'est exercer les grandes options politiques, prendre les décisions essentielles qui engagent l'avenir national ; administrer est quelque chose de beaucoup plus quotidien et de beaucoup plus technique : c'est prendre toutes les décisions nécessaires pour mettre en œuvre, rendre effectives, les décisions politiques du gouvernement. Cela va jusqu'aux actes les plus humbles : la tournée du facteur, le geste de l'agent qui règle la circulation. Il ne faut jamais oublier que les grandes décisions qui sous-tendent l'action de l'Administration sont des décisions politiques – d'où la célèbre formule que, parfois, « l'intendance ne suit pas ». Seulement il est très difficile de déterminer la frontière exacte entre les deux domaines d'autant plus que ce sont parfois les mêmes organes qui ont en charge tout à la fois le gouvernement et l'administration : par exemple, les ministres. Telle nomination de haut fonctionnaire aura une portée gouvernementale si elle marque un changement de politique, ou une signification purement administrative. La distinction n'a donc pas de portée juridique. 7 Définition ◊ Au terme des développements qui précèdent, l'administration apparaît donc comme l'activité par laquelle les autorités publiques, et parfois privées, pourvoient, en utilisant le cas échéant des prérogatives de puissance publique, à la satisfaction des besoins d'intérêt public. § 2. Le droit administratif 11 Il y a nécessairement un certain rapport entre l'action administrative et le droit mais ce rapport n'est ni nécessaire, ni constant. Il faut donc en préciser la nature. L'Administration est soumise au droit ce qui, dans une perspective historique, n'a pas toujours été le cas (v. ss 39). Cette liaison de l'Administration par la règle de droit c'est ce que l'on appelle le principe de légalité (v. ss 40). Les règles qui s'imposent à l'Administration sont, tout à la fois, de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses – nationales ou internationales. L'existence d'un droit administratif entendu comme le droit applicable à l'Administration pose trois problèmes : – celui de son contenu, c'est-à-dire de l'autonomie du droit administratif ; – celui de sa codification ; – celui de son caractère jurisprudentiel. 8 A. L'autonomie du droit administratif ◊ L'Administration peut-elle être soumise aux mêmes règles de droit que les particuliers, ou doit-elle être soumise à des règles spécifiques ? En France, elle est parfois soumise au même droit que les particuliers mais, le plus souvent, soumise à des règles dérogatoires à celles-ci que l'on désigne alors sous l'appellation de « droit administratif stricto sensu ». 9 1 L'Administration soumise au même droit que les particuliers ◊ Le principe de la soumission de l'administration au droit o n'entraîne pas nécessairement l'existence d'un droit administratif pris au sens de droit spécial à l'administration. Elle peut être régie par le même droit que les particuliers, c'est-à-dire par le droit privé. Dans ce cas il y a bien soumission de l'administration au droit mais non pas droit administratif stricto sensu. Pour prendre un exemple à l'étranger, l'administration anglaise est longtemps restée soumise, en principe, au même droit que n'importe quel particulier britannique. Il y a, en Angleterre, comme dans tous les pays, des lois qui organisent l'administration, décrivent ses organes, fixent leur statut. Mais, lorsqu'elle agit, ce sont, sous réserve d'exceptions établies par le Parlement souverain, les procédés juridiques du droit commun qu'elle utilise : ses contrats sont les mêmes que ceux des particuliers, sa responsabilité est engagée dans les mêmes cas. Il n'y a donc pas en Angleterre, tout au moins en principe, un régime juridique propre à l'action administrative. Mais, en pratique, l'évolution a modifié cette situation en multipliant les textes qui dérogent à la Common Law au profit de l'administration . En France, l'administration utilise fréquemment les procédés du droit privé ; si le propriétaire de l'immeuble dont elle a besoin accepte de le lui vendre à un prix raisonnable, elle passera avec lui un contrat de vente régi par le Code civil. Ce recours au droit privé est la solution normale pour les entreprises industrielles ou commerciales dont l'administration assure la gestion. Elles fonctionnent sous un régime analogue à celui des entreprises privées similaires (v. ss 402). On nomme gestion privée ce recours de l'administration aux procédés juridiques de droit commun . Cette distinction de la gestion publique, qui implique le recours à des prérogatives de puissance publique (v. ss 4), et de la gestion privée est aussi ancienne qu'importante en droit administratif. Le problème de l'autonomie du droit administratif ne se pose, bien sûr, que dans l'hypothèse de la gestion publique. 12 13 10 2 L'administration soumise à des règles dérogatoires au droit commun ◊ Le principe, en France, est la soumission de l'administration à un o 14 droit particulier, différent de celui qui régit les activités privées en ce que, à des problèmes semblables (les contrats, la responsabilité) il apporte des solutions distinctes. C'est ce que l'on exprime en parlant de l'autonomie du droit administratif, de son caractère dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire au droit privé. Mais, trop souvent, on en déduit, à tort selon moi, que dans le cadre de la gestion publique, c'est-à-dire lorsque l'administration utilise des prérogatives de puissance publique et relève à ce titre de la compétence de la juridiction administrative, on écarterait par principe les règles du droit privé. C'est la thèse de l'inapplicabilité, par système, des règles du droit privé, et notamment du Code civil, à l'action administrative. À l'appui de celle-ci on cite toujours le célèbre arrêt Blanco rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873 (GAJA, n 1) qui affirme que la responsabilité que l'administration peut encourir du fait des personnes qu'elle emploie dans le service public ne peut être régie par les principes établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier et que cette responsabilité a ses règles spéciales. Mais cette affirmation du Tribunal des conflits – qui, au surplus, sort de son rôle en indiquant les règles qui doivent, sur le fond, permettre de trancher le conflit alors qu'il n'est qu'un juge des compétences (v. ss 573) – ne concerne que le seul droit de la responsabilité publique et c'est par une interprétation singulièrement constructive que l'on a voulu l'étendre à l'ensemble du droit administratif. Dans la pratique, et c'est cela qui importe, on constate que les cas où le juge administratif fait application à l'administration – dans le cadre de la gestion publique – de règles du droit privé ne sont pas rares . Afin de « sauvegarder » cependant l'autonomie du droit administratif dans ces hypothèses on fait observer que s'il y a alors application des règles du droit privé c'est parce que le juge administratif l'a bien voulu alors que rien ne l'y obligeait. Mais il va de soi que l'autonomie d'une branche du droit ne peut pas être une autonomie « formelle » – l'autonomie des sources – mais doit être une autonomie « foncière » – sur le fond la règle est-elle semblable ou différente . On en arrive ainsi à une constatation pleine de bon sens et en harmonie avec l'unité du système juridique français : lorsque la règle de droit privé ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'action administrative, elle est tout naturellement écartée et on lui substitue une règle originale, spécifique ; mais lorsque la règle de droit privé ne contredit pas les nécessités de l'action administrative, il n'y a strictement aucune raison de ne pas en faire application à l'administration. L'autonomie du droit administratif n'est donc qu'une autonomie relative. o 15 16 17 11 B. Le droit administratif n'a pas fait l'objet d'un code ◊ Il n'existe pas, en droit administratif, une codification semblable à celles intervenues pour les grandes disciplines du droit privé au XIX siècle. La codification en France, au moment du Consulat et de l'Empire, a consisté à prendre d'une discipline juridique une vue d'ensemble et à l'organiser de façon complète et cohérente à partir de quelques principes assurant l'homogénéité du tout. Ainsi sont nés les grands codes qui ont assuré la cohérence et la longue continuité du droit civil, du droit pénal, ou du droit commercial, et facilité leur connaissance et leur application. Selon l'observation du Doyen Vedel , la codification du droit civil a été à la e 18 fois rassemblement, choix et exclusion à partir de règles d'origine diverses et de sens divers mais déjà existantes. Bref, « penser le droit civil ce n'était pas le créer ». Pour cette raison – l'absence d'un corps de règles suffisant – la codification du droit administratif, au sens du droit privé, était matériellement impossible, bien sûr au XIX siècle, mais même encore dans la première moitié du XX siècle. Mais depuis, en matière administrative, le législateur s'est le plus souvent contenté d'aller au plus pressé : des lois successives et fragmentaires, souvent liées aux circonstances et aux nécessités, ont mis en place les organes administratifs et décrit certaines des procédures utilisées par eux. Elles ont très rarement posé des principes ayant une portée générale ou donné des définitions. Cette prolifération, qui est allée en s'accélérant, des textes législatifs et surtout réglementaires, qui poussent souvent à l'extrême la minutie des détails, ainsi que la multiplication des réglementations d'origine communautaire (v. ss 320), rendrait hautement souhaitable l'élaboration d'un véritable Code administratif au sens que l'on donne à ce terme en droit privé. Reste à savoir si cela est possible (v. ss 724). Pour l'instant il n'y a que des codifications au sens que l'on donne à cette expression en droit administratif. Elle consiste à regrouper, de manière cohérente, tous les textes – lois et règlements – concernant une même matière administrative – par exemple l'urbanisme, le droit des collectivités locales – sans y apporter d'autres changements que les modifications de pure forme qu'appelle ce regroupement ; on a ainsi un « Code de l'urbanisme » ou un « Code général des collectivités territoriales ». C'est ce que l'on appelle la codification à droit constant (v. ss 334). Ce travail facilite la recherche des textes, mais il ne prétend pas définir des principes généraux assurant la cohérence de la discipline . e e 19 12 C. Le caractère jurisprudentiel du droit administratif ◊ On a longtemps caractérisé le droit administratif comme étant un « droit jurisprudentiel » c'est-à-dire très largement créé par le juge. Dans une perspective historique la chose est certaine. Obligé de résoudre les litiges pour lesquels la loi ne lui fournissait aucun principe de résolution – par exemple en matière de responsabilité de la puissance publique – le juge administratif a dû construire, souvent de toutes pièces, la règle dont il allait faire application. Ce travail d'élaboration a été l'œuvre du Conseil d'État, qui a longtemps concentré dans ses mains la quasi-totalité de la juridiction administrative. Il en a résulté des conséquences très importantes : 1 Du point de vue formel, beaucoup de règles de droit administratif n'ont pas d'autre origine que l'arrêt dans lequel le Conseil d'État les a formulées : la 20 o connaissance des grands arrêts (désignés par le nom du requérant) joue donc pour l'étude de ce droit le même rôle que la connaissance, en droit civil, des articles fondamentaux du Code. 2 Plus profondément le droit administratif, œuvre du juge, envisage les problèmes dans l'optique du juge. Par exemple, alors que le droit civil étudie le problème de la nullité des actes juridiques en lui-même, le droit administratif, lui, n'a longtemps abordé ce problème que par le biais du contentieux : dans quels cas le juge annulera-t-il les actes administratifs qui lui sont déférés ? De même, beaucoup de théories fondamentales du droit administratif n'ont eu d'autre but que de résoudre le problème de la compétence du juge administratif : c'est, par exemple, à l'occasion de la détermination des cas dans lesquels le juge administratif, plutôt que le juge judiciaire, devait connaître d'un litige portant sur un contrat qu'a été élaborée la définition du contrat administratif. 3 L'esprit général des règles du droit administratif reflète leur origine. Le juge, qui les posait pour pouvoir statuer sur le litige qui lui était soumis, avait le souci, en les formulant, de ne pas se lier trop étroitement pour l'avenir, de façon à pouvoir tenir compte, plus tard, des circonstances propres à chaque espèce : d'où le caractère très souple des règles, et la marge d'incertitude qui les entoure. Celle-ci s'accroît du fait que le Conseil d'État a l'habitude, explicable par l'histoire, de rédiger les motifs de ses décisions avec une concision qui frise parfois l'hermétisme, ou l'extrême subtilité : il faut, pour en pénétrer le sens, une initiation à ce style particulier . Le droit administratif doit à cette circonstance un certain ésotérisme, qui n'est pas sans attrait, mais fort discutable d'un point de vue pratique car le Droit n'est pas fait pour la délectation intellectuelle de quelques-uns ! Tout cela aboutit à en faire une construction intellectuelle originale, alliant curieusement, à l'empirisme et au sens des réalités, la subtilité et le goût des nuances . Mais l'inflation législative et réglementaire que nous connaissons depuis quelques décennies, ajoutée à l'invasion des textes de droit communautaire, a sensiblement modifié la situation. En ce qui concerne le droit écrit ce n'est plus la pénurie mais le trop-plein qu'il faut maintenant craindre. Le rôle du juge administratif, dès lors, devient beaucoup plus classique : c'est celui d'appliquer, aux espèces dont il est saisi, les règles générales posées par le législateur et le pouvoir réglementaire, mais aussi, et surtout, d'interpréter ces textes ce qui est loin d'être aisé compte tenu de leur caractère bien souvent ésotérique . Ceci réduit la place laissée à l'initiative créatrice du juge. o o 21 22 23 13 Définition du droit administratif ◊ Au sens large le droit administratif est l'ensemble des règles juridiques applicables à l'activité administrative, que celles-ci soient des règles de droit privé ou qu'elles soient différentes de celles-ci. Mais, par commodité, au sens restreint, on réserve l'expression de droit administratif pour désigner les seules règles originales, c'est-à-dire distinctes de celles du droit privé. On peut accepter une telle définition – les ouvrages de droit administratif n'étudient que les seules règles originales, renvoyant implicitement, pour les règles de droit privé, aux ouvrages des privatistes – à la condition de ne pas perdre de vue que, ce faisant, on ne décrit pas la totalité des règles applicables à l'action administrative . 24 § 3. La science administrative 14 Le droit n'est jamais que la mise en forme juridique des conceptions éthiques, sociales, économiques qui prévalent dans une certaine civilisation. Ainsi du droit administratif : ses règles présupposent un certain nombre d'options fondamentales, touchant soit les relations de l'administration avec les particuliers, soit les meilleures méthodes d'aménagement et de gestion de l'organisme administratif. Le régime administratif d'un pays est donc défini, tout à la fois, par les règles juridiques qui constituent son droit administratif, et par ces options, dont le droit retient et sanctionne les principales, mais qui méritent d'être étudiées en elles-mêmes, dans une perspective technique et non juridique. La question de savoir s'il vaut mieux confier le pouvoir de décision, dans un service, au chef de la hiérarchie siégeant à Paris, ou à ses représentants locaux, ne relève pas du droit, mais de la technique et de la politique administratives ; de même, la meilleure façon de découper le territoire pour y implanter les divers services. La solution une fois adoptée, elle prend, si un texte la consacre, force juridique. On appelle science administrative l'étude des diverses méthodes d'organisation et de gestion de l'administration, et des facteurs humains et techniques qui les commandent. L'étude du droit administratif ne peut, bien que son objet soit différent, se désintéresser des données qui expliquent les règles dont ce droit se compose . 25 SECTION 2. LA FORMATION HISTORIQUE DU RÉGIME ADMINISTRATIF FRANÇAIS Il ne s'agit pas, dans cette section, d'étudier pour eux-mêmes, selon les perspectives de l'histoire, les régimes administratifs qui se sont succédé en France, mais seulement leur apport au régime actuel, incompréhensible sans cet inventaire des héritages successifs dont il se compose . 26 § 1. L'œuvre de l'an VIII Si l'on choisit l'an VIII comme point de départ, c'est que la structure donnée à l'administration française par le Premier Consul n'avait, jusqu'aux réformes récentes, fait l'objet d'aucune rénovation radicale ; si profonde qu'ait été l'évolution, c'est dans le cadre imposé par Napoléon qu'elle s'est déroulée. Mais l'œuvre de l'an VIII ne prend son relief que par rapport aux deux traditions à l'égard desquelles elle a dû prendre position : celle de l'Ancien Régime, celle de la Révolution. 15 A. L'administration d'Ancien Régime ◊ Elle est, comme toutes les institutions de l'ancienne France, un produit du temps, plutôt qu'une construction de l'esprit. D'où son extrême complexité. Mais, dans cet enchevêtrement historique, la volonté royale insère progressivement la cohérence et la centralisation : 1 L'enchevêtrement est le legs de la période féodale. Il se manifeste dans les domaines les plus divers. Enchevêtrement des activités publiques et privées : les Corps et Communautés, locaux ou professionnels, laïques ou ecclésiastiques, assument une large part des tâches d'intérêt général en même temps qu'ils défendent leurs intérêts propres. La frontière du privé et du public se laisse mal discerner. Enchevêtrement dans le découpage géographique du pays : les circonscriptions sont différentes, selon leur objet, et selon leur origine historique. Le régime des collectivités locales n'est pas moins bigarré, faisant, à leur autonomie administrative, une place très variable. Enchevêtrement, enfin – pour s'en tenir à l'essentiel – de l'action administrative et de l'action judiciaire, les Parlements ne cessant de s'immiscer dans l'activité des agents du roi. 2 La création progressive de l'administration royale. Dans ce chaos émerge progressivement, à partir du XVI siècle, une organisation cohérente, centralisée, hiérarchisée, qui est l'œuvre de la Monarchie et qui, au XVIII siècle surtout, tend à concentrer en elle l'essentiel de l'action administrative. On y trouve déjà les pièces qui seront celles du régime de l'an VIII : des organes centraux (secrétaires d'État, Conseil du roi), des représentants locaux du pouvoir central, dotés d'une compétence administrative très large, les intendants, dans chaque généralité ; des corps administratifs spécialisés – Ponts et Chaussées, Mines, Eaux et forêts, etc. – ; des procédures particulières pour certaines tâches administratives, par exemple en matière de travaux publics ; enfin, des juridictions spécialisées dans les litiges intéressant l'administration o o e e royale, notamment le Conseil des Parties. 16 B. L'œuvre de la Révolution ◊ On peut la ramener à trois points principaux. 1 D'abord une œuvre de destruction : la quasi-totalité de l'administration d'Ancien Régime disparaît. C'est, au moins en apparence, la table rase, la rupture totale avec le passé. Seuls subsistent les corps administratifs spécialisés, en raison de leur caractère technique. 2 Sur le sol ainsi déblayé, la Révolution va tenter d'édifier une administration rationnelle, uniforme et cohérente. Des divers essais qui se succèdent en ce sens, un seul élément positif subsistera : le découpage territorial de la France en départements et en communes. Mais la méthode par contre survivra : l'esprit de système et le goût de l'uniformité caractériseront longtemps le régime administratif français. 3 Enfin, et surtout, la Révolution formule les principes de philosophie politique qui resteront la base de toute l'élaboration ultérieure : le primat de la loi, la séparation des autorités administrative et judiciaire, le libéralisme politique, l'égalité des citoyens devant l'administration, le libéralisme économique. De cette idéologie, certaines composantes se sont estompées, notamment en matière économique, mais la plupart ont gardé leur autorité ; elles fournissent au droit administratif l'essentiel de ses principes généraux. o o o 17 C. L'œuvre de l'an VIII ◊ À chacune des deux traditions précédentes, le Premier Consul a emprunté les éléments qui lui paraissaient de nature à servir l'autorité de l'État, et l'efficacité de l'action administrative. 1 L'organisation du territoire est uniforme et centralisée. À chacun des échelons de la division territoriale héritée de la Constituante – département, arrondissement (ancien district), commune – on trouve les mêmes organes : un administrateur, placé sous l'autorité du pouvoir central, un conseil, essentiellement consultatif ; préfet et conseil général au département, souspréfet et conseil d'arrondissement, maire et conseil municipal, tous sont nommés. De cet ensemble se détache le préfet, représentant direct du pouvoir central dans le département, muni de larges pouvoirs, mais étroitement contrôlé, qui reprend la tradition de l'Intendant. 2 Les services administratifs, souvent continuateurs des corps administratifs du XVIII siècle, sont, quant à leur objet, spécialisés dans des tâches précises, excluant toute pénétration dans le domaine économique, réservé aux particuliers. Leur organisation est du style militaire, centralisée et hiérarchisée. Leur action, enfin, s'exerce essentiellement par voie autoritaire, o o e et, bien que soumise en principe à la légalité, est, en fait, fort peu bridée étant donné le faible développement du droit administratif. 3 Une justice administrative distincte de la juridiction ordinaire apparaît, mais elle est encore sommaire, et offre peu de garanties au particulier. 4 Au cœur de l'édifice, le pouvoir central concentre l'essentiel de l'autorité, tant sur ses agents que sur les administrés. Si l'envahissante personnalité de Napoléon laisse dans une ombre relative les ministres, chefs des administrations, elle tolère cependant la coopération active, à l'ensemble de l'œuvre administrative, du Conseil d'État, organe consultatif, qui reprend, pour l'essentiel les différents rôles assumés par le Conseil du Roi. o o § 2. Les facteurs d'évolution 18 Schéma général ◊ Depuis l'An VIII la France n'avait pas connu de révolution comparable à la table rase de 1789. Pendant longtemps on a certes modifié notre organisation administrative mais celle-ci connaissait une stabilité relative qui contrastait avec l'instabilité des institutions politiques, et peut-être l'expliquait-elle en partie en maintenant ainsi la continuité nécessaire à la vie nationale par la limitation de l'incidence des bouleversements politiques . Faut-il en déduire que la stabilisation de nos institutions politiques a permis les très profondes réformes, actuellement en cours, de nos institutions administratives ? Toujours est-il que c'est à un très vaste renouvellement de celles-ci que nous assistons actuellement. Trois facteurs expliquent les évolutions de notre système administratif depuis l'An VIII : – l'avènement de la démocratie ; – l'interventionnisme de l'État ; – la décentralisation. 27 19 A. L'Avènement de la Démocratie ◊ Le développement de la liberté politique a suscité la nécessité de protéger le citoyen contre le pouvoir. Ceci résulta tout d'abord de la séparation de l'exécutif et du législatif et de la primauté reconnue à ce dernier. De même on a vu se développer les garanties légales et juridictionnelles destinées à lutter contre l'arbitraire. Enfin, dernière exigence de la démocratie, on a organisé la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir qui les régit, cette exigence ne s'étant guère imposée dans les rapports des administrés et de l'État jusqu'à une époque récente . 28 20 B. L'interventionnisme de l'État ◊ Plus radical encore que la transformation politique a été l'accroissement considérable des tâches publiques né des répercussions, sur la structure de la société, du développement scientifique et technique. Non que le but de l'action administrative ait changé : il reste défini par la satisfaction de l'intérêt général. Mais la conception de l'intérêt général s'est profondément transformée, à partir de la fin du XIX siècle (v. ss 3). Elle a entraîné, dans les faits, un recul progressif – remis en question par les institutions européennes – de la conception libérale de l'État, amené à accroître le champ de ses interventions. 1 Au point de départ, l'intérêt général n'englobe qu'un nombre limité de tâches bien définies : la défense nationale et l'action internationale, le maintien de l'ordre, la création des conditions générales permettant le jeu de l'économie – monnaie, voies de communication –, la Justice. À cela s'ajoutent, dans des régimes autoritaires qui ne se désintéressent pas de l'ordre dans les esprits, l'Université et les Cultes. Enfin, les Finances pourvoient à la réunion des moyens nécessaires pour faire vivre cet ensemble. C'est l'État-gendarme, reflet, tout à la fois, d'un certain état de l'opinion, dominée par le libéralisme économique, et d'un certain état de la société et de la technique : une France encore rurale pour l'essentiel. 2 Les révolutions des XIX et XX siècles. Les révolutions techniques et scientifiques qui se succèdent à un rythme accéléré créent des moyens nouveaux, dont la mise en œuvre ne peut, dans certains cas, être assurée par l'initiative privée, soit parce qu'elle se prête mal au jeu de la concurrence (chemins de fer, moyens de communication), soit parce qu'elle n'est pas rentable (développement de l'hygiène publique, protection de l'environnement). L'intérêt général exige pourtant que les possibilités ainsi offertes à la collectivité ne soient pas négligées : l'action de l'État s'en trouve élargie d'autant. Au plan économique, l'utilisation des techniques nouvelles par les particuliers transforme la structure du pays. Les entreprises concentrées, à tendance monopolistique, acquièrent dans la vie nationale une importance telle que l'intérêt général s'attache, tantôt à leur protection – car leur ruine serait un désastre pour la communauté – tantôt à leur mise en tutelle – car leur excès de puissance peut recéler une menace pour le pouvoir politique. De même il faut veiller à assurer la meilleure répartition possible, sur l'ensemble du territoire, des hommes et des moyens de production : c'est l'apparition de la politique d'Aménagement du Territoire. L'évolution économique et la croissance des villes qu'elle entraîne, au détriment de l'ancienne société rurale, développent, au plan social, des faiblesses et des misères : celles du prolétariat industriel que l'intérêt général e o o e e ne permet pas d'abandonner à son sort, celles des banlieues défavorisées, où l'extrême pauvreté est génératrice de désordre et d'insécurité. D'où le développement d'une administration sociale, et des services qu'impose l'aménagement de la vie urbaine. Cette évolution se répercute dans le domaine psychologique : l'homme réclame de l'État une protection accrue, un niveau de vie décent et la sauvegarde de sa sécurité. Succédant au thème de l'État-gendarme, c'est le thème de l'État-Providence qui s'affirme. Les courants idéologiques qui se développent, et notamment les diverses formes du socialisme, sont allés longtemps dans le même sens. 3 Le contrecoup de ces transformations est triple. D'une part, les tâches traditionnelles de l'État subissent, du fait des bouleversements techniques, un extraordinaire gonflement. La défense nationale, dans un État moderne, implique un contrôle permanent sur de larges secteurs de l'industrie ; les communications, domaine traditionnel de l'État, se réduisaient jadis à la construction et à l'entretien des routes par le service des « ponts et chaussées » ; elles s'accroissent du rail, du transport aérien, du transport de l'énergie, des réseaux de télécommunication. Même quand il fait « la même chose » que l'État du XIX siècle, l'État moderne est conduit à étendre considérablement son action, et à la diversifier. Plus décisive encore que l'extension des tâches traditionnelles est l'apparition de tâches entièrement nouvelles : c'est tout le développement des services économiques et sociaux, c'est aussi la prolifération des textes et des contrôles en matière d'urbanisme, de circulation, de protection de l'environnement. Enfin, la nature même de l'activité de l'administration se modifie. Elle ne se borne pas à gérer le présent : il lui incombe de préparer l'avenir. Cette attitude prospective exige des instruments nouveaux – plans de développement, d'urbanisme, directives, etc. – et remet en question nombre de solutions acquises . o e 29 21 C. La Décentralisation ◊ Le droit administratif classique s'était construit essentiellement autour de la personne morale que constitue l'État. C'était la centralisation, apparue sous la France de l'Ancien Régime et systématisée par le Consulat et l'Empire, qui présidait à l'organisation administrative. Or, après les réformes des aurores de la III République, la Cinquième République s'est engagée dans une politique résolue de décentralisation qui, outre qu'elle suscite un fort vif débat politique, modifie en profondeur bien des données du droit administratif. Désormais les collectivités territoriales jouent un rôle de plus en plus important dans l'Administration de la France. Pour n'en donner ici qu'un E seul exemple, mais symptomatique, elles assument désormais les trois quarts des investissements publics de notre Pays. § 3. Les résultats de l'évolution 22 Vue d'ensemble ◊ Les transformations imposées au régime administratif par les facteurs qu'on vient de recenser se ramènent à trois ordres d'idées . 1 Évolution des cadres. Dans l'ensemble, les cadres territoriaux issus de la Révolution – communes, départements – subsistent mais, d'une part, leur contenu a changé, dénaturant plus ou moins profondément l'institution. On retrouve toujours, dans la commune, un conseil municipal et un maire : mais ils sont devenus, du fait de la décentralisation, les organes d'une collectivité qui s'administre d'autant plus librement que le contrôle exercé sur elle par l'État s'est allégé. D'autre part, des structures différentes s'y sont ajoutées, soit entièrement nouvelles, les Régions, soit regroupant les collectivités traditionnelles (communautés d'agglomération, communautés de communes, etc.). On ne saurait trop insister sur l'importance de plus en plus grande que revêtent ces structures de coopération intercommunale. Quant aux administrations de l'État, elles ont conservé leur structure hiérarchique, avec cependant l'apparition des Autorités administratives indépendantes (v. ss 96), mais le développement des garanties accordées aux agents publics, le rôle assigné à leurs syndicats, et surtout, plus récemment, le clivage entre leurs organes centraux et leurs services déconcentrés sont en train de les modifier. Les réformes décentralisatrices, sur la base de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (v. ss 129) ont encore accentué cette évolution. 2 Retour à la complexité. L'administration de l'an VIII, à partir de la table rase de 1789, était simple dans ses lignes. La structure administrative contemporaine a pris une complexité qui la rapproche, par des voies différentes, de celle de l'Ancien régime. La différenciation des activités publiques et privées s'est atténuée : elles s'exercent souvent, désormais, dans les mêmes domaines, ce qui les conduit à utiliser des procédés juridiques identiques. Il est fréquent de voir des personnes privées associées à des tâches d'intérêt général, et dotées, à ce titre, de prérogatives de puissance publique. À l'inverse, la réhabilitation, dès 1983, des modes de gestion propres aux entreprises privées, puis, en 1986, et dans le cadre de la construction européenne, de l'économie de marché, pénètre dans le secteur public, et jusque dans les administrations traditionnelles : modernisation, performance, rentabilité, soumission au droit de la concurrence, évaluation sont des mots d'ordre qui, même si leur contenu reste parfois 30 o o imprécis, y sont à l'ordre du jour et inspirent nombre de réformes. La complexité résulte aussi de la nouvelle répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales nées de la décentralisation. L'urbanisation croissante, la désertification des campagnes entraînent une différenciation des règles applicables aux diverses collectivités. Enfin, les relations des particuliers avec l'administration se sont, elles aussi, différenciées : à côté des rapports de sujétion, dans lesquels le particulier apparaît comme un administré, se sont créées des situations dans lesquelles il possède, en qualité d'usager du service, un pouvoir d'exiger, ou des situations de collaboration (v. ss 436). L'administré devient tout simplement un citoyen, traité en tant que tel 3 Développement du droit et des garanties juridictionnelles. Par l'action du législateur, et par l'effort créateur du juge administratif, l'administration a vu son action enserrée dans une double limite : le principe de légalité, dont le contenu s'est considérablement enrichi, est sanctionné par l'annulation par le juge administratif des décisions contraires au droit, grâce au développement du recours pour excès de pouvoir ; d'autre part, le développement de la responsabilité administrative impose aux personnes publiques l'indemnisation des particuliers auxquels elles ont causé un dommage. Mais ces progrès ont une contrepartie : la multiplication des recours a entraîné, dans l'exercice de la Justice, une inévitable lenteur, qui en compromettrait l'efficacité, et qui a rendu nécessaire une profonde réforme de la juridiction administrative, notamment par la loi du 31 décembre 1987 (v. ss 618). On a également vu apparaître, à côté du contrôle juridictionnel, un contrôle non-juridictionnel (le Médiateur de la République, remplacé par le Défenseur des Droits) qui se révèle important. 4 Au terme de cette longue histoire, il n'est que trop évident que le droit administratif est aujourd'hui en pleine évolution (v. ss 721). Les tâches nouvelles qu'assume l'administration – aménagement du territoire, urbanisme, animation culturelle, protection sociale, lutte contre les pollutions, recherche d'une meilleure « qualité de la vie » – s'accommodent mal des structures et des méthodes traditionnelles, dont le caractère autoritaire s'avère peu compatible avec ces nouvelles activités. Dans ces domaines, d'autre part, la prolifération, l'instabilité, la technicité de la réglementation la rendent difficilement connaissable, et d'autant plus facile à éluder que, s'attachant souvent à des comportements quotidiens, la sanction qui devrait en assurer le respect devient aléatoire, donc peu dissuasive . D'où la recherche d'un facteur d'obéissance à la règle autre que la seule contrainte : l'adhésion des assujettis, par l'explication de la décision prise, voire la participation à son élaboration. D'où, aussi, le développement d'une « politique contractuelle » qui tend à réduire la part des décisions autoritaires en multipliant les accords entre l'État 31 o o 32 33 et les autres personnes publiques, collectivités locales ou établissements publics d'une part, et d'autre part entre l'ensemble des personnes publiques et les organisations privées, associations ou entreprises. Enfin, et peut-être surtout, la construction de l'Europe, qui s'accélère, et donc le développement des règles communautaires ont déjà, et auront dans l'avenir proche, de profondes répercussions sur le droit des administrations nationales, de plus en plus liées par les décisions prises par les institutions européennes en matière économique, et par la mise en œuvre des droits de l'homme dans le cadre européen. Au total, les changements sont particulièrement sensibles dans quatre domaines essentiels : la notion et le régime du service public ; l'organisation des administrations de l'État et des collectivités locales ; la juridiction administrative, sa structure et ses pouvoirs à l'égard des administrations ; les relations entre l'Administration et les administrés. Sur ces quatre questions, les réformes ne cessent de se poursuivre. SECTION 3. LES CLÉS DU DROIT ADMINISTRATIF Le droit administratif français repose sur quelques grands principes qui font son originalité et son intérêt. Ces principes seront exposés longuement dans le cadre de cet ouvrage. Mais il paraît nécessaire, dès maintenant, d'en donner une vue synthétique afin de permettre au lecteur d'avoir une vue globale du régime administratif français, ce qui ne peut qu'en faciliter la compréhension. Afin de ne pas en alourdir inutilement la présentation, on n'a pas jugé utile, à propos de chacun d'eux, de faire référence à l'exposé plus complet qui en sera donné dans la suite de l'ouvrage. On évoquera successivement, comme principes fondateurs du droit administratif français, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire (§ 1), la dérogation au droit commun (§ 2), le principe de légalité (§ 3), le contrôle de l'Administration (§ 4). § 1. Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire 23 A. Les origines du principe de séparation ◊ Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire a été posé par la loi des 16-24 août 1790 votée par la Constituante. L'article 13 de ce texte dit : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Cette interdiction fut réitérée par le décret du 16 Fructidor An III. Les hommes de la Révolution n'avaient pas oublié le conflit permanent des Parlements et de l'administration royale. Ils ne voulaient pas que le corps judiciaire reprenne, à l'encontre de l'administration nouvelle, la tradition d'ingérence et d'opposition qui était la sienne sous l'Ancien Régime. Lui interdire de statuer sur les litiges dans lesquels l'administration est en cause était, sans mauvais jeu de mots, un remède souverain. 24 B. L'apparition de la dualité des ordres de juridiction ◊ Le principe posé par la loi des 16-24 août 1790 était purement négatif : il interdisait au corps judiciaire de trancher les affaires dans lesquelles était impliquée l'Administration mais il ne disait pas à qui incomberait désormais cette mission. Au lendemain de la loi on appliqua tout simplement le système de l'administrateur-juge : c'était donc l'administration elle-même qui tranchait les litiges l'opposant aux administrés. Le système n'offrait aucune garantie à ceuxci puisque l'administration était, au sens strict, juge et partie et l'on peut penser que les administrés ne l'auraient pas toléré bien longtemps. Mais, la Constitution de l'An VIII créa le Conseil d'État qui, à côté de son rôle législatif, était conçu comme le grand conseil juridique de l'Administration. Il va donc tout naturellement être consulté par celle-ci sur les réclamations présentées par les administrés et, en pratique, les avis du Conseil d'État furent toujours suivis. On était donc dans un système de justice « retenue » : le Chef de l'État se réservait l'exercice de la justice même si, dans la pratique, ce rôle était assuré par le Conseil d'État. Il ne restait plus qu'à mettre en harmonie le fait et le droit, ce qui fut fait avec la loi du 24 mai 1872 qui confia au Conseil d'État la justice déléguée, c'est-à-dire le soin de trancher lui-même les litiges opposant l'Administration aux administrés. Par ailleurs, toujours en l'An VIII, on avait créé dans chaque département un Conseil de Préfecture, présidé par le préfet. C'était une juridiction d'attribution, c'est-à-dire ne pouvant statuer que sur les seuls litiges pour lesquels la loi lui attribue expressément compétence, essentiellement les contributions directes et les travaux publics. Avec la loi du 24 mai 1872 il y a donc désormais, en France, à côté des juridictions judiciaires, un deuxième ordre de juridiction – celui des juridictions administratives – comprenant un juge de premier ressort à compétence d'attribution, les Conseils de Préfecture, et un juge de droit commun, le Conseil d'État. On considère que l'apparition d'un ordre de juridiction spécialisé dans les litiges administratifs a permis l'apparition d'un droit administratif (au sens strict), seul un juge spécialisé pouvant créer un droit spécialisé, ce que les juridictions judiciaires n'auraient pas su, ou voulu, faire. Il faut examiner maintenant les problèmes qui découlent de l'existence de deux ordres de juridiction. 25 C. Les problèmes nés de la dualité des ordres de juridiction ◊ À partir du moment où existent deux ordres de juridiction se pose un problème de répartition des affaires contentieuses entre eux. Afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, les contrariétés de jurisprudence, un certain type d'affaires doit être de la compétence de l'un ou de l'autre ordre, mais il ne doit pas y avoir de chevauchements des compétences. À l'inverse toute affaire doit nécessairement trouver un juge acceptant de la trancher, le déni de justice étant intolérable. Dans l'immense majorité des cas la ventilation des compétences s'opérera par accord tacite entre les deux juridictions suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Mais au cas de désaccord entre elles, il faut un organe pour arbitrer le conflit de compétences : c'est le Tribunal des conflits. Par ailleurs, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice – c'est-à-dire dans l'intérêt des justiciables – il est nécessaire qu'existe un « critère des compétences » c'est-à-dire un principe, le plus simple possible, permettant de répartir de manière rationnelle les affaires entre les deux ordres de juridiction. 26 1 Le Tribunal des conflits ◊ La solution logique au problème des conflits o de compétence entre les deux ordres de juridiction est de les faire trancher par une juridiction spécialement constituée à cet effet et comprenant à égalité des membres des deux juridictions suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation. C'est ce que fait la loi du 24 mai 1872 qui crée un Tribunal des conflits réunissant quatre représentants du Conseil d'État et quatre de la Cour de cassation. Au cas de partage des voix, notamment du fait de la parité, c'était le ministre de la Justice, garde des Sceaux qui venait « vider le partage » du Tribunal des conflits ; ce système a été supprimé et désormais le partage est tranché par une formation élargie comprenant quatre membres de plus. Le Tribunal des conflits est un organe départiteur des compétences ; à ce titre : – il juge le conflit positif ou conflit d'attribution ; – il intervient pour prévenir les conflits de compétence ; – il juge, le cas échéant, le conflit négatif. À titre tout à fait exceptionnel le Tribunal des conflits peut également être un juge du fond. 27 a) Le conflit positif ou conflit d'attribution ◊ Ce type de conflit se produit lorsque le juge judiciaire est saisi d'une affaire que l'Administration estime ne pas être de sa compétence. Dans l'immense majorité des cas c'est parce que l'Administration estime que l'affaire devrait être portée devant la juridiction administrative. C'est le préfet qui est alors chargé de soulever l'incompétence de la juridiction judiciaire et, au cas de désaccord avec celleci, il pourra saisir le Tribunal des conflits qui désignera l'ordre de juridiction compétent pour trancher l'affaire sur le fond. En ce cas, à vrai dire, il n'y a pas conflit entre les deux ordres de juridiction mais entre le juge judiciaire et l'Administration. On peut regretter qu'il n'existe pas une procédure symétrique qui permettrait au juge judiciaire de réclamer une affaire engagée à tort devant la juridiction administrative. 28 b) La prévention des conflits de compétence ◊ Mieux vaut prévenir que guérir. Le Tribunal des conflits sera saisi afin d'éviter, lorsqu'un ordre de juridiction s'est déclaré incompétent, que l'autre ordre de juridiction, qui estime cette décision erronée, se déclare également incompétent : il doit alors saisir le Tribunal des conflits qui désignera l'ordre compétent pour trancher l'affaire. Par ailleurs toute juridiction rencontrant une délicate question de compétence peut, à titre de précaution, demander au Tribunal des conflits de désigner l'ordre de juridiction compétent. 29 c) Le conflit négatif ◊ Le conflit négatif est destiné à éviter le déni de justice. Il se produit lorsque chacun des deux ordres de juridiction a décliné sa compétence pour connaître d'une affaire, au motif que c'est l'autre ordre de juridiction qui est compétent, ce qui ne peut se produire que lorsque la juridiction saisie en second n'a pas respecté la procédure de prévention du conflit (v. ss 28 b). C'est alors le Tribunal des conflits qui désignera l'ordre de juridiction qui doit statuer sur l'affaire. 30 d) Le Tribunal des conflits juge du fond ◊ C'est à titre tout à fait exceptionnel que le Tribunal des conflits est appelé à trancher une affaire sur le fond car sa mission naturelle est d'être le régulateur suprême des compétences. Cependant la loi du 20 avril 1932, qui est une loi de circonstance, lui a confié le soin de trancher lui-même une affaire sur le fond tout simplement pour éviter l'injustice résultant du fait que, sur le fond, un tribunal judiciaire et un tribunal administratif ont rendu des décisions contradictoires, logiquement inconciliables, et qu'il en résulte une iniquité. Schématiquement, lorsque deux tribunaux, de chacun des deux ordres de juridiction, ont rendu sur le fond deux décisions devenues définitives, contradictoires et qu'il en résulte un déni de justice, la victime de ces décisions peut saisir le Tribunal des conflits qui tranche alors l'affaire sur le fond. 31 e) Le Tribunal des conflits juge des recours en responsabilité pour durée excessive d'une procédure juridictionnelle ◊ Le Tribunal des conflits est alors seul compétent pour indemniser le préjudice résultant de cette durée excessive d'une procédure. La répartition des compétences est donc opérée par les juridictions des deux ordres, et plus spécialement par les deux juridictions suprêmes avec, le cas échéant, l'arbitrage du Tribunal des conflits. Encore faut-il savoir sur la base de quelle idée directrice est opéré le partage. 32 2 Le critère de compétence ◊ Le problème du critère de compétence est un o problème de principe, celui de savoir autour de quelle idée-force se construit le droit administratif. Mais c'est aussi, beaucoup plus prosaïquement, un problème pratique : permettre à un justiciable de savoir, avec la plus grande certitude possible, quel est l'ordre de juridiction qu'il convient de saisir lorsqu'il veut engager un procès. Le problème du critère de compétence se trouve au cœur du droit administratif pour ceux qui pensent qu'il y a une liaison de la compétence et du fond, c'est-à-dire que le juge administratif applique nécessairement et uniquement le droit administratif au sens strict. En effet, désigner le juge compétent c'est alors, de ce seul fait, choisir la règle de droit qui, sur le fond, permettra de trancher le litige. C'est pour cette raison que certains parlent alors du « critère du droit administratif ». Mais, selon moi, il n'y a pas de lien nécessaire entre la compétence et le fond (v. ss 586). Il est vrai que l'on a soutenu qu'il n'était pas souhaitable qu'il existe un critère gouvernant la répartition des contentieux . C'est ce que l'on a appelé « l'existentialisme juridique ». Pour B. Chenot, la réalité serait trop mouvante et échapperait de ce fait à toute systématisation. Bien plus, celle-ci ne serait pas souhaitable afin de ne pas obérer la liberté d'appréciation du juge. Dans un article qui est un classique du droit administratif, Jean Rivero a sévèrement condamné cette thèse en soulignant combien le Droit administratif avait besoin d'une systématisation . Cette nécessité admise encore faut-il trouver le concept fédérateur. Sur ce point les idées ont passablement évolué. 34 35 33 a) Le critère du service public ◊ De quelques arrêts rendus au début de 36 ce siècle, par le Conseil d'État et le Tribunal des conflits et plus spécialement du célèbre arrêt Blanco (T. confl. 8 févr. 1873, GAJA, n 1), les principaux auteurs de cette période – notamment Duguit et Jéze – ont cru pouvoir conclure que le droit administratif trouverait son unité dans la notion de service public (v. ss 386). Pour ces auteurs, la différence essentielle entre l'activité des particuliers et l'activité publique réside dans le fait que celle-ci est toute entière consacrée à la gestion des entreprises propres à satisfaire l'intérêt général, c'est-à-dire des services publics. Ces activités, dans le monde libéral, sont foncièrement différentes, par leur objet, des activités privées ; elles ont leurs exigences propres, qui commandent leur régime juridique particulier. Dès lors, on peut définir le droit administratif comme étant le droit des services publics. Dans cette conception, le service public trace la frontière du droit administratif – et par là même celle de la compétence du juge administratif. Il lui fournit aussi son contenu : toutes les solutions propres au droit administratif s'expliquent par les nécessités du service public. Cette conception a animé la jurisprudence et inspiré la majorité de la doctrine jusqu'aux années 1950. o 37 34 b) La crise de la notion de service public ◊ Dès le départ il est apparu que la thèse voulant faire du droit administratif le droit des services publics comportait, pour le moins, deux exceptions : – tout d'abord, l'administration ne se borne pas à gérer que des services publics ; la réglementation de l'activité des particuliers dans le cadre de la police administrative (v. ss 375), notamment, qui est une partie importante de son action, ne constitue pas à proprement parler la gestion d'un service. Le droit administratif a donc un objet plus large que le service public. – en second lieu, et à l'inverse, la gestion du service public n'utilise pas toujours les procédés du droit administratif, il lui arrive, on l'a vu (v. ss 9) de faire appel aux procédés du droit privé. Mais surtout, au lendemain de la 1 guerre mondiale, on a vu apparaître avec l'arrêt dit du Bac d'Eloka (T. confl. 22 janv. 1921, Sté Commerciale de l'Ouest Africain, GAJA, n 35) une nouvelle catégorie de services publics, les services publics industriels et commerciaux qui réalisent des interventions des collectivités publiques dans le secteur industriel ou commercial et qui, pour cette raison, sont très largement soumis au droit civil et au droit commercial, ainsi qu'à la compétence des juridictions judiciaires. Voilà donc un ensemble de services publics – qui est longtemps allé en s'élargissant – qui échappe en majeure partie au droit administratif. Dans le même ordre d'idées, l'État confie à des organismes privés, soumis au re o droit privé – par exemple les Caisses de Sécurité sociale – des services publics. Bien plus, au sein même des services traditionnels, l'emploi des procédés de droit privé se fait plus considérable. Au total il apparaît de plus en plus que le service public n'appelle pas nécessairement pour sa gestion, le droit administratif. Dans ces conditions, il n'est plus possible de trouver dans la notion de service public, ni le champ d'application du droit administratif, ni le critère de la compétence de la juridiction administrative, en dépit des efforts du Conseil d'État pour restaurer une notion à laquelle il reste attaché . 38 35 c) La recherche d'un autre critère de compétence ◊ Le Doyen Vedel a mis en avant la notion de puissance publique . Pour lui le droit administratif c'est « le droit commun de la puissance publique ». On voit la logique d'un tel système : c'est lorsqu'une personne agit en utilisant les prérogatives de la puissance publique ou des procédés différents de ceux du droit commun qu'il paraît légitime de lui appliquer un régime de droit administratif. Malheureusement, aussi séduisantes que soient ces idées, elles ne correspondent pas à l'état actuel du droit positif car elles ne permettent pas de synthétiser l'ensemble de la jurisprudence. La puissance publique ne peut donc pas être présentée, même si on le regrette, comme « le » critère de la compétence de la juridiction administrative. À la vérité on peut se demander pourquoi il faudrait fonder le droit administratif sur une notion unique, ce qui confine presque au pari stupide. Aucune autre branche du droit n'a une telle prétention : se construire autour d'une notion unique. Il nous semble que deux notions sont au cœur du droit administratif : celle de service public et celle de puissance publique . En effet, en ce qui concerne le service public, il ne faudrait pas passer d'un excès à un autre : ce qui est critiquable c'est l'idée que l'ensemble du droit administratif pourrait se construire autour de cette notion, mais il n'en demeure pas moins que le service public continue à jouer un rôle important en droit administratif. On en arrive ainsi, par exemple, à la thèse de René Chapus qui voit dans la puissance publique le critère de la compétence du juge administratif et dans le service public le critère fondamental du droit administratif . Si l'on examine le problème du critère de la compétence de la juridiction administrative, sous l'angle du seul intérêt du justiciable, on peut se demander dans quelle mesure il ne serait pas souhaitable que le législateur vienne régler cette question par voie d'autorité en énumérant tout simplement les catégories d'affaires de la compétence de la juridiction administrative. Rien n'interdirait, bien sûr, que cette énumération s'inspire d'une ou deux idées directrices. On vient de le constater, l'une des caractéristiques du système administratif 39 40 41 42 français est donc la possibilité de déroger au droit commun. § 2. La dérogation au droit commun 36 La logique du système français, on l'a vu (v. ss 10), est qu'il faut reconnaître des pouvoirs exorbitants à ceux qui exécutent des tâches administratives lorsque cela est absolument nécessaire. Cela peut, a priori, inquiéter en raison du risque d'abus toujours possibles, surtout si on fait la comparaison avec le système anglo-saxon qui applique une logique inverse : aligner les droits de l'Administration sur ceux des particuliers. La réalité est beaucoup plus nuancée. Tout d'abord parce que le système n'est pas à sens unique : si l'intérêt public exige que l'on reconnaisse des droits exorbitants à l'Administration, ce même intérêt général exige qu'on lui impose aussi des obligations, également exorbitantes (v. ss 38). D'autre part, et surtout, parce qu'il faut juger un système à ses résultats. On verra (v. ss 568) que l'exercice des pouvoirs exorbitants se fait sous le contrôle du juge qui sanctionnera tout abus. Par ailleurs, l'expérience montre que, ce qui peut paraître paradoxal, le système français peut se révéler plus protecteur des droits des particuliers que le système anglo-saxon. Par exemple, en ce qui concerne la responsabilité de la puissance publique, c'est dès 1873 que le droit administratif français a admis que l'Administration pouvait être responsable des dommages que son action cause aux particuliers ; il a fallu attendre 1946 pour que cela soit admis par le droit fédéral américain et 1947 en ce qui concerne la Grande-Bretagne. 37 A. Les prérogatives de puissance publique ◊ On l'a vu (v. ss 4) c'est parce que l'Administration, ou ceux qui administrent, agissent dans l'intérêt public, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité, qu'il faut leur reconnaître des droits exorbitants. Nombre de prérogatives de l'Administration découlent d'un principe fondamental : son pouvoir d'action d'office. Si un particulier prend une décision qui porte atteinte aux intérêts d'un autre particulier, il ne peut pas l'exécuter d'autorité, c'est-à-dire se faire justice à luimême. Par exemple, un créancier ne peut pas saisir d'office un bien de son débiteur pour se payer. Il devra, pour obtenir satisfaction, suivre toute une procédure : demander à un juge de reconnaître le bien-fondé de sa créance, c'est-à-dire condamner le débiteur récalcitrant à payer. Ce n'est qu'après avoir obtenu une décision de justice, revêtue de la formule exécutoire, qu'il pourra demander le concours de la force publique pour obtenir satisfaction. L'Administration a, elle, le privilège de prendre unilatéralement des décisions qui sont obligatoires pour les particuliers : c'est ce que l'on appelle le privilège de la décision exécutoire. L'Administration se délivre à elle-même le titre exécutoire que les particuliers, eux, doivent demander au juge. Bien plus, si le particulier ne se plie pas à cette décision, dans un certain nombre de cas, l'Administration pourra passer à l'exécution forcée sans recourir au juge : c'est le privilège de l'exécution forcée. On désigne souvent les deux privilèges – de la décision exécutoire et de l'exécution forcée – sous l'appellation de privilège d'action d'office. Il faut souligner, ce qui est une limitation importante, que l'Administration ne doit recourir à ces privilèges que lorsque cela est absolument nécessaire et doit limiter ce recours au strict minimum indispensable. 38 B. Les sujétions de puissance publique ◊ Comme l'a souligné Jean Rivero la puissance publique ne se caractérise pas seulement par des « dérogations en plus » mais aussi par des « dérogations en moins ». Il faut, dans l'intérêt public, imposer à ceux qui administrent des obligations, des sujétions, plus rigoureuses que celles qui pèsent sur les simples particuliers. Par exemple, un particulier a toute latitude pour choisir à sa fantaisie la personne avec laquelle il va passer un contrat. Cela est interdit à l'Administration. En effet, lorsqu'elle passe un contrat celle-ci engage les finances publiques : il faut avoir la certitude qu'elle contractera au meilleur coût financier et avec le plus apte à bien exécuter la prestation. C'est dans ce but que toute une série de règles – notamment celles du Code des marchés publics – s'imposent à l'Administration lorsqu'elle désire passer un contrat. De même, lorsque l'Administration désire recruter du personnel elle doit, en principe, recourir au procédé du concours alors qu'une entreprise privée pourra choisir librement son personnel. Toute la dialectique du droit administratif consiste à concilier, de la manière la plus heureuse possible, l'exercice des prérogatives de puissance publique que l'on doit reconnaître à celui qui administre et la sauvegarde des droits des administrés. C'est un équilibre difficile à trouver : pendant la phase de construction du droit administratif on avait mis l'accent sur les droits qu'il convient de reconnaître à l'Administration ; depuis quelques décennies on met beaucoup plus volontiers en œuvre les droits qu'il faut reconnaître à l'administré face à l'Administration. Mais ce qui rend acceptable les droits exorbitants de l'Administration ce sont deux données essentielles du droit administratif : – le principe de légalité, et – le contrôle de l'Administration. 43 § 3. Le principe de légalité 39 A. L'Administration peut n'être pas soumise au droit ◊ Il est difficile de concevoir, aujourd'hui, une société dans laquelle l'administration serait totalement arbitraire, c'est-à-dire dans laquelle le bon plaisir des administrateurs ne serait tempéré par aucune règle de quelque nature que ce soit. Mais si l'action administrative paraît appeler l'existence d'une règle, celle-ci peut ne pas présenter les caractères de la règle juridique. Il peut s'agir de règles purement internes à l'administration et que, de ce fait, l'administré ne peut pas invoquer à son profit, à supposer d'ailleurs qu'il les connaisse. Un tel schéma n'est nullement théorique, il correspond à ce que les auteurs allemands du siècle dernier appelaient l'État de police, dans lequel l'administration est bien soumise à une « police », c'est-à-dire à une réglementation, mais sans valeur juridique ; telle était l'administration du XVIII siècle, sous l'empire du despotisme éclairé. e 40 B. L'administration soumise au droit : le principe de légalité ◊ Cette conception de l'État de police – qu'il ne faut pas confondre avec « l'État policier » au sens polémique de l'expression – a fait place, de façon générale, à celle de l'État de droit : dans toutes les démocraties modernes, il est admis que l'administration est liée par la règle de droit. C'est là un des principes fondamentaux du libéralisme politique : c'est l'idéologie de 1789 qui explique son développement. C'est ce que l'on appelle « le principe de légalité » – la légalité désignant ainsi l'ensemble des règles juridiques – : il signifie que l'Administration doit agir conformément au droit. Traditionnellement les règles de droit dont le respect s'impose à l'Administration étaient essentiellement des règles d'origine nationale ; elles sont, de plus en plus souvent, des règles transnationales. 44 41 1 Les règles d'origine nationale ◊ Elles comprennent : o a) Au sommet de toutes celles-ci la Constitution – norme suprême – qui est la source directe ou indirecte de toutes les compétences qui s'exercent dans l'ordre administratif. b) Les lois organiques, qui sont des lois expressément prévues par la Constitution et qui viennent compléter un article de celle-ci. c) La loi qui est l'acte voté par le Parlement selon la procédure législative. La loi vient poser des règles générales et impersonnelles et ne peut intervenir que dans les seules matières limitativement énumérées à l'article 34 de la Constitution. d) Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution par lesquelles le Gouvernement, sur habilitation du Parlement, prend des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. e) Le règlement qui est un acte, à portée générale, élaboré par une autorité exécutive à l'échelon national ou local. Au plan national, l'article 37 de la Constitution prévoit que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » ; elles relèvent donc, selon l'article 21 de la Constitution, du Premier ministre. Le pouvoir réglementaire s'exerce soit sous la forme de décrets (président de la République et Premier ministre), soit sous la forme d'arrêtés. À l'échelon local le maire, par exemple, exerce un pouvoir réglementaire en matière de police administrative (v. ss 177). f) À côté de ces sources de droit écrit, l'Administration est également soumise aux « principes généraux du droit », formulés par le juge administratif et qui constituent l'une des originalités du droit administratif. Il s'agit de règles qui ne résultent directement d'aucune source écrite et que l'administrateur doit cependant respecter. Autrement dit, ce sont des règles non écrites et qui cependant sont obligatoires pour l'Administration. Il s'agit, par exemple, du principe d'égalité de tous les citoyens devant le service public ou encore du principe de la non-rétroactivité des actes de l'Administration. L'existence des principes généraux du droit découle de ce que le Conseil d'État estime que notre Droit s'inspire d'un certain nombre de grands principes qui constituent le fondement même de nos Institutions. Ils font partie de notre droit et sont donc obligatoires pour l'Administration alors même qu'ils n'ont pas été expressément formulés par un texte de droit écrit. Au fond, ils sont élaborés par le juge pour des motifs supérieurs d'équité et afin de sauvegarder les droits des administrés. 42 2 Les règles transnationales ◊ Parmi les règles dont le respect s'impose à o l'Administration, celles découlant des Traités internationaux ratifiés par la France n'ont, pendant fort longtemps, joué pratiquement aucun rôle. Les choses ont commencé à changer lorsque la Constitution de 1946 leur a reconnu valeur de droit positif. Actuellement, l'article 55 de la Constitution énonce que les traités « ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Ainsi, non seulement ils s'imposent à l'Administration mais aussi au législateur. Mais ce qui a le plus profondément modifié le droit administratif français c'est l'apparition de l'Union européenne et donc du droit communautaire qui génère un très grand nombre de textes, mais aussi une jurisprudence, s'imposant à l'Administration. En effet, non seulement l'Administration est liée par les dispositions des Traités communautaires (Traité de Rome de 1957, de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice, de Lisbonne) mais elle est aussi liée parce que l'on appelle le « droit dérivé » c'est-à-dire par les règles prises par les organes de l'Union européenne et notamment par les règlements et les directives européens. Après l'échec du Traité dit « Constitution européenne », qui a été rejeté par la France (au référendum) et la Hollande, le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, est entré en vigueur le 1 décembre 2009 à la suite de sa ratification par les 27 États de l'Union européenne et notamment par celle de l'Irlande. C'est sur la base de celui-ci que se poursuit la construction européenne. Il faut à nouveau le souligner : le droit de l'Union européenne prend une place de plus en plus importante au sein du principe de légalité. er 43 La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ◊ Il s'agit d'une Convention conclue, dans le cadre du Conseil de l'Europe, le 4 novembre 1950. Elle vient reconnaître aux ressortissants des États parties à la Convention un certain nombre de droits et libertés publiques. Mais ce qui fait son importance et sa grande originalité c'est qu'elle donne la possibilité à un citoyen, qui estime que les droits qu'il tient de la Convention ont été méconnus par l'Administration de son pays, de former un recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme siégeant à Strasbourg . Si le recours est fondé, l'État sera condamné. Les décisions de la Cour européenne prennent une importance de plus en plus grande dans le système juridique français. 45 44 C. Conséquences ◊ Le principe de légalité comporte deux séries de conséquences. La première – la plus évidente – est la liaison de l'administration par la règle de droit : elle ne peut l'enfreindre sans que son acte se trouve dénué de toute valeur. Notamment, l'administration est liée par ses propres règles, c'està-dire les règles qu'elle a elle-même posées. Cela est remarquable lorsque celles-ci viennent reconnaître des droits aux administrés. Il s'agit alors d'un phénomène d'auto-limitation. La seconde conséquence est non moins importante : les contraintes que le principe de légalité fait peser sur l'administration ne sont pas toujours les mêmes. Le principe de légalité n'est pas un principe à contenu constant. Dans les circonstances exceptionnelles les textes – par exemple l'article 16 de la Constitution – ou la jurisprudence vont substituer une légalité de crise, à la légalité ordinaire. Dans certaines situations de crise, le respect de toutes les règles qui s'imposent en période ordinaire à l'Administration, risquerait de paralyser l'administration, en lui interdisant de prendre les mesures nécessaires, ou en les retardant. Il faut parfois choisir entre l'efficacité – qui peut aller jusqu'à concerner la survie de l'État – et le respect strict du droit. Le principe de légalité est donc une garantie donnée aux administrés et une limitation de l'Administration. Mais il ne suffit pas de poser le principe de la soumission de l'Administration au droit. Encore faut-il avoir la certitude qu'il sera respecté et que l'Administration sera sanctionnée lorsqu'elle aura manqué au droit. C'est pour cette raison que le problème du contrôle de l'Administration est une question essentielle dans la logique du droit administratif français. Un contrôle efficace de l'Administration est la condition même de la reconnaissance de prérogatives de puissance publique à celle-ci. § 4. Le contrôle de l'Administration 45 De manière un peu surprenante il n'y a pas, dans la doctrine contemporaine, de théorie générale du contrôle de l'Administration . Cela s'explique par le fait que pendant très longtemps on a confiné le problème du contrôle de l'Administration au seul contrôle par le juge. Mais il a bien fallu reconnaître que, quel que soit le très grand mérite de celui-ci, il ne pouvait subvenir à toutes les nécessités d'un contrôle efficace ; on a donc vu apparaître, parallèlement au contrôle juridictionnel, un contrôle non juridictionnel de l'administration. 46 46 A. Le contrôle juridictionnel de l'Administration ◊ Ce qui caractérise le droit administratif c'est la très grande importance qu'il accorde au contrôle juridictionnel c'est-à-dire au contrôle de l'Administration par un juge spécialisé, le juge administratif, qui a le pouvoir d'annuler les décisions illégales de l'Administration. Au fond, on considère que si l'Administration manque au Droit c'est au juge administratif qu'il revient de la sanctionner. Pour cela les administrés disposent d'un certain nombre de recours, l'un de ceux-ci, le recours pour excès de pouvoir ayant une importance toute particulière. 47 1 Les différents recours contentieux ◊ Il faut procéder à une o classification des recours que les administrés peuvent présenter au juge car ceux-ci n'obéissent pas tous aux mêmes règles pour leur jugement. La classification moderne des recours repose sur la nature de la question posée au juge par le requérant. Sous cet angle on distingue : – le contentieux de l'excès de pouvoir ; – le plein contentieux ; – le contentieux de la répression. a) Le contentieux de l'excès de pouvoir. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir une seule question est posée au juge : celle de la légalité ou de l'illégalité d'une décision de l'Administration. Il s'exerce par le biais du recours pour excès de pouvoir ou du recours en appréciation de légalité lorsque le juge judiciaire demande au juge administratif de se prononcer sur la légalité, ou l'illégalité, d'un acte de l'Administration qui est invoqué devant lui. b) Le contentieux de pleine juridiction. Il s'agit d'un contentieux où le juge, allant au-delà de l'annulation d'un acte, peut prendre « toute décision utile » : annuler un contrat, accorder une indemnité, annuler une imposition, annuler une élection etc. Il a alors le pouvoir de substituer sa propre décision à celle qui lui est déférée. c) Le contentieux de la répression. C'est un contentieux extrêmement particulier destiné à la réparation de dommages causés à certains biens appartenant à des personnes publiques (contraventions de grande voirie). Compte tenu de son importance, il faut souligner ce qui fait l'originalité du recours pour excès de pouvoir. 48 2 Le recours pour excès de pouvoir ◊ Le recours pour excès de pouvoir o est souvent présenté comme « LA » garantie des administrés face à l'Administration. À cet égard on a rappelé la parabole du « Meunier de SansSouci » : Frédéric II voulait exproprier un moulin uniquement pour l'extension et l'embellissement de l'une de ses résidences personnelles et donc point dans un but d'intérêt général. Le meunier résista aux menaces du Roi en lui disant : « Il y a des juges à Berlin ! ». On serait tenté de dire, à l'identique « Il y a des juges au Palais Royal ! » (siège du Conseil d'État). 49 a) Traits généraux ◊ A priori, on pourrait être sceptique sur l'efficacité du recours pour excès de pouvoir et ceci pour au moins deux raisons. Tout d'abord il faut que l'administré connaisse la possibilité de recours qui lui est offerte. En second lieu il pourrait hésiter à y recourir soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons financières. Or, et ceci est important, le recours pour excès de pouvoir échappe très largement à ces obstacles. Le nombre des recours présentés chaque année au juge montre que ce recours est loin d'être ignoré de l'administré. Par ailleurs, ce qui caractérise le recours pour excès de pouvoir c'est tout à la fois la simplicité et la gratuité. Simplicité, parce qu'il est difficile de trouver un recours moins formaliste : aucune formule « sacramentelle » il suffit de prendre une feuille de papier et de formuler les griefs que l'on articule à l'encontre de la décision attaquée, en joignant celle-ci au recours. Gratuité, parce que le recours est dispensé du ministère d'avocat et qu'il n'y a aucun frais d'enregistrement. 50 b) Les ouvertures au recours pour excès de pouvoir ◊ On a essayé de classer, par grandes catégories, les griefs que l'on peut articuler à l'encontre d'une décision pour en démontrer l'illégalité. C'est ce que l'on appelle « les ouvertures au recours pour excès de pouvoir ». On les regroupe en deux ensembles : – L'illégalité externe qui comprend l'incompétence (l'acte a été fait par une personne qui n'avait pas le pouvoir de l'accomplir) le vice de procédure (on a méconnu l'une des règles organisant la procédure d'élaboration de la décision) le vice de forme (non-respect des règles relatives à la présentation extérieure de l'acte). – L'illégalité interne qui comprend ce que l'on appelle souvent « la violation de la loi » (erreur de droit ; erreur de fait ou erreur de qualification des faits) et le détournement de pouvoir (l'auteur de la décision a utilisé son pouvoir dans un but autre que celui pour lequel on le lui avait donné). 51 c) La procédure de jugement du recours ◊ La procédure suivie pour le jugement du recours se caractérise par trois traits qui contribuent à donner des garanties au requérant. – La procédure a un caractère essentiellement écrit. Toute l'argumentation s'opère par écrit. À l'audience il n'y a pas, le plus souvent, de véritables plaidoiries mais de simples observations orales, au moins devant le Conseil d'État. – La procédure a un caractère inquisitoire. Cette formule veut dire que le juge va pouvoir jouer, dans l'instruction de l'affaire, un rôle actif. Par exemple, si la preuve de ce qu'avance le requérant se trouve dans le dossier de l'Administration, il pourra ordonner qu'il soit produit devant lui. – L'intervention lors du jugement d'un « Rapporteur public », dénomination substituée à celle traditionnelle de « Commissaire du Gouvernement » (décr. 7 janvier 2009) à la suite de pressions fort regrettables exercées par la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit de l'un des membres de la juridiction qui, en toute indépendance, va, en tant que juriste émérite, donner son opinion sur l'affaire. L'expérience montre que dans l'immense majorité des cas celle-ci sera suivie. Son intervention constitue une garantie pour le requérant : si celui-ci est incapable de formaliser le raisonnement juridique démontrant l'illégalité de la décision qu'il attaque, le Rapporteur public pourra le faire à sa place. À l'issue de l'affaire il n'y a que deux solutions possibles : – soit la décision attaquée est annulée rétroactivement (l'annulation pouvant n'être que partielle) – soit le recours est rejeté. 52 B. Le contrôle non juridictionnel de l'Administration ◊ Quels que soient les grands mérites du contrôle juridictionnel de l'Administration on a, de plus en plus, admis qu'il ne pouvait pas, à lui seul, assumer un plein contrôle de l'Administration. Pour ne donner qu'un seul exemple, si la décision de l'Administration dont se plaint l'administré est conforme au droit, mais non à l'équité , le recours pour excès de pouvoir ne lui est d'aucune utilité puisqu'il ne peut porter que sur la légalité de la décision et non sur son opportunité. Il y a donc place, à côté du contrôle juridictionnel, pour un contrôle non juridictionnel, ces deux formes de contrôle étant complémentaires. C'est dans cet esprit qu'avait été créé, par la loi du 3 janvier 1973, « le Médiateur » intitulé ensuite « Médiateur de la République ». Il s'agissait d'une personnalité, nommée en Conseil des ministres, qui recevait les réclamations des administrés dans leurs relations avec les administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. Le Médiateur n'avait pas de pouvoir de décision mais émettait des recommandations. L'expérience a montré que la création d'un tel organisme de contrôle correspondait à un véritable besoin et son institution fut une belle réussite. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 substitue au Médiateur de la République un « Défenseur des Droits » (v. ss 560 s.) assisté d'un Défenseur des Enfants, d'un Adjoint chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité et d'un Adjoint chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Cet ensemble est régi par la loi organique du 29 mars 2011. 47 53 Plan de l'ouvrage ◊ On étudiera : – dans une Première Partie : les organes de l'action administrative ; – dans une Seconde Partie : l'action de l'Administration ; – dans une Troisième Partie : le contrôle de l'Administration. PREMIÈRE PARTIE LES ORGANES DE L'ACTION ADMINISTRATIVE SOUS-PARTIE 1 LES ORGANES DE DROIT PUBLIC SOUS-PARTIE 2 LES ORGANES DE DROIT PRIVÉ La description du système français d'administration, compte tenu de l'évolution qui s'est produite (v. ss 5) comporte l'étude des Organes de droit public (Sous-partie 1) et des Organes de droit privé (Sous-partie 2) qui en ont la charge. SOUS-PARTIE 1 Les organes de droit public CHAPITRE 1 LES NOTIONS FONDAMENTALES DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE CHAPITRE 2 THÉORIE GÉNÉRALE DES PERSONNES PUBLIQUES TITRE 1 L'ADMINISTRATION D'ÉTAT TITRE 2 LES PERSONNES ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES Pendant fort longtemps, les organes de droit public ont constitué, à eux seuls, ce que l'on appelait « l'Administration ». Ils demeurent aujourd'hui, bien sûr, les éléments essentiels de notre système administratif. À la base de cette organisation se trouvent un certain nombre de notions fondamentales (Chapitre 1) et une certaine conception de ce que sont les personnes publiques administratives (Chapitre 2). On étudiera ensuite l'organisation administrative de l'État (Titre 1), puis les personnes administratives spécialisées (Titre 2). CHAPITRE 1 LES NOTIONS FONDAMENTALES DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section 1. ÉTAT UNITAIRE ET ÉTAT FÉDÉRAL Section 2. CENTRALISATION ET DÉCENTRALISATION Section 3. LA DÉCONCENTRATION Section 4. LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER Lorsqu'il s'agit d'organiser l'État, il faut tout d'abord trancher une option essentielle entre deux grands types d'organisation : celui de l'État unitaire ou celui de l'État fédéral (Section 1). L'organisation administrative de l'État unitaire repose sur un certain équilibre entre centralisation et décentralisation (Section 2). La centralisation nécessite le recours, dans la pratique, à une certaine déconcentration (Section 3), de même la décentralisation suscite un système de tutelle sur les collectivités territoriales, appelé désormais contrôle (Section 4). SECTION 1. ÉTAT UNITAIRE ET ÉTAT FÉDÉRAL 54 La France constitue ce que l'on appelle un État unitaire, cette forme d'organisation de l'État s'opposant à celle de l'État fédéral, système pratiqué par un grand nombre de pays parmi les plus importants (États-Unis, Allemagne, Brésil, Belgique, Canada, Mexique, etc.). Ce qui distingue l'État unitaire de l'État fédéral c'est le statut des entités constitutives de l'État. Dans l'État fédéral, les États fédérés tiennent de la Constitution fédérale leurs compétences mais elles fixent elles-mêmes la forme de leurs institutions. Dans l'État unitaire l'ensemble du statut des composantes de l'État est fixé par celui-ci : elles n'ont pas le pouvoir d'y introduire des modifications et leur statut peut toujours être modifié par l'autorité centrale. D'autre part, dans l'État fédéral, les collectivités composantes, les États fédérés, sont, en tant que telles, associées à l'exercice du pouvoir central, ce qui n'est pas le cas dans l'État unitaire. En troisième lieu, dans l'État fédéral, les compétences des États fédérés peuvent s'étendre aux domaines législatif et judiciaire, alors que les collectivités de l'État unitaire n'ont de compétences que dans l'ordre administratif. Enfin, alors que, dans l'État fédéral, les États membres sont souverains en ce qui concerne les matières que la Constitution fait entrer dans leur compétence, les collectivités, dans l'État unitaire, demeurent toujours placées sous le contrôle de l'État, qui vérifie, au minimum, la légalité de leur action. D'un point de vue théorique, l'opposition est donc fort nette entre ces deux principes d'organisation de l'État. Dans la pratique, les choses sont plus nuancées. En effet, si l'on examine les pouvoirs réels des collectivités membres de l'État on peut estimer que la différence entre l'État unitaire et l'État fédéral est beaucoup moins importante qu'elle ne l'était autrefois car l'État fédéral a évolué dans le sens d'une plus grande centralisation, alors que l'État unitaire est de plus en plus décentralisé. La France a toujours constitué un État unitaire. SECTION 2. CENTRALISATION ET DÉCENTRALISATION 55 A. La centralisation ◊ La centralisation, sous sa forme la plus rigoureuse, ne reconnaît aux collectivités membres de l'État aucune vie juridique ; l'État, seule personne publique pour l'ensemble du territoire national, assume seul, sur son budget, par ses agents, la satisfaction de tous les besoins d'intérêt général pris en charge par la puissance publique. Ceci n'exclut évidemment pas le découpage du territoire en circonscriptions plus ou moins étendues. Mais il ne faut pas confondre les circonscriptions , simples cadres destinés à permettre une implantation rationnelle des services de l'État sur l'ensemble du territoire et les collectivités territoriales, qui correspondent à des ensembles humains préexistants dotés d'une vie juridique propre. Un régime de centralisation pure comporte des circonscriptions, mais ne reconnaît pas de collectivités. Par ailleurs, c'est un second aspect de la centralisation, complémentaire du premier, l'Administration d'État y est rigoureusement hiérarchisée. Le pouvoir de décision est concentré au sommet de la hiérarchie, entre les mains du ministre. Les échelons subordonnés ne font que transmettre et exécuter : transmettre les questions de l'endroit du territoire où elles se posent jusqu'au ministre compétent pour les trancher ; transmettre, dans le sens inverse, la décision ministérielle et exécuter les tâches concrètes selon les ordres reçus. 48 Ainsi, par la centralisation, une volonté unique, partant du centre de l'État, se transmet jusqu'aux dernières extrémités du Pays . Naturellement un État strictement et uniquement centralisé ne serait qu'une vue de l'esprit. 49 56 B. La décentralisation ◊ La décentralisation consiste à retirer certains pouvoirs de décision en matière administrative à l'autorité centrale pour les remettre à des autorités indépendantes du pouvoir central. 1 Dans la décentralisation territoriale, l'autorité locale qui reçoit les pouvoirs transférés constitue ce que l'on appelle une collectivité territoriale (on parle aussi de collectivité locale) parce qu'elle se définit par référence à un certain territoire, une certaine aire géographique, et cette collectivité a la personnalité morale (v. ss 63), ce qui lui permet d'accomplir tous les actes de la vie juridique. La décentralisation implique une distinction, parmi la masse des besoins auxquels l'administration doit pourvoir, entre ceux qui intéressent l'ensemble de la population – tous les Français ont besoin d'être défendus en cas de guerre – et ceux qui demeurent particuliers à une collectivité – l'adduction d'eau au village, le tramway qui relie la gare à la Place Kléber de Strasbourg. La décentralisation repose donc sur la distinction des affaires nationales et des affaires locales, seules les dernières relevant de la décentralisation . Le second élément qui caractérise la décentralisation est l'indépendance, au regard de l'échelon central, de l'autorité locale qui reçoit les compétences transférées. Pratiquement cette condition est satisfaite lorsque les organes des collectivités bénéficiaires des transferts de compétences procèdent de l'élection, ce procédé, dans une perspective historique, s'étant substitué à celui de la nomination par le pouvoir central. Dès lors que l'État n'intervient en aucune manière dans la constitution des organes de la collectivité territoriale, ceux-ci sont indépendants de lui ; l'État n'a pas le pouvoir hiérarchique sur les responsables des collectivités territoriales ; il ne peut pas leur donner d'ordres. L'un des grands problèmes de l'organisation de l'État unitaire est celui de savoir quel équilibre il convient de réaliser entre centralisation et décentralisation territoriale. 2 La décentralisation sectorielle. La notion de décentralisation, telle que l'on vient de la présenter, s'est formée à propos des rapports entre État et collectivités territoriales. Mais les mêmes procédés juridiques, plus ou moins transposés, ont été également utilisés en ce qui concerne l'organisation de l'administration de l'État lui-même afin de mettre en échec la centralisation de celle-ci. En effet, certains services, nettement individualisés par leur objet ou leur structure (par exemple, les universités) sont mis en quelque sorte en dehors de la hiérarchie, dotés de la personnalité juridique (v. ss 63), d'un o 50 o patrimoine et d'organes chargés de diriger leur action ; ces organes bénéficient d'une certaine autonomie, l'autorité supérieure n'exerçant plus sur eux le pouvoir hiérarchique mais seulement un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur les collectivités territoriales (v. ss 59). Normalement ces services reçoivent le statut d'établissement public (v. ss 237). À cette méthode on donne le nom de décentralisation par services, pour tout à la fois la rapprocher et la distinguer de la décentralisation territoriale. Quelle que soit la valeur du rapprochement, il ne faut pourtant pas perdre de vue les différences profondes qui séparent les deux procédés : l'élection, capitale dans la décentralisation territoriale, ne joue qu'exceptionnellement pour la désignation des dirigeants de l'établissement public (c'est le cas, cependant, des universités) : celui-ci, en effet, ne correspond que rarement à une communauté préexistante. Il n'est qu'un procédé juridique permettant la meilleure gestion d'un service public. SECTION 3. LA DÉCONCENTRATION 57 51 Un système d'administration totalement centralisé ne serait pas viable. Selon la formule de Lammenais, ce serait « l'apoplexie au centre et la paralysie aux extrémités ». Le système ne peut fonctionner que si l'on recourt à la déconcentration. Celle-ci consiste à remettre certains pouvoirs de décision à des agents locaux du pouvoir central. Par exemple, ce n'est plus le ministre de l'Intérieur qui, depuis Paris, prend la décision ; celle-ci est prise, dans chaque département, par le préfet représentant local du Gouvernement et donc du ministre de l'Intérieur. Selon le mot d'Odilon Barrot, dans la déconcentration, « c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche ». On voit donc la différence entre décentralisation et déconcentration. Dans la déconcentration, la décision est toujours prise au nom de l'État par un de ses agents ; il y a seulement substitution d'un agent local au chef de la hiérarchie. L'État ne s'est dessaisi d'aucun de ses pouvoirs. Dans la décentralisation, la décision n'est plus prise au nom et pour le compte de l'État par un de ses agents, mais au nom et pour le compte d'une collectivité territoriale par un organe qui émane d'elle. Mais les deux procédés ont un grand avantage commun : rapprocher l'administration – c'est-à-dire celui qui prend la décision – des administrés. C'est pourquoi la loi du 6 février 1992 (v. ss 103) les rapproche : les progrès de la décentralisation exigent que le représentant local du pouvoir central dispose de pouvoirs importants, et donc déconcentrés. Mais la différence entre ces deux procédés, du point de vue juridique, reste pourtant essentielle. Il ne faut pas confondre la déconcentration avec la notion de délocalisation 52 apparue plus récemment dans le vocabulaire administratif. La délocalisation consiste à déplacer hors de Paris un certain nombre d'organismes relevant de l'administration d'État, dont le Gouvernement estime que leur implantation dans la capitale n'est nullement nécessaire bien que leur activité présente un intérêt national et non local. L'exemple le plus connu de cette pratique est le transfert de l'ENA à Strasbourg . Elle correspond à une certaine politique d'aménagement du territoire national, mais n'a aucune portée juridique. 53 SECTION 4. LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 58 On ne peut pas accepter qu'une autorité administrative exerce ses pouvoirs sans aucun contrôle (v. ss 45 s.). Ainsi, dans une administration centralisée, le supérieur possède, à l'égard des actes du subordonné, les plus larges pouvoirs ; il peut, sous certaines réserves non négligeables , les réformer ou les annuler, non seulement pour des raisons d'illégalité mais aussi lorsqu'il les juge inopportuns. C'est le contrôle hiérarchique. En ce qui concerne les collectivités territoriales il n'y a pas de pouvoir hiérarchique de l'État et donc pas de contrôle hiérarchique. Doit-il en résulter qu'aucun contrôle ne doive peser sur celles-ci ? Ce n'est pas envisageable. L'État va exercer sur les collectivités territoriales ce que l'on appelait traditionnellement la « tutelle », terme remplacé désormais par celui de « contrôle » ; en effet, la loi du 2 mars 1982 (v. ss 119) intitule deux de ses chapitres « suppression de la tutelle administrative » et « suppression de la tutelle financière ». D'ailleurs, l'article 72 de la Constitution de 1958 confie au délégué du Gouvernement (le préfet) la charge « du contrôle administratif » des collectivités territoriales. Ce contrôle est nécessaire, à la fois dans l'intérêt de l'État lui-même qui doit sauvegarder son unité politique et veiller au respect de la loi, mais aussi dans l'intérêt de la personne décentralisée, qui serait la première victime de la mauvaise gestion de ses représentants, et dans l'intérêt des administrés, qui peuvent avoir besoin d'une protection contre l'autorité décentralisée. 54 59 1 L'autorité chargée du contrôle ◊ Elle est tout naturellement, o déconcentrée. Le contrôle est confié au préfet et la loi du 2 mars 1982, qui a supprimé la tutelle, lui maintient en la matière un rôle important (v. ss 119). Ce même texte précise bien qu'il ne doit pas y avoir de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. 60 2 L'objet du contrôle ◊ Lorsque l'État veut contrôler les collectivités o territoriales, ce contrôle peut se proposer deux objets bien différents : il peut s'agir d'un contrôle de légalité ou d'un contrôle d'opportunité. a) Le contrôle de légalité vise à vérifier que la décision prise est « légale », c'est-à-dire conforme au droit. Il va de soi que personne, et notamment pas les collectivités territoriales, ne peut avoir une sorte de « droit à l'illégalité ». Si celles-ci prennent une décision illégale il est naturel qu'elle soit annulée. Cependant, il est souhaitable que ce soit un juge, dont c'est le rôle, et non l'autorité de tutelle, qui se prononce sur ce point. b) Le contrôle d'opportunité est quelque chose de fort différent. Cette foisci on ne discute plus de la conformité au droit de la décision ; on se demande, ce qui n'est pas du tout la même chose, si celle-ci est « raisonnable », si elle correspond à un standard de bonne administration. Bref, si elle est opportune ou inopportune. Si l'autorité de contrôle a le pouvoir d'apprécier l'opportunité des décisions prises par les collectivités territoriales, c'est le principe même de la décentralisation qui est remis en cause. Selon un adage bien connu : « donner et retenir ne vaut ». Désormais le contrôle de l'État sur les collectivités territoriales ne porte plus que sur la légalité. 61 3 Les techniques du contrôle ◊ Le contrôle des collectivités territoriales o peut porter soit sur les personnes des élus, mais ce pouvoir est alors toujours étroitement limité, soit sur les actes. En ce qui concerne ces derniers, plusieurs procédés peuvent être utilisés : on les évoquera en allant du plus acceptable au moins acceptable du point de vue de la décentralisation ; a) La saisine du juge. Ce procédé ne peut jouer que lorsque c'est la légalité d'une décision qui est en cause. Il est tout à fait satisfaisant puisque le débat entre le représentant de l'État et la collectivité territoriale sur la légalité d'une décision est arbitré par un tiers, dont c'est le métier, le juge administratif ; b) Le pouvoir d'approbation. La décision ne devient applicable que lorsqu'elle a été approuvée par le représentant de l'État. La décision d'approbation peut être expresse ou implicite, le silence gardé pendant un certain temps valant alors approbation. Compte tenu du nombre de décisions prises par les collectivités territoriales, c'est ce système d'approbation implicite qui permet alors au système de fonctionner. c) Le pouvoir d'annulation. Cette fois-ci l'atteinte au principe de décentralisation est évidente puisque le représentant de l'État a le pouvoir d'annuler une décision de la collectivité territoriale. d) Le pouvoir de substitution d'office. Avec ce procédé on permet au représentant de l'État de se substituer aux organes normalement compétents de la collectivité territoriale pour prendre, en leur lieu et place, une décision relevant des attributions de cette collectivité. Ce procédé peut paraître choquant. On verra (v. ss 236) cependant qu'il est nécessaire dans certains cas. CHAPITRE 2 THÉORIE GÉNÉRALE DES PERSONNES PUBLIQUES Section 1. LA PERSONNALITÉ MORALE Section 2. LA DISTINCTION DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT PRIVÉ § 1. Les personnes morales de droit privé § 2. Les personnes morales de droit public Section 3. L'ÉVOLUTION DE LA DISTINCTION ENTRE PERSONNES MORALES PUBLIQUES ET PRIVÉES § 1. L'évolution des personnes morales de droit privé § 2. L'évolution des personnes morales de droit public Les personnes publiques ont la qualité de personnes morales (Section 1) ; parmi celles-ci on distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé (Section 2) ; l'évolution a diminué l'opposition entre personnes morales de droit public et de droit privé (Section 3). SECTION 1. LA PERSONNALITÉ MORALE 62 A. Le problème de la personnalité morale ◊ La civilisation occidentale, essentiellement humaniste, fait coïncider, en principe, la qualité de personne humaine et celle de sujet de droit. La personnalité morale met cette coïncidence en échec : elle consacre l'existence de sujets de droit qui ne sont pas des personnes humaines. C'est cette particularité qui explique les discussions longtemps poursuivies entre ceux qui affirmaient que les personnes morales étaient des personnes réelles, et ceux qui y voyaient de simples fictions . Inconsciemment, les uns et les autres partaient de l'idée que les sujets de droit sont, normalement, les 56 55 personnes humaines ; d'où les efforts des partisans de la « réalité » pour assimiler, contre tout bon sens, personne morale et personne physique ; d'où les conclusions de ceux qui, constatant la différence évidente entre personnes physiques et personnes morales, déniaient à celles-ci toute réalité : « Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale », s'exclamait Gaston Jèze. Ce débat d'école avait une portée très pratique, et même politique : si les personnes morales sont des réalités, en effet, l'État n'est pas libre de les créer ou de les supprimer : elles s'imposent à lui. Si au contraire elles sont de pures fictions, l'État en est le maître. Dans les luttes engagées à la fin du XIX siècle, en Allemagne, puis en France, autour des personnes morales à caractère religieux, notamment des congrégations, les deux thèses justifiaient des attitudes opposées. Cette façon de poser le problème l'a considérablement obscurci. L'histoire enseigne, en effet, que la liaison entre la personnalité humaine et la personnalité juridique n'est ni constante, ni nécessaire : des civilisations entières ont connu des sujets de droit qui n'étaient point des hommes, et refusé à des hommes, par l'esclavage, la qualité de sujets de droit. L'expérience montre également que la personnalité juridique peut exister sans les attributs de la personnalité humaine, raison, liberté, volonté : le nouveau-né est sujet de droit, et de même l'aliéné. La qualité de sujet de droit, l'aptitude à la vie juridique, est donc une qualité abstraite, que chaque civilisation attache aux réalités qu'elle juge dignes de la protection du droit. La personne humaine, dans notre civilisation, est la principale de ces réalités, mais d'autres, intérêts collectifs, entreprises, communautés, peuvent bénéficier de la même protection. D'où la définition de Marcel Waline, qui voit, dans la personne morale, un centre d'intérêts juridiquement protégés. e 63 B. Les éléments de la personnalité morale ◊ Il y a, dans toute personne morale, deux séries d'éléments. D'abord, la réalité de base qu'il faut protéger, c'est-à-dire une somme d'intérêts qui ne sauraient se réduire à des intérêts individuels. Le plus souvent, ces intérêts correspondent à l'existence d'un groupe humain possédant une certaine homogénéité (habitants d'une commune). Parfois, ils ont bien une réalité objective, mais sans qu'une communauté se soit formée autour d'eux (intérêts des indigents, des malades). Le second élément est le procédé juridique utilisé pour protéger ces intérêts. Il est tout à fait faux de dire qu'il consiste à les traiter comme ceux d'une personne humaine. En réalité, l'octroi de la personnalité morale a un effet triple : 1 Tous les actes concernant les intérêts en question sont rattachés à un seul et même centre érigé en sujet de droit : c'est la personne morale. 2 Ce sujet se voit reconnaître la permanence, malgré le renouvellement incessant des individus intéressés. 3 Des organes sont créés pour agir au nom du sujet de droit. o o o 64 C. Personnes morales et personnes physiques ◊ On aperçoit dès lors les différences qui les séparent sur le terrain juridique. 1 La personne morale échappe à la précarité des personnes humaines : sa durée n'est pas limitée par la mort naturelle. 2 Alors que la personne humaine est libre et peut poursuivre n'importe quel objet licite, la personne morale ne peut agir qu'en fonction des intérêts pour le service desquels elle est créée : c'est le principe de la spécialité des personnes morales . 3 La personnalité juridique est acquise de plein droit, à toute personne humaine ; au contraire, seuls sont appelés à la vie juridique les intérêts jugés dignes d'une protection spéciale. C'est donc l'intervention de l'autorité publique qui, en principe, fonde l'existence de la personnalité morale, soit directement, soit en fixant les conditions auxquelles les particuliers devront satisfaire pour créer une personne morale d'un certain type (lois sur les associations, sur les sociétés). Toutefois, il est admis que l'octroi de la personnalité morale par la loi peut être tacite : il suffit qu'elle ait consacré l'existence d'un groupement et la licéité de son action pour que celui-ci accède de plein droit à la personnalité morale . 4 Alors que toutes les personnes physiques jouissent normalement de la même capacité, celle des personnes morales peut être plus ou moins large, le législateur restant maître de graduer la protection qu'il accorde. 5 Les personnes morales se différenciaient des personnes physiques dans la mesure où, contrairement à celles-ci, elles échappaient à toute répression pénale. Le nouveau Code pénal a mis fin à cette situation : l'article 121-2 pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, à l'exception de l'État . o o 57 o 58 o o 59 SECTION 2. LA DISTINCTION DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT PRIVÉ La distinction des personnes morales de droit privé et de droit public est fondamentale. Bien que les premières relèvent d'autres disciplines que le droit administratif, il est nécessaire d'en prendre ici une vue sommaire (§ 1) pour deux raisons : c'est par rapport à elles que s'affirment les caractères propres des personnes de droit public ; certaines d'entre elles intéressent au premier chef l'action de l'administration, soit par les contrôles qu'elle exerce sur elles, soit par l'utilisation qu'elle en fait, notamment pour son action économique . Il conviendra ensuite de caractériser les personnes publiques (§ 2). 60 § 1. Les personnes morales de droit privé 65 A. Caractères généraux ◊ Toutes les personnes morales de droit privé ont en commun les traits suivants, qui les opposent aux personnes publiques. 1 Leur création résulte en principe de l'initiative privée. La loi se borne à déterminer les conditions de cette création ; les particuliers mettent en œuvre, s'ils le souhaitent, les possibilités qui leur sont ainsi offertes. 2 La liberté qui préside à la création se retrouve dans l'appartenance au groupement : nul n'est tenu d'y adhérer, nul ne peut être contraint d'y rester. 3 La capacité des personnes morales, variable selon leur nature, est toujours limitée à des actes de droit privé ; elle exclut, normalement, toute prérogative de puissance publique. o o o 66 B. Principaux types ◊ Ces traits communs laissent subsister de profondes différences de régime entre les diverses personnes privées. La distinction essentielle découle du caractère lucratif ou non lucratif du but poursuivi. 1 Les personnes morales à but lucratif sont les sociétés civiles et commerciales ; toutes se caractérisent par la recherche d'un profit pécuniaire. Elles ont été les premières à connaître la faveur du législateur du XIX siècle. Aujourd'hui encore, elles bénéficient de la capacité la plus étendue. Ces constatations s'expliquent par l'adhésion de l'État au libéralisme économique, qui le poussait à faciliter au maximum la recherche du profit, et par l'évolution technique qui exigeait la concentration des capitaux pour mettre les entreprises à même d'utiliser les moyens puissants, mais onéreux qu'elle leur offrait. À l'heure actuelle, cette faveur n'exclut pas un certain contrôle exercé par l'État sur les personnes à but lucratif, qui peut aller jusqu'à l'association, dans le cadre de la société anonyme, des capitaux publics et des capitaux privés (économie mixte), ou encore à la création, par les personnes publiques, de sociétés qui restent, de par leur forme, des personnes privées, et possèdent ainsi une plus grande liberté d'action. 2 Les personnes morales à but non lucratif n'ont été admises que o e o tardivement par le législateur français ; dans l'ensemble, leur régime est plus sévère que celui des personnes à but lucratif. Cette défiance a des causes historiques : l'individualisme révolutionnaire condamnait les groupements, dans lesquels l'homme peut aliéner une part de sa personnalité ; la plupart des régimes du XIX siècle redoutaient que la liberté d'association permît le regroupement des opposants ; enfin, le libéralisme économique dénonçait le phénomène dit de la mainmorte : les personnes morales désintéressées attirent les dons, leurs patrimoines tendent à s'enfler, et leur caractère perpétuel aboutit à mettre les biens ainsi accumulés hors du circuit économique normal. Il fallut attendre la fin du XIX siècle pour que cédassent ces divers éléments d'hostilité. Le développement du régime démocratique, le recul de l'individualisme dans une société où le groupement apparaissait seul à l'échelle des problèmes nouveaux qui se posaient à l'homme, ont amené le législateur à autoriser le développement des personnes morales à but non lucratif. Néanmoins, leurs régimes, qui varient selon leur objet, sont moins libéraux, dans l'ensemble, que les précédents. On distingue, parmi elles : a) Les syndicats professionnels (loi du 21 mars 1884, C. trav., art. L. 21111 s.). Ce sont des groupements ayant pour but la défense des intérêts professionnels ; ils bénéficient d'un régime particulièrement favorable. Leur étude relève du droit du travail. Ils intéressent le droit administratif par de nombreux points : extension du droit syndical aux fonctionnaires publics, et rôle des syndicats de fonctionnaires en ce qui concerne le régime de la fonction publique, participation des syndicats à de très nombreux organismes administratifs, association des syndicats à l'exercice du pouvoir réglementaire en matière de régime du travail par le procédé de la convention collective, etc. b) Les associations (loi du 1 juill. 1901) . Ce sont des groupements que les individus, dès lors qu'ils poursuivent un but légal, et non lucratif, peuvent créer librement. S'ils désirent développer leur action en obtenant la personnalité morale, elle leur est acquise du seul fait de leur déclaration à la préfecture ; mais la capacité des associations déclarées reste limitée. Pour l'accroître, l'association doit obtenir la reconnaissance d'utilité publique, accordée par décret, qui s'accompagne d'un contrôle particulier. Longtemps, l'administration ne s'est occupé des associations que pour les surveiller, dans les limites fixées par la loi ; aujourd'hui, il est fréquent de voir l'administration confier à des associations, qu'elle soumet, dès lors, à un contrôle plus strict, des tâches d'intérêt général . Souvent même, la création d'une association de la loi de 1901 est un procédé auquel les personnes publiques recourent pour agir dans un domaine qui requiert plus de souplesse que n'en permettent les e e 61 er 63 62 procédures administratives et notamment les règles strictes de la comptabilité publique : le procédé a été vivement dénoncé par la Cour des comptes. Des associations proprement dites, il faut rapprocher divers types de groupements que la loi soumet à un régime particulier, soit plus sévère (congrégations religieuses) soit plus libéral (sociétés mutualistes). c) Les fondations. Un particulier affecte un patrimoine à une tâche désintéressée, et organise la gestion de ce patrimoine en vue de cette tâche. L'œuvre ne peut fonctionner que si elle obtient la personnalité. C'est un décret qui la lui accorde, en la déclarant d'utilité publique. Les fondations, en France, entrent donc dans la catégorie des « établissements d'utilité publique » (v. ss 244). On remarquera qu'ici, la reconnaissance d'utilité publique crée la personnalité alors qu'en matière d'associations, elle ne fait qu'élargir la capacité. Un effort a été tenté pour faciliter et développer l'initiative privée dans ce domaine , notamment en permettant aux entreprises à but lucratif qui le souhaitent de créer des fondations à but désintéressé dans les domaines culturel et humanitaire (mécénat d'entreprise). La loi du 10 août 2007 « relative aux libertés et responsabilités des universités » crée au profit de celles-ci deux types de fondations destinées à faciliter leur financement : la fondation universitaire et la fondation partenariale. 64 § 2. Les personnes morales de droit public 67 65 A. Caractères généraux ◊ Ils s'opposent radicalement à ceux des personnes morales de droit privé. 1 La création des personnes de droit public n'est jamais le résultat de l'initiative privée ; c'est l'autorité publique seule qui y procède. 2 Les particuliers n'ont aucune liberté d'adhésion ; sitôt qu'ils remplissent certaines conditions de fait, ils relèvent ipso facto de telle personne publique. Fixer son domicile, c'est s'agréger à la commune, au département, à la région, dans lesquels ce domicile est situé. L'appartenance à ces collectivités en découle nécessairement. 3 Les buts assignés aux personnes publiques ne sont pas d'ordre privé : toujours, c'est la satisfaction de certains intérêts généraux qui leur est confiée. Il en résulte qu'elles ne poursuivent jamais une fin purement lucrative ; la réalisation d'un bénéfice, si elle n'est nullement exclue dans nombre de cas, ne saurait justifier à elle seule la création d'une personne publique, même dans l'ordre économique. 4 La capacité des personnes publiques, si elle varie, s'étend toujours audelà des moyens d'action du droit privé ; elles ont à leur disposition des o o o o prérogatives de puissance publique : pouvoir d'exproprier, d'imposer, d'agir par voie d'autorité. 68 B. Principaux types ◊ Les personnes publiques, on l'a vu, se classent en deux grandes catégories. 1 Les principales, du point de vue de l'organisation administrative, correspondent à des entités territoriales (v. ss 56) c'est-à-dire à des groupes humains, liés par la vie en commun sur un même sol : outre l'État, personnification juridique de la communauté nationale, ce sont la région, le département et la commune. 2 Une seconde catégorie correspond à ce que l'on appelle la décentralisation par services, c'est-à-dire des établissements publics (v. ss 56). Selon que la tâche qui leur est confiée intéresse la nation tout entière ou une collectivité territoriale, les établissements publics sont rattachés à la collectivité correspondante (établissements publics nationaux, régionaux, départementaux ou communaux). Initialement, les établissements publics assuraient la gestion de services publics d'ordre social (hôpitaux) ou intellectuel (Universités, Facultés) ; par la suite, le procédé a été utilisé pour des services publics industriels et commerciaux ; il a été appliqué aussi à certains services d'organisation et de représentation professionnelle (Chambres de commerce, d'agriculture). De plus, le législateur a qualifié d'établissements publics des personnes morales regroupant, en vue de résoudre leurs problèmes communs, des collectivités territoriales, communes, départements ou régions (v. ss 266 s.). Les groupements d'intérêt public (GIP), créés à partir de 1982, qui réunissent des personnes publiques et des personnes privées en vue d'une tâche commune (recherche, culture, sport, etc.), ne sont pas des établissements publics mais des personnes sui generis (v. ss 284). Cette multiplicité d'applications a abouti à une très grande différenciation dans le régime juridique des divers établissements publics. o o 69 C. Personnalité morale et autonomie des personnes publiques ◊ Dans l'analyse classique des personnes publiques il y a un lien nécessaire entre reconnaissance de la personnalité juridique et autonomie. C'est pour accorder une importante autonomie aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qu'on leur reconnaît la personnalité morale. L'évolution a montré que cette relation n'est pas systématique : il y a des cas où il y a personnalité sans autonomie et, à l'inverse, autonomie sans personnalité juridique. À l'origine de ces phénomènes il y a la multiplication des démembrements de l'État, qui sont devenus pratique courante, de même que la prolifération des organismes agissant dans l'orbite des collectivités territoriales. On a recherché, à travers ces créations, avant tout l'autonomie de gestion, le problème de la personnalité juridique des organismes créés n'apparaissant pas comme essentiel. On s'éloigne ainsi du schéma traditionnel. Par exemple, à l'intérieur des universités (établissements publics dotés de la personnalité) on trouve un certain nombre de composantes – les UFR – n'ayant pas la personnalité mais établissant leur propre budget, ce qui représente une autonomie de gestion loin d'être négligeable . De même l'arrondissement, circonscription de l'Administration d'État (v. ss 114) n'a pas la personnalité juridique ; et cependant, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, il disposait pour sa gestion d'un Conseil d'arrondissement, élu, ce qui lui conférait une certaine autonomie. À l'inverse, à l'intérieur des universités on peut également trouver des unités elles-mêmes dotées de la personnalité morale et qui sont cependant loin de jouir de l'autonomie que devrait leur conférer cette qualité. De manière plus générale ce sont souvent les statuts fondateurs d'un organisme doté de la personnalité juridique qui déterminent les conditions dans lesquelles l'exercice de telle compétence peut être délégué. 66 70 D. Les conséquences attachées à la qualification de personne morale de droit public ◊ 1 Le principe de spécialité . L'activité des personnes de droit public – à l'exception de l'État – comme celle d'ailleurs des personnes morales de droit privé, est dominée par le principe de spécialité. Appliqué aux collectivités territoriales, le principe signifie que la compétence de celles-ci s'étend à l'ensemble des intérêts généraux de la collectivité, tels que la loi les définit, mais à eux seuls. Le principe de spécialité, en ce qui les concerne, s'entend donc d'une spécialité territoriale et de la définition de ce que sont « les affaires propres de la collectivité » que les textes leur confient. Dans la pratique on a de grandes difficultés à définir ce que sont de telles affaires (v. ss 164). Le principe de spécialité est surtout lié à la notion d'établissement public. Il signifie que celui-ci doit limiter ses activités aux seules missions qui lui ont été assignées par les textes constitutifs. Par exemple, une Caisse des Écoles, qui a pour mission de faciliter la fréquentation des écoles publiques, méconnaît le principe de spécialité si elle vise également la fréquentation des écoles privées (CE 22 mai 1903, Caisse des Écoles du 6 arrondissement de Paris, S. 1905. 3. 33 note Hauriou). Toutefois il n'est pas rare que la spécialité de l'établissement public soit définie de manière assez large, ce qui lui enlève o 67 e alors une bonne part de son caractère contraignant. Le principe de spécialité n'est pas applicable à l'État, car « l'État, par définition, n'a pas de spécialité ; il a une vocation générale pour l'ensemble des activités qui ne sont pas soit confiées à une autre personne morale de droit public, soit réservées au secteur privé » (concl. G. Braibant, sous CE 29 avr. 1970, Sté Unipain, AJDA 1970. 430). 2 Les privilèges inhérents à la qualité de personne publique. On l'a vu (v. ss 4) la qualité de personne publique entraîne la disposition d'un certain nombre de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire de prérogatives qui n'appartiennent pas aux simples particuliers. Mais la qualité de personne publique permet également d'échapper à un certain nombre de procédures qui s'appliquent aux particuliers. a) Les personnes publiques ne peuvent pas faire l'objet de voies d'exécution, c'est-à-dire de procédures permettant d'obtenir, par la force, l'exécution d'un acte ou d'un jugement qui reconnaît à quelqu'un une prérogative ou un droit. On s'était demandé si cette exemption devait être limitée aux seuls établissements publics ou si elle jouait en faveur de l'ensemble des personnes publiques. La Cour de cassation a tranché en faveur de cette seconde hypothèse en jugeant que le principe de l'insaisissabilité des biens s'applique aux EPIC mais en rappelant que ceux-ci sont soumis à la loi du 16 juillet 1980 relative à l'exécution des décisions de justice (v. ss 717), (Civ. 1 , 21 déc. 1987, Bureau de Recherches géologiques et minières, RFDA 1988. 771, concl. Charbonnier, note Pacteau). Le principe peut paraître logique dans la mesure où l'État a le monopole de la contrainte organisée ; il ne peut pas se contraindre lui-même, si l'on peut dire. Mais cela pose problème lorsque l'État se fait commerçant public. Par ailleurs, la contrepartie de cette exemption des voies d'exécution devrait être, de la part des personnes publiques, l'exécution spontanée des décisions de justice rendues à leur encontre. Cela est loin d'être toujours le cas (v. ss 713). b) Dans le même esprit, les personnes publiques ne peuvent pas faire l'objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. c) La tradition voulait que les personnes publiques ne puissent pas recourir à la procédure de l'arbitrage pour le règlement des litiges dans lesquels elles se trouvent impliquées (v. ss 624). On considérait que les affaires concernant les personnes publiques ne peuvent être jugées que par la justice « officielle » : CE, ass., 13 déc. 1957, Sté nationale de vente des surplus, D. 1958. 517, concl. Gazier. Toutefois la loi du 9 juillet 1975, art. 5, – insérée dans le Code civil, art. 2060 – a prévu que, par exception à ce principe, certaines catégories d'établissements publics industriels et commerciaux dont la liste serait fixée par décret, pourraient recourir à l'arbitrage. Le décret n'a jamais été pris mais o re plusieurs lois ont autorisé l'arbitrage pour telle ou telle entreprise publique (SNCF, la Poste, France-Telecom, Réseau ferré de France, Chambres de Commerce). Cet état du droit positif avait été critiqué par la doctrine (v. par ex. Y. Gaudemet, « L'avenir de l'arbitrage en droit administratif français », Mélanges Moreau, p. 165). Cela a conduit le Vice-Président du Conseil d'État à créer un groupe de travail, présidé par D. Labetoulle, chargé d'étudier « les hypothèses et les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public pourraient recourir à l'arbitrage pour la solution des litiges autres que ceux relatifs au contentieux des actes administratifs unilatéraux » . Le Rapport, qui limitait les recours à l'arbitrage au seul domaine des contrats – ce que je regrette – n'a toujours pas abouti à la réforme préconisée, ce qui ressemble fort à un abandon. 68 SECTION 3. L'ÉVOLUTION DE LA DISTINCTION ENTRE PERSONNES MORALES PUBLIQUES ET PRIVÉES L'abandon de la conception organique de l'Administration a fait qu'il a été de plus en plus fréquent de confier des tâches d'Administration publique à des personnes morales de droit privé (v. ss 5). Cela a eu pour conséquence de rapprocher les deux catégories de personnes morales au point de faire apparaître des situations intermédiaires. Dans la pratique, parfois, il est difficile de dire si telle personne morale (par exemple un hospice ou une caisse d'épargne) appartient à l'une ou à l'autre catégorie. § 1. L'évolution des personnes morales de droit privé 71 L'autorité publique, désormais, prend souvent l'initiative de créer elle-même une personne morale privée – association, fondation, société – afin de donner plus de souplesse à son action dans le domaine qui lui est confié. Ainsi, par exemple, la Fondation française des sciences politiques (Ord. du 9 octobre 1945). Par ailleurs, il est fréquent que des personnes publiques s'associent avec des particuliers dans le cadre d'une personne morale privée ; ainsi des Sociétés d'économie mixte, qui sont des sociétés anonymes dont les actions appartiennent pour partie à des capitalistes privés et pour partie à des personnes publiques (v. ss 299 s.). À la limite, les particuliers peuvent être totalement éliminés sans que la personne morale perde son caractère privé : c'est le cas des sociétés nationales (v. ss 298) dont l'État détient toutes les actions. La logique de cette évolution conduit à octroyer à certaines personnes morales de droit privé, en raison de l'intérêt général qui s'attache à leur action, des prérogatives de puissance publique : par exemple, elles pourront recourir à l'expropriation, recouvrer les cotisations de leurs adhérents par voie autoritaire, ou prendre des règlements comme des autorités publiques. Le système est logique même si on peut, a priori, trouver étrange qu'un simple particulier se voit confier des prérogatives de puissance publique. Parfois des personnes morales privées participent à l'action des organismes publics : ainsi de certaines associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement (L. 10 juill. 1976, art. 40). On aboutit, par ces diverses voies, à la catégorie intermédiaire des personnes privées d'intérêt général (CE 20 déc. 1935, Sté des Établissements Vezia, RD publ. 1936. 119, concl. Latournerie). § 2. L'évolution des personnes morales de droit public 72 Parmi les établissements publics (v. ss 237) on a vu se développer des établissements dont les activités, analogues à celles que peuvent se proposer les particuliers, ont pour effet de les soumettre, dans une large mesure, au droit privé ; c'est le cas pour les établissements à caractère industriel et commercial, voire pour les établissements publics de coopération culturelle créés par la loi du 4 janvier 2002. 73 Le rapprochement entre personnes morales de droit public et de droit privé qui s'est effectué a pris tout son relief avec la création, par le législateur, de personnes morales qu'il a chargées, sans préciser leur nature, de l'organisation et de la discipline des professions. Les unes (comités d'organisation) ont disparu avec le régime de Vichy qui les avait créées ; mais les autres, les ordres professionnels (des médecins, des pharmaciens, etc.) se sont maintenues. Le Conseil d'État n'a pas voulu trancher le problème de la nature publique ou privée de ces organismes ; il s'est borné à affirmer le caractère de service public de la mission à eux confiée, tout en leur refusant la qualité d'établissement public (CE 31 juill. 1942, Monpeurt, GAJA, n 49 ; pour les comités d'organisation : 2 avr. 1943, Bouguen, GAJA, n 50 ; pour les ordres professionnels, v. ss 305). La doctrine est partagée, certains y voyant des personnes privées chargées d'un service public – ce que je pense – d'autres des personnes publiques d'un type nouveau . Cette dernière conception peut o o 69 d'ailleurs s'appuyer sur la création, par le législateur, d'autres organismes publics qu'il se refuse à qualifier d'établissements publics tout en les dotant de la personnalité : Agence France-Presse (L. 10 janv. 1957), « Ensembles urbains » (L. 10 juill. 1970), etc. Ainsi pourrait se confirmer l'existence d'une nouvelle catégorie de personnes publiques « innommées ». 70 TITRE 1 L'ADMINISTRATION D'ÉTAT CHAPITRE 1 L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ÉTAT CHAPITRE 2 L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT CONCLUSION LA RÉFORME DE L'ÉTAT 74 Vue d'ensemble ◊ Dans un pays longtemps centralisé, comme la France, la part des tâches administratives considérées comme d'intérêt national et assurées, dès lors, par l'État, reste considérable. C'est l'administration d'État qui constituait, jusqu'aux réformes de 1982, l'essentiel de l'armature administrative française. Malgré les réformes intervenues depuis un quart de siècle, l'administration d'État garde un poids important dans la vie nationale, même s'il tend progressivement à se réduire sous la double influence de la décentralisation et des compétences croissantes de l'Union européenne. Il faut insister sur l'importance des transformations qui sont en cours en matière d'organisation administrative. La physionomie administrative de la France, dont les traits essentiels n'avaient que peu changé depuis l'An VIII, est en train de se modifier profondément, les réformes succédant aux réformes. L'Administration d'État comprend des éléments qui correspondent à la centralisation de notre système administratif, c'est l'Administration centrale de l'État (Chapitre 1) et des éléments qui permettent la déconcentration, c'est l'Administration territoriale de l'État (Chapitre 2). CHAPITRE 1 L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ÉTAT Section 1. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE § 1. L'évolution des rôles respectifs du président de la République et du chef du Gouvernement § 2. Les attributions administratives § 3. Les services de la Présidence de la République Section 2. LE PREMIER MINISTRE § 1. Les attributions administratives § 2. Les services du Premier ministre Section 3. LES MINISTRES § 1. Les attributions administratives § 2. L'organisation-type d'un ministère Section 4. LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET LES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES § 1. La vogue des Autorités administratives indépendantes § 2. Les pouvoirs des Autorités administratives indépendantes § 3. Le contrôle des Autorités administratives indépendantes Section 5. LES AGENCES Section 6. LA COORDINATION DE L'ACTION DES AUTORITÉS CENTRALES Les organes de l'Administration d'État sont de deux sortes : d'une part, les autorités investies, dans l'ordre administratif, de compétences générales : le président de la République (Section 1) et le Premier ministre (Section 2), placés à la tête du système administratif. D'autre part, en dessous d'eux, des organes spécialisés dans la direction d'un groupe de services, les Ministres et leurs collaborateurs (Section 3). À côté de ces structures classiques ont été créés, depuis une trentaine d'années, des organismes qui échappent à la subordination hiérarchique en raison de la nature des missions qui leur sont confiées, les Autorités administratives indépendantes (Section 4). On a également vu se multiplier des organismes jouant un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques, les agences (Section 5). La dispersion des tâches administratives entre ces différentes autorités pose le problème, dans un souci de cohérence de l'action des autorités administratives centrales, de la coordination de leurs actions (Section 6). SECTION 1. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Le bicéphalisme du pouvoir exécutif à la tête de l'État – c'est-à-dire le fait que le pouvoir exécutif suprême est partagé entre deux personnes, le président de la République et le Premier ministre – commande la ventilation des attributions administratives entre ces deux autorités (§ 1) ; dans le système actuel, le président de la République possède des attributions administratives importantes (§ 2) ; il dispose, pour les exercer, d'un certain nombre de services (§ 3). § 1. L'évolution des rôles respectifs du président de la République et du chef du Gouvernement 75 Les lois constitutionnelles de 1875 ne connaissaient que le seul président de la République. Mais le problème du bicéphalisme du pouvoir exécutif se posa, dès les débuts de la III République, lorsqu'apparut, de manière strictement coutumière, le Président du Conseil des ministres. Dans la pratique ce fut ce dernier qui exerça les attributions administratives extrêmement importantes que la Constitution attribuait au président de la République, ce qui est un fort bel exemple de coutume constitutionnelle. La Constitution de 1946 devait, en quelque sorte, rédiger cette coutume ; son article 47 prévoit que « le Président du Conseil des ministres est chargé de l'exécution des lois », ce qui signifiait, si l'on se réfère à la tradition constitutionnelle française, qu'il est le chef du pouvoir exécutif, avec tout ce que cela implique. Dans un tel contexte le président de la République n'a pratiquement plus aucun rôle à jouer en matière administrative, si ce n'est formel. La V République a maintenu le bicéphalisme de l'exécutif mais en renversant le rapport des forces, c'est-à-dire en faisant du président de la République, « clef de voûte des institutions » selon la formule bien connue de e e Michel Debré, le véritable chef du pouvoir exécutif et lui donnant donc un rôle important en matière administrative. Mais si l'intention est certaine, elle ne se traduit qu'imparfaitement dans les textes qui ne sont pas exempts d'ambiguïté. En effet, si l'article 13 de la Constitution (v. ss 76) confie expressément d'importantes attributions administratives au président de la République, l'article 20 de ce même texte n'en prévoit pas moins que le Gouvernement – c'est-à-dire l'ensemble formé par le Premier ministre et les ministres – « dispose de l'Administration » et que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », l'article 21 ajoutant que le Premier ministre « assure l'exécution des lois » (v. ss 80). La pratique de la V République a fait du président de la République le véritable chef de l'Administration. Il n'en va autrement qu'en période de « cohabitation » où l'on en revient à l'application stricte des textes, le Premier ministre étant alors le chef de l'Administration . Le « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V République », dit Comité Balladur, dans le Rapport remis au président de la République, avait proposé de lever cette ambiguïté en précisant à l'art. 5 de la Constitution que le Président « définit la politique de la nation » et à l'art. 20 que le gouvernement « conduit » celle-ci. Cette proposition n'a pas été retenue. e 71 e § 2. Les attributions administratives 72 Il faut distinguer les attributions administratives du président de la République en période « ordinaire » et en période « exceptionnelle », c'est-àdire d'application de l'article 16 de la Constitution. 76 A. En période ordinaire ◊ Les attributions administratives du Président en période ordinaire figurent aux articles 13, 15, et 38 de la Constitution. Ce sont : 1 La signature des décrets délibérés en Conseil des ministres (art. 13, 1 alinéa). La règle est importante puisqu'elle signifie que dès qu'un décret a été délibéré en Conseil des ministres il requiert la signature du Président, ce qui pose la question de savoir quels sont les décrets examinés en Conseil des ministres. Les textes exigeant expressément un « décret en Conseil des ministres » sont relativement rares : en dehors de ce cas, aucun texte n'indique quels sont les décrets qui doivent venir en Conseil des ministres. Dans la pratique, – et par révérence envers le président de la République, chef du pouvoir exécutif – les décrets les plus importants sont examinés en Conseil des ministres. Toutefois, en période de cohabitation, on n'y fera venir que ceux pour o er lesquels une telle formalité est exigée. Si un décret a été pris en Conseil des ministres, alors que cela n'était pas obligatoire, il ne peut plus être abrogé ou modifié que par le président de la République en Conseil des ministres (CE, ass., 10 sept. 1992, Meyet, Rec. 327, concl. D. Kessler ; CE 19 juin 2013, M. C., AJDA 2013. 1894) mais le décret modificatif peut prévoir qu'à l'avenir il pourra l'être par décret du Premier ministre (CE 9 sept. 1996, Min. de la Défense c/ Callas, D. 1997. 129, note O. Gohin) . 2 La signature des ordonnances de l'article 38 de la Constitution. L'article 38 de la Constitution (v. ss 335) prévoit que les ordonnances sont délibérées en Conseil des ministres, et l'article 13 de la Constitution exige pour celles-ci la signature du Président. Lorsque la Constitution prévoit qu'un décret ou une ordonnance sont signés par le Président, se pose le problème de savoir s'il peut refuser sa signature, problème qui, dans la pratique, ne peut se poser qu'en période de cohabitation. Il semble difficile de considérer que le Président est alors une sorte de « distributeur automatique » de signatures. S'il signe c'est qu'il a aussi le pouvoir de ne pas signer. Le problème s'est posé en 1986 lorsque le Président a refusé de signer les ordonnances relatives au découpage des circonscriptions électorales qui avaient été délibérées en Conseil des ministres. La raison donnée par le Président – à savoir que l'on ne pouvait pas procéder à ce découpage par Ordonnance – n'était certainement pas pertinente car l'article 38 de la Constitution ne limite pas les matières pouvant faire l'objet d'ordonnances (le Gouvernement peut y recourir « pour l'exécution de son programme »). Les ordonnances ont alors tout simplement été transformées en un projet de loi qui a été voté sans aucun délai par le Parlement… et la loi ainsi votée promulguée par le Président. 3 La nomination aux emplois civils et militaires de l'État (Const., art. 13, 2 al.). La Constitution énumère un certain nombre de hauts fonctionnaires (ambassadeurs, préfets, conseillers d'État…) qui sont nommés en Conseil des ministres et, pour les autres emplois, renvoie à une loi organique le soin de fixer ceux auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le Président peut déléguer son pouvoir de nomination. L'Ordonnance du 28 novembre 1958 énumère donc les autres emplois pourvus en Conseil des ministres, ceux qui le sont par décret simple du président de la République (par exemple les Professeurs d'Université), le pouvoir de nomination pour les autres emplois étant délégué au Premier ministre. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, modifiant l'article 13 de la Constitution (5 al.) a créé une procédure soumettant à l'avis préalable du 73 o o e e Parlement un certain nombre de nominations effectuées par le président de la République. La L.O. du 23 juillet 2010 énumère les 51 emplois concernés (dirigeants de grandes entreprises publiques, présidents d'autorités administratives indépendantes…) et la loi du 23 juillet 2010 précise laquelle des Commissions permanentes de chaque Assemblée a, dans chaque cas, compétence pour formuler l'avis. Il s'agit d'un avis public mais la nomination n'est pas possible si l'addition des votes négatifs représente au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés dans chaque commission. Sur le refus de réunir la Commission du Sénat compétente pour donner cet avis : CE 13 déc. 2017, Président du Sénat, Rec. 370. La procédure s'applique à la nomination du Défenseur des Droits et à celle des membres du Conseil constitutionnel mais celles faites par le Président de chacune des deux assemblées sont soumises au seul avis de la commission compétente de l'assemblée concernée . 4 Les attributions en matière de Défense nationale (Const., art. 15). Le président de la République « chef des Armées », préside les Conseils et Comités supérieurs de la défense nationale. Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Aux termes de l'article 19 Const. les décisions prises par le président de la République dans le cadre de ses attributions administratives sont soumises au contreseing (signer avec) du Premier ministre et des « ministres responsables », c'est-à-dire ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des actes en cause. 74 o 77 B. En période d'application de l'article 16 de la Constitution ◊ Lorsqu'une menace grave et immédiate pèse sur les institutions de la République ou l'indépendance de la Nation et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République peut, sous sa seule signature, décider la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution (v. ss 356). Cela lui permet de prendre « les mesures exigées par ces circonstances ». Les décisions ainsi prises, après avis du Premier ministre, des Présidents des Assemblées et du Conseil constitutionnel, peuvent comprendre non seulement des décisions générales dans les domaines tant législatif que réglementaire et modifiant ou complétant les textes antérieurs, mais encore des décisions particulières, conformes ou non aux lois et règlements . 75 § 3. Les services de la Présidence de la République 76 78 Alors que, en 1958, on a donné d'importants pouvoirs au président de la République, on n'a pas pour autant constitué autour de lui une véritable administration. Cela tient, pour partie, à l'exiguïté du Palais de l'Élysée (le Général de Gaulle avait songé à installer la présidence au château de Vincennes). Cela veut dire que, dans un certain nombre d'hypothèses, la présidence utilisera soit les Services de Matignon, soit ceux de tel ou tel ministère (par exemple, pour préparer un projet de texte). Autour du Président se trouvent : 1. Le Secrétariat général de la Présidence de la République , composé d'un Secrétaire général, du Secrétaire général-adjoint et d'une trentaine de conseillers techniques et de chargés de mission qui ont en charge les relations avec un ou plusieurs ministères. Le Secrétariat général étudie les affaires que lui confie le Président mais peut également lui soumettre une question qui lui paraît mériter son attention. 2. Le Cabinet, ayant à sa tête le directeur du cabinet, qui est chargé de l'organisation matérielle et financière de la Présidence, ainsi que de l'agenda du Président. 3. L'État-major particulier qui assiste le Président dans son rôle de chef des Armées. Le décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017, « relatif aux collaborateurs du président de la République et des membres du gouvernement », prévoit que ceux-ci ne peuvent pas compter parmi les membres de leur cabinet leur conjoint ou différents parents. 77 78 SECTION 2. LE PREMIER MINISTRE 79 Sous la V République, le Premier ministre détient des attributions administratives importantes (§ 1) ; pour les exercer il dispose de services étoffés (§ 2). e § 1. Les attributions administratives La mission générale dévolue au Premier ministre (le Titre III de la Constitution est intitulé « Le Gouvernement » et non « le Premier ministre ») est définie à l'article 20 de la Constitution : « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée ». C'est l'article 21 de la Constitution qui énumère les attributions du Premier ministre. 79 A. La direction de l'action du Gouvernement ◊ La formule de l'article 21 de la Constitution selon laquelle « le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement » est susceptible de deux interprétations : soit le Premier ministre n'est qu'un primus inter pares, c'est-à-dire le premier parmi ses pairs, soit il est le supérieur hiérarchique des ministres – au sens que le droit administratif donne à cette expression – ce qui implique, par exemple, le pouvoir de réformation des décisions prises par ceux-ci. La question a été tranchée, sous la IV République, le Conseil d'État ayant jugé que le Président du Conseil n'était pas le supérieur hiérarchique des ministres : CE 12 nov. 1965, Cie Marchande de Tunisie, AJDA 1966. 167, concl. Questiaux. e 80 B. Le Premier ministre assure l'exécution des lois ◊ (Const., art. 21). Cette formule a toujours été interprétée comme conférant à son titulaire le pouvoir réglementaire général, c'est-à-dire le pouvoir de statuer par voie générale même lorsqu'aucun texte ne vient expressément lui donner cette compétence (CE 8 août 1919, Labonne, GAJA, n 34 ; CE 28 juin 1918, Heyriès, GAJA, n 30). L'article 21 de la Constitution fait application de cette jurisprudence en précisant expressément que « sous réserve des dispositions de l'article 13, il (le Premier ministre) exerce le pouvoir réglementaire » . L'article 34 C. n'a pas retiré au Chef du gouvernement les attributions de police qu'il exerçait antérieurement (CE 19 mars 2007, M Le Gac, Rec. 123). En résumé, le Premier ministre a le pouvoir réglementaire lorsque le décret n'est pas délibéré en Conseil des ministres (la compétence revient alors au président de la République, v. ss 76), ou lorsqu'aucun texte ne vient donner compétence à une autre autorité administrative. Il détient, notamment, le pouvoir réglementaire de l'article 37 de la Constitution. Le pouvoir réglementaire du premier ministre n'est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution dont la méconnaissance peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité : CE 26 avr. 2017, Sté Enedis, AJDA 2017. 913. o 80 o 81 me 81 C. La nomination aux emplois civils et militaires ◊ Il exerce cette compétence, pour certains emplois, par délégation du président de la République (v. ss 76). 82 D. Le Premier ministre est responsable de la Défense nationale ◊ Cette disposition crée une ambiguïté puisque le président de la République est le « chef des armées » (v. ss 76). Le Comité consultatif pour la révision de la Constitution (dit « Comité Vedel ») avait proposé, en 1993, de préciser que le Premier ministre est responsable de l'organisation de la Défense nationale. 83 En ce qui concerne l'exercice de ces différentes attributions, l'article 22 de la Constitution prévoit que « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ». Selon la jurisprudence, il s'agit des ministres qui ont compétence « pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution des actes en cause » (CE, ass., 27 avr. 1962, Sicard, AJDA 1962. 284, commentaires M. Galabert et M. Gentot). § 2. Les services du Premier ministre 82 À la différence de l'Élysée on trouve autour du Premier ministre des services aussi nombreux qu'importants. Ils comprennent : – le Cabinet ; – le Secrétariat général du Gouvernement ; – les services rattachés au Premier ministre. 84 A. Le Cabinet ◊ Les membres du cabinet préparent les décisions du Premier ministre et servent de relais entre celui-ci et les ministres. 85 B. Le Secrétariat général du Gouvernement ◊ Il s'agit d'un rouage 83 très important – bien que le plus souvent méconnu – de l'Administration française ; il a à sa tête le Secrétaire général du Gouvernement (qui est le plus souvent un membre du Conseil d'État) et comprend essentiellement des juristes. C'est le Secrétariat général du Gouvernement qui permet au Premier ministre d'assurer effectivement la fonction de direction de l'administration. 1. Il prépare l'ordre du jour du Conseil des ministres, dont il assure le secrétariat, ainsi que la mise en forme des décisions qui y sont prises. Le Secrétaire général du Gouvernement assiste au Conseil des ministres. 2. Il a en charge la préparation et la coordination des textes élaborés par le Gouvernement. C'est lui qui, le cas échéant, transmettra les projets de loi ou de règlement aux organismes appelés à donner leur avis sur ceux-ci. Il transmet les projets de loi au Parlement, assure le service du contreseing etc. Il assure la conservation et l'archivage des décisions. 3. Il est chargé de la documentation générale du Gouvernement et des services d'études. 86 C. Les services rattachés au Premier ministre ◊ Un certain nombre de services de l'Administration sont directement rattachés au Premier ministre, soit parce que leur mission déborde le cadre d'un seul département ministériel, soit parce que, du fait de leur importance, il paraît préférable qu'ils soient « dans le giron » du Premier ministre. Parmi les services rattachés on peut citer, à titre d'exemple, la Commission d'accès aux documents administratifs (v. ss 445), la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Haut-Conseil de l'intégration, l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes etc. Le décret du 21 avril 2006 a créé sous l'autorité du Premier ministre, un « Secrétariat général de l'Administration » pour suivre les problèmes des agents constituant l'encadrement supérieur des administrations. Deux services méritent une mention particulière : 1. Le Secrétariat Général aux Affaires européennes (SGAE), créé par un décret du 17 octobre 2005, a succédé au Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI) qui était l'organe chargé des relations entre l'Administration française et l'Union européenne ; c'est dire que son rôle a été de plus en plus important. Le SGAE, qui compte quelque 200 agents, assure la coordination de la position des différentes administrations françaises sur l'ensemble des questions communautaires. C'est, ensuite, cette position, prenant en compte, le cas échéant, les résolutions votées en la matière par le Parlement (Const., art. 884), qui sera défendue par les représentants de la France auprès de l'Union européenne (v. ss 320). Le SGAE est placé sous l'autorité du Premier ministre mais la nomination à sa direction du Conseiller Europe du président de la République le place, en fait, dans l'orbite de la Présidence de la République. Cela paraît assez logique puisque c'est le président de la République, et non le Premier ministre, qui assiste au Conseil européen. Le décret du 17 octobre 2005 crée également, sous la présidence du Premier ministre, un Comité Interministériel sur l'Europe. 2. Le Secrétariat général de la défense nationale (SGDN). Le SGDN, organisme de plus de cinq cents personnes, prépare les délibérations des Conseils et Comités de défense, informe le Gouvernement sur les questions de défense et participe à la coopération internationale en matière de défense. 84 SECTION 3. LES MINISTRES 85 Le ministre est un véritable Janus à double visage : – tout d'abord, homme politique, siégeant en tant que tel au Gouvernement ; – mais aussi autorité administrative, supérieur hiérarchique d'un secteur de l'administration (sauf le cas, rare, du ministre « sans portefeuille »). En principe tous les ministres sont sur un pied d'égalité, même si, dans la pratique, on peut craindre le primat du ministre en charge des Finances qui a un représentant – le contrôleur financier – dans chaque ministère et même à Matignon. La formule de Michel Debré : « L'État ne doit pas être une entreprise menée par son caissier » ne correspond pas toujours à la réalité. Le nombre des départements ministériels dans un Gouvernement n'est pas fixé par la loi. En pratique, les nécessités politiques jouent un rôle essentiel dans la détermination du nombre des ministères, en fonction des personnes que le chef du gouvernement juge utile de s'associer. Le nombre des ministères était de 17 avant 1950, il oscille maintenant autour de la trentaine . Cela reflète le développement des attributions de l'État : création d'un ministère de la Protection de la nature et de l'environnement (1971), secrétariat d'État aux Droits de l'homme, à la francophonie etc. On étudiera les attributions administratives du ministre (§ 1) et le schéma type d'organisation d'un ministère (§ 2). 86 § 1. Les attributions administratives Le ministre a des attributions importantes, même si elles ne figurent pas dans la Constitution. Elles se rattachent toutes à cette idée que le ministre est le supérieur hiérarchique de son Administration. Elles comprennent : 87 A. L'organisation de ses services ◊ Il appartient au ministre, même dans le silence des textes (CE 7 févr. 1936, Jamart, S. 1937. 3. 113 note Rivero, GAJA, n 45) de prendre tous les règlements nécessaires à l'organisation et au bon fonctionnement de ses services. o 88 B. La gestion de la carrière de ses agents ◊ Supérieur hiérarchique de son administration, le ministre doit prendre toutes les décisions relatives à la carrière des fonctionnaires de ses services. Cela peut représenter une masse considérable de décisions à prendre s'il s'agit, par exemple, de l'Éducation nationale qui compte près d'un million d'agents, ce qui, au surplus, démontre la nécessité de déconcentrer de tels pouvoirs de décision 89 C. Le pouvoir d'instruction ◊ Supérieur hiérarchique, le ministre a le pouvoir de donner des instructions à ses subordonnés. Ce pouvoir peut prendre la forme d'ordres collectifs ou individuels. 1. Les ordres collectifs se présentent sous la forme d'instructions de service ou de circulaires ministérielles (v. ss 428). Ces dernières jouent, dans le fonctionnement pratique de l'administration française, un rôle important : c'est la « bible » et le « parapluie » du fonctionnaire ! 2. Les ordres individuels sont naturellement obligatoires pour les personnes qui les reçoivent. Il se pose, cependant, le problème de l'ordre illégal. Aux termes de la jurisprudence, si l'ordre est entaché d'une « illégalité manifeste et évidente » c'est alors la désobéissance qui est le devoir du subordonné (CE 10 nov. 1944, Lagneur, D. 1945. 88, concl. Chenot). 90 D. Le pouvoir de réformation des décisions des subordonnés ◊ Le ministre, soit spontanément, soit sur requête d'un administré (il s'agit alors d'un recours hiérarchique, v. ss 557) peut soit annuler, soit modifier (ne serait-ce qu'en procédant à une substitution de motifs, c'est-à-dire en substituant une motivation pertinente à la motivation initiale de l'acte qui ne l'était pas), la décision prise par son subordonné. Ce pouvoir était, traditionnellement, présenté (sous réserve des règles gouvernant le retrait et l'abrogation, v. ss 454 s.) comme très étendu. J.-Cl. Groshens a montré qu'en réalité il était enfermé dans des limites strictes . 87 91 E. Le problème du pouvoir réglementaire des ministres ◊ Aussi curieux que cela puisse paraître a priori, les ministres (y compris le ministre de l'Intérieur) n'ont pas le pouvoir réglementaire c'est-à-dire le pouvoir de statuer par voie générale ; à la réflexion cela n'est pas illogique puisque le pouvoir réglementaire général appartient au Premier ministre (v. ss 80). Le ministre ne dispose d'un pouvoir réglementaire que dans deux cas : – tout d'abord pour l'organisation de ses services (v. ss 87), – en second lieu lorsqu'un texte le lui confère expressément, ce qui n'est pas rare (par exemple pouvoir donné au ministre des Transports de prendre les règlements relatifs aux transports). Mais la réalité nécessite que l'on nuance sérieusement l'affirmation, toute théorique, que les ministres n'ont pas de pouvoir réglementaire. Tout d'abord le ministre pourra suggérer au titulaire du pouvoir réglementaire, par exemple le Premier ministre, de prendre tel ou tel décret. En ce cas, il est plus que probable qu'on lui demandera de préparer, c'est-à-dire de rédiger, le texte en cause. À l'arrivée, le ministre devra contresigner le décret. Enfin, la pratique montre qu'il n'est pas rare que, sous le couvert de circulaires, le ministre prenne de véritables règlements (v. ss 428) . Le ministre statue, normalement, par voie d'arrêté ministériel, comprenant l'indication des textes qui fondent la décision (visas), et la décision elle-même, divisée en articles (dispositif). Lorsque celle-ci est défavorable, elle doit, 88 depuis la loi du 11 juillet 1979, indiquer ses motifs (v. ss 439). L'arrêté ministériel est, selon son contenu, individuel ou réglementaire. Si la décision à prendre relève de plusieurs ministres elle prend la forme d'un arrêté interministériel. § 2. L'organisation-type d'un ministère 89 Les ministres étant libres d'organiser leurs services à leur convenance il y a une assez grande diversité dans l'organisation des services des différents ministères. Cependant, ceux-ci comportent un certain nombre d'éléments communs : en effet, on trouve toujours : 92 A. Le cabinet ◊ C'est le groupe des collaborateurs directs du ministre, librement choisis par lui, à raison de la confiance qu'ils lui inspirent ; leurs fonctions prennent fin lorsque lui-même abandonne le ministère. En pratique, les principaux membres des cabinets ministériels sont fréquemment pris parmi le personnel des grands corps de l'État : Conseil d'État, Inspection des finances, Cour des comptes. Le cabinet est organisé selon une hiérarchie particulière (directeur du cabinet, chef de cabinet, attachés, chargés de mission). Sa composition, longtemps laissée à l'appréciation du ministre a parfois donné lieu à un gonflement abusif . Par le décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017, le président de la République a fixé à dix membres au maximum le cabinet d'un ministre, à huit membres au maximum le cabinet d'un ministre délégué et à cinq membres au maximum celui d'un secrétaire d'État, ce qui fait de ceux-ci des entourages particulièrement restreints. Il sera intéressant de voir si ce texte sera respecté sans manœuvres dilatoires ! Par ailleurs (art. 4) tout membre d'un cabinet doit adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les fonctions du cabinet, toujours importantes, dépendent des conceptions propres à chaque ministre. Elles sont pour partie d'ordre politique (rapports du ministre avec le Parlement et les électeurs du ministre), pour partie d'ordre administratif, le ministre préférant souvent confier à ses collaborateurs personnels, plutôt qu'aux bureaux, l'étude de questions particulièrement importantes ou délicates. Les membres des cabinets ne sont pas nécessairement des fonctionnaires. 90 91 93 B. L'administration centrale proprement dite ◊ Ce sont « les bureaux du ministère », organes permanents de préparation et d'exécution des décisions. Ils sont – à la différence du cabinet – composés de fonctionnaires qui y font leur carrière. Bien que dénués de tout pouvoir propre (leur rôle se limite à la préparation, le ministre seul décide), ils n'en possèdent pas moins, en fait, une puissance considérable, qui tient d'une part à leur stabilité – les ministres passent, les bureaux demeurent – d'autre part, à leur technicité – c'est eux qui mettent le ministre au courant des problèmes qu'il doit résoudre – enfin au nombre des décisions incombant au ministre, si considérable qu'il ne peut prendre, de chaque dossier, une connaissance personnelle, et, souvent, est obligé de s'en remettre à l'avis de ses collaborateurs. Ainsi s'expliquait, sous la IV République, la relative continuité, malgré l'instabilité politique, de la vie administrative française, les bureaux poursuivant souvent, à travers les changements politiques, leur propre tradition . L'organisation de chaque ministère est fixée par décret. Elle varie de l'un à l'autre. Partout, cependant, la subdivision essentielle est la direction, ou la direction générale, regroupant des bureaux et des divisions. Le personnel est hiérarchisé ; à la tête des directions, les directeurs ou directeurs généraux sont de hauts fonctionnaires, nommés par décret en Conseil des ministres, qui jouent dans la vie nationale un rôle souvent ignoré, mais essentiel. Sous leur autorité les agents relèvent, soit du cadre supérieur des administrateurs civils, issus, en principe, de l'École nationale d'administration, soit, pour les emplois moins importants, du cadre des attachés d'administration centrale, recrutés par un concours distinct. Dans certains ministères (Finances, Intérieur, Défense, Agriculture par exemple) la coordination des services est confiée à un Secrétaire général dont les attributions sont fixées par le décret 2014-834 du 24 juillet 2014. e 92 94 C. Les corps d'inspection et de contrôle ◊ Ce sont des corps de fonctionnaires chargés, pour le compte du ministre auquel ils sont directement rattachés, d'inspecter les services déconcentrés du ministère, soit au point de vue technique (inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire), soit au point de vue financier (contrôleurs généraux des Armées, et surtout Inspection générale des Finances). Il faut faire une place à part à ce dernier corps, qui, audelà de ses fonctions propres, a pris dans la vie administrative un rôle de premier plan. Il arrive également que le Ministre les charge d'étudier ou de préparer une réforme qu'il désire entreprendre. Sur les conditions de nomination à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'administration : CE, ass., 11 juill. 2012, Synd. autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration au ministère de l'Intérieur, Rec. 275. 93 95 D. Les organismes consultatifs ◊ Ce sont des organes placés soit auprès 94 de l'ensemble du gouvernement, soit auprès d'un ministre pour donner un avis, avant décision, sur certaines catégories de projets préparés par l'administration centrale. Ils sont très – trop – nombreux, et très divers mais il faut mettre à part deux organes partiellement consultatifs, dont l'existence est consacrée par la Constitution, et dont le rôle est d'une extrême importance : le Conseil d'État, organe consultatif commun à tous les ministères, en même temps que juridiction administrative (v. ss 636), et la Cour des comptes qui, outre ses attributions contentieuses à l'égard des comptes des comptables publics, « assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances… ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques » (Const., art. 47-2). 1 Statut. Il varie de l'un à l'autre ; le texte institutif fixe leur nom (comité, conseil, commission, etc.), leur durée (quelques-uns sont provisoires, la plupart sont institués à titre permanent), le régime de leurs sessions : ils se réunissent, soit sur convocation du ministre, soit selon une périodicité imposée. 2 Composition. Les membres des conseils ne sont normalement appelés à y siéger qu'en raison de leur activité ou de leur fonction principales, qui fait présumer leur aptitude à donner des avis utiles. Cette aptitude tient, soit à leur compétence technique, soit à leur autorité personnelle, soit à leur caractère représentatif (délégués des professions ou des intérêts en cause) : dans ce cas, l'administration consultative peut constituer un moyen de participation des intéressés à l'administration. La composition des conseils est donc extrêmement variée, comprenant aussi bien des particuliers que des fonctionnaires. 3 Attributions. Un trait est constant : les conseils sont de simples donneurs d'avis, sans aucun pouvoir de décision. L'avis est normalement sollicité par un ministre, soit que les textes lui en fassent une obligation, soit qu'il le demande librement ; mais il ne lie jamais le ministre qui, même lorsqu'il est tenu de le demander, reste libre de ne pas le suivre, hormis les cas très rares où les textes prévoient que la décision doit être prise sur « avis conforme » du Conseil. Parfois, le Conseil peut se saisir lui-même et prendre l'initiative d'un avis. Parfois aussi, il a le droit de s'enquérir des suites que le ministre a réservées à son avis. 4 Les conseils sont soit rattachés à un ministère, soit interministériels ; d'autres sont rattachés directement au Premier ministre (v. ss 86) ; on en trouve aussi dans les services déconcentrés, auprès du préfet. 5 À côté des organes consultatifs permanents, les gouvernements font souvent appel à des Commissions d'étude, provisoires, composées de o o o o o personnalités très variées auxquelles le vocabulaire récent confère une présomption de « sagesse », pour procéder à l'examen approfondi d'un problème. On les désigne souvent par le nom de leur président. Les rapports qui font la synthèse de leurs travaux sont parfois à l'origine de réformes importantes ; plus souvent, ils tombent dans l'oubli. Ce même type d'étude peut être confié, non à une commission, mais à une seule personne, notamment à un parlementaire en mission. 6 La multiplication des conseils est un des traits de l'administration contemporaine . Les avantages en sont évidents, sur le terrain de la compétence technique et plus encore de l'association des intéressés à la vie administrative. Les risques ne sont pas moindres : dilution des responsabilités si le ministre cherche un paravent dans l'avis du conseil pour éviter de se prononcer lui-même, gaspillages de force dans les cas, nombreux, où les avis demeurent sans suites ; toujours, retard ; parfois, fausse sécurité, certains membres des conseils ne pouvant consacrer qu'un minimum d'attention à des affaires qui demeurent étrangères à leurs préoccupations principales ; d'où un effort pour en réduire le nombre. Cependant le recensement annexé au projet de loi de finances pour 2010 recense 719 comités ou instances consultatives… après suppression de 225 de ceux-ci et 668 en 2012 ! Un décret du 23 mai 2013 en a supprimé également 64. Ces problèmes ont fait l'objet de l'ordonnance 2004-637 du 1 juillet 2004. Le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif a réalisé en la matière une simplification certaine. Un décret du 23 mai 2013 a supprimé un certain nombre de commissions administratives à caractère consultatif et modifie le décret du 8 juin 2006. D'autre part, l'article 16 de la loi du 17 mai 2011 « de simplification et d'amélioration de la qualité du droit », donne la possibilité de recourir, préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire, à la consultation publique sur un site internet de toutes les personnes concernées par le projet. Cette procédure a fait l'objet du décret n 2011-1832 du 8 décembre 2011. Le Titre III du CRPA codifie « l'association du public aux décisions prises par l'administration » et, notamment, tout ce qui concerne les consultations ouvertes sur Internet. L'ordonnance 2014-1329 du 6 novembre 2014 et le décret 2014-1627 du 26 décembre 2014 organisent les délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Le problème de l'Administration consultative est apparu suffisamment important pour faire l'objet du Rapport annuel du Conseil d'État pour 2011 . o 95 er o 96 SECTION 4. LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET LES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES 97 Depuis plus d'une trentaine d'années on a vu apparaître au sein des administrations centrales de l'État ce que l'on appelle des « Autorités administratives indépendantes ». Le phénomène a pris de plus en plus d'ampleur (§ 1) ; il pose le problème des pouvoirs qu'il convient de leur reconnaître (§ 2) et donc de leur contrôle (§ 3). § 1. La vogue des Autorités administratives indépendantes 96 À l'origine de l'apparition des Autorités administratives indépendantes, il y a la volonté de donner plus de liberté et d'indépendance à certains services des administrations centrales parce qu'ils ont la responsabilité de secteurs « sensibles », c'est-à-dire touchant aux droits et libertés des citoyens, tels, par exemple, que les fichiers, l'informatique ou le contrôle de la radio et de la télévision. Pour cela on ne passe pas par le biais de la reconnaissance de la personnalité morale – il ne s'agit pas de « services personnalisés » – mais leur indépendance provient du fait qu'ils ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique d'un ministre ; ils prennent leurs décisions en toute liberté. Certains ont dénoncé, dans cette technique, un processus de démembrement du pouvoir central. On a même fait observer, d'un point de vue constitutionnel, qu'elles échappaient très largement au Premier ministre, alors, cependant, que celui-ci « dispose de l'Administration » (art. 20 Const.) et qu'il répond du fonctionnement de celle-ci devant le Parlement. La première autorité administrative indépendante a été créée, en 1978, pour veiller au respect des droits des administrés en ce qui concerne les fichiers : il s'agit de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) . Depuis on a vu apparaître, sans que cette liste soit exhaustive, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), également en 1978 (v. ss 443) ; la Commission de la concurrence à laquelle s'est substituée l'Autorité de la concurrence (L. 4 août 2008 et Ord. 13 nov. 2008) ; la Commission des opérations de bourse, remplacée par l'Autorité des marchés financiers qui, aux termes de l'art. L. 621-1 Code monétaire et financier, juridiquement, n'est pas une autorité administrative indépendante mais une « autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale » (v. ss 285) ; parallèlement, l'Ordonnance du 21 janvier 2010 a créé l'Autorité de contrôle prudentiel, par fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la 98 99 100 banque et de l'assurance ; la Commission nationale de déontologie de la sécurité ; l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (L. 12 juil. 1999) ; l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) qui s'est substituée à l'ART (L. 20 mai 2005) ; la Haute autorité de la communication audiovisuelle, créée par la loi du 29 juillet 1982, a été remplacée par la Commission nationale de la communication et des libertés (L. 30 sept. 1989), à laquelle a succédé le Conseil supérieur de l'audiovisuel (L. 17 janv. 1989), instance suprême en matière de radio et de télévision ; la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE – L. 30 déc. 2004) qui relève désormais du Défenseur des Droits ; la Haute Autorité de Santé (L. 13 août 2004) ; l'Agence française de lutte contre le dopage (L. 5 avr. 2006) ; l'Autorité de sûreté nucléaire (L. 13 juin 2006) ; le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (L. 30 oct. 2007) ; l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (L. 8 déc. 2009) ; l'Autorité de régulation des jeux en ligne (L. 12 mai 2010) ; la Haute Autorité de la transparence de la vie publique (L.-O. et loi du 11 octobre 2013) ; la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) créée par la loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement. Selon le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation on dénombrait, en 2006, 39 AAI. Pour leur composition il faut mentionner l'ordonnance 2015-948 du 31 juillet 2015 « relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ». Cette multiplication d'organes administratifs d'un type nouveau témoignait, certes, d'une volonté de modernisation de l'Administration traditionnelle, mais avait, cependant, un caractère désordonné et constituait ce que Patrice Gélard, dans un rapport au Sénat, avait qualifié « d'objets juridiques non identifiés » ; on était en présence d'un véritable « patchwork » juridique et il fallait y mettre bon ordre. C'est ce qui s'est produit, à l'initiative des parlementaires, avec le vote d'un statut les concernant. 101 102 103 97 Le statut des AAI et API ◊ La réforme a été opérée par la loi organique n ° 2017-54 du 20 janvier 2017 « relative aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes » et par la loi n ° 2017-55 du 20 janvier 2017 « portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes . La création des AAI et API, qui disposent de la personnalité morale, est réservée à la loi qui « fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des AAI et des API » (art. 1 L-O). En annexe à la loi du 104 105 er 20 janvier 2017 figure la liste des 19 AAI et 7 API (v. la liste de celles-ci in AJDA 2017. 4). La durée des mandats des membres de ces autorités est comprise entre trois et six ans, et les fonctions ne sont renouvelables qu'une seule fois. Ils ne sont pas révocables et ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité dans l'exercice de leurs fonctions (art. 9 de la loi). L'article 4 de la loi organique ajoute plusieurs présidences d'AAI et d'API à la liste des fonctions qui doivent être soumises à l'approbation du Parlement en application de l'article 13 de la Constitution. Les textes organisent un régime assez strict d'incompatibilités des fonctions, pour les présidents et pour les membres, tant avec un certain nombre de mandats électifs qu'avec des fonctions économiques (par exemple, celle de chef d'entreprise). La loi impose une déontologie des fonctions et la prévention des conflits d'intérêts. Le contrôle du Parlement sur les autorités est renforcé et celles-ci doivent lui adresser un rapport annuel rendant compte de leur activité, sans compter les demandes formulées par les commissions du Parlement. § 2. Les pouvoirs des Autorités administratives indépendantes 98 Les pouvoirs reconnus aux Autorités administratives indépendantes sont extrêmement variables. Certaines n'ont qu'un simple pouvoir d'avis, d'autres peuvent prendre de véritables règlements , certaines ont même le pouvoir d'infliger des sanctions, parfois extrêmement lourdes . Le Conseil constitutionnel a jugé que ce pouvoir de sanction n'était contraire à aucun texte ou principes constitutionnels et qu'il devait s'exercer dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'Autorité à laquelle il est confié dès lors que son exercice est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis (Cons. const. n 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, p. 107). Mais il a sanctionné l'absence de séparation, au sein de l'autorité, entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement (Cons. const. Décis. n 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, AJDA 2013. 1421 ; Cons. const. Décis. n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, AJDA 2017. 2336). D'autres, par exemple l'Autorité de la concurrence, possèdent de véritables pouvoirs juridictionnels . Ceci pose le problème des garanties qu'il convient de donner à ceux qui relèvent de telles instances. 106 107 o o 108 § 3. Le contrôle des Autorités administratives indépendantes 109 99 La logique voudrait, s'agissant d'Autorités administratives, que le contentieux des Autorités administratives indépendantes relève de la compétence des juridictions administratives. Mais il est de plus en plus fréquent que les assignations de compétence opérées par le législateur se fassent au profit de la juridiction judiciaire (v. ss 589). C'est ce qui se passe assez souvent en ce qui concerne les Autorités administratives indépendantes. Ainsi, à titre d'exemple, les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, et plus spécialement de la Cour d'appel de Paris, mais les actions en responsabilité causées par son fonctionnement défectueux relèvent, elles, de la compétence administrative (T. confl. 2 mai 2011, Société Europe finance et industrie, AJDA 2011. 932) . Sur le fond, et c'est cela l'essentiel, les deux ordres de juridiction considèrent que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (v. ss 324) sont applicables aux autorités administratives indépendantes : pour la juridiction administrative, v. : CE, ass., 3 déc. 1999, Didier, GAJA n 97 ; CE 9 mars 2016, M. V., Rec. 63 ; CE, sect., 27 oct. 2006, M. Parent et autres, RD publ. 2007. 610. Ainsi, la Commission de contrôle des assurances lorsqu'elle exerce une fonction juridictionnelle doit respecter le principe d'impartialité : CE 28 oct. 2002, M. Laurent, AJDA 2002. 1492, note D. Costa ; CE 26 juill. 2007, M. P., AJDA 2007. 1947 ; CE 22 déc. 2011, Union mutualiste générale de prévoyance, AJDA 2012. 670. 110 o SECTION 5. LES AGENCES 100 111 Depuis les années 1960, on a vu se multiplier des organismes – le plus souvent sous l'appellation d'agences – jouant un rôle important dans la mise en œuvre des politiques publiques. Elles se présentent sous les formes juridiques les plus diverses : établissement public administratif, service à compétence nationale, établissements publics industriels et commerciaux, groupements d'intérêt public ou même associations ou sociétés. Il s'agit, par exemple, de l'Office National des Forêts (ONF), du Pôle Emploi, ou encore des Agences régionales de Santé. Le Rapport du Conseil d'État en dénombre 103 représentant un budget de 330,4 milliards d'euros et recourant aux services de 145 000 équivalents temps plein ! Les Agences sont des organismes opérationnels, pas indépendants mais autonomes et rattachés à une autorité de tutelle. Le risque est bien sûr qu'elles constituent des démembrements de l'État même si, pour le Vice-Président du Conseil d'État « l'agence ce n'est pas moins d'État, c'est l'État autrement ». Il paraît pour le moins indispensable d'encadrer strictement le recours aux agences, ce que se propose de faire une circulaire du Premier ministre du 9 avril 2013 (AJDA 2013. 716). L'Inspection Générale des Finances a dressé un constat très critique de celles-ci (AJDA 2012. 1708). SECTION 6. LA COORDINATION DE L'ACTION DES AUTORITÉS CENTRALES La ventilation des attributions administratives entre le président de la République, le Premier ministre, les ministres et les Autorités indépendantes pose le problème de la cohérence des actions menées à l'échelon central. Toute contradiction en la matière, ou même une insuffisante complémentarité, serait hautement dommageable. Cela est loin d'être aisé. Si l'on prend, par exemple, les problèmes relatifs à l'enseignement on constate qu'un grand nombre de ministères ont à intervenir en la matière : – Éducation nationale ; – Santé publique ; – Agriculture ; – Travail ; – Armées ; – Industrie ; – Affaires étrangères. À côté des moyens traditionnels (A) de la coordination interministérielle, existent des structures (B) spécialement créées à cet effet. 101 A. Les moyens classiques de la coordination ◊ Au sommet, la coordination peut tout d'abord être assurée par les délibérations du Conseil des ministres . Mais elle est surtout le fait des Conseils ou Comités interministériels. Il s'agit d'instances présidées soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, qui réunissent les seuls ministres intéressés par la question traitée ; ceux-ci peuvent venir accompagnés des hauts fonctionnaires qui, au sein de leur administration, suivent le problème traité. L'objectif le plus général de tels conseils ou comités est d'assurer la coordination au niveau gouvernemental. De même c'est la fonction par essence du Secrétariat général du Gouvernement (v. ss 78) que d'être l'organe de la coordination et de la continuité gouvernementales. 112 102 B. Les structures « ad hoc » de la coordination ◊ Depuis quelques décennies on recourt également à ce que l'on appelle quelquefois la « coordination horizontale », c'est-à-dire que l'on crée spécialement un organisme auquel on confie la coordination de l'action des administrations centrales dans un secteur déterminé. C'est par exemple dans ce but que l'on a créé, en 1963, la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) qui correspond à ce que l'on appelle une « administration de mission », c'est-à-dire qu'elle doit faire faire, sans faire elle-même. La DATAR a pour mission de coordonner l'action des différentes administrations en matière d'aménagement du territoire, les décisions nécessaires étant prises par le Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT). La DATAR a été remplacée par la « Délégation interministérielle à l'aménagement et à l'attractivité régionale » (Décr. du 14 sept. 2009) qui a été à son tour supprimée par le décret du 31 mars 2014, modifié par le décret du 21 juillet 2017, créant le Commissariat général à l'égalité des territoires. C'est dans le même esprit qu'a été créé, en 1946, le Commissariat général au Plan appelé à prendre en charge la planification « à la française » et jouant donc un rôle important en ce qui concerne la coordination des actions économiques. Le Commissariat au Plan avait été remplacé par le « Centre d'analyse stratégique », auquel on a substitué le « Commissariat général à la stratégie et à la prospective » (Décr. du 22 avril 2013, modifié par le décret du 24 mars 2017). Placé auprès du Premier ministre « il apporte son concours au Gouvernement pour la détermination des grandes orientations de l'avenir de la nation et des objectifs à moyen et à long terme de son développement économique, social, culturel et environnemental ainsi que pour la préparation des réformes décidées par les pouvoirs publics ». CHAPITRE 2 L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT 113 Section 1. L'ESSOR DE LA DÉCONCENTRATION Section 2. § 1. § 2. § 3. LES SERVICES RÉGIONAUX DE L'ÉTAT La résolution des problèmes posés par la loi du 16 janvier 2015 Les organes de la circonscription régionale Les compétences de la circonscription régionale Section 3. LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉTAT § 1. Le préfet § 2. Les services du préfet Section 4. L'ARRONDISSEMENT Section 5. LA COMMUNE L'État a des services répartis géographiquement sur l'ensemble du territoire. Ce sont eux qui permettent la déconcentration. La déconcentration de l'organisation administrative de l'État prend de plus en plus d'importance (Section 1). Sur cette base les Services de l'État sont organisés à quatre niveaux d'importance fort inégale : la région (Section 2), le département (Section 3), l'arrondissement (Section 4), la commune (Section 5). SECTION 1. L'ESSOR DE LA DÉCONCENTRATION 103 114 Pendant longtemps, il n'y a pas eu de véritable politique en ce qui concerne la déconcentration. De temps en temps on décidait un « train de mesures de déconcentration » qui était trop souvent un moyen commode pour les administrations centrales de se débarrasser d'un certain nombre de compétences peu « gratifiantes » : on déconcentrait, par exemple, le pouvoir de décider l'agrandissement des cimetières communaux, ou celui de décerner la médaille d'honneur des pompiers ! Mais depuis plus d'une vingtaine d'années tous les gouvernements ont souligné la nécessité et l'importance de la déconcentration, ne serait-ce que pour accompagner les progrès de la décentralisation : les collectivités territoriales auxquelles on transfère de nouvelles compétences doivent en effet trouver, à l'échelon local, un représentant de l'État disposant également de réels pouvoirs. C'est une véritable politique de la déconcentration que l'on a mise en place avec la loi du 6 février 1992 (relative à l'Administration territoriale de la République). Ce texte confie aux administrations centrales « les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial ». Toutes les autres missions sont confiées aux services déconcentrés (appellation qui se substitue à celle de « services extérieurs »). Le législateur avait prévu qu'un décret en Conseil d'État viendrait mettre en œuvre ce principe nouveau de répartition des compétences ; il était intervenu avec le décret du 1 juillet 1992 portant « Charte de la déconcentration ». L'importante réforme de la décentralisation opérée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (v. ss 129) et mise en œuvre par la loi du 13 août 2004, ainsi et surtout que la réforme régionale mise en place par la loi du 16 janvier 2015 ont provoqué tout naturellement un nouvel approfondissement de la déconcentration. Les services déconcentrés de l'État sont en pleine transformation pour mettre en place dans les départements et les nouvelles régions ce que l'on a appelé « l'État interministériel ». Le décret 2015-510 du 7 mai 2015 a donc mis en place une nouvelle Charte de la déconcentration qui se substitue à celle de 1992 . Son art. 1 définit ainsi la déconcentration : « La déconcentration consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l'État le pouvoir, les moyens et la capacité d'initiative pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques définies au niveau national et européen, dans un objectif d'efficience, de modernisation, de simplification, d'équité des territoires et de proximité avec les usagers et les acteurs locaux… ». La Charte a pour ambition de « donner aux Préfets et aux chefs des services de l'État sur le territoire les marges de manœuvre et la capacité d'initiative nécessaires pour rendre l'État plus efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques ». Ce qui est important, la déconcentration pourra désormais permettre des organisations différentes selon les territoires, en fonction des réalités locales. Le décret du 7 mai 2015 organise les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les compétences et les moyens de ces derniers. Les textes ayant une er 115 er influence sur les services déconcentrés devront faire l'objet d'une étude d'impact et les objectifs hiérarchisés et coordonnés seront pluriannuels. Il est créé auprès du Premier ministre une « Conférence nationale de l'administration territoriale », présidée par le Secrétaire général du Gouvernement, qui doit veiller « à la bonne articulation des relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés et au respect des principes de déconcentration fixés par le présent décret » (art. 17). Le décret 2015-55 du 26 janvier 2015 crée un Coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l'État placé, pour deux ans, auprès du Secrétaire général du Gouvernement, durée portée à quatre ans par un décret du 13 octobre 2016. La Cour des comptes a publié, le 11 décembre 2017, un rapport intitulé « Les services déconcentrés de l'État ». Il est fort sévère puisqu'il estime que « les effets des évolutions structurelles ne sont pas à la hauteur des objectifs attendus ». Il conviendrait, selon la Cour, de recentrer les services déconcentrés sur les missions prioritaires de l'État et suggère la création d'une filière administrative interministérielle et la diminution du nombre des corps exerçant dans l'administration territoriale (v. AJDA 2017. 2441). SECTION 2. LES SERVICES RÉGIONAUX DE L'ÉTAT 116 La région est tout à la fois une collectivité territoriale (v. ss 201 s.) et une circonscription de l'administration de l'État. C'est en cette dernière qualité qu'on l'étudiera ici. La France métropolitaine était divisée en 22 régions (sans compter la Corse qui a un statut particulier) auxquelles s'ajoutent les 4 régions d'Outre-Mer. Cette organisation a été bouleversée par la loi du 16 janvier 2015 qui réduit le nombre des régions métropolitaines de 22 à 13, 6 conservant leur ancien périmètre mais les 7 autres sont issues du regroupement de 16 anciennes régions v. ss 205). Cela a donc nécessité une restructuration complète des circonscriptions régionales de l'administration d'État. § 1. La résolution des problèmes posés par la loi du 16 janvier 2015 104 Il a donc fallu réduire le nombre des Préfectures de région. Celles dont le territoire n'a pas été modifié demeurent, mais il était nécessaire d'organiser les services des 7 nouvelles régions. Pour accomplir cette mission, on a nommé 7 Préfets dits « préfigurateurs ». Ils étaient investis d'une double mission : – concevoir la répartition de l'ensemble des actuelles directions et de leurs agents sur le nouveau territoire régional : – arrêter le choix du siège des chefslieux provisoires des 7 régions. À cet égard la loi du 16 janvier 2015 a désigné Strasbourg comme le chef-lieu de sa nouvelle région, les autres chefs-lieux devant être fixés après avis des conseils régionaux élus au mois de décembre 2015. Le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 a fixé le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales. Dans chaque région fusionnée il y a outre un seul Préfet de région, un seul directeur général d'agence régionale de santé et un seul directeur régional pour chacune des administrations de l'État . Le Gouvernement veut qu'un tiers des nouvelles directions régionales soient implantées en dehors du chef-lieu. En ce qui concerne l'éducation nationale, il a également été nommé 9 Recteurs « coordonnateurs » chargés de refondre la carte des académies en 13 régions académiques. Naturellement la réforme a un important impact en ce qui concerne les personnels. On a évalué à 1 000 – ce qui paraît assez optimiste – le nombre de fonctionnaires qui devront changer d'affectation géographique dans les années à venir. Il est prévu, pour ceux dont les emplois seront supprimés, un dialogue social renforcé, un suivi personnalisé, des priorités de recrutement dans d'autres services et des aides à la mobilité. 117 § 2. Les organes de la circonscription régionale Le Préfet de région est l'organe essentiel de l'État à l'échelle de la Région. Il dispose de services relativement peu nombreux. 105 A. Le préfet de région ◊ Le préfet de région est le préfet du département 118 chef-lieu de la région. Il est le dépositaire de l'autorité de l'État, à la charge des intérêts nationaux et du respect des lois ; il représente le Premier ministre et chacun des ministres. Depuis le décret du 29 avril 2004 relatif aux Préfets, on était resté dans un « flou artistique » en ce qui concerne la nature exacte des liens régissant les relations entre le Préfet de Région et les Préfets des départements de sa région. De manière très heureuse le décret du 16 février 2010 vient lever toute ambiguïté en donnant au Préfet de région garant de la cohérence de l'action de l'État dans la région, une autorité hiérarchique sur les préfets de département qui prennent leurs décisions « conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région ». Bien plus, le préfet de région peut évoquer tout ou partie d'une compétence des préfets de département à des fins de coordination régionale . Il arrête, après consultation du Comité d'Action Régional (CAR) le projet d'action stratégique de l'État dans la région (PASER) qui hiérarchise les priorités de la politique gouvernementale pour l'adapter aux particularités de la région. Les services de l'État dans la région sont organisés en Directions régionales. Le décret 2015-1689 du 17 décembre 2015 organise les services de l'État dans les régions créées par la loi du 16 janvier 2015. Aux termes de son article 1 ceux-ci comprennent : – 1° les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 2° les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 3° les directions régionales des affaires culturelles ; 4° les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 5° les secrétariats généraux pour les affaires régionales. À quoi s'ajoute l'Agence régionale de santé. Le décret du 16 février 2010 renforce le rôle du préfet de région, en matière financière : il est associé au processus budgétaire en faisant au gouvernement des propositions d'objectifs et d'allocation de moyens. Il reçoit délégation, sous forme de dotations globales, des autorisations de programme relatives aux investissements civils exécutés ou subventionnés par l'État. Le Préfet de région est le délégué territorial des établissements publics de l'État comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État (art. 33 déc. 16 févr. 2010). 119 er 106 B. Les services du préfet de région ◊ Pour l'assister dans l'exercice de 120 ses attributions, le préfet de région dispose d'un Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR), ainsi que d'un certain nombre de chargés de mission outre, bien sûr les chefs des pôles régionaux. Il est assisté par le Comité de l'administration régionale (CAR) qui s'est substitué, en 2004, à la Conférence administrative régionale. Le Comité comprend, les préfets des départements, les chefs des services régionaux, le Secrétaire général pour les affaires régionales, et le Secrétaire général du département chef-lieu de la région. Il joue le rôle d'une sorte de Conseil d'administration de l'État en région : il assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions, il est consulté sur les orientations stratégiques de l'État dans la région et examine les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. § 3. Les compétences de la circonscription régionale 107 L'article 5 du décret du 7 mai 2015, portant Charte de la déconcentration, définit ainsi les missions de la circonscription régionale : elle est l'échelon territorial « 1° De l'animation et de la coordination des politiques de l'État ; 2° De la mise en œuvre des politiques nationales et de l'Union européenne en matière d'emploi, d'innovation, de recherche, de culture, de statistiques publiques, de développement économique et social, et d'aménagement durable du territoire ; 3° De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région ; 4° De la conduite d'actions de modernisation des services déconcentrés dans les domaines de la simplification de leur activité administrative et de l'amélioration de leurs relations avec les usagers ; 5° De la définition du cadre stratégique de la politique immobilière des services déconcentrés de l'État ». SECTION 3. LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉTAT 121 Les services départementaux de l'État ont été longtemps l'échelon de base des services déconcentrés de l'État. Cette fonction, on l'a vu, est maintenant dévolue à la Région. Comme la région, le département est tout à la fois une collectivité territoriale (v. ss 179) et une circonscription pour l'organisation des services de l'État. C'est en cette seconde qualité qu'on l'étudie ici. À cet égard, le département c'est un homme, le préfet, ayant des attributions importantes (§ 1), et une administration placée sous son autorité (§ 2). § 1. Le préfet 108 122 Le préfet est une création de la loi du 28 pluviôse An VIII (son uniforme est typiquement un habit du Consulat) mais il n'a pas été créé « ex nihilo » : il est l'héritier, en ligne directe, de l'Intendant de l'Ancien Régime. Bonaparte attachait à la fonction préfectorale une importance telle qu'il en a choisi personnellement les premiers titulaires et qu'il avait déclaré : « Je veux que le bonheur des Français date de l'institution des préfets ». De nos jours, ce qui est fort rare, l'institution préfectorale a reçu une consécration constitutionnelle : l'article 72, 3 alinéa, de la Constitution de 1958 dispose en effet : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Le statut des préfets n'a pas été modifié en 1982 : il reste celui fixé par e le décret du 29 juillet 1964 (modifié, bien sûr, à plusieurs reprises et notamment par le décret du 16 février 2010 et celui du 15 mai 2015). On examinera successivement le statut du préfet, puis ses attributions. 109 A. Le statut du préfet ◊ Le recrutement et les garanties de carrière du préfet sont fonction d'un choix initial : soit le gouvernement souhaite conserver à son entière discrétion ses représentants ce qui conduit à leur refuser toute garantie de carrière ; soit, à l'inverse, il préfère trouver en eux des spécialistes de l'administration, ce qui implique une formation et des garanties de stabilité. En pratique, les deux aspects coexistent et sont également essentiels ; il a donc fallu aboutir à un compromis. Il existe bien un corps préfectoral, dans lequel on peut faire carrière, mais les garanties de carrière sont réduites pour laisser au gouvernement toute liberté à l'égard de ses représentants directs. 110 1 Le recrutement ◊ Les préfets sont nommés par décret du président de la o République pris en Conseil des ministres (art. 13 Const.). Dans la proportion des 2/3, ils sont choisis parmi les sous-préfets ou administrateurs civils ayant atteint la hors classe de leur grade, corps qui se recrutent essentiellement à la sortie de l'ENA. Mais pour 1/3 des postes la nomination a lieu « au tour à l'extérieur », c'est-à-dire que le Gouvernement a alors une totale liberté de nomination, aucune condition n'étant mise à cette nomination. A priori, on peut penser que ce moyen de diversifier le recrutement des préfets est judicieux, à condition toutefois qu'il n'y ait pas d'abus du procédé, ce qui n'a pas toujours été le cas . La nomination implique une affectation à un poste territorial. 123 111 2 Les garanties de carrière ◊ De tous les fonctionnaires, le préfet est celui o qui a le moins de garanties de carrière : en effet, l'emploi de préfet figure parmi « les emplois à la discrétion du gouvernement ». Cela veut dire qu'ils n'ont que des garanties disciplinaires extrêmement réduites : uniquement la communication du dossier. Mais surtout le retrait d'emploi est à la discrétion du gouvernement et peut intervenir pour n'importe quelle raison. Les préfets ont une obligation de loyalisme politique et n'ont ni le droit syndical (ils se réunissent, cependant, au sein de l'Association du corps préfectoral) ni, a fortiori, le droit de grève. En contrepartie de ces obligations strictes, le préfet, dans l'intérêt même de la fonction, bénéficie d'avantages matériels destinés à assurer son prestige : logement, service, parc automobile, etc. En pratique, la carrière préfectorale – hormis les crises politiques graves – 124 assure à l'heure actuelle, à ses membres, une relative sécurité, qu'exige le développement de leur rôle administratif par rapport à leur rôle politique . 125 112 B. Les attributions du préfet ◊ L'article 72 de la Constitution (v. ss 108) définit de manière générale la mission du préfet : délégué du Gouvernement, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Ces formules sont précisées par les articles 9, 10 et 11 du décret du 29 avril 2004. Le préfet de département met en œuvre les politiques nationales et communautaires sous l'autorité du préfet de région ; il « assure le contrôle administratif du département, des communes et des établissements publics locaux » ; il a « la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations » ; il est compétent « en matière d'entrée et de séjour des étrangers, ainsi qu'en matière de droit d'asile ». Dans le cadre de la décentralisation opérée en 1982 (v. ss 119) un certain nombre de compétences transférées aux collectivités territoriales étaient déconcentrées. De ce fait, les préfets ont, à l'époque, connu une diminution sensible de leurs attributions. Mais, à l'inverse, elles ont augmenté avec la « Charte de la déconcentration », (v. ss 103), qui est venue préciser le rôle dévolu au département en tant qu'échelon de l'administration déconcentrée. Il résulte de cet ensemble de textes que, dans le département, le préfet est tout à la fois : – le représentant de l'État ; – le représentant du Gouvernement ; – un rouage de l'Administration générale ; – le chef des services de l'État. 1 Le représentant de l'État. À l'échelle du département le préfet incarne l'État. C'est pour cette raison qu'il a la préséance dans toutes les cérémonies et que Napoléon voulait qu'il vive dans de véritables palais en ayant un grand train de maison ! Il assure la représentation juridique de l'État en signant en son nom les contrats, en le représentant en justice etc. 2 Le représentant du Gouvernement. C'est l'aspect politique de son rôle. À ce titre, le préfet a une mission générale d'information : il doit tenir le Gouvernement au courant de l'évolution de l'opinion publique dans le département ; à l'inverse il doit, auprès de celle-ci, expliciter la politique des pouvoirs publics et l'orienter en faveur des gouvernants. Pendant longtemps, la tâche essentielle des préfets, aux yeux des gouvernements, était de leur préparer des élections conformes à leurs vœux. L'évolution des modes de communication (interventions radio-télévisées du Gouvernement, sondages d'opinion) a diminué le rôle dévolu au préfet en la matière. 3 Le préfet, organe de l'administration générale a) Le maintien de l'ordre. Le préfet a la charge de l'ordre public. À ce titre, il exerce la police administrative (v. ss 381) dans l'ensemble du département, o o o celle-ci visant, à titre préventif, au maintien de l'ordre public, c'est-à-dire au maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques. Les problèmes du maintien de l'ordre se posant avec de plus en plus d'acuité, en de nombreux endroits, il est possible, depuis 1972 (Décr. 20 sept. 1972 ; Décr. 23 sept. 1989) de nommer auprès du préfet du département un Préfet adjoint pour la Sécurité ayant en charge uniquement ces problèmes de sécurité Par contre, la loi du 4 janvier 1993 lui a retiré les pouvoirs de police judiciaire qu'il tenait de l'article 10 de l'ancien Code de procédure pénale en ce qui concerne les crimes intéressant la sûreté de l'État et qui, bien que réduits, n'en étaient pas moins contraires aux principes fondamentaux du libéralisme en matière de sécurité. b) Le contrôle administratif. C'est au préfet qu'il revient d'assurer le contrôle administratif – ce que l'on appelait traditionnellement la tutelle – sur les communes et sur le département. Cela représente un travail important mais exercé avec le concours des sous-préfets (v. ss 232). c) Les procédures d'intérêt général. Le préfet intervient dans toute une série de procédures d'intérêt général. Par exemple, il lui revient, le cas échéant, d'élever le conflit d'attribution devant les juridictions judiciaires (v. ss 575), ou encore de conduire la phase administrative de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'intervenir en matière de réquisitions, etc. d) L'expérimentation d'un pouvoir de dérogation à certaines normes réglementaires. Le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 permet à certains préfets de métropole et d'outre-mer de déroger, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, à certaines dispositions réglementaires. L'article 2 du décret énumère les matières pouvant faire l'objet de cette dérogation (par exemple, les subventions ou encore l'environnement) et elles doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et par des circonstances locales (v. AJDA 2018. 16). Le décret a fait l'objet d'une circulaire (n° 607-SG) du 9 avril 2018 (AJDA 2018. 770). 4 Le préfet, chef des services de l'État dans le département De même qu'à l'échelon central il faut assurer la coordination des actions menées par les différentes administrations, à l'échelle du département, il faut également assurer la coordination de l'action des différents services déconcentrés. C'est au préfet que revient cette mission : il dirige tous les services de l'État dans le département à l'exception des services de l'Éducation nationale, de l'Inspection du Travail, des services financiers et fiscaux et des organismes juridictionnels. Compte tenu de la tendance des chefs des services déconcentrés à vouloir échapper à l'autorité du préfet, en traitant directement avec leur administration centrale, le décret du 14 mars 1964, repris par celui du 10 mai 1982, a pris un o ensemble de mesures permettant au préfet d'assumer effectivement la direction des services de l'État. Dans l'exécution de ses missions le préfet est assisté d'un collège des chefs de service qui comprend, sous son autorité, les membres du corps préfectoral en fonction dans le département ainsi que les chefs des services de l'État dans le département. Dans le souci de recentrer les préfectures sur leurs missions essentielles (sécurité et protection des populations ; respect des libertés publiques et de la démocratie ; dossiers de proximité) les services départementaux de l'État ont fait l'objet d'une profonde restructuration. Depuis le 1 janvier 2010 ils comprennent, selon l'importance de la population, deux ou trois structures interministérielles : – la Direction départementale de la cohésion sociale ; – la Direction départementale de la protection des populations ; – la Direction départementale des Territoires. Les décisions du préfet prennent normalement la forme de l'arrêté, soit individuel (nomination, autorisation etc.), soit réglementaire (en matière de police administrative, par exemple). Parfois la décision est précédée de l'avis d'un organe consultatif (v. ss 95). Le préfet peut déléguer une partie de ses pouvoirs de décision au secrétaire général (v. ss 113) ou aux sous-préfets dans leur arrondissement (v. ss 114). er § 2. Les services du préfet 113 126 Aux termes de l'article 7 du décret du 16 février 2010 le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, d'un directeur de cabinet, des chefs des services déconcentrés de l'État, et des sous-préfets d'arrondissement. Outre la possibilité de confier les tâches du maintien de l'ordre à un Préfet pour la Sécurité placé auprès du Préfet, le décret n 20051621 du 22 décembre 2005 prévoit la possibilité de nommer auprès de lui un « Préfet pour l'égalité des chances » pour ce qui concerne la cohésion sociale, l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations. Pour exercer ses importantes attributions le préfet dispose donc d'un cabinet et des bureaux de la préfecture. 1 Le cabinet. Le préfet dispose d'un directeur de cabinet, qui est un jeune sous-préfet, et d'un ou plusieurs chargés de mission ; leur nombre varie en fonction de la taille du département. Le directeur du cabinet est le collaborateur direct et personnel du préfet. 2 Les bureaux de la préfecture. Ils jouent auprès du préfet le même rôle de préparation et d'exécution que l'administration centrale auprès du ministre. Ils o o o sont composés de fonctionnaires de l'État qui constituent deux cadres distincts : attachés de préfecture et secrétaires administratifs de préfecture, recrutés au concours. À la tête des services de la Préfecture se trouve le Secrétaire général de la préfecture, qui est un sous-préfet ayant déjà une ancienneté certaine ; dans les départements les plus importants il peut avoir le grade de préfet. C'est le collaborateur le plus important du préfet. De manière significative, les attributions du Secrétaire général ne sont fixées par aucun texte. Cela veut dire qu'il exerce les fonctions que le préfet lui confie : tout dépend donc des relations de confiance qui s'établissent entre eux. Le plus souvent ces fonctions sont importantes. Il n'a qu'une seule attribution de plein droit : assurer l'intérim du préfet au cas de vacance ou d'empêchement. SECTION 4. L'ARRONDISSEMENT 114 Créé par la loi du 28 pluviôse An VIII, l'arrondissement est une circonscription de l'Administration d'État relativement peu importante car sans décentralisation et qui, pour cette raison, n'a pas la personnalité morale. L'arrondissement c'est essentiellement le sous-préfet, c'est-à-dire le fonctionnaire de l'État ayant la responsabilité de cette circonscription. Le rôle du sous-préfet est défini par l'article 14 du décret du 29 avril 2004 modifié par le décret du 16 février 2010. Délégué du préfet dans l'arrondissement, « il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales ». Le préfet peut lui confier des missions particulières. Il constitue donc un échelon de l'État proche des administrés et notamment des maires qu'il connaît bien et auprès desquels il peut constituer une précieuse agence de services et de conseils. C'est ce qui a fait dire à un Premier ministre qu'ils devaient constituer « les postes avancés de l'État sur le Territoire » . Cependant le ministère de l'Intérieur a lancé une Mission de concertation autour de l'évolution du réseau des sous-préfectures (AJDA 2012. 1827). Très clairement il s'agit de supprimer un certain nombre de celles-ci (de l'ordre de 70 sur 238). C'est ainsi que les Préfets des Régions Alsace et Lorraine avaient été chargés, à titre d'expérimentation, de proposer la rénovation du réseau des sous-préfectures dans les deux départements du Rhin et de la Moselle. Pour moi il est absolument impératif de maintenir les souspréfectures en milieu rural. Un rapport récent (« La réforme de l'administration préfectorale et sa contribution au maintien de la présence de l'État dans les territoires ») souligne la baisse des moyens des préfectures et des sous-préfectures et constate que « un nombre significatif de sous127 préfectures n'ont manifestement pas les moyens de couvrir le large spectre des missions qui leur sont confiées » (AJDA 2017. 774). SECTION 5. LA COMMUNE 115 La commune est presque exclusivement une collectivité territoriale. Il se trouve seulement que, dans certains cas, l'État « emprunte » à la commune son maire pour en faire un agent de l'État pour certaines affaires. Il s'agit, par exemple, de l'exécution du service de l'état-civil, ou encore d'attributions en matière électorale (établissement des listes électorales, délivrance des cartes électorales), délivrance de certains permis de construire etc. Lorsqu'il agit en tant qu'agent de l'État, le maire est alors soumis au pouvoir hiérarchique du préfet et, le cas échéant, c'est la responsabilité de l'État que son action engagera. 128 CONCLUSION LA RÉFORME DE L'ÉTAT 129 116 Le problème de la réforme de l'État est un thème récurrent dans le discours politique. Dans le gouvernement d'Édouard Philippe, le décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, lui confie d'importantes attributions en matière de décentralisation (art. 2), qu'il exerce conjointement avec M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires. Nombre de réformes intervenues ces dernières années vont dans le sens d'une importante transformation de l'État. C'est le cas de la décentralisation (v. ss 119 s.) qui modifie l'équilibre entre l'État central et les collectivités territoriales ; de même, la déconcentration remet en cause la ventilation des attributions entre l'échelon central et les services déconcentrés. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, le cas de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1 août 2001 qui, en bouleversant la présentation des crédits de l'État – reposant sur 48 missions définissant les différentes politiques publiques et 170 programmes – a pour objectif non seulement de clarifier mais aussi de modifier les politiques publiques de l'État . Comme le constatent Ch. Waline et P. Desrousseau la LOLF suppose que le Parlement renonce a priori lors de l'examen du projet de budget à une partie de son pouvoir pour mieux l'exercer a posteriori lors de son exécution ou de la reddition des comptes. Il s'agit, tout simplement – si l'on peut dire – d'introduire une culture du résultat. D'autre part, la mise en œuvre par la France du Traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance a nécessité le vote de la loi organique du 17 décembre 2012 « relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » . Comme le souligne Michel Lascombe, cette loi « modifie la nature des lois de programmation des finances publiques introduites en droit interne par la révision du 23 juillet 2008 » et « constitue une révolution dans la conception même de notre droit budgétaire tant par le principe qu'elle affirme que par les actes et les mécanismes qu'elle met en place ». Le décret du 22 janvier 2014 a créé un Conseil stratégique de la dépense publique chargé de proposer et de suivre la réalisation des économies er 130 131 132 133 structurelles dans le cadre du programme de stabilité de la France. La volonté de réforme de l'État s'était cristallisée dans la mise en œuvre par Nicolas Sarkozy de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) lancée au mois de juin 2006 et confiée au Conseil de Modernisation des Politiques Publiques présidé par le président de la République. Celui-ci se fixait un triple objectif : – le retour à l'équilibre des finances publiques ; – l'amélioration de la qualité des services publics ; – la simplification administrative. La RGPP avait fait l'objet de critiques tant du Parlement , que du Conseil Économique, Social et Environnemental et posé problème en ce qui concerne son application aux collectivités territoriales . Le gouvernement de J.M. Ayrault avait décidé de mettre fin à la RGPP et a demandé un bilan de celle-ci . Elle est remplacée par la « Modernisation de l'Action Publique » (MAP). Celle-ci a été mise en place par deux décrets du 30 octobre 2012, le premier (n 2012-1198) créant le Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action publique (SGMAP), sous l'autorité du Premier ministre et rattaché au Secrétariat général du gouvernement ; son action et ses moyens sont définis par le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015. Le second (n 2012-1199) créant le Comité Interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP). La modernisation de l'action publique se propose un triple objectif : – favoriser et soutenir les travaux en vue d'évaluer et de moderniser l'action publique ; – améliorer le service rendu aux citoyens et aux usagers ; – contribuer à la bonne gestion des deniers publics. Tout cela n'est pas substantiellement différent de ce que se proposait la RGPP. L'examen des travaux des premiers CIMAP montre l'importance attachée à l'évaluation des politiques publiques ainsi qu'à la simplification administrative . Le gouvernement d'Édouard Philippe ne veut pas « réformer » l'État mais le « transformer » (sic). À cette fin il a mis en place un « Comité d'Action Publique 2022 » (CAP 2022) composé d'une trentaine de personnalités extrêmement diverses et notamment de Haut-responsables étrangers. Le Comité doit présenter un rapport identifiant des réformes structurelles et des économies significatives et durables sur 21 politiques publiques prioritaires. Les ministres devront faire des propositions de transformation à l'horizon 2022 sous forme d'une « contribution initiale synthétique » qui sera remise au CAP 2022. Parallèlement à ces travaux se déroulera le « Forum de l'action publique » chargé de recueillir le point de vue des usagers et des agents publics. Mais, si la méthode est nouvelle, les objectifs ne sont pas, eux, fondamentalement 134 135 136 o 137 o 138 139 nouveaux : améliorer le service rendu à l'usager ; faire monter les agents publics en compétence, notamment numérique ; rendre la dépense publique plus efficace. (v. AJDA 2017. 1862 et 1980). Il va de soi que la Cour des comptes, à travers ses Rapports publics (par ex. celui de 2008), participe également aux réflexions relatives à la réforme de l'État. Le rôle dévolu au Parlement, en la matière, a été consacré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 précisant à l'art. 24 C. que le Parlement « évalue les politiques publiques » . L'Assemblée nationale a donc modifié son Règlement pour créer un « Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques », création avalisée par le Conseil constitutionnel non sans quelques réserves (Cons. const. n 2009-581 DC du 25 juin 2009, p. 120). Ce problème a également fait l'objet de la loi n 2011-140 du 3 février 2011 « tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques » . La loi n 015-411 du 13 avril 2015 prévoit que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Une autre innovation mérite d'être soulignée : l'établissement, depuis 2006, d'un véritable bilan comptable de l'État à l'instar de ce qui se fait pour une entreprise. En effet la Cour des comptes certifie maintenant les comptes de l'État. Pour l'année 2008 le solde des opérations de l'exercice s'établit, par exemple, à –73,1 milliards d'euros, avec un passif supérieur à l'actif de 686 milliards d'euros (AJDA 2009. 1075) . 140 o o 141 o2 142 TITRE 2 LES PERSONNES ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES SOUS-TITRE 1 LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SOUS-TITRE 2 LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOUS-TITRE 3 LES AUTRES PERSONNES PUBLIQUES SPÉCIALISÉES À côté de l'État qui a une vocation générale, notamment en matière administrative, il existe des personnes publiques dont le rôle, en matière administrative, est limité par le principe de spécialité. Les personnes administratives spécialisées se définissent soit par un certain territoire, soit à partir de certaines tâches d'intérêt général qui leur sont confiées. Ce sont les collectivités territoriales (Sous-titre 1) et les établissements publics (Sous-titre 2), auxquelles il faut ajouter, maintenant, d'autres personnes publiques spécialisées (Sous-titre 3). SOUS-TITRE 1 LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 143 CHAPITRE 1 L'ÉVOLUTION DE LA DÉCENTRALISATION DEPUIS 1958 CHAPITRE 2 LA COMMUNE CHAPITRE 3 LE DÉPARTEMENT CHAPITRE 4 LA RÉGION CHAPITRE 5 LES COLLECTIVITÉS À STATUT PARTICULIER CHAPITRE 6 LE CONTRÔLE DE L'ÉTAT SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La V République a réalisé de grands progrès en ce qui concerne la décentralisation. Après avoir pris la mesure de cette évolution (Chapitre 1), on examinera l'organisation administrative des différentes collectivités territoriales : la commune (Chapitre 2), le département (Chapitre 3), la région (Chapitre 4), les collectivités à statut particulier (Chapitre 5). On étudiera ensuite le contrôle de l'État sur ces collectivités (Chapitre 6). e CHAPITRE 1 L'ÉVOLUTION DE LA DÉCENTRALISATION DEPUIS 1958 Section 1. LA DÉCENTRALISATION DANS LA CONSTITUTION DE 1958 Section 2. LA DÉCENTRALISATION DANS LA LOI DU 2 MARS 1982 § 1. Le volet organique et fonctionnel § 2. La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales § 3. Le statut de la fonction publique territoriale Section 3. LA RÉFORME OPÉRÉE À PARTIR DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DU 28 MARS 2003 § 1. La codification du système existant § 2. Les innovations de la loi du 28 mars 2003 § 3. La loi du 13 août 2004 Section 4. LE RAPPORT BALLADUR ET LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 2010 Section 5. § 1. § 2. § 3. LES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT AYRAULT La loi organique et la loi du 17 mai 2013 La loi du 27 janvier 2014 La loi organique et la loi du 14 février 2014 Section 6. LES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT VALLS 117 La Monarchie n'a pu réaliser l'unité française qu'en opposant au foisonnement des collectivités de toute nature issues de la période féodale, fortes de leurs privilèges et enracinées dans la tradition, un effort continu de centralisation administrative. Les pouvoirs des Intendants, le développement au XVIII siècle des administrations d'État (Ponts et Chaussées, Corps des mines etc.), sont les instruments les plus connus de cette action. La tradition centralisatrice ainsi fondée a été reprise par le Consulat e et l'Empire. Le mouvement décentralisateur s'est amorcé dès le début de la Monarchie de Juillet . Mais le véritable point de départ de l'évolution contemporaine de la décentralisation se situe à l'aube de la III République avec la loi du 10 août 1871 sur le département et la loi du 5 avril 1884 sur la commune. Il est tout à fait extraordinaire de constater que l'on va vivre ensuite presque un siècle sur la base de ces deux textes. Bien sûr, ils seront modifiés à d'assez nombreuses reprises, mais uniquement sur des points de détail ; sur le fond rien de véritablement important. De même, la volonté décentralisatrice affirmée par le constituant de 1946 n'a pas pu prévaloir sur les forces centripètes et est demeurée lettre morte . Ce n'est qu'avec la V République que l'évolution dans le sens d'une plus grande décentralisation va reprendre. Elle est maintenant irréversible. Par ailleurs, le développement de l'Union européenne pose l'important problème de savoir le rôle qui est réservé aux collectivités territoriales au sein de cet ensemble . Inscrite dans le texte initial de la Constitution (Section 1), la décentralisation va connaître cinq importantes étapes : celle des années 1982 (Section 2), la réforme du 28 mars 2003 (Section 3) puis sur la base du Rapport Balladur, la loi du 16 décembre 2010 « de réforme des collectivités territoriales » (Section 4), les réformes entreprises par le gouvernement de J.M. Ayrault (Section 5), enfin celles du gouvernement de M. Valls (Section 6) . 144 e 145 e 146 147 148 SECTION 1. LA DÉCENTRALISATION DANS LA CONSTITUTION DE 1958 149 118 L'article 72 de la Constitution de 1958 affirme le principe de la libre administration des collectivités territoriales, c'est-à-dire de la décentralisation : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». Pour savoir ce qui, en la matière, relève de la loi, il faut donc se reporter à l'article 34 de la Constitution qui prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » . Ces formules, même si elles restent relativement imprécises, n'en ont pas moins une conséquence capitale : elles élèvent au niveau constitutionnel le principe de la décentralisation (v. ss 130). Ce principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales est, bien sûr, très important mais il doit se concilier avec d'autres principes également à valeur 150 constitutionnelle, par exemple celui du contrôle pesant sur celles-ci, ce qui en réduit la portée car le Conseil constitutionnel est assez compréhensif à l'égard des textes qui doivent se concilier avec le principe de la libre administration. Il y a eu, en 1976, un important effort de réflexion mené pour repenser globalement l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales : c'est le « Rapport Guichard » intitulé « Vivre ensemble » . Il avait débouché sur un projet de loi « pour le développement des responsabilités des collectivités locales » qui n'a pas eu de suites dans l'immédiat. 151 SECTION 2. LA DÉCENTRALISATION DANS LA LOI DU 2 MARS 1982 152 119 Le Gouvernement issu des élections législatives de juin 1981, sous l'impulsion notamment de Gaston Defferre, s'est engagé dans une importante réforme de la décentralisation. De manière tout à fait symbolique, ce dernier prend le titre de Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation ; de même on substitue au titre de préfet, legs du centralisme napoléonien, celui de Commissaire de la République et surtout la loi du 2 mars 1982 est intitulée « loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ». De nombreux textes ont suivi la loi du 2 mars 1982 qui donnait, en quelque sorte, le coup d'envoi de la réforme : – lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences ; – loi du 19 novembre 1982 relative au mode d'élection des conseils municipaux, etc. Au total cette réforme décentralisatrice a compté une douzaine de lois et un nombre impressionnant de décrets. Depuis la réforme de 1982-1983 et dans son prolongement on a vu se multiplier les interventions du législateur relatives à la décentralisation. Mais cette multiplication de textes, plus ou moins fragmentaires, n'a pas toujours contribué à simplifier et à clarifier le droit positif. En se limitant aux seuls textes généraux, sont ainsi intervenues successivement : – les lois des 9 janvier et 19 août 1986 ; – la loi du 13 janvier 1989 ; – la loi du 5 janvier 1988, dite « d'amélioration de la décentralisation » ; – la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; – la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. La réforme de 1982-1983 comprend trois grands volets : – un volet organique et fonctionnel ; – une nouvelle répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales ; – un statut de la fonction publique territoriale. 153 154 § 1. Le volet organique et fonctionnel Ce sont quatre lois qui viennent modifier l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales. 120 A. La loi du 2 mars 1982 ◊ Elle réalise des réformes essentielles et c'est, de manière emblématique, que l'on commence par celles-ci : 1. Tout d'abord elle supprime la principale anomalie de la décentralisation qui faisait du préfet, représentant de l'État, l'exécutif de la Région et du Département, collectivités décentralisées. Désormais ce sera le Président du Conseil régional, d'une part, et d'autre part le Président du Conseil départemental, qui exécuteront (après les avoir préparées) les délibérations votées par leurs assemblées respectives. 2. Elle supprime la tutelle remplacée par un contrôle administratif. Le contrôle administratif est exercé, a posteriori, par le Tribunal administratif. 3. Enfin la loi permet, dans une mesure appréciable, l'intervention des collectivités territoriales dans le secteur économique et social. 121 B. La loi du 22 juillet 1982 ◊ Elle est obligée de remettre l'ouvrage sur le métier en ce qui concerne le contrôle administratif des collectivités territoriales pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel (Décis. n 82-137 DC du 25 févr. 1982, Rec. 38) qui avait déclaré contraire à la Constitution la disposition prévoyant que les actes des autorités des collectivités territoriales étaient de plein droit exécutoires avant même leur transmission au représentant de l'État, ce qui privait celui-ci de la possibilité de saisir la juridiction administrative pour en empêcher l'entrée en vigueur (v. ss 234). o 122 C. La loi du 10 juillet 1982 ◊ Elle vient créer les Chambres régionales des comptes, juridictions financières appelées, entre autres, à intervenir dans le contrôle financier des collectivités locales. 123 D. Enfin la loi du 19 novembre 1982 ◊ Elle réalise un important changement dans le mode d'élection des Conseils municipaux (v. ss 156). Ces différents textes restent fidèles à la tradition d'uniformité dans les statuts, et même la renforcent : non seulement ils n'introduisent aucune distinction nouvelle entre les communes selon leur dimension , mais encore ils soumettent à des règles identiques, à quelques détails près, les trois catégories de collectivités : commune, département, région. 155 § 2. La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales 124 Au départ ce sont trois lois (7 janv., 22 juill. et 29 déc. 1983) qui viennent régler cet important problème. Ces textes posent les principes qui gouvernent la répartition des compétences ; – ils fixent les grandes lignes de celle-ci ; – ils aménagent les moyens permettant leur exercice. 125 A. Les principes gouvernant la répartition ◊ Ils font l'objet du titre 1 de la loi du 7 janvier 1983 qui est intitulé : « Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences ». On peut en distinguer trois : 1 Les transferts de compétences ne doivent pas aboutir à la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre (art. 2 de la loi). Le risque d'une telle tutelle est fort grand, en effet, du fait des « financements croisés ». Faute de ressources suffisantes pour la réalisation d'un investissement, la commune, par exemple, est bien obligée de faire appel au concours financier du département et de la région. Ceux-ci peuvent, à cette occasion, établir une tutelle de fait sur les communes qui n'ont pas un droit acquis à l'obtention de ces subventions. 2 Éviter les chevauchements de compétences (art. 3). En principe les transferts de compétences sont globaux : chaque domaine est attribué en totalité soit à la région, soit au département, soit à la commune. Mais le texte, trop prudemment, assortit cette règle d'une réserve : « … dans la mesure du possible ». Très malheureusement c'est la réserve qui, dans la pratique, est devenue la règle. La volonté simplificatrice s'est heurtée à certaines impossibilités ou à certaines habitudes. Il n'y a que fort peu de « blocs » de compétences et ce problème n'est toujours pas réglé à l'heure actuelle. 3 Le transfert des moyens. Chaque transfert d'une compétence nouvelle à une collectivité territoriale doit s'accompagner du transfert des moyens (matériels et humains) nécessaires à l'exercice de cette compétence. er o o o 126 B. Les grandes lignes de la répartition ◊ La décentralisation traditionnelle se fondait sur la distinction entre affaires nationales et affaires locales (v. ss 56). La réforme, sans abandonner cette distinction, la nuance. La formule de l'article 1 de la loi du 7 janvier 1983 est révélatrice de ce changement : les lois antérieures, qui subsistent, confiaient aux conseils municipaux ou généraux « les affaires de la commune » ou « du département » ; ils règlent en plus, désormais, « les affaires de leur compétence », c'est-à-dire celles dont le législateur estime qu'elles seront er 156 mieux traitées au niveau communal, départemental ou régional qu'au niveau national. Dans la pratique, pour la répartition des compétences – que l'on étudiera à propos de chaque collectivité territoriale – le législateur n'a pas procédé par collectivité (région, département, commune) mais par matière (enseignement, aide sociale…). Dans quelques matières, l'essentiel des compétences a pu être attribué à une collectivité déterminée : – à la région : planification, économie, apprentissage ; – au département : action sociale et sanitaire, transports scolaires ; – à la commune : urbanisme. Mais, même dans ces matières, la compétence prédominante laisse souvent place, soit à l'action d'une autre collectivité, soit à celle de l'État. Exemple de la première situation : si la région élabore le plan de développement régional, les communes peuvent s'associer pour établir une « charte de développement et d'aménagement » dans les domaines économique, social et culturel. Exemple de la seconde situation : la prépondérance de la Commune dans le domaine de l'urbanisme laisse à l'État l'essentiel du pouvoir en ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine et des sites. 157 127 C. Les moyens pour exercer les compétences transférées ◊ Les collectivités territoriales doivent disposer des moyens nécessaires à un bon exercice des compétences transférées. Il s'agit : – des personnels ; – des biens ; – des ressources financières. 1 Les moyens en personnel. La loi du 7 janvier 1983 distingue : – Le transfert des compétences d'État aux départements et aux régions s'accompagne du transfert des services correspondants. Une convention conclue dans chaque département et chaque région entre le représentant de l'État et le président du Conseil départemental ou régional assure la mise en œuvre du transfert, en attendant la réorganisation des services transférés. – Les transferts de compétence aux communes n'entraînent pas, à leur profit, transfert des services, au moins dans l'immédiat. Mais ceux-ci sont « mis à leur disposition » pour l'exercice de leurs nouvelles compétences. Plus généralement, la mise à la disposition des services non transférés, mais utiles à l'exercice des compétences locales, vaut pour toutes les collectivités. 2 Les biens tant mobiliers qu'immobiliers affectés aux services transférés sont mis à la disposition de la collectivité chargée du service, à titre gratuit, mais avec l'obligation pour elle d'en assurer désormais la charge. Lorsque ces biens appartiennent à l'État, la propriété pourra, par la suite, être transférée à la collectivité territoriale. Au cas contraire (immeubles loués pour le service), o o celle-ci succède à l'État en tant que locataire. 3 Les ressources financières. C'est le problème essentiel et le plus délicat. Le principe est, évidemment, la corrélation entre le transfert des compétences et les ressources nécessaires à leur exercice, après évaluation de celles-ci . Techniquement, les transferts financiers de l'État aux collectivités locales s'opèrent par le biais de subventions. Pendant longtemps celles-ci ont été le meilleur moyen de l'État pour mettre sous tutelle les collectivités territoriales : il suffisait de refuser la subvention destinée à tel ou tel investissement pour que celui-ci ne puisse pas être réalisé. La globalisation des subventions, sous forme de dotation, a donc constitué un progrès certain. À côté des deux dotations versées aux collectivités territoriales – la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la dotation globale d'équipement (DGE) – on a créé une dotation générale de décentralisation destinée, au moins en principe, à compenser intégralement les charges financières correspondant aux compétences transférées. Mais il y a eu un grave malentendu à ce sujet. En effet, l'État a bien transféré aux collectivités territoriales les crédits que lui-même consacrait aux compétences transférées. Ceux-ci étant notoirement insuffisants les collectivités territoriales, soucieuses d'un bon exercice de leurs nouvelles compétences (par exemple les lycées pour la région et les collèges pour le département), ont du abonder très largement les crédits de l'État en puisant dans leurs ressources propres. La décentralisation est donc devenue un important vecteur de transfert de charges financières de l'État sur les collectivités territoriales (v. ss 134). Le problème ne pourra être résolu que par un remaniement complet tant de la fiscalité d'État, que de la fiscalité locale, impliquant un transfert aux collectivités territoriales de certains impôts d'État . o 158 159 § 3. Le statut de la fonction publique territoriale 128 160 Le dernier volet des réformes intervenues dans la continuité de la loi du 2 mars 1982 a été la fixation par l'État du statut des agents des collectivités territoriales, ce que l'on appelle la fonction publique territoriale, par la loi du 26 janvier 1983 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) et la loi du 12 juillet 1984 (relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale). Ce dernier texte a été modifié par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 « relative à la fonction publique territoriale ». La décentralisation ne va donc pas jusqu'à permettre aux collectivités territoriales de fixer elles-mêmes le statut de leurs agents. L'étude du statut des agents publics, d'après les programmes universitaires, o fait l'objet d'enseignements et d'ouvrages particuliers. On se limitera donc ici à quelques observations générales en ce qui concerne le statut de la fonction publique territoriale. 1 Le nouveau statut est unique, et uniforme : tous les agents locaux, quelle que soit la collectivité qui les emploie, commune, département ou région, sont regroupés dans un seul et même ensemble, la fonction publique territoriale, et soumis au même statut. 2 Ce statut, très proche de celui qui régit la fonction publique de l'État, confère à tous les agents locaux, sauf rares exceptions, la qualité de fonctionnaires publics, et les soumet au régime qui en découle. 3 Les fonctionnaires territoriaux sont, comme ceux de l'État, répartis entre trois catégories (A, B, et C) selon le niveau de leur emploi, et regroupés en corps, en fonction de la nature de leur activité. Ils sont recrutés par des concours organisés, selon la catégorie, au plan national (catégorie A), régional (B), ou départemental (C). Leur carrière (avancement, positions diverses, discipline) est régie par des règles analogues à celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'État, et bénéficie des mêmes garanties. Cette quasi-identité des statuts permet le passage d'une catégorie à l'autre : entre la fonction territoriale et la fonction publique d'État, la loi organise une certaine perméabilité. 4 La gestion des carrières est confiée à des établissements publics administratifs, les Centres de gestion, réunissant des élus locaux, au plan national (catégorie A), régional (B) et départemental (C). Les collectivités sont obligatoirement tenues de faire connaître au Centre dont elles relèvent les emplois vacants. Le Centre assure la publicité de la vacance, recueille les candidatures, et les transmet à l'exécutif local, président du Conseil régional ou départemental, ou maire. Celui-ci choisit librement, parmi les candidats, celui qui lui convient. Si aucun ne lui agrée, le poste reste vacant jusqu'à ce qu'un concours permette de le pourvoir. Une fois nommé, le fonctionnaire relève de l'autorité hiérarchique du chef de l'exécutif local. 5 Un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, composé pour moitié de représentants syndicaux des fonctionnaires territoriaux, et pour moitié de représentants des collectivités, est chargé d'étudier, à titre consultatif, l'application du statut et ses modifications éventuelles. Il joue dans certains cas, notamment en matière disciplinaire, le rôle d'instance de recours. 6 Au total, la réforme, paradoxalement, aboutit à limiter de façon stricte la liberté des organes locaux dans le choix de leurs personnels. Elle distend les liens entre les collectivités et leurs agents en permettant à ceux-ci de passer de l'une à l'autre au cours de leur carrière. Enfin, on s'accorde à souligner la lourdeur, la complexité et le coût du système. o o o 161 o o o SECTION 3. LA RÉFORME OPÉRÉE À PARTIR DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DU 28 MARS 2003 162 129 La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 « relative à l'organisation décentralisée de la République » réalise une très importante réforme de la décentralisation. On l'a parfois présentée comme « l'acte II » de la décentralisation. Selon ses auteurs c'est une erreur car la « nouvelle décentralisation » ne veut pas s'inscrire dans les pas des réformes de 1982. Elle a pour ambition d'opérer un changement beaucoup plus important. En effet, la révision se propose un triple objectif : – relancer la décentralisation en supprimant les obstacles constitutionnels qui, jusqu'à maintenant, empêchaient certaines mutations ; – définir et organiser des transferts de compétences de l'État vers les Collectivités territoriales, dans le but de « faire émerger une République des proximités », tout en veillant à satisfaire l'exigence de cohérence dans l'action publique ; – permettre l'expression directe des citoyens dans les débats locaux, en organisant un véritable « principe de participation populaire ». Sur un certain nombre de questions la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 n'innove pas réellement. Elle apparaît comme une sorte de « codification » de principes déjà admis, mais avec, cependant, une conséquence importante : élever au rang de « règles constitutionnelles » – avec tout ce que cela implique – certaines règles qui n'avaient pas jusqu'à maintenant nécessairement ce caractère. Sur d'autres points, en revanche, la loi constitutionnelle apporte d'importantes innovations. § 1. La codification du système existant 130 A. La confirmation du principe de « décentralisation » ◊ Le Conseil constitutionnel avait déjà eu à plusieurs reprises l'occasion d'affirmer la valeur constitutionnelle du principe de la libre administration des collectivités territoriales . L'article 1 de la loi constitutionnelle aux termes duquel : « son organisation (de la République) est décentralisée » est donc une confirmation solennelle du principe ainsi que la volonté de conforter, si besoin était, sa valeur constitutionnelle. 163 131 er B. Les collectivités territoriales à statut particulier ◊ Le 1 alinéa du er nouvel article 72 de la Constitution fait figurer dans la liste des collectivités territoriales de la République, les collectivités à statut particulier. La possibilité de créer de telles collectivités n'est pas, en soi, nouvelle. Le législateur avait, par exemple, par la loi du 13 mai 1991, érigé la Corse en « Collectivité territoriale de la Corse » (v. ss 212) et le Conseil constitutionnel avait, à cette occasion, confirmé la possibilité pour le législateur de créer « une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même ne comprenant qu'une unité » et de la doter d'un statut spécifique . En revanche, ce qui est nouveau, c'est la possibilité de créer de nouvelles collectivités territoriales « le cas échéant en lieu et place d'une ou plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa » (art. 72, 1 al.) c'est-à-dire existantes (les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer). L'échec de la première application que l'on a essayé de faire de cette disposition en organisant, en Corse, un référendum (sur la base de l'article 72-1 nouveau) sur la création d'une collectivité unique qui aurait regroupé l'actuelle collectivité territoriale de Corse et les deux départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud, n'était pas très encourageant d'autant plus qu'un second échec était intervenu avec le référendum du 7 avril 2013 en Alsace . Dans le même sens, mais sur la base de l'article 72-4, 1 alinéa de la Constitution (qui oblige à consulter, Outre-Mer, les populations concernées lorsque l'on envisage une modification des collectivités les concernant), la population de la Martinique et celle de la Guadeloupe ont rejeté, au mois de décembre 2003, la proposition de créer une collectivité territoriale unique, se substituant, dans chaque cas, au département et à la région . Mais si par référendum du 10 janvier 2010 la Martinique et la Guyane ont refusé de se transformer en Collectivité d'Outre-Mer régie par l'article 74 C., elles ont accepté, par celui du 24 janvier 2010, la création d'une collectivité unique se substituant au département et à la région . 164 er 165 166 er 167 168 132 C. L'expérimentation au moyen de lois ou de règlements ◊ L'article 3 de la loi constitutionnelle, modifiant l'art. 37 de la Constitution, prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Ici encore le phénomène n'a rien de nouveau ; il n'est pas rare qu'en matière administrative on utilise la méthode expérimentale pour tester, en grandeur nature, la réforme projetée. Pour ne donner qu'un seul exemple, le décret du 14 mars 1964 réorganisant les services extérieurs de l'État avait été précédé du décret du 10 avril 1962 réorganisant, à titre expérimental, les services dans quatre départements. La jurisprudence avait bien délimité le régime juridique de cette pratique : notamment, le législateur doit clairement préciser les procédures d'évaluation conduisant au maintien, à la modification, à la généralisation ou à l'abandon de l'expérience, à l'issue du délai fixé pour celleci. 133 D. Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales ◊ Le nouvel article 72, 3 al. de la Constitution prévoit que les collectivités territoriales « disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ». Ce qui est intéressant, ce n'est pas la mention du pouvoir réglementaire, puisque les collectivités territoriales ont toujours disposé d'une telle faculté (par exemple le pouvoir de police du maire) mais la précision que ce pouvoir leur est donné « pour l'exercice de leurs compétences ». Cela peut paraître un truisme. Mais, a contrario, cela veut dire qu'elles n'ont pas un pouvoir réglementaire « autonome » contrairement à ce que certains avaient voulu soutenir . e 169 134 E. Le problème de l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales ◊ L'un des grands problèmes de la 170 décentralisation est celui de la réforme des finances des collectivités territoriales – bien délicat à résoudre – et de la marge d'autonomie financière qui doit leur être laissée. Celle-ci n'a cessé de se réduire ces dernières années, l'État supprimant des impôts bénéficiant aux collectivités territoriales (et dont elles pouvaient fixer le taux) pour les remplacer par des compensations, pas toujours intégrales, des pertes de recettes ainsi provoquées. Cela a pour effet de diminuer la marge de manœuvre fiscale des collectivités au moment où elles votent leur budget en raison de la part croissante, dans celui-ci, des subventions compensatrices de l'État sur lesquelles, bien sûr, elles n'ont aucun pouvoir. Afin d'éviter la poursuite d'une telle politique, on s'était tourné vers le Conseil constitutionnel pour qu'il s'érige en défenseur de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Dans sa décision du 12 juillet 2000 (loi de finances rectificatives pour 2000, p. 104), le Conseil a érigé en principe que les règles posées par la loi « ne sauraient avoir pour effet de diminuer les ressources globales des collectivités territoriales ou de réduire la part des recettes fiscales dans ces ressources au point d'entraver leur libre administration ». Mais il n'a, dans la pratique, encore jamais considéré que tel fut le cas. Le Sénat ayant déposé une proposition de loi constitutionnelle, relative à « la libre administration des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières », avait voté, au mois d'octobre 2000, un texte prévoyant que « les ressources hors emprunt de chacune des catégories de collectivités territoriales sont constituées pour la moitié au moins de recettes fiscales et autres ressources propres ». La discussion de ce projet de loi n'a pas dépassé le stade du vote par le Sénat en première lecture, en raison du dépôt par le Gouvernement du projet de loi constitutionnelle « relative à l'organisation décentralisée de la République ». Très malheureusement, la loi constitutionnelle se contente de prévoir que les recettes fiscales et les autres ressources doivent représenter « une part déterminante » de l'ensemble de leurs ressources. On renonce donc à tout pourcentage chiffré au profit d'une notion qui n'a strictement aucun caractère juridique . La loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales donne une définition des « ressources propres », partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (décis. n 2004-500 DC du 29 juill. 2004, p. 116) et qui laisse subsister bien des interrogations. D'autre part, la disposition de la loi constitutionnelle relative à la compensation financière des compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales, consolide, en la constitutionnalisant (!), une solution regrettable. En effet, l'article 72-2, 4 alinéa, prévoit l'attribution aux collectivités territoriales « de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». Or, on l'a vu (v. ss 127), le plus souvent les ressources que l'État consacrait à l'exercice de ces compétences ne permettent pas un exercice « normal » de la compétence transférée, pour reprendre la formule qui figurait, à ce propos, dans la loi du 7 janvier 1983 . Sur le problème des compensations financières : CE 21 févr. 2018, Région ProvenceCôte d'Azur et CE 21 févr. 2018, Département du Calvados, AJDA 2018. 845, Chr. Roussel et Nicolas. 171 172 o e 173 135 F. La coopération entre collectivités territoriales ◊ Depuis la loi du 2 mars 1982 se pose le problème de la coordination des actions conjointes entreprises par plusieurs collectivités territoriales sur un seul et même objet, d'autant plus que le principe qu'il ne doit pas y avoir de tutelle d'une collectivité sur une autre a maintenant valeur constitutionnelle (art. 72, 5 al.). À cet effet, la loi du 28 mars 2003 prévoit que « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles, ou un de leurs groupements, à organiser les modalités de leur action commune ». e § 2. Les innovations de la loi du 28 mars 2003 Les innovations de la loi constitutionnelle portent essentiellement sur trois points : – la possibilité pour les collectivités territoriales de déroger aux lois et règlements ; – l'application d'un principe de subsidiarité à la ventilation des compétences ; – l'appel au peuple, à travers le droit de pétition et le référendum. 136 A. Le pouvoir de déroger aux lois et règlements ◊ Avec ce pouvoir on est au cœur de l'expérimentation. C'est un point essentiel, l'un de ceux qui nécessitaient l'intervention du constituant pour le permettre, mais c'est aussi l'un de ceux qui soulèvent le plus d'interrogations. L'article 72, 4 al., indique que dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales, ou leurs groupements, peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Cette disposition est une conséquence directe des problèmes soulevés par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. En effet, le Parlement avait voté une disposition permettant à l'Assemblée de Corse de procéder à des expérimentations comportant des dérogations aux règles législatives en vigueur. Le Conseil constitutionnel avait jugé que cette possibilité donnée à la Corse de prendre des mesures relevant du domaine de la loi était contraire à la Constitution et notamment à son article 34, et que le législateur ne saurait déléguer sa compétence dans un cas non prévu par la Constitution, toutes choses difficilement contestables. Autrement dit, une telle expérimentation ne pouvait être possible qu'à la suite d'une révision levant l'obstacle constitutionnel. C'est ce que fait la loi du 28 mars 2003. En revanche, il n'y avait aucun problème en ce qui concerne la dérogation aux dispositions réglementaires, celle-ci ayant été admise par le Conseil constitutionnel, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit fondamental constitutionnellement garanti. Les conditions mises à l'expérimentation ont été précisées par la loi organique du 1 août 2003 . Une loi doit définir l'objet et la durée (qui ne peut excéder 5 ans, avec prorogation possible d'un an) de l'expérimentation, ainsi que les dispositions auxquelles il peut être dérogé. Les collectivités territoriales se portent alors volontaires et le Gouvernement, après vérification que les conditions légales sont remplies, dresse par décret la liste des e 174 er 175 collectivités autorisées à participer à l'expérimentation. Mais le plus important est sans doute la manière dont s'achève l'expérimentation. Au vu d'un rapport transmis par le Gouvernement, le Parlement, avant l'expiration du terme fixé par la loi, décide : – soit de mettre fin à l'expérimentation ; – soit de la prolonger en en modifiant le cas échéant les modalités ; – soit de généraliser les mesures prises à titre expérimental. Ce mécanisme, complètement nouveau, de l'expérimentation permettant à des collectivités territoriales de déroger à des dispositions législatives, pose d'épineux problèmes juridiques. Par exemple, quelle sera la place, dans la hiérarchie des normes, des actes pris en la matière par les collectivités territoriales ? Quel sera le sort de celles-ci au cas où le Parlement met fin, purement et simplement, à l'expérimentation ? ; – Le Parlement pourra-t-il légiférer sur les questions faisant l'objet de l'expérimentation, pour les collectivités qui n'y sont pas incluses, alors que le Parlement ne peut pas renoncer de son propre chef à exercer sa compétence (ce que l'on appelle parfois « l'incompétence négative ») ? C'est la loi de finances pour 2007, du 21 décembre 2006, qui, pour la première fois, a mis en œuvre cette nouvelle procédure . Il semble que les collectivités territoriales soient assez hésitantes face à cette innovation . 176 177 137 B. Le principe de subsidiarité en ce qui concerne la répartition des compétences ◊ On l'a vu (v. ss 126) il y a un enchevêtrement très regrettable des compétences des différentes collectivités territoriales, la politique des « blocs de compétence » ayant largement échoué. La loi du 28 mars 2003 aurait pu être l'occasion de remettre de l'ordre en la matière. C'est une attitude complètement différente qu'a adoptée le Gouvernement en constitutionnalisant (art. 72, 2 al.) un concept complètement nouveau, du moins en droit interne : celui de la subsidiarité. Il est formulé très clairement : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». Ainsi formulé (les collectivités territoriales « ont vocation ») on peut se demander s'il ne s'agit pas plus d'un vœu, d'une intention, que d'une véritable obligation juridique. Mais surtout, sa mise en œuvre suppose que soit résolu au préalable un problème particulièrement délicat : comment déterminer, pour une question précise, quel est le meilleur niveau d'exercice d'une compétence ? Très concrètement, on peut se demander comment le principe de subsidiarité sera mis en œuvre. Il semble difficile, en se fondant sur lui, de procéder à une redistribution générale des compétences actuellement dévolues aux différentes collectivités territoriales. Le principe ne jouerait donc que pour l'avenir. e Encore faudrait-il s'y tenir : la loi du 13 août 2004 (v. ss 139) n'en fait guère application. La seule expérience, jusqu'à maintenant, visant à mettre en œuvre un principe de subsidiarité est celle de l'Union européenne au sein de laquelle il fut introduit par le Traité de Maastricht. Il n'y a guère prospéré. 138 C. La démocratie de proximité : le recours au droit de pétition et au référendum ◊ La plus grande innovation de la loi du 28 mars 2003, 178 avec la possibilité de déroger aux lois, est sans doute la volonté de faire appel au Peuple. L'exposé des motifs de la loi formule le désir que les citoyens soient plus souvent consultés, la décentralisation des compétences devant aller de pair avec cette expression directe des citoyens. Tout d'abord, les électeurs peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante d'une collectivité d'une délibération relevant de sa compétence (art. 72-1) . Le droit de pétition est lié à notre plus ancienne tradition constitutionnelle puisqu'il figurait déjà dans la Constitution de 1791. Très malheureusement il est très largement tombé en désuétude, probablement par défaut d'information du public sur le droit qui lui est ainsi reconnu. On peut espérer que, le phénomène associatif aidant, il n'en sera pas de même à l'échelon local. C'est une loi ordinaire qui doit fixer les conditions d'exercice de ce droit. En second lieu, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis par la voie du référendum à la décision des électeurs de cette collectivité, système qui peut se combiner avec le droit de pétition, si celle-ci porte sur l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de l'organisation d'un référendum sur une question déterminée. La loi organique du 1 août 2003 « relative au référendum local » et le décret 2005-433 du 4 mai 2005 fixent les conditions dans lesquelles on peut recourir au référendum. Il y a, tout d'abord, pour les assemblées délibérantes, une sérieuse « clause de sauvegarde » : elles seules peuvent décider le référendum, même si celui-ci est demandé par voie de pétition. Le référendum n'est pas possible dans les six mois qui précédent le renouvellement total ou partiel de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ainsi que pendant les campagnes électorales (présidentielles, législatives, sénatoriales) ou si un référendum a été décidé à l'échelon national. Les textes organisent l'information des électeurs ainsi que l'organisation de la campagne référendaire. En revanche, et c'est un pas essentiel qui est franchi, le référendum a un caractère décisoire, à la condition que la moitié au moins des électeurs inscrits 179 er ait participé à celui-ci. Le dispositif est en place : pour la première fois on organise dans notre système juridique, du moins à l'échelon local, le recours à l'initiative populaire et au référendum décisoire. Sera-t-il utilisé en dépit des réticences traditionnelles des élus locaux envers cette forme de la souveraineté du peuple ? Ce sera l'une des choses les plus intéressantes à observer dans l'application de la loi du 28 mars 2003. De ce référendum « décisoire » il faut distinguer celui organisé par l'article 122 de la loi du 13 août 2004 (CGCT, art. L. 1112-6) et qui permet aux assemblées délibérantes de consulter les électeurs sur les décisions qu'elles envisagent de prendre, mais dont le résultat ne lie pas l'assemblée. L'organisation d'une telle consultation peut être demandée par 1/5 des électeurs communaux et 1/10 des électeurs départementaux ou régionaux. e e § 3. La loi du 13 août 2004 139 180 Il restait à mettre en œuvre les principes et les réformes établis par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. C'est ce que fait la loi du 13 août 2004 « relative aux libertés et responsabilités locales ». Elle a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel qui, dans une décision assez brève, n'a déclaré qu'un seul de ses articles contraire à la Constitution (Cons. const. n 2004-503 DC du 12 août 2004, Rec. 144). De longues précisions pour son application figurent dans une circulaire du 21 décembre 2004, AJDA 2005. 175. La discussion de ce texte au Parlement a été, par moments, assez vive, reflétant la méfiance qu'inspire à certains élus, désormais, la décentralisation, essentiellement en raison des transferts de charges financières de l'État sur les collectivités territoriales qu'elle peut provoquer. Il s'agit d'un texte touffu (202 articles !) modifiant un grand nombre de dispositions concernant le droit des collectivités territoriales. La loi procède à des transferts de compétences au profit des trois catégories de collectivités et traite longuement de la coopération intercommunale. C'est donc en traitant plus loin de ces questions que l'on analysera les principales dispositions de ce texte. o SECTION 4. LE RAPPORT BALLADUR ET LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 2010 181 140 Un décret du 22 octobre 2008 a créé un « Comité pour la réforme des collectivités locales » présidé par Édouard Balladur. La lettre de mission que lui a adressée le président de la République partait du principe que : « Le temps de mettre à l'étude et de décider une profonde réforme de l'administration locale est venu ». Après avoir souligné ce que la situation actuelle avait de peu satisfaisant (prolifération des échelons de décision, confusion dans la répartition des compétences et des moyens, uniformité des règles appliquées, etc.) il était demandé au Comité d'évoquer toutes les modifications d'ordre administratif, juridique ou fiscal qui lui paraîtront utiles avec une priorité à accorder à la modification des structures en vue de leur simplification et à la répartition des compétences en vue de leur clarification. Ce rapport a été remis au président de la République le 5 mars 2009 et publié (JO du 6 mars 2009, p. 4161). Sa conclusion essentielle est formulée ainsi : « La bipolarisation des institutions locales au profit de la région et de l'intercommunalité a semblé au Comité permettre un désenchevêtrement des compétences ». Le Comité formule ensuite vingt propositions dont la plupart seront reprises dans le projet de loi « de réforme des collectivités territoriales ». Depuis la L. O. du 15 avril 2000 les projets de loi doivent faire l'objet d'une « étude d'impact » définissant les objectifs que le projet poursuit et justifiant le système qui a été retenu. Celle de la loi du 16 décembre 2010 (85 pages + annexes) est très intéressante et constitue une importante documentation sur les collectivités territoriales. La discussion du projet de loi a donné lieu au Parlement à des débats passionnés et à une vive opposition entre l'Assemblée nationale et le Sénat . Avant sa promulgation, le texte voté a fait l'objet d'un recours au Conseil constitutionnel ; dans sa décision n 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Rec. 367, celui-ci a écarté la quasi-totalité des objections qui avaient été formulées à son encontre . Le texte promulgué comporte 90 articles (49 p. du JO !) concernant essentiellement : – la création des conseillers territoriaux ; – la réforme de l'intercommunalité ; – le problème de la fusion de départements, de régions ou de la région et des départements ; – le problème de la répartition des compétences ; – la création de « métropoles » ; – la création du « Grand Paris ». Le décret n 2012-124 du 30 janvier 2012 est intervenu « pour la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi » . On exposera l'apport de la loi du 16 décembre 2010 à propos de l'examen de chacune de ces questions. 182 o 183 o 184 SECTION 5. LES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT AYRAULT 185 Le gouvernement de J.M. Ayrault, reflétant l'hostilité de sa majorité à l'encontre des réformes opérées lors du précédent quinquennat, a souhaité modifier sur des points importants le droit positif et mettre en œuvre de nouveaux dispositifs en matière de décentralisation. Ceci s'est traduit par la loi organique et la loi du 17 mai 2013, par la loi du 27 janvier 2014 et par la loi organique et la loi du 14 février 2014. § 1. La loi organique et la loi du 17 mai 2013 141 186 Ces deux textes concernent « l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ». On en étudiera la portée lorsque l'on examinera ces diverses élections (v. ss 156, 180 s., 266 s.). Mais dès maintenant il faut souligner que la loi du 17 mai 2013 abroge le système du conseiller territorial mis en place par la loi du 16 décembre 2010 et qui devait siéger tout à la fois au Conseil régional et au Conseil général, désormais intitulé « Conseil départemental ». Il ne sera donc jamais entré en application. Pour ce dernier elle met en place le système du « binôme ». § 2. La loi du 27 janvier 2014 142 La loi du 27 janvier 2014 « de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » est un modèle de ce que l'on ne devrait jamais faire ! Ses 94 articles remplissent 79 pages du JO (!) et mélangent des réformes importantes, par exemple la création de la grande Métropole de Paris, ou des Métropoles de Lyon et Aix-Marseille-Provence, avec des dispositifs d'une grande technicité ; mais qu'il faille, par exemple, 16 pages de JO pour organiser la Métropole de Lyon laisse pantois. Que serait-ce si l'article 34 de la Constitution ne limitait pas la compétence du législateur en la matière à la seule détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ? On examinera les principales innovations de ce texte à propos de l'étude de chacune des collectivités territoriales et de leurs regroupements. Mais la loi met aussi en place un important dispositif destiné à assurer la clarification et la coordination de l'action de ces collectivités. 187 143 La coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs regroupements : la conférence territoriale de l'action publique ◊ L'art. 4 de la loi du 27 janvier 2014 (codifié à l'article L. 1111-91 CGCT) crée la Conférence territoriale de l'action publique. Celle-ci, présidée par le Président du Conseil régional, comprend les présidents des conseils départementaux, les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants, un représentant de ceux de moins de 30 000 habitants et des représentants des communes distingués selon la population de celles-ci. Le Préfet de Région y assiste si se pose un problème de délégation d'une compétence de l'État ou à sa demande. La Conférence est chargée de « favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités » et débat des projets qui lui sont présentés par les collectivités. Cela aboutit à des Conventions territoriales d'exercice concerté d'une compétence. 144 Les collectivités territoriales chefs de file ◊ L'article 3 de la loi du 27 janvier 2014 (CGCT, art. L. 1111-9) prévoit que lorsque l'exercice des compétences des collectivités territoriales nécessite le concours de plusieurs collectivités des délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la Convention territoriale d'exercice concerté. Mais surtout ce texte énumère les domaines dans lesquels la région, le département et la commune sont respectivement chefs de file. § 3. La loi organique et la loi du 14 février 2014 145 Le problème de la limitation du cumul des mandats électoraux était un « classique » du débat politique. On en parlait beaucoup mais c'était l'Arlésienne car on se heurtait à l'hostilité des parlementaires dont un grand nombre sont des « cumulards ». Le gouvernement de J.M. Ayrault, en dépit de cette hostilité, a fait voter la loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, et la loi du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen. Ces dispositions se sont appliquées aux renouvellements des assemblées qui ont eu lieu après le 31 mars 2017. Toujours en ce qui concerne le statut des élus territoriaux, un certain nombre de ceux-ci doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale en exécution de la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique. 188 189 SECTION 6. LES RÉFORMES DU GOUVERNEMENT VALLS 146 190 Le Gouvernement de Manuel Valls a fait adopter deux lois importantes en ce qui concerne les collectivités territoriales et donc la décentralisation. La première est la loi 2015-29 du 16 janvier 2015 « relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » . Cette loi réduit le nombre des régions métropolitaines de 22 à 13, plus la Corse, ce qui n'a pas été sans provoquer de très vives controverses (v. ss 104). Elle fixe le nombre des conseillers régionaux à élire dans chaque section départementale et décalait les élections régionales au mois de décembre 2015 . La seconde, qui a été adoptée après un long et très animé débat parlementaire, est la loi 2015-991 du 7 août 2015 « portant nouvelle organisation territoriale de la République » (NOTRe) . Ce texte est un « fourre-tout » abominable comme on a la faiblesse d'en fabriquer de plus en plus souvent : 136 articles sur 97 pages de Journal Officiel ! Le Titre premier supprime la clause de compétence générale pour la région et renforce les responsabilités régionales. Le Titre II vise la rationalisation de l'intercommunalité et le renforcement de l'intégration communautaire. Le Titre III supprime la clause de compétence générale des départements et garantit la solidarité et l'égalité des territoires. Le Titre IV veut améliorer la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. Enfin, le Titre V regroupe les dispositions relatives aux agents Les réformes envisagées par l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, et son Premier ministre, Édouard Philippe, seront exposées lorsque l'on étudiera les différentes collectivités territoriales et leurs regroupements. Sur le problème de leur autonomie financière : X. Cabanes : « L'autonomie financière des collectivités territoriales après les récentes lois financières », AJDA 2018. 720. 191 192 193 CHAPITRE 2 LA COMMUNE Section 1. ÉVOLUTION DU RÉGIME DES COMMUNES Section 2. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. LE CONSEIL MUNICIPAL Composition Élection Durée du mandat Statut des élus municipaux Fonctionnement Attributions Section 3. LE MAIRE § 1. Statut § 2. Attributions 147 Traits généraux ◊ Trois traits caractérisent la structure communale française : – l'ancienneté : héritières des paroisses de l'Ancien Régime, les communes constituent, et de beaucoup, la plus ancienne de nos collectivités territoriales. Rares sont les agglomérations qui se sont formées après le Moyen Âge, et beaucoup ont une origine plus ancienne, parfois romaine ou même préromaine ; – la multiplicité : Après une diminution d'un millier de municipalités en deux ans, par suite de la politique de regroupement menée par les pouvoirs publics, la France comptait encore cependant, au 1 janvier 2017, 35 498 communes, c'est-à-dire, à elle seule, plus que les cinq autres pays fondateurs de la CEE. – l'exiguïté : plus d'un dixième des communes n'ont pas 100 habitants (il y a même, dans les statistiques du ministère de l'Intérieur « des communes sans population »), 22 700 communes ont moins de 500 habitants (elles n'étaient que 15 800 en 1851) et 42 seulement ont plus de 100 000 habitants. Ces traits expliquent, tout à la fois, la force du patriotisme communal – 194 er chaque collectivité a une nette conscience de son existence propre, héritage d'une longue tradition – et la relative pauvreté de la vie administrative locale dans les petites communes, où le manque de ressources se prête mal au développement d'une véritable autonomie municipale . La Commune ne se réduit pas à l'agglomération qui lui donne son nom : elle a un territoire, souvent fort vaste, limité par celui des communes voisines, l'ensemble du territoire national ayant été, à partir de 1821, partagé entre les communes. Les modifications aux limites territoriales des communes, leur suppression éventuelle, ainsi que le changement de nom d'une commune, relèvent du pouvoir exécutif (CGCT, art. L. 2112-2 s.). L'organisation des collectivités territoriales françaises, et donc de la commune, repose sur le schéma le plus simple qui soit : une assemblée délibérante, élue au suffrage universel, qui choisit en son sein l'exécutif de la collectivité. Après un rappel de l'évolution du régime des communes (Section 1), on étudiera le conseil municipal (Section 2) et le maire (Section 3). 195 SECTION 1. ÉVOLUTION DU RÉGIME DES COMMUNES 148 A. Jusqu'à l'an VIII ◊ 1 L'Ancien Régime. Jusqu'à la Révolution, la plus o grande diversité régnait en matière communale ; les paroisses du plat pays, les communautés d'habitants ne possédaient pas de vie juridique propre. Celle qui avait été conférée à un grand nombre de collectivités urbaines ou rurales trouvait son principe dans des chartes particulières, consacrant des statuts très divers selon les régions et les époques. 2 La Révolution. Elle substitua, à cette diversité née de l'histoire, un régime de rigoureuse uniformité. Toutes les paroisses accèdent à la vie juridique et à la qualité de commune ; c'est cette mesure absolument capitale qui a entraîné la prolifération des petites communes, caractéristique initiale du système français d'administration locale. D'autre part toutes les communes, quelle que soit leur importance, sont dotées du même statut. Ce statut, fut, tour à tour un régime de décentralisation intégrale (loi du 14 déc. 1789), une vigoureuse centralisation de fait avec la Convention, enfin, avec la loi du 5 fructidor an III, la recherche d'un équilibre entre ces deux extrêmes. Mais le principal intérêt de cette loi est dans sa tentative de réaction contre l'uniformité ; déjà consciente du problème posé par les petites communes, elle les regroupait, au-dessous de 5 000 habitants, dans le cadre du canton, pour une administration collective (municipalité de canton). o 149 B. La centralisation de l'an VIII ◊ La loi du 28 pluviôse an VIII marque le point de départ de l'évolution ; elle rétablit l'uniformité ; elle y ajoute la centralisation. La commune conserve la personnalité morale ; mais le maire qui l'administre, et le conseil municipal, assemblée principalement consultative composée de 10 à 30 membres selon l'importance de la commune, sont nommés par le pouvoir central, et placés sous l'autorité hiérarchique du préfet. 150 C. Les étapes de la décentralisation ◊ 1 L'élection est acquise, pour le o conseil municipal dès la loi du 21 février 1831, pour le maire, seulement avec la loi du 28 mars 1882. Le conseil municipal devient assemblée délibérante, et non plus organe consultatif, en 1837 ; des lois successives étendent ses attributions et allègent la tutelle sur ses délibérations, en 1867, 1884 et 1926. 2 C'est la grande loi municipale du 5 avril 1884 qui va constituer le texte de base de la commune, collectivité décentralisée. 3 Le mouvement de décentralisation connaît ensuite une longue interruption. Même si on laisse de côté la parenthèse du régime de Vichy, rigoureusement centralisateur en accord avec son caractère autoritaire, la tendance centralisatrice s'est nettement réaffirmée dès les années 1930. De nombreux textes de détail ont renforcé la tutelle en matière financière surtout, transféré à l'État tout ou partie de certaines matières jusque-là purement communales (maintien de l'ordre, hygiène publique), imposé aux communes, pour l'organisation de leurs services et le statut de leur personnel, des règles impératives qui limitent leur liberté d'action. 4 En réaction contre cette tendance, un certain retour à la décentralisation, notamment par l'allégement de la tutelle, s'affirme avec l'ordonnance du 5 janvier 1959 et la loi du 31 décembre 1970. Ce mouvement se parachève avec la loi du 2 mars 1982 et la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (v. ss 129) qui consacrent le triomphe de la décentralisation. o o o 151 D. Le renouvellement des problèmes de la commune ◊ On peut se demander si la décentralisation suffit à résoudre les problèmes que pose aujourd'hui la collectivité communale. C'est sa structure même qui est remise en cause. Le passage d'une civilisation rurale à une société industrielle et urbaine aboutit au dépérissement des petites communes, cependant que les agglomérations qui englobent plusieurs communes en un seul ensemble autour d'une métropole n'ont ni le statut ni les moyens permettant de coordonner leur gestion. De plus en plus le problème essentiel est celui de la coopération intercommunale, seul moyen de pallier le trop grand nombre de communes françaises. C'est à travers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI : art. L. 5210-1 CGCT) que seront résolus les problèmes de la collectivité communale (v. ss 265 s.). Les EPCI prennent de plus en plus d'importance dans le paysage administratif local notamment avec la loi du 16 décembre 2010 et du 7 août 2015. 196 152 E. Le régime actuel ◊ Sa base reste la loi du 5 avril 1884, fréquemment modifiée, et dont la substance est passée dans le Code général des collectivités territoriales (cité sous l'abréviation CGCT). Il s'est longtemps caractérisé par son uniformité, héritée de la Révolution : la loi ne distinguait pas, contrairement à beaucoup de législations étrangères, entre communes rurales et urbaines ; elle ne prenait en considération le chiffre de la population que sur des points de détail (par exemple pour fixer le nombre des conseillers municipaux). Cette situation est en voie d'évolution. La distinction entre la ville et les communes rurales s'est affirmée. Mais surtout les problèmes sociaux propres aux banlieues, l'insécurité qu'elles connaissent souvent justifient des mesures spécifiques pour les zones dites « sensibles », et la création, pour les localités en difficulté économique, de « zones franches » destinées à faciliter, par la création d'entreprises, la lutte contre le chômage local. Trois grandes villes (Paris, Lyon, Marseille) ont un régime propre (v. ss 225). La loi du 27 janvier 2014 a profondément accentué leur particularisme en les érigeant en métropoles à statut particulier. La loi du 13 juillet 1991, qui reconnaît aux citoyens un « droit à la ville », au contenu d'ailleurs incertain, cherche à faciliter par des mesures appropriées la construction de logements sociaux, ainsi que les équipements, les services, et la réhabilitation des quartiers anciens ou dégradés. Le régime actuel des communes se soucie également, de plus en plus, de développer la participation des habitants à la gestion communale. Cette volonté d'introduire dans celle-ci un supplément de démocratie est une des orientations de la loi du 6 février 1992 (sur l'administration territoriale de la République), de la loi du 27 février 2002, relative, précisément, « à la démocratie de proximité » , et de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (v. ss 138). « Les communes constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité » (art. 145, L. 13 août 2004). Ces textes visent : – à une meilleure information des habitants par la mise à leur disposition de toute une série de documents (budget et documents financiers, arrêtés municipaux etc.) ; – à rapprocher l'administration des administrés par la création, dans les communes de 80 000 habitants et plus, de « quartiers », dotés d'un conseil de quartier qui peut être consulté par le maire ou lui faire des propositions et la 197 possibilité de nommer des adjoints de quartier (CGCT, art. L. 2143-1 ; L. 2122-2-1 ; L. 2144-2) ; – à donner un pouvoir de décision aux administrés par le moyen du référendum (v. ss 138). – à associer des personnes étrangères au conseil municipal à la gestion de la commune par la participation à des comités consultatifs, d'associations locales, de jeunes ou de résidents étrangers ; – à permettre à la population de participer à l'élaboration de grands projets d'aménagement ou d'équipement, par le biais de procédures de consultation. De manière plus générale, les articles 135 et 136 de la loi du 27 février 2002 prévoient une concertation réciproque entre l'État et les collectivités territoriales pour leurs projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages dont le coût est supérieur à un certain seuil. Aux termes de l'art. L. 2121-40 CGCT le maire reçoit du préfet les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune et fournit à ce dernier les informations dont il peut également avoir besoin à ce sujet. 198 SECTION 2. LE CONSEIL MUNICIPAL 199 § 1. Composition 153 Le nombre des conseillers municipaux varie en fonction de la population de la commune, de 7 pour les communes de moins de 100 habitants, à 69 pour les communes de plus de 300 000 habitants. Ce nombre est supérieur pour Paris, Lyon et Marseille. Les conseillers municipaux sont toujours en nombre impair afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, le partage par moitié du Conseil. § 2. Élection 154 200 A. Électorat ◊ Sont électeurs toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune. Les Français établis à l'étranger peuvent se faire inscrire sur la liste électorale d'une commune avec laquelle ils ont une attache : commune de naissance, de leur dernier domicile etc. (C. élect., art. L-12). En vertu des dispositions du Traité de Maastricht sont également électeurs les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui résident en France et qui en ont fait la demande. Cette disposition a nécessité une révision de la Constitution qui réservait l'électorat aux seuls nationaux français. C'est l'article 88-3 de la Constitution (issu de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992) et la loi organique du 25 mai 1998 qui règlent la question. Il y aurait, d'après l'INSEE, plus d'un million de citoyens de l'Union européenne vivant en France, mais assez peu (150 000 semble-t-il) utilisent la faculté de voter aux élections municipales en France. 155 B. L'éligibilité ◊ Sont éligibles tous les électeurs âgés de 18 ans, attachés à la commune par un lien légal, qui peut être, soit le domicile (pour les ¾ des élus), soit la qualité de contribuable dans la commune. Il existe des inéligibilités absolues, qui interdisent d'être candidat dans n'importe quelle commune, et des inéligibilités relatives : les préfets (CE 6 mai 2015, AJDA 2015. 1779), les magistrats, les membres de la police, ne peuvent être candidats dans les communes de leur ressort territorial ; les agents communaux ainsi que les salariés du centre communal d'action sociale ne peuvent l'être dans la commune qui les emploie ; les personnes exerçant au sein du Conseil départemental ou régional des fonctions de direction, ne peuvent l'être dans les communes du département ou de la région concernée (C. élect., art. L. 231-8) ; les entrepreneurs et concessionnaires de travaux et de services publics, dans celles avec lesquelles ils sont en relation d'affaires. Des incompatibilités frappent certains élus : préfets et fonctionnaires supérieurs de la police doivent opter entre leur mandat et leurs fonctions ; de même, nul ne peut demeurer simultanément conseiller municipal dans deux communes. Par contre, il n'y a pas d'incompatibilité entre le mandat municipal et ceux de conseiller départemental, de conseiller régional ou de membre du Parlement, sous réserve des règles générales relatives au cumul des mandats électoraux. L'incompatibilité entre le mandat de conseiller municipal et les fonctions de militaire de carrière est contraire à la Constitution (Cons. const. Décision n° 2015-471 QPC du 29 mai 2015, p. 538). Sur la base du Traité de Maastricht les électeurs ressortissants d'un État de l'Union européenne, inscrits sur la liste électorale de la commune, sont éligibles. Toutefois, le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint (Const., art. 88-3). Selon le ministre de l'Intérieur, 204 ressortissants de l'Union européenne avaient été élus lors des municipales de 2001 dans les communes de plus de 3 500 habitants. 201 156 C. L'opération électorale ◊ L'élection du Conseil municipal est régie par la loi du 19 novembre 1982, modifiée par la loi du 17 mai 2013, qui est une excellente loi électorale. En effet, elle garantit dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants la constitution d'une majorité « de gouvernement » tout en assurant la représentation des minorités. Il s'agit, en fait, d'un scrutin majoritaire tempéré d'une certaine dose de représentation proportionnelle. La loi du 17 mai 2013 distingue les communes de moins de 1 000 habitants et celles de 1 000 habitants et plus. Normalement, chaque électeur est appelé à désigner tous les conseillers. Il n'en va autrement que dans les communes composées de plusieurs agglomérations distinctes ; il faut éviter, dans ce cas, que l'agglomération se trouve privée de toute représentation au conseil. D'où la procédure du sectionnement électoral dans les communes de plus de 20 000 habitants. Il est décidé par le Conseil départemental : la commune est, pour le vote, divisée en sections dont chacune élit un nombre de conseillers correspondant à sa population (deux au minimum) . 202 1. Communes de moins de 1 000 habitants Il s'agit d'un scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Les listes ne sont pas obligatoires et il y a la possibilité de candidatures individuelles mais celles-ci sont désormais obligatoires alors qu'avant la loi du 17 mai 2013 on pouvait voter pour des personnes qui ne s'étaient pas portées candidates, ce qui constituait l'un des attraits de ce mode de scrutin. Sont élus au premier tour de scrutin les listes ou les candidats individuels ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés (parmi lesquels on ne compte toujours pas les votes blancs !). Peuvent seuls se présenter au second tour les candidats du premier tour, sauf si le nombre de candidats est inférieur au nombre des sièges à pourvoir. 2. Communes de 1 000 habitants et plus a) C'est un scrutin de liste : le dépôt des listes est obligatoire et elles doivent comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir ; les électeurs ne peuvent pas les modifier. En application de la révision constitutionnelle du 9 juillet 1999, instituant le principe de parité, la loi du 31 janvier 2007 dispose que « la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe », système appelé familièrement « chabadabada » ! b) Si une liste obtient au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés (c'est-à-dire plus de la moitié de ceux-ci), elle reçoit la moitié des sièges à pourvoir arrondie à l'entier supérieur, les autres étant répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des voix, y compris la liste majoritaire . Cette dernière a donc l'assurance de disposer d'une majorité importante au sein du Conseil. c) Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue il y a lieu à un second tour 203 204 de scrutin. Ne peuvent se présenter à celui-ci que les seules listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1 tour. Par ailleurs, les listes restant en présence peuvent être modifiées pour y intégrer des candidats qui figuraient sur une liste du 1 tour ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Dans la pratique, cette possibilité a été jusqu'à maintenant assez peu utilisée. La règle de répartition des sièges est la même que celle du premier tour : la liste arrivée en tête, même si elle n'atteint pas la majorité absolue, reçoit la moitié des sièges arrondie à l'entier supérieur, les autres sièges étant répartis à la proportionnelle comme indiqué ci-dessus. er er 157 D. Contentieux ◊ Les contestations de l'élection sont portées devant le Tribunal administratif et, en appel, devant le Conseil d'État. Le recours est ouvert à tout électeur, dans les cinq jours, et au préfet, dans les quinze jours. Le Tribunal a trois mois pour statuer ; passé ce délai, il est dessaisi et le dossier transmis au Conseil d'État, qui statue alors en premier et dernier ressort . Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille ont fait l'objet de la loi du 31 décembre 1982 (v. ss 225). 205 § 3. Durée du mandat 158 1 Le Conseil est élu pour six ans. Le renouvellement a lieu, pour la France entière, au mois de mars. 2 Le Conseil peut être dissous par décret motivé pris en Conseil des ministres lorsqu'il est dans l'impossibilité, notamment du fait de tensions politiques en son sein, de remplir ses fonctions . S'il y a urgence, il peut être suspendu pour un mois par le représentant de l'État. Dans les deux mois de la dissolution, les électeurs désignent un nouveau Conseil, mais celui-ci ne reste en fonction que jusqu'à la fin des six années en cours. Entre-temps, les affaires courantes sont gérées par une délégation spéciale nommée par le représentant de l'État. Les mêmes règles s'appliquent en cas de démission collective du Conseil, ou d'annulation de son élection par le Tribunal administratif ou le Conseil d'État sur appel. 3 Le mandat de chaque conseiller peut prendre fin, outre le décès, par la démission. Celle-ci peut être prononcée d'office par le Tribunal administratif à l'égard du conseiller qui, sans excuse valable, refuse de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi . La démission est définitive dès la réception par le maire de la lettre la présentant (CGCT, art. L. 2121-4 ; CE 12 févr. 2003, Commune de la Seyne-sur-Mer, AJDA 2003. 112). Le décès ou la démission ne donne jamais lieu à élection partielle. Dans les communes o o 206 o 207 de plus de 1 000 habitants, le remplacement du conseiller élu sur une liste est assuré par le candidat qui venait immédiatement après le dernier élu de cette liste, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Dans toutes les communes, il y a lieu à élections partielles lorsque le Conseil a perdu un tiers de ses membres, ou s'il doit élire un nouveau maire. § 4. Statut des élus municipaux 159 208 Pendant la durée de leur mandat, les conseillers municipaux bénéficient de l'ensemble des garanties sociales accordées par la loi du 3 février 1992 à tous les élus locaux. Lorsqu'ils sont salariés, l'employeur est tenu de leur laisser le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, la perte de salaire qui en résulte pouvant, dans certaines limites, être compensée par la collectivité dont ils relèvent. Les absences liées à ces fonctions ne peuvent entraîner pour eux ni licenciement, ni déclassement professionnel, ni sanction disciplinaire. La loi aménage leur situation par rapport à la Sécurité sociale. D'autre part, ils peuvent recevoir, à la charge de la collectivité, la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Leurs fonctions normalement gratuites sauf remboursement des frais de mission, peuvent, sur décision du conseil municipal, à certaines conditions et dans certaines limites, faire l'objet d'une indemnité. L'ensemble de ce statut de l'élu est repris dans le titre II de la loi du 27 février 2002 « relative à la démocratie de proximité ». La loi du 31 mars 2015 « visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat » comprend une « charte de l'élu local » qui doit être lue lors de la première réunion du conseil municipal suivant son élection. La loi améliore le crédit d'heures dont bénéficient les élus pour l'exercice de leur mandat, et leur accorde un « droit individuel à la formation » . Les fonctions de conseiller municipal ne sont pas prises en compte par les textes limitant le cumul des mandats. 209 § 5. Fonctionnement 160 A. Organisation intérieure ◊ Comme toute assemblée délibérante, le Conseil élabore son règlement intérieur ; il peut désigner dans son sein des commissions spécialisées dans l'étude de certains problèmes (commission des finances, de l'enseignement etc.). Les conseillers prennent rang selon « l'ordre du tableau », déterminé par la date de la première élection, et le nombre des voix obtenues. 161 B. Régime des réunions ◊ Il a été profondément modifié par la loi du 31 décembre 1970, dans le sens d'un assouplissement. Jusque-là, le conseil municipal tenait obligatoirement quatre sessions annuelles, dont la loi fixait la durée maximum. Désormais la loi prévoit simplement l'obligation, pour le conseil, de se réunir au moins une fois par trimestre. Il peut tenir des réunions supplémentaires chaque fois que le maire le juge utile, ou sur demande de la moitié des conseillers (un tiers seulement dans les communes de plus de 3 500 habitants), ou sur demande motivée du préfet. La convocation, faite par le maire trois jours au moins avant la réunion, doit en indiquer l'ordre du jour. Au-delà de 3 500 habitants, le délai est de cinq jours et la convocation doit s'accompagner d'une note sur les affaires à débattre ; s'il s'agit de la discussion du budget, un débat sur ses orientations générales doit se dérouler dans les deux mois précédents. Les séances sont présidées par le maire, éventuellement remplacé par un adjoint ; elles sont publiques, sauf formation en comité secret pour certains débats mettant en cause des particuliers ; la loi impose des conditions de quorum. La commune assure l'information des élus « par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés » (CGCT, art. L. 2121-13-1). 210 211 162 C. Les délibérations ◊ Les réunions du Conseil, qui peuvent comporter des questions orales posées par les conseillers sur les affaires de la commune, et être diffusées par des moyens audiovisuels, aboutissent normalement à des délibérations, votées à la majorité des suffrages exprimés. L'entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales est régie par l'art. L. 222-1 du CRPA. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'art. L. 2121-21 CGCT qui prévoit la possibilité d'un vote à bulletins secrets (Cons. const. Décision n° 2015-471 QPC 29 mai 2015, D. 2015. 1158). Par ailleurs le Conseil d'État applique aux délibérations du Conseil municipal la jurisprudence « Danthony » (v. ss 674) qui veut que toute illégalité de procédure n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'acte (CE, sect., 23 oct. 2015, Sté CFA Méditerranée, AJDA 2015. 2382, Concl. Bohnert). Les délibérations constituent soit des décisions possédant tous les caractères juridiques de l'acte administratif unilatéral, soit des avis, que le Conseil est fréquemment appelé à donner en application des textes ou sur demande des autorités de l'État, soit des vœux, qu'il émet de sa propre initiative. Certaines décisions, il faut le rappeler (v. ss 138), peuvent être prises directement par les électeurs de la commune statuant par voie de référendum. § 6. Attributions 163 Elles sont définies à la fois par la formule traditionnelle de l'article L. 2121-29 CGCT : « le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », et, par celle de la loi du 7 janvier 1983 « les communes règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence », ce qui veut dire, les affaires que le législateur estime qu'elles seront mieux traitées au niveau communal ou, tout simplement, qu'elles relèvent du niveau communal par application du nouveau principe de subsidiarité (v. ss 137). 164 La commune conserve la clause de compétence générale , alors que la loi NOTRe du 7 août 2015 supprime celle du département et de la région. 165 A. Champ d'action du Conseil municipal ◊ 1 Les « affaires de la 212 o commune » . Tout ce qui concerne la collectivité communale et elle seule relève du conseil ; il constitue en quelque sorte, l'autorité communale de droit commun. Toutefois la loi apporte à ce principe des exceptions : certaines matières communales sont réservées au maire (police). Surtout, la délimitation des affaires communales et des affaires de l'État est loin d'être facile, et laisse place à beaucoup d'arbitraire : longtemps, l'État n'a pas hésité à réputer « communales » des tâches onéreuses, par exemple, la construction et l'entretien des bâtiments nécessaires à certains services d'État implantés dans la commune (bâtiments scolaires, palais de justice etc.) tout simplement pour en transférer la charge financière aux communes. Les anciens contrats de plan État-Régions, rebaptisés désormais « contrats de projets » (v. ss 464), peuvent aussi être l'occasion de financements communaux pour des opérations qui ne relèvent pas directement des « affaires de la commune ». Dans le champ ainsi délimité le Conseil peut déléguer certaines de ses compétences – dont la liste est fixée par la loi du 31 décembre 1970 – au maire. Celui-ci doit rendre compte des décisions ainsi prises en vertu de la délégation, qui est toujours révocable. (CGCT, art. L. 2122-22). 2 Les compétences sectorielles. Elles concernent, essentiellement, les domaines suivants : – Planification : les communes comprises dans un périmètre arrêté par le préfet peuvent s'associer pour élaborer une « charte intercommunale de développement et d'aménagement » dans les domaines économique, social et culturel. – Urbanisme : c'est dans ce domaine que la compétence communale trouve sa plus grande extension : de la commune relèvent désormais l'élaboration des 213 o plans locaux d'urbanisme (nouvelle appellation depuis la loi SRU du 13 décembre 2000 des anciens POS), la délivrance du permis de construire, et celle des autres autorisations relatives à des immeubles (lotissements, permis de démolir, de clôturer, aménagement de campings, etc.). Conscient, semble-til, des difficultés auxquelles vont se heurter les petites et moyennes communes pour l'exercice de ces compétences, en raison tant de leur aspect technique que de la réglementation touffue, changeante et complexe dont elles font l'objet, le législateur privilégie en la matière le rôle des organismes intercommunaux. D'autre part, la prépondérance reconnue à la commune en matière d'urbanisme laisse une place à la concertation avec les autres collectivités et l'État. Enfin, celui-ci par son représentant se réserve, sur quelques points essentiels, soit un pouvoir de contrôle pouvant aller jusqu'à la substitution après mise en demeure, soit une compétence exclusive (schémas de mise en valeur de la mer). Son rôle devient prépondérant en matière de sauvegarde du patrimoine et des sites : si la loi prévoit, dans ce domaine une concertation avec les autorités locales, c'est au préfet qu'elle réserve, pour l'essentiel, la décision. – Logement : la commune peut élaborer un programme local de l'habitat, notamment en ce qui concerne la rénovation de l'habitat social, mais elle n'a pas la maîtrise des moyens permettant de le réaliser. – Ports : seuls relèvent de la commune, pour leur création et leur exploitation, les ports de plaisance. – Enseignement public : la commune décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles ; elle en assure la construction, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération des maîtres, qui incombe à l'État. En ce qui concerne les établissements des niveaux supérieurs (collèges, lycées), qui ne relèvent pas de la commune, elle est, sur certaines questions, appelée à donner un avis, voire un accord. – Action sociale et santé : la commune n'a pas reçu, dans ces domaines, d'attributions propres, mais elle peut, par voie d'accord avec le département, prendre en charge les compétences attribuées à celui-ci. La loi du 13 août 2004 donne compétence à la commune pour l'enseignement artistique initial et pour l'organisation et l'exploitation des ports de commerce qui leur sont transférés. Elles ont, de surcroît, la possibilité de créer un Office municipal de tourisme et de participer à la construction de logements pour étudiants. Enfin, à titre expérimental, elles peuvent créer des établissements publics locaux d'enseignement primaire et prendre en charge la lutte contre l'habitat insalubre. 166 B. Le vote du budget communal ◊ 214 1 Règles générales. Le budget est l'acte qui prévoit et autorise chaque année les dépenses et les recettes de la commune. Il doit être voté en équilibre réel et avant le 31 mars de l'exercice auquel il se rapporte. Dans les deux mois qui précèdent le budget primitif doit avoir lieu, dans les communes d'au moins 3 500 habitants, un débat d'orientation budgétaire. En cours d'exercice peut intervenir un budget supplémentaire qui tient compte de ce qui a été déjà exécuté, et corrige ou complète le budget primitif. Préparé par le maire, le budget, dans sa forme, emprunte obligatoirement le cadre imposé par les ministères des Finances et de l'Intérieur ; il comporte une section de fonctionnement qui comprend les dépenses et les recettes appelées à se reproduire chaque année, et une section d'investissement. Le chapitre 3 de la loi du 12 avril 2000 contient un certain nombre de dispositions relatives à « la transparence financière ». 2 Les dépenses. On distingue les dépenses obligatoires, dont la loi du 2 mars 1982 a réduit la liste (CGCT, art. L. 2321-2) et les dépenses facultatives. Les dépenses les plus importantes correspondent au fonctionnement des services – rémunération du personnel, entretien des locaux et du matériel etc. – au remboursement des emprunts, aux travaux ne correspondant pas à des investissements, aux subventions accordées à des organismes privés . Le problème des subventions accordées par les personnes publiques mériterait une étude exhaustive ; il me semble qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de droit à obtenir une subvention même lorsque l'on remplit les critères arrêtés par la personne publique. Sur la base du principe de laïcité, les subventions aux cultes, directes ou indirectes, sont interdites . Les subventions à l'enseignement libre du premier degré le sont aussi (sous réserve de l'application des lois sur l'aide à l'enseignement privé sous contrat), mais en vertu d'un texte formel qui ne s'applique pas aux autres ordres d'enseignement, et qui, d'autre part, n'interdit pas de faire bénéficier des mêmes avantages tous les enfants des familles peu fortunées, quelque école qu'ils fréquentent. 3 Les recettes. On évoquera rapidement un problème complexe dont l'étude relève du droit financier plus que du droit administratif. Les recettes des communes sont diverses : revenus des biens, produits des services rendus, mais, surtout fiscalité, subventions d'État et emprunts. L'insuffisance de la fiscalité dont disposent les collectivités territoriales les fait dépendre dans une proportion qui n'est que difficilement compatible avec la décentralisation – il n'y a pas d'autonomie réelle sans autonomie financière (v. ss 134) – des subventions versées par l'État et de l'emprunt qui, lui, pose le problème du taux d'endettement des collectivités territoriales. a) La fiscalité. L'un des grands problèmes de la décentralisation est celui de o o 215 216 o 217 la réforme des finances des collectivités territoriales et plus spécialement de la fiscalité locale. Les communes ne peuvent pas créer elles-mêmes d'impôts, mais seulement percevoir ceux que la loi met à leur disposition. Or, ceux-ci sont assis sur des bases qui n'ont aucune véritable réalité économique, ce qui a le grave inconvénient de contraindre les collectivités territoriales, pour équilibrer leur budget, à voter régulièrement des augmentations des taux des impôts locaux. En dehors de quelques taxes de faible importance offertes au libre choix des communes (taxe sur la publicité, taxe de séjour, etc.), l'essentiel des ressources fiscales locales provient de quatre impôts directs, perçus obligatoirement, que des ordonnances de 1959 ont substitués au système ancien des centimes additionnels. On désignait par là des contributions établies sur la base d'impôts directs autrefois perçus au profit de l'État : contribution mobilière, contributions foncières, patente. Les centimes additionnels ont été remplacés par quatre taxes, qui s'attachent aux mêmes éléments : les taxes foncières sur la propriété bâtie et sur la propriété non bâtie, la taxe d'habitation, et la taxe professionnelle qui a été supprimée par la loi de finances pour 2010 et remplacée par la contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont le taux est fixé au plan national. La suppression de la taxe professionnelle entraînant des pertes de recettes pour les collectivités territoriales ces dernières seront compensées par un transfert de recettes fiscales de l'État vers les collectivités. En ce qui concerne la taxe d'habitation, la loi de finances pour 2018 (art. 5) vise, en s'ajoutant aux dégrèvements et exonérations déjà existants, à dispenser progressivement, d'ici à 2020, près de 80 % des redevables (en fonction de leurs revenus, à savoir 27 000 euros) de l'acquittement de cette taxe au titre de leur résidence principale. Cette réforme ne doit pas avoir d'impact financier pour les communes. Le Conseil constitutionnel a jugé cette réforme conforme à la Constitution et ne portant pas atteinte au principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales (Cons. const. Décis. n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, JO 31 déc., texte n° 11). L'assemblée locale fixe elle-même, chaque année, le taux des taxes ; mais ce pouvoir est enfermé dans certaines limites. b) Les subventions de l'État . On l'a vu (v. ss 127) la globalisation des subventions versées par l'État aux collectivités territoriales – dotation globale de fonctionnement ; dotation globale d'équipement ; dotation générale de décentralisation – constitue un progrès certain. Mais le mécanisme de calcul de ces dotations est d'une rare complexité. C'est pour cette raison que le Gouvernement souhaite engager une profonde révision des mécanismes internes 218 219 220 de répartition des dotations. La loi de finances pour 2004 a amorcé une simplification de la DGF (sur tous ces points, v. : F. Aubert, AJDA 2003. 1692). c) Les emprunts sont le plus souvent contractés auprès d'organismes publics contrôlés par l'État (Caisse des dépôts et consignations, Crédit foncier). Sur la base de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation de l'activité bancaire a été mise en place l'Agence France Locale pour le financement des investissements des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 1611-3-2) . 221 222 167 C. Les interventions dans le secteur économique ◊ Il s'agit de ce que 223 l'on appelle le « socialisme municipal » : les communes peuvent-elles intervenir dans le secteur économique soit en subventionnant des activités privées industrielles ou commerciales, soit en créant elles-mêmes des entreprises commerciales et industrielles ? Les données du problème sont assez simples. A priori, de telles initiatives sont contraires au principe de la liberté du commerce et de l'industrie posé par la fameuse loi des 2-17 mars 1791, même s'il a, depuis, connu bien des avatars. Par ailleurs, il y a le risque d'une concurrence déloyale, faite aux entreprises privées, car celles-ci ont l'obligation d'équilibrer leur gestion alors que la collectivité peut fort bien, le cas échéant, supporter une exploitation déficitaire. À l'inverse, peut-on accepter que la municipalité, qui a en charge l'avenir de la population de la commune, voie la situation de l'emploi et de l'économie se dégrader sur le territoire communal sans pouvoir y remédier ? Encore faut-il que cela n'aboutisse pas à soutenir à fonds perdus des entreprises qui ne sont plus viables . Le Conseil d'État, saisi de recours contre ces mesures soit par des contribuables, soit par des commerçants atteints par cette concurrence, s'est d'abord montré extrêmement rigoureux (29 mars 1901, Casanova, GAJA, n 8). Il a maintenu cette rigueur, et la fidélité au libéralisme économique dont elle procédait, même après qu'un décret du 5 novembre 1926 fut venu étendre le champ d'action des communes aux entreprises industrielles et commerciales intéressant le ravitaillement, le logement, l'urbanisme, l'assistance, l'hygiène, la prévoyance sociale ; le Conseil d'État n'hésita pas à affirmer, contre l'évidence, que ce texte n'avait eu « ni pour objet, ni pour effet, d'étendre en matière de services industriels et commerciaux les attributions conférées au conseil municipal par la législation antérieure » (CE 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce de Nevers, GAJA, n 41 et la jurisprudence citée). Mais, depuis, la position jurisprudentielle s'est transformée, notamment à partir des arrêts 224 o o Lavabre (CE 23 juin 1933, Rec. 677) et Zénard (24 nov. 1933, Rec. 1100). Les solutions acquises peuvent se résumer ainsi : – Les communes, comme l'État lui-même, ont pour principe d'action l'intérêt général, non la recherche du profit : dès lors, celles de leurs interventions qui se justifieraient par ce seul mobile demeurent illégales. – Dans les domaines qui ressortissent traditionnellement à l'intérêt général (hygiène, assistance), la création d'un service, même commercial, est légale (CE 12 juill. 1939, Chambre syndicale des maîtres buandiers de SaintÉtienne, Rec. 478). – En dehors de ces domaines, la création d'un service économique est admise lorsqu'il vise à la satisfaction d'un besoin public auquel l'initiative privée ne pourvoit pas . Les deux termes de cette formule sont entendus de plus en plus largement : l'intérêt public justifie par exemple la création d'un théâtre de verdure ayant pour but de mettre à la disposition de la population, pendant l'été, des possibilités de distraction en plein air (CE 12 juin 1959, Syndicat des exploitants de cinémas de l'Oranie, D. 1960. J. 402), ou la création d'un camping municipal lorsque les campings privés ne suffisent pas à faire face au nombre croissant des campeurs (CE 17 avr. 1964, C de MervilleFranceville, AJDA 1964. 304, et la note, p. 288) ; il justifie également des initiatives qui constituent le prolongement naturel de l'activité d'un service luimême légal – par exemple, l'adjonction d'une station-service à un parc municipal de stationnement (CE 18 déc. 1959, Delansorme, D. 1960. J. 371). D'autre part, la carence de l'initiative privée n'a plus besoin d'être totale : le service municipal pourra être légal s'il améliore les conditions dans lesquelles le besoin public reçoit satisfaction (par ex., : initiatives des communes en matière de logement, CE 22 nov. 1935, Chouard, Rec. 1080 ; de soins dentaires, CE 20 nov. 1964, Ville de Nanterre, AJDA 1964. 686 ; de consultations juridiques, CE 23 déc. 1970, Commune de Montmagny, AJDA 1971. 166 ; d'équipement en piscines, 23 juin 1972, Sté La Plage de la Forêt, AJDA 1972. 463). Ces solutions sont-elles remises en cause par la loi du 2 mars 1982 ? Ce texte a eu le grand mérite de provoquer, au Parlement, un débat de fond sur la question et de permettre au législateur de fixer les principes, et les limites, des interventions économiques des collectivités territoriales, en rappelant que c'est l'État qui a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale. C'est ce qu'exprime le 1 alinéa de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 : « L'État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du 225 ne er territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article ». Dans ce cadre les communes peuvent octroyer des aides directes ou indirectes destinées soit à favoriser le développement, soit à faciliter le redressement, dans l'intérêt de la population, d'entreprises en difficulté, soit enfin à assurer, en milieu rural, le maintien des services nécessaires . Enfin, les participations dans des sociétés commerciales n'ayant pas pour objet la gestion d'un service ou d'une activité d'intérêt général demeurent subordonnées à une autorisation par décret en Conseil d'État. Les conditions dans lesquelles les personnes publiques peuvent intervenir dans le secteur économique ont fait l'objet d'un important arrêt : CE, ass., 31 mai 2006, Ordre des Avocats au barreau de Paris, AJDA 2006, Chron. Landais et Lenica, p. 1592. Par ailleurs, selon la constatation de Sophie Nicinski : « En droit français rien ne permet de s'opposer à l'offre de services gratuits par les personnes publiques » (commentaire de l'arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 2014, Sté Sigmalis, AJDA 2014. 1876). La loi du 5 janvier 1988, dite « loi pour l'amélioration de la décentralisation » subordonne l'aide que la commune peut accorder pour assurer le maintien en milieu rural des services qu'exige la satisfaction des besoins de la population à une convention avec le bénéficiaire de l'aide fixant les obligations de celui-ci. Elle peut, dans le même but, passer des conventions avec d'autres collectivités. L'article 10 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit l'intervention d'une convention pour toute subvention dépassant un certain seuil financier (actuellement 23 000 euros annuels) . La loi précise également les conditions de certaines interventions dans l'ordre économique (garantie d'emprunt à une personne de droit privé, participation au capital de certains établissements de crédit). Dans la pratique, ces interventions restent assez peu fréquentes. Les interventions économiques des collectivités territoriales ont fait l'objet d'un rapport fort – trop ? – critique de la Cour des comptes qui pense qu'il est nécessaire de « les revoir fondamentalement » (AJDA 2007. 2228 et AJDA 2014. 2213). Le décret n 2012-716 du 7 mai 2012 fixe le cadre réglementaire des interventions financières des collectivités territoriales (AJDA 2012. 919). 226 227 228 o 168 D. La création communaux ◊ et l'organisation des services publics 229 1 Le Conseil municipal décide la création et fixe l'organisation des services publics communaux. Sur ce point, sa liberté n'est pas complète puisque la loi o lui impose la création de services considérés comme indispensables (état civil, pompes funèbres , désinfection etc.). L'art. 79 de la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que « un Centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus » et son art. 88 qu'« un Conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ». 2 Quant au mode de gestion des services , le Conseil peut choisir dans une gamme de procédés assez étendue (régie directe, régie dotée de l'autonomie financière, régie dotée, en plus, de la personnalité morale ; concession ; société d'économie mixte ; société publique locale) . À chacun de ces procédés, correspondent des règles d'organisation détaillées, prévues pour chacun, par le CGCT . La loi du 2 mars 1982 les a assouplies ; les cahiers des charges et règlements types établis par le ministère de l'Intérieur, jusque-là obligatoires, ne sont plus, désormais que des modèles proposés aux communes. Enfin, il existe également des règles propres à certains services, selon leur objet (par ex. : abattoirs, poids publics, musées, cf. CGCT, art. L. 2224-1 s.). Ces différents modes de gestion contractuelle avaient été regroupés sous l'appellation « délégation de services publics » (L. 6 févr. 1992) (v. ss 409). Les conventions de délégation sont soumises à une publicité préalable (CGCT, art. L. 1411-1). La même règle s'applique aux conventions de délégation de services publics des départements et des régions. La Société publique locale, qui a été créée par la loi n 2010-559 du 28 mai 2010 , est une structure à statut privé mais à capital entièrement public susceptible de se voir confier sans mise en concurrence les interventions économiques et, plus généralement, les opérations d'intérêt général, des collectivités territoriales, selon la définition qu'en donne Sophie Nicinski . Sur le contrôle de celles-ci : TA Lille, Ord. 29 mars 2012, Cté de Cnes Sambre-Avesnois, TA Montpellier, 23 mars 2012, FADUC, M Fraysse, AJDA 2012. 1521, note S. Brameret ; CE 6 nov. 2013, Cne de Marsannay-la-Côte, AJDA 2014. 60, note G. Clamour. La Cour des comptes veut un meilleur contrôle des entreprises publiques locales (AJDA 2017. 1810). 3 Les communes de plus de 10 000 habitants doivent créer une Commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention ou exploités en régie dotée de l'autonomie financière. Elle est présidée par le maire et les usagers y sont représentés (CGCT, art. L. 1413-1). 4 Les maisons des services publics. Afin de faciliter les démarches des administrés et d'améliorer la proximité des services publics, l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 prévoit la création, par convention, de maisons des services publics qui font l'objet du décret 2001-494 du 6 juin 2001. 230 231 o 232 233 234 o 235 236 me o o 169 E. La gestion des personnels communaux 170 F. La gestion des biens communaux ◊ La commune est propriétaire d'un ◊ Dans les petites communes, il est réduit au seul secrétaire de mairie ; dans les grandes villes le personnel est nombreux. Leur statut a été longtemps arrêté par les Conseils municipaux. Ceux-ci se bornent désormais à fixer la liste des emplois, ceux qui sont appelés à les occuper relevant du statut de la fonction publique territoriale (v. ss 128). Seuls les emplois les plus élevés des communes les plus importantes peuvent être pourvus de façon discrétionnaire. 237 certain nombre de biens qui constituent son domaine. C'est au Conseil municipal qu'il revient de prendre les décisions relatives à la gestion de ce domaine. Les revenus domaniaux figurent dans les recettes du budget communal. Ils peuvent parfois être relativement importants (cas, par exemple, des communes forestières). 171 G. Divers ◊ Le Conseil autorise la conclusion, par le maire, des contrats et décide des actions à exercer en justice ; il statue également sur les travaux publics à effectuer, notamment en ce qui concerne la voirie communale (ord. 59-115 du 7 janv. 1959). Dans le prolongement de cette activité, le Conseil établit le plan d'alignement qui fixe les limites des rues et chemins ruraux par rapport aux propriétés qui les bordent, et surtout, il joue un rôle déterminant dans l'élaboration des plans destinés à soumettre le développement de la localité aux règles de l'urbanisme, notamment les plans locaux d'urbanisme (v. ss 164). SECTION 3. LE MAIRE 172 238 Le maire est un rouage essentiel de la commune ; à l'échelle communale on constate aussi le phénomène de la « personnalisation du pouvoir ». On pourrait parler d'un régime présidentiel à l'échelle de la commune. Pour exercer ses importantes attributions (v. ss 176) le maire est aidé par un certain nombre de conseillers municipaux que l'on appelle « les adjoints au maire ». Le Conseil fixe librement le nombre de ceux-ci, sans qu'il puisse excéder 30 pour 100 de son effectif (CGCT, art. L. 2122-2). Dans les communes de moins de 1 000 habitants les adjoints sont élus, selon le système utilisé pour l'élection du maire, et immédiatement après celle-ci ; ils siègent dans l'ordre de leur élection. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, un nouveau système a été mis en place par la loi 2007-128 du 31 janvier 2007 relative à « l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ». Les adjoints sont élus au scrutin de liste, l'écart sur celle-ci entre les candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative si un troisième tour est nécessaire. Aux termes de l'article 10 du décret 2007-1670 du 26 novembre 2007 (CGCT, art. R. 2121-3) l'ordre du tableau est déterminé « entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste ». On désigne parfois sous le nom de « municipalité » le groupe formé par le maire et ses adjoints ; mais ceci ne doit pas faire illusion : l'exécutif communal est confié à un seul homme : le maire. Cependant la loi du 31 décembre 1970 crée, entre le maire et ses adjoints, une certaine solidarité : s'il y a lieu pour le Conseil de désigner un nouveau maire, par suite de décès ou de démission, il doit, en même temps, désigner à nouveau les adjoints. La loi tend donc à créer une « équipe municipale ». Il reste que les adjoints n'ont pas d'attributions propres ; le maire peut seulement leur déléguer une partie des siennes, ces délégations étant toujours révocables : le conseil municipal doit, en ce cas, se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions (CGCT, art. L. 2122-18). Le Premier adjoint assure la suppléance du maire en cas d'empêchement. On examinera successivement le statut du maire (§ 1), puis ses attributions (§ 2). 239 § 1. Statut 173 A. Désignation ◊ Longtemps nommé par le pouvoir central, en toute liberté d'abord, puis parmi les conseillers municipaux, le maire, depuis 1882, est élu par le conseil municipal, parmi ses membres (CGCT, art. L. 2122-4). Aux termes de l'article 88-3 de la Constitution, les ressortissants de l'Union européenne, éligibles au Conseil, ne peuvent pas exercer les fonctions de maire ou d'adjoint. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus (CGCT, art. L. 2122-4). L'élection a lieu normalement à la première séance qui suit le renouvellement du conseil ou la sortie de charge du maire précédent si ses fonctions prennent fin de façon prématurée. Dans ce dernier cas, le conseil devant être au complet pour cette élection, il y a lieu, le cas échéant, à une élection partielle. Si deux tours de scrutin successifs ne permettent pas d'aboutir à une élection à la majorité absolue (plus de la moitié des votants), l'élection est acquise, au troisième tour, à la majorité relative ; en cas d'égalité des voix, c'est le plus âgé qui est proclamé élu. Dans la pratique, il n'y a guère de problème dans les communes de plus de 1 000 habitants puisque le mode de scrutin municipal y dégage des majorités cohérentes. Le maire est tout simplement celui qui a mené la liste aux élections et de facto il est donc élu au suffrage universel ; il est le chef de la majorité du conseil municipal : d'où son autorité sur lui. Il n'existe qu'un cas d'inéligibilité : un maire qui a fait l'objet d'une mesure de révocation ne peut être réélu avant un an ; d'autre part, certaines fonctions, compatibles avec le mandat de conseiller, ne le sont pas avec celui de maire. Aux termes de la loi organique du 14 février 2014 les fonctions de maire et d'adjoint au maire sont incompatibles avec le mandat de député ou de sénateur mais, importante concession faite aux parlementaires, cette incompatibilité n'était applicable qu'à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent suivant le 31 mars 2017 ; l'interdiction du cumul s'applique donc désormais tant aux députés qu'aux sénateurs. . Aux élections législatives de juin 2017 un nombre non négligeable de députés sortants ont opté pour leur mandat de maire. Quant au mandat de député européen, aux termes de la loi du 14 février 2014, il est compatible avec un seul mandat local. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions de l'article L. 2122-16 du CGCT qui permet la révocation des maires et des adjoints par le pouvoir exécutif (Décis. n 2011-210 QPC du 13 janv. 2012, AJDA 2012. 546, note Verpeaux). Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres . Par ailleurs, les maires d'une commune de plus de 20 000 habitants et les adjoints d'une commune de plus de 100 000 habitants sont tenus de déposer une déclaration de leur patrimoine (loi du 11 octobre 2013). Ces réformes vont avoir un double effet : en premier lieu, dans nombre de villes importantes, le maire ne sera plus parlementaire et, en second lieu, on devrait voir augmenter le nombre de femmes devenant maire . 240 o 241 242 174 B. Durée du mandat ◊ En principe, le maire et les adjoints sont élus pour toute la durée du mandat du conseil municipal, c'est-à-dire jusqu'au renouvellement normal du Conseil, ou exceptionnellement jusqu'à sa dissolution. Les fonctions de maire peuvent cependant prendre fin de façon anticipée, soit par décès, soit par la survenance d'inéligibilités (par ex. condamnation) ou d'incompatibilités qui aboutissent à la perte du mandat de conseiller municipal, soit par démission, celle-ci pouvant être une première fois refusée par le représentant de l'État, mais devenant définitive un mois après avoir été présentée une seconde fois , soit enfin par révocation par décret en Conseil des ministres, celle-ci pouvant être précédée d'une mesure de suspension prise 243 par arrêté ministériel . Dans tous ces cas, le maire élu en remplacement et les adjoints élus en même temps que lui restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du Conseil. Il faut souligner le fait que, si le conseil municipal choisit le maire, il ne peut pas, juridiquement du moins, décider de mettre fin à ses fonctions : le régime municipal n'est pas un régime parlementaire. 244 175 C. Rémunération ◊ Le mandat de maire, longtemps gratuit, est aujourd'hui 245 rémunéré, selon un barème fixé par l'art. 3 de la loi du 31 mars 2015, en fonction de l'importance des communes ; le maire a droit, en outre, au remboursement de ses frais de mission. L'abandon du principe de la gratuité se justifie pleinement étant donné le caractère absorbant des fonctions de maire dans les communes de quelque importance. § 2. Attributions 246 On a déjà décrit le rôle du maire en tant qu'agent de l'État (v. ss 115) ; on examinera maintenant son rôle en tant qu'organe exécutif de la commune. À ce titre il a des attributions au regard du Conseil municipal et des pouvoirs propres. Son action est susceptible d'entraîner certaines responsabilités. 176 A. Attribution vis-à-vis du Conseil municipal ◊ À l'égard du Conseil municipal le rôle du maire est triple : 1 Il prépare ses délibérations et notamment le budget, avec le concours des adjoints et des agents municipaux. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect des fonctions du maire. La manière dont est constitué et présenté le dossier qui sera soumis à la délibération du Conseil a une influence certaine sur l'orientation de la discussion qui s'instaurera. Ce rôle est encore plus important lorsqu'il s'agit du budget car, compte tenu de sa technicité, celui-ci ne sera modifié – s'il l'est ! – qu'à la marge en cours de discussion et ceci, d'autant plus, qu'il y a eu un débat d'orientation budgétaire. 2 Le maire préside les séances et a la police de celle-ci. 3 Il exécute, avec le concours de ses adjoints, les délibérations (CGCT, art. L. 2122-21). Il passe les contrats tels qu'ils ont été approuvés par le Conseil, délivre les alignements, procède à l'ordonnancement des dépenses, dirige les travaux, représente la commune en justice, etc. Dans sa fonction d'exécution, il est placé sous le contrôle du conseil municipal qui, s'il n'a pas juridiquement le pouvoir de le désinvestir, peut lui demander des explications : ses membres ont, à o o o 247 certaines conditions, le droit d'être informé de tout ce qui touche aux affaires de la commune (CE 9 nov. 1973, C de Pointe-à-Pitre, RD publ. 1974. 1148, notes Waline, T. 1, n 68 ; CE, sect., 23 avr. 1997, Ville de Caen c/ Paysant, Rec. 158). La loi du 6 février 1992 confirme et développe ce droit, de même que la loi du 27 février 2002 (possibilité de créer une mission d'information et d'évaluation sur une question d'intérêt communal : CGCT, art. L. 2121-22-I) . Si le conseil est en désaccord avec la politique du maire, il peut, par une attitude d'opposition systématique à ses projets, l'amener en pratique à démissionner, ou provoquer sa propre dissolution par l'autorité de tutelle, les électeurs arbitrant alors le différend. Le Conseil, en outre, statue chaque année sur les comptes présentés par le maire en exécution du budget, dans une séance à laquelle celui-ci n'assiste pas ; le refus d'approuver une dépense irrégulière peut aboutir à la mise en jeu de la responsabilité civile du maire vis-à-vis de la commune. ne o 248 177 B. Pouvoirs propres ◊ 1 Le maire détient, en propre, la police municipale, pouvoir qu'il exerce sans le concours du Conseil municipal. La police rurale, qui s'applique sur l'ensemble du territoire non urbanisé de la commune, lui est également confiée. Le maire est une autorité importante en ce qui concerne la police administrative (v. ss 381). C'est là, pour le maire, une attribution essentielle ; il l'exerce sous le contrôle administratif du préfet. Mais, dans un grand nombre de communes, ses attributions en matière de maintien de l'ordre ont été transférées au préfet (v. ss 381). 2 La loi 2007-297, du 5 mars 2007, « relative à la prévention de la délinquance », associe le maire à celle-ci. Il est informé des infractions concernant un trouble à l'ordre public et il anime sur le territoire de la commune la politique de prévention de la délinquance en en coordonnant la mise en œuvre (v. art. L. 132-1 et s. du Code de la sécurité intérieure). Ce dispositif a été complété par la loi du 14 mars 2011 (LOPPSI 2) qui prévoit que le maire peut convenir avec l'État des modalités nécessaires à la réalisation des actions de prévention et rend obligatoire, pour les communes de plus de 50 000 habitants, la création d'un Conseil pour les droits et devoirs des familles. 3 Le maire est le chef hiérarchique des agents communaux ; il les nomme, les note, dirige leur action, dans les conditions fixées par leur statut et dans les limites définies pour l'ensemble de la fonction publique territoriale (v. ss 128). Il délivre les permis de construire et diverses autres autorisations individuelles en matière d'urbanisme. Il a des fonctions de représentation importantes dans les grandes villes. o o o Le maire, enfin, peut prendre, en matière de gestion des biens et intérêts communaux, des mesures conservatoires, jusqu'à ce que le conseil puisse intervenir et statuer définitivement. Les décisions du maire revêtent la forme de l'arrêté . 249 178 C. Les responsabilités nées de l'activité du maire ◊ 1 Responsabilité civile. Selon qu'il agit dans l'exercice de ses attributions d'agent de l'État ou d'agent de la Commune, le maire, par ses fautes de service, engage la responsabilité de la personne morale correspondante . En outre, sa responsabilité propre est engagée, selon le droit commun, par ses fautes personnelles (v. ss 543), soit, vis-à-vis des particuliers, soit, dans certaines hypothèses tout au moins, vis-à-vis de la commune. Elle l'est encore, mais sur la base de divers articles du Code civil, en ce qui concerne les fonctions d'officier de l'État civil. 2 Responsabilité pénale. La responsabilité pénale du maire peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes. C'est pourquoi une loi du 18 juillet 1974 avait étendu aux maires, ainsi qu'aux adjoints et aux conseillers municipaux, pour leur éviter des poursuites arbitraires, la procédure protectrice de mise en cause pénale applicable aux magistrats et aux préfets lorsque le crime ou le délit se rattache à l'exercice des fonctions . Mais ce privilège leur a été retiré par la loi du 4 janvier 1993. Il reste que la responsabilité pénale reconnue aux personnes morales autres que l'État, par le nouveau Code pénal , est assumée par le maire en tant que représentant de la commune, et peut entraîner pour lui une condamnation. Toutefois, la loi du 13 mai 1996, dans le cas où les faits ont mis en danger la personne d'autrui, excluait la responsabilité du maire « s'il avait accompli les diligences normales ». La même règle s'applique aux responsables des autres collectivités territoriales. Cet état du droit positif, et un certain nombre d'inculpations pénales de maires dans des affaires où leur « culpabilité » était loin d'être évidente, avaient soulevé de très vives protestations de la part des élus locaux. Bien plus il était de nature à décourager nombre d'élus de se représenter aux élections municipales. On a donc mis en chantier sur cette question une délicate réforme législative destinée à empêcher les procédures abusives sans pour autant accorder aux élus locaux des privilèges ou immunités indus. Après de sérieuses oppositions entre les deux chambres du Parlement, a été votée la loi du 10 juillet 2000 « tendant à préciser la définition des délits nonintentionnels » . Aux termes de l'article 1 de ce texte, il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité « s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli o 250 o 251 252 253 er les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Ce texte, général, est de nature à apaiser les craintes des élus locaux. Sur l'application de ce texte, v. : Crim. 24 oct. 2000, D. 2002. 514, note J.-C. Planque ; TGI La Rochelle, 7 sept. 2000, D. 2000, n 34, Dern. Actualité ; Crim. 4 juin 2002, D. 2003. 95, note S. Petit (la nonconformité de buts de football ne constitue pas une faute caractérisée au sens de la loi du 10 juillet 2000). Pour la responsabilité du maire de La Faute-sur-Mer et de son adjointe pour les conséquences tragiques de la tempête Xynthia : TGI Les Sables d'Olonne, 12 déc. 2014, AJDA 2014. 2447, obs. de Montecler ; CA Poitiers, 4 avr. 2016, AJDA 2016. 631, note de Montecler . Par une circulaire du 13 juin 2013 le ministre de l'Intérieur a rappelé aux maires que leur refus de procéder au mariage de personnes de même sexe, prévu par la loi du 17 mai 2013, était susceptible de les exposer à des poursuites pénales . Mais le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une éventuelle atteinte à la liberté de conscience des maires du fait de cette obligation. Par sa décision n° 2013-353 QPC 18 oct. 2013 (p. 1002) le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la disposition ne permettant pas aux officiers d'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les mariages de personnes de même sexe. Faut-il cependant rappeler ici qu'à un moment donné le président de la République avait lui-même envisagé la possibilité d'une clause de conscience en la matière ? o 254 255 256 CHAPITRE 3 LE DÉPARTEMENT 257 Section 1. § 1. § 2. § 3. § 4. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL Évolution du mode d'élection du Conseil Le système de la loi du 17 mai 2013 Fonctionnement Attributions Section 2. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL § 1. Élection § 2. Attributions Section 3. LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER § 1. Le système antérieur à la loi du 28 mars 2003 § 2. Les innovations de la loi du 28 mars 2003 179 C'est l'Assemblée constituante qui, pour mettre fin à l'enchevêtrement des circonscriptions du Royaume, a posé le principe d'une nouvelle division de la France en départements par la loi du 22 décembre 1789. En ce qui concerne le découpage départemental, Thouret avait proposé une division géométrique du territoire en « carrées » de 18 lieues (soit environ 70 km) de côté. Sous l'influence de Mirabeau l'Assemblée, par la loi du 15 janvier – 16 février 1790, créa 83 départements, se subdivisant en districts et cantons. Le principe retenu pour le découpage est bien connu : il fallait que tout habitant du département puisse se rendre (à cheval, bien sûr) au chef-lieu dans la journée. À l'origine, le département n'était qu'une circonscription de l'Administration d'État (v. ss 108). Ce n'est que progressivement qu'il est devenu une collectivité décentralisée : création des conseils généraux en l'An VIII ; élection des conseils généraux (1833) ; affirmation de la personnalité morale du département (avis du Conseil d'État du 27 août 1834) ; loi du 10 mai 1838 qui accroît les pouvoirs du conseil général, enfin, et surtout, la grande loi d'organisation du département, celle du 10 août 1871. Depuis (v. ss 120) la loi du 2 mars 1982 a retiré au préfet son rôle d'exécutif du département. On présente parfois le département comme une circonscription artificielle. Le reproche est injuste car le découpage auquel il a été procédé en 1790 n'était pas si artificiel que cela : on avait pris pour base les Provinces du Royaume. Mais surtout, à supposer qu'il l'ait été initialement, il a maintenant la réalité sociologique qu'il tire de deux siècles d'existence. C'est l'hommage que lui a rendu la Commission Guichard (v. ss 118) lorsqu'elle écrit : « Le département est apparu à la Commission comme l'un des plus sûrs niveaux de développement des responsabilités locales » . D'ailleurs, chaque fois que l'on remet sur le métier la ventilation des compétences décentralisées, on annonce que celle-ci se fera au détriment du département et c'est le contraire qui se produit. Ainsi, la loi du 13 août 2004 transfère au département d'importantes compétences (v. ss 191). Comme la commune, le département, collectivité territoriale, comprend une assemblée délibérante, le Conseil départemental (Section 1) et un exécutif, le Président du Conseil départemental (Section 2). Les départements d'OutreMer ont un régime particulier (Section 3). 258 SECTION 1. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 259 Depuis la loi du 28 Pluviôse An VIII l'assemblée du département prenait le nom de « Conseil général ». Cette dénomination, bien que traditionnelle, avait l'inconvénient de ne pas indiquer clairement aux non-initiés qu'il s'agissait de l'assemblée gérant le département collectivité territoriale. La loi du 17 mai 2013 a donc décidé de substituer l'appellation de « Conseil départemental » à celle de « Conseil général ». « Il y a dans chaque département un Conseil départemental qui représente la population et les territoires qui le composent » (CGCT, art. L. 3121-1). Le Conseil départemental est l'organe essentiel de la décentralisation à l'échelle du département. 260 § 1. Évolution du mode d'élection du Conseil 180 Jusqu'à la loi du 16 décembre 2010, le principe était extrêmement simple : il y avait, dans un département, autant de conseillers généraux qu'il y a de cantons, puisque chacun de ceux-ci élisait un – « son » – conseiller général. Le nombre des cantons, d'un département à l'autre, variait de 25 à la cinquantaine. Il en résultait, dans la composition des conseils, une nette prépondérance de l'élément rural sur l'élément urbain même si des réformes successives avaient réduit quelque peu ce déséquilibre en créant de nouveaux cantons urbains. À ce reproche fait au Conseil général d'être une « chambre d'agriculture » on répondait que « la terre doit être représentée ». Les conseillers étaient élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 181 La réforme de la loi du 16 décembre2010 . Depuis assez longtemps on se demandait, en ce qui concerne l'organisation administrative, s'il n'y avait pas un échelon de trop ; autrement dit s'il ne convenait pas de supprimer soit le département soit la région. La plupart de ceux qui se posaient cette question optaient pour la suppression du département. À cette question le Comité Balladur (v. ss 140) avait donné une solution originale : on conserve le département et la région mais pour supprimer les inconvénients qui résultent de cette dualité, ce sont les mêmes élus – les conseillers territoriaux – qui siégeront au Conseil général et au Conseil régional. C'est ce que décidait la loi du 16 décembre 2010 : « Il y a dans chaque département un Conseil général. Il est composé de conseillers territoriaux ». Cela avait nécessité le découpage des départements en nouvelles circonscriptions pour l'élection de ces conseillers. Après de vives controverses il avait été décidé de les faire élire au scrutin majoritaire à deux tours dans toutes les circonscriptions. 261 § 2. Le système de la loi du 17 mai 2013 262 La loi du 17 mai 2013 a supprimé le système des conseillers territoriaux – qui n'aura donc jamais été appliqué – et organise un système de « binôme » pour l'élection du Conseil départemental. 182 A. Électorat ◊ Sont électeurs, pour la désignation des conseillers départementaux, toutes les personnes de nationalité française inscrites sur les listes électorales du canton. La loi du 17 mai 2013 ayant décidé la suppression de la moitié des cantons il a fallu procéder dans chaque département à un redécoupage cantonal. Le nombre des cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept et il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. Le projet de découpage est préparé par le Préfet. Puis on applique les dispositions de l'art. L. 3113-2 du CGCT : le découpage est décidé par décret en Conseil d'État après consultation du Conseil départemental qui se prononce dans les six semaines à compter de sa saisine, à l'expiration de ce délai son avis étant réputé rendu (sic). Le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques et être continu ; par ailleurs doit être entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. Le législateur avait prévu qu'un certain nombre de dérogations pouvaient être apportées au critère démographique afin de limiter le pouvoir discrétionnaire du gouvernement et l'obliger à prendre en compte toutes les situations locales dans le découpage. Dans sa décision du 16 mai 2013 (préc.) le Conseil constitutionnel a jugé que certaines de ces dérogations étaient trop précises et donc contraires à la Constitution. Pour le contentieux provoqué par ce découpage des cantons : CE 21 mai 2014, M. Hyest, Rec. 138 ; CE 4 juin 2014, Commune de Dieuze, Rec. 155 ; CE, sect., 5 nov. 2014, M. Ceccaldi, Rec. 324 ; CE Sect., 5 nov. 2014, Commune de Ners, Rec. 329, Concl. A. Bretonneau. Le redécoupage effectué par le gouvernement – et faut-il rappeler ici qu'une telle opération n'est jamais indemne de préventions politiques ? – réduit le nombre des cantons de 3 971 à 2 068, mais le nombre des conseillers passant, lui, de 3 971 à 4 136. Cette réduction drastique du nombre des cantons renforce le poids des zones urbaines par rapport aux zones rurales. C'est un peu la fin de la « France du seigle et de la châtaigne ». Il est assez préoccupant que 56 départements sur 98 aient rejeté le projet de découpage cantonal, d'autant plus que ce rejet n'est pas nécessairement motivé par des raisons politiques, puisque 17 départements « de gauche » en font partie, alors que c'est celle-ci qui est au pouvoir à cette époque. 183 B. Éligibilité ◊ Est éligible tout électeur âgé d'au moins 18 ans demeurant dans le département ou inscrit au rôle des contributions directes dans celui-ci. On a supprimé la règle qui limitait au quart des élus la proportion des conseillers non domiciliés dans le département. Les inéligibilités particulières concernent, d'une part un certain nombre de fonctionnaires de l'État dans le ressort où s'exerce leur compétence (C. élect., art. L. 195), d'autre part les conseillers ayant fait l'objet de certaines sanctions. 184 C. Mode de scrutin ◊ On a, depuis maintenant une quinzaine d'années, tout 263 mis en œuvre pour promouvoir le principe de parité en politique, notamment en matière électorale, et cela ne peut qu'être approuvé sans la moindre réserve. Mais il ne faut pas oublier que l'excès en tout est un défaut ! Ainsi, par exemple, il était pour le moins pittoresque de voir que l'on avait modifié le Règlement de l'Assemblée nationale pour permettre à un groupe parlementaire de se doter conjointement de deux présidents de sexe différent, disposition heureusement déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Or il y avait un problème en ce qui concerne le Conseil départemental qui ne comptait qu'environ 15 % de femmes. La seule manière de le résoudre serait, bien sûr, de passer à un scrutin de liste mais cela ne serait guère souhaitable car, selon moi et par expérience, je pense qu'il est indispensable que l'une des assemblées territoriales procède d'un scrutin uninominal qui crée un lien réel entre l'élu et la population du canton. Le législateur de 2013 a cru pouvoir résoudre le problème en inventant un mode de scrutin sans exemple et ceci pas seulement en France : l'élection d'un binôme. Le remède est pire que le mal. En effet, aux termes de l'art. 32 de la loi : « les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique ». Ils déposent une déclaration conjointe de candidature avec mention dans chaque cas de la personne, de même sexe, appelée à les remplacer. Pour l'élection on applique le scrutin majoritaire à deux tours avec la condition d'avoir obtenu au moins 10 % des électeurs inscrits pour pouvoir figurer au second tour qui doit opposer au moins deux binômes. Si, au second tour, plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. C'est ce mode de scrutin où chaque canton élit désormais deux personnes et non plus une seule qui a obligé le législateur à diviser par deux le nombre des cantons de chaque département afin d'éviter une inflation d'élus. Mais ce qu'il y a peut-être de plus critiquable encore est que, une fois élu, chaque membre du binôme retrouve son entière liberté de manœuvre pouvant, par exemple, ne pas s'inscrire au même groupe politique. Tout ceci explique que lors de la discussion du projet de loi, le Sénat, incarnation des collectivités territoriales de la République a, à trois reprises, voté contre le système du binôme. La suppression du conseiller territorial par la loi du 17 mai 2013 laisse non résolu le problème du doublon région-département auquel il faudra bien trouver une solution. Pour ma part je pense que l'idée de faire gérer ces deux collectivités par les mêmes élus était une bonne solution ; ce qu'il aurait fallu remettre en cause était le mode d'élection des conseillers territoriaux en s'orientant vers un système où certains auraient été élus au scrutin majoritaire (dans les circonscriptions rurales) et les autres à la proportionnelle (dans les circonscriptions urbaines), à supposer, bien sûr, que cela paraisse possible au Conseil constitutionnel ! 264 185 D. Renouvellement ◊ Traditionnellement les conseillers généraux étaient élus pour six ans, chaque Conseil se renouvelant par moitié tous les trois ans. La loi du 17 mai 2013 met fin à ce système ; désormais les conseillers départementaux sont élus pour six ans, sont rééligibles et les Conseils se renouvellent intégralement. En cas de décès le conseiller est remplacé par son suppléant qui achève le mandat de celui auquel il succède. Si le fonctionnement du Conseil se révèle impossible, il peut être dissous par décret en Conseil des ministres, et le Parlement en est informé. Dans ce cas il y a lieu à élection dans les deux mois. Il ne peut pas y avoir de dissolution des Conseils départementaux par voie de mesure générale. 186 E. Statut des élus ◊ Les conseillers départementaux bénéficient des garanties sociales que la loi du 6 février 1992 accorde à l'ensemble des élus locaux (v. ss 159) : s'ils sont salariés, garantie de maintien de l'emploi ; pour tous, droit à une formation en vue de l'exercice des fonctions. Ils reçoivent une indemnité de fonctions et sont remboursés de leurs frais de déplacement. L'art. 11 de la loi du 11 octobre 2013 fait obligation aux conseillers départementaux de déposer une déclaration de patrimoine. § 3. Fonctionnement 187 Le Conseil départemental se réunit au moins une fois par trimestre (on a supprimé l'ancien système des sessions) à l'initiative de son Président. Il peut, en outre, se réunir à la demande, soit de la Commission permanente, soit d'un tiers de ses membres. En cas de circonstances exceptionnelles le Gouvernement peut le convoquer par décret. À l'instar des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales, le Conseil départemental ne peut siéger que si la majorité absolue de ses membres sont présents. Les séances sont publiques (le Président a la police de la séance) mais le Conseil peut décider suite à la demande de son Président, ou de cinq de ses membres, de siéger à huis clos. Le représentant de l'État peut y être entendu avec l'accord du Président ou sur demande du Premier ministre. Le Conseil départemental élabore son règlement intérieur. Il constitue en son sein des commissions (finances, culture, sport etc.) qui préparent les délibérations des assemblées plénières. Après l'élection du Président (v. ss 194) le Conseil fixe le nombre des viceprésidents (de 4 à 15, dans la limite de 30 % de l'effectif) et des autres élus qui constituent, avec le Président, la Commission permanente. Les membres de la Commission permanente, autres que le Président, sont élus au scrutin de liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel (CGCT, art. L. 3122-5). Il n'y a pas lieu à scrutin si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, c'est-à-dire en cas d'accord entre les groupes politiques pour sa désignation. La Commission permanente qui se réunit, dans la pratique, chaque mois, est un rouage important du Conseil départemental car elle reçoit de nombreuses délégations (CGCT, art. L. 32112) – peut-être trop – accordées par le Conseil. Le Président et les membres de la Commission permanente ayant reçu une délégation, constituent le bureau, organe dépourvu de tout pouvoir et qui ne semble pas avoir d'existence réelle. La loi du 14 février 2014 interdit le cumul d'un mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de Président ou de Vice-Président d'un Conseil départemental. Les délibérations, prises à la majorité des suffrages exprimés, constituent soit des décisions possédant tous les caractères juridiques de l'acte administratif unilatéral, soit des avis. Les textes imposant un avis du Conseil départemental sont très nombreux et portent souvent sur des questions de peu d'importance. Il n'en va cependant pas toujours ainsi : par exemple le Conseil est consulté sur le plan régional de développement et d'équipement, et sur son exécution. Enfin le Conseil peut prendre des vœux, à son initiative, sur toutes les questions économiques, d'administration générale ou même politiques, et adresser directement au ministre compétent des réclamations et observations au sujet des services publics implantés dans le département. 265 § 4. Attributions 188 Traditionnellement, le Conseil départemental bénéficiait d'une clause de compétence générale aux termes de laquelle il « règle par ses délibérations les affaires du département ». Après bien des péripéties, l'art. 94-2° de la loi du 7 août 2015 (loi NOTRe) a supprimé cette clause de compétence générale. Désormais, aux termes de l'art. L. 3211-1 CGCT : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » . Le département devient donc une collectivité territoriale spécialisée. Mais les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 ont élargi de manière importante les attributions du département. Il en a été de même avec la loi du 13 août 2004 . 266 267 189 A. Création et organisation des services publics départementaux ◊ Dans les limites légales (principe de laïcité, respect de la liberté du commerce et de l'industrie) le Conseil décide la création des services publics départementaux et pourvoit à leur gestion . Il fixe le nombre des emplois départementaux qui ne cessent d'augmenter en raison de la décentralisation et notamment des transferts de personnels de l'État car les services gérés par le département, jusqu'ici peu nombreux, se développent avec celle-ci. En ce qui concerne l'intervention dans le secteur économique, les règles sont celles qui ont été exposées à propos du socialisme municipal (v. ss 167). Le Conseil peut accorder des subventions aux activités d'intérêt général ; elles ont, en pratique, une grande importance. En ce qui concerne les subventions accordées à une autre collectivité territoriale le Conseil d'État a jugé que, sans méconnaître le principe qu'il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre, le département pouvait moduler ses subventions selon le mode de gestion du service public en cause (CE, ass., 12 déc. 2003, Département des Landes, AJDA 2004. 195, note F. Donnat et D. Casas). 268 269 270 190 B. Le vote du budget ◊ Préparé par le Président du Conseil départemental et précédé d'un débat d'orientation budgétaire, il obéit, de façon générale, aux règles qui s'appliquent au budget communal, v. ss 166 : distinction du budget primitif et du budget supplémentaire, des sections de fonctionnement et d'investissement, des dépenses obligatoires et facultatives. Les recettes sont identiques à celles des communes, posent les mêmes problèmes, et sont, pour l'essentiel, régies par les mêmes textes. Ceci vaut pour les subventions, pour les impôts directs (la substitution aux centimes additionnels des quatre taxes créées en 1959 s'applique aux départements comme aux communes), pour les emprunts, et pour les ressources liées aux transferts de compétence (dotation globale de décentralisation). Cf. v. ss 166. Les départements ont été autorisés, pour les années 2014 et 2015 à augmenter le plafond des droits de mutation à titre onéreux. Pour tenir compte des difficultés financières de plus en plus grandes que connaissent les départements par suite des transferts de charges indues opérées à leur détriment par l'État, la loi de finances rectificative pour 2015 a créé un Fonds de soutien exceptionnel en faveur des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales ; il se monte à 50 millions d'euros . Comme pour les communes, la dotation globale de fonctionnement prend en compte la plus ou moins grande richesse des départements pour transférer aux plus pauvres une part des sommes attribuées aux plus aisés ou réputés tels. Le principe de la péréquation destinée à favoriser l'égalité financière entre collectivités territoriales « riches » et « pauvres » a maintenant valeur constitutionnelle (Const., art. 72271 272 2, 5 al.) . e 191 273 C. Attributions en matière sociale et sanitaire ◊ En ce qui concerne l'action sociale, la compétence du département devient prépondérante ; c'est un véritable « bloc de compétences » qui est ainsi constitué. Les dépenses d'action sociale représentent, en moyenne, près de 60 % du budget de fonctionnement des départements. Entre 2010 et 2016 les dépenses sociales des départements (RSA, Aide sociale à l'enfance, personnes âgées et personnes handicapées) ont cru de 24,5 %, soit un total de 32 milliards d'euros, avec un taux de couverture de l'État de 57 %. La loi du 1 décembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) avait conféré au département un rôle important en ce qui concerne sa mise en œuvre. À compter du 1 janvier 2004 c'est la responsabilité totale de cette prestation qui avait été transférée au département. L'augmentation du nombre des « Rmistes » a provoqué un surcroît de charges que le gouvernement s'était engagé à compenser. Au 1 juin 2009 le Revenu de solidarité active (RSA) a remplacé le RMI. Celui-ci représente pour le département une charge de plus en plus lourde. Les dépenses de RSA sont passées de 7,1 milliards d'euros en 2010 à 10,1 milliards en 2016, avec un reste à la charge des départements de l'ordre de 4 milliards d'euros. En second lieu, le département doit mettre en œuvre le revenu minimum d'activité (RMA) pour les bénéficiaires du RMI depuis au moins une année. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée (20 heures hebdomadaires sur 18 mois au maximum) passé entre un employeur et le bénéficiaire du RMI. La charge de l'accueil des mineurs non accompagnés représente une dépense de un milliard d'euros, en 2017, pour les départements. D'autre part, et surtout, la loi n 2001-647 du 20 juillet 2001 a créé une allocation personnalisée d'autonomie (APA) destinée à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées. L'application de ce texte constitue une très lourde charge financière pour les départements qui ont la responsabilité de la gestion de l'allocation qui a nécessité des recrutements de personnels et parce que le Fonds créé pour son financement n'accorde aux départements qu'une partie de la prise en charge de l'APA. Il y avait plus d'un million de bénéficiaires au 31 décembre 2006 et, en 2003, la charge financière totale de l'APA représentait déjà une dépense se situant entre 3,6 et 3,9 milliards d'euros . Dans le même esprit, le département a désormais la responsabilité de l'animation du dispositif local d'insertion. Enfin, le département sera de plus en plus l'échelon d'exercice des er er er o 274 compétences décentralisées en ce qui concerne les handicapés. Ainsi la loi n 2005-112 du 11 février 2005 « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » met à la charge des départements la prestation de compensation pour les personnes handicapées ainsi que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) qu'elle crée, véritables guichets uniques au service de celles-ci. Si l'on ajoute le rôle du département en ce qui concerne la santé : lutte contre certains fléaux sociaux ; les vaccinations ; la protection maternelle et infantile etc., on voit l'ampleur de la tâche qui lui est dévolue en matière sociale et sanitaire. o 192 D. Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ◊ La 275 loi du 3 mai 1996 a opéré la départementalisation des services d'incendie et de secours, le service départemental étant appelé à fédérer l'ensemble des corps de sapeurs-pompiers et à se substituer, sauf exceptions, aux services communaux et intercommunaux . Il s'agit d'un service obligatoire pour le département, constitué sous la forme d'un établissement public (CGCT, art. L. 1424-1). La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a considérablement renforcé le poids du département dans la gestion du service mais aussi, et surtout, dans son financement . 276 277 193 E. Autres attributions ◊ – Le département a la charge de l'entretien des routes départementales. Cette charge s'est considérablement alourdie avec le transfert aux départements de 20 000 km de routes nationales, sur la base de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 ; on peut redouter qu'il s'agisse là, une fois de plus, d'un transfert de charges financières sur les départements, sous couvert de décentralisation. Le transfert de ces routes a entraîné, par voie de conséquence, le transfert d'une grande partie des personnels des services déconcentrés du Ministère des Transports et de l'Équipement (DDE) aux départements . – Depuis 1983 le département a la responsabilité de la construction et de l'entretien des collèges, ce qui constitue pour lui une charge financière importante. La loi du 13 août 2004 a transféré au département les personnels techniques, ouvriers et de service des collèges, le choix leur étant laissé de conserver leur statut de fonctionnaire de l'État ou d'opter pour celui de fonctionnaire territorial ; Parmi les autres compétences du département figurent notamment : – l'aménagement rural (équipement, remembrement, réorganisation foncière) ; 278 279 280 – les ports maritimes de commerce et de pêche ; – les soins aux aliénés ; – le tourisme (aménagement des itinéraires de randonnée) ; – des compétences en matière culturelle (bibliothèques centrales de prêt ; centralisation des archives locales) ; – la loi 2007-308 du 5 mars 2007, relative à la protection juridique des majeurs, fait également appel au département en ce qui concerne la « mesure d'accompagnement social personnalisé » . À l'instar du Conseil municipal, le Conseil départemental assure la gestion des biens et des intérêts du département. À cette fin, il décide des contrats à passer, des actions à intenter ou à soutenir, des travaux à faire. Parmi ces biens, un certain nombre d'immeubles, bien qu'affectés à des services d'État, sont placés dans le domaine du département, qui a ainsi la charge de leur entretien. Par ailleurs (L. 13 août 2004, art. 97), le département, au même titre que les autres collectivités territoriales, peut demander le transfert de monuments historiques de l'État. La loi de 2004 limitait cette possibilité aux monuments figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État ; cette restriction a été supprimée par la loi de finances pour 2010 . Le Conseil départemental possède quelques attributions extradépartementales ; il intervient, exceptionnellement, dans l'administration des communes (il statue, par exemple, sur le sectionnement électoral, v. ss 156). Le Conseil est appelé, par les textes, à donner des avis sur des matières concernant l'administration d'État. Chaque année, il entend le rapport du préfet sur l'activité des Services de l'État dans le département qui peut être suivi d'une discussion fructueuse. Enfin, à titre individuel, les conseillers départementaux participent à l'élection des sénateurs, ce qui leur confère une importance politique au plan national. 281 282 SECTION 2. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 283 Le transfert de la qualité d'organe exécutif du département du préfet au président du Conseil départemental est sans doute la réforme la plus spectaculaire apportée par la loi du 2 mars 1982. On étudiera successivement son élection (§ 1 ) puis ses attributions (§ 2). er § 1. Élection 194 Le Conseil départemental élit son président lors de la réunion qui suit son renouvellement. La majorité absolue est exigée aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième, la majorité relative suffit. Au cas d'égalité de voix, est proclamé élu le candidat le plus âgé. Les mêmes règles s'appliquent à l'élection des vice-présidents (v. ss 187). § 2. Attributions 195 Les attributions du président figurent aux articles L. 3221-1 s. CGCT. Le président prépare et exécute les délibérations du Conseil général. À ce dernier titre, le président exécute le budget, est l'ordonnateur des dépenses, le chef des services départementaux et de leurs agents ; il passe les contrats, représente le département en justice. Chargé de la gestion du domaine du département, il est habilité à exercer les pouvoirs de police inhérents à cette gestion, notamment en matière de circulation sur les dépendances domaniales . Aux termes de l'art. L. 3121-22 CGCT après l'élection de la Commission permanente le Conseil général peut déléguer à son président certaines attributions qu'il énumère. Il peut déléguer certaines de ses fonctions à des vice-présidents (CGCT, art. L. 3221-3). Le contrôle du conseil départemental sur son organe exécutif se manifeste : – par l'obligation faite au président d'adresser à chaque conseiller, huit jours avant les réunions, un rapport sur les affaires figurant à l'ordre du jour ; – par la présentation, chaque année, d'un rapport sur la situation du département, de ses services et de ses finances. Le rapport est suivi d'un débat. Pour l'exercice de ses attributions, le président dispose de services qui se sont étoffés avec la décentralisation de 1982 (ceux des bureaux de la préfecture nécessaires à l'exercice des attributions du président ont été, à la suite d'une convention entre lui et le préfet, placés sous son autorité exclusive : v. ss 127). Les transferts de compétences ont entraîné de profondes restructurations de l'administration départementale, par exemple pour l'équipement ou les affaires sociales (v. ss 193). Les services, qui sont organisés en directions, sont placés sous l'autorité d'un directeur général des services. Au moins au début de la décentralisation on a vu des préfets, ou d'autres membres du corps préfectoral, rejoindre les services des départements. Le président dispose d'un cabinet, composé d'un directeur, de conseillers techniques et de chargés de mission. 284 SECTION 3. LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 285 Il existait traditionnellement quatre départements d'Outre-Mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Un cinquième a été créé avec la L.O. 2009-969 du 3 août 2009 qui décide « qu'à compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011 la collectivité territoriale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'art. 73 C., qui prend le nom de “Département de Mayotte” et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer ». Mayotte est donc devenu le 101 département français le 31 mars 2011 jour de l'installation de son assemblée unique . On exposera ce que sont les grandes lignes de leur organisation administrative (§ 1), avant de voir les modifications apportées par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (§ 2). e 286 § 1. Le système antérieur à la loi du 28 mars 2003 196 287 Les quatre « vieilles colonies » ont été départementalisées par la loi du 19 mars 1946. Alors que pendant assez longtemps les DOM avaient présenté un très fort particularisme au regard de l'organisation des départements métropolitains, il faut souligner que, dès lors, celui-ci a très largement disparu. L'article 73 (initial) de la Constitution de 1958 déclarait : « Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'Outre-Mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière ». Ce texte est fort clair : il ne peut s'agir que de simples adaptations du régime de droit commun ; il n'y a place pour aucun particularisme. C'est d'ailleurs bien ainsi qu'il a été interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 1982 (loi portant adaptation de la loi du 2 mars 1982, p. 70) : le législateur avait prévu de substituer, dans les DOM, au Conseil général et au Conseil régional une assemblée unique élue à la représentation proportionnelle dans une circonscription unique ; le Conseil constitutionnel déclare cette disposition contraire à la Constitution car elle va au-delà d'une simple mesure d'adaptation puisque la nouvelle assemblée aurait été très différente des conseils généraux de métropole (sur cette décision v. la chronique de L. Favoreu, RD publ. 1983. 377). Sur le fond, il y a une extension des pouvoirs du préfet relatifs à la sécurité intérieure et extérieure, ainsi qu'à la tarification de certains produits. Les Conseils généraux doivent donner leur avis sur tout projet de loi ou de règlement ayant pour objet de procéder à l'adaptation de l'organisation administrative ou de la législation dans les DOM. Le Conseil général peut, de son propre chef, saisir le Gouvernement de propositions d'adaptation ou demander des dispositions spéciales pour les DOM. § 2. Les innovations de la loi du 28 mars 2003 197 288 La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 fait une large place aux problèmes de l'Outre-Mer qui sont l'objet d'une profonde rénovation. Le 1 alinéa de l'article 72-3 de la Constitution commence par situer les populations d'Outre-Mer dans la République : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'Outre-Mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Le second alinéa de cet article énumère, comme l'on dit maintenant, les « Outre-Mers » en ne reprenant pas la distinction classique entre départements d'Outre-Mer (DOM) et Territoires d'Outre-Mer (TOM). Le nouveau clivage distingue, d'une part les DOM et Régions d'Outre-Mer ensemble, et, d'autre part, les Collectivités d'Outre-Mer. La Nouvelle-Calédonie ne constitue pas une collectivité territoriale au sens de l'art. 72 Const. ; (CE, sect., 13 déc. 2006, M. Genelle, AJDA 2007. 363, chron. Lenica et Boucher). Les DOM (et ROM) sont régis par les dispositions de l'article 72-4 et 73 de la Constitution. On distinguera en ce qui les concerne le problème du changement de statut (A), de la modification des structures (B) et du régime juridique applicable (C). er 198 A. Le changement de statut ◊ Aux termes de l'article 72-4, 1 alinéa de la er Constitution, aucun changement de régime vers l'un ou l'autre de ceux prévus par les articles 73 et 74 – c'est-à-dire le passage au régime des DOM-ROM ou au régime des Collectivités d'Outre-Mer – ne peut se faire sans que le consentement des électeurs de la collectivité, ou de la partie de collectivité intéressée, ait été préalablement recueilli. L'opération se déroule alors en trois temps : – proposition du Gouvernement ; – consultation de la population ; – loi organique opérant le changement de statut. En application de ces dispositions la loi organique n 2007-223 du 1 février 2007 a érigé en Collectivités d'OutreMer deux communes de la Guadeloupe : Saint-Barthélemy et Saint-Martin . En revanche, par le référendum du 10 janvier 2010, la Martinique et la Guyane ont refusé le statut de Collectivité d'outre-mer (v. ss 131). À l'inverse, on vient de le voir, Mayotte, par le référendum du 29 mars 2009, a opté pour le statut de o er 289 département et région d'outre-mer. 199 B. Modification des structures ◊ L'article 73, 7 alinéa de la Constitution e concerne l'hypothèse où le législateur voudrait créer une collectivité nouvelle se substituant au département et à la région, ou qui, sans fusionner ces deux collectivités, créerait une assemblée délibérante unique pour celles-ci. Une telle réforme ne peut intervenir qu'avec le consentement des électeurs. On le sait, (v. ss 131) il a déjà été fait usage de cette possibilité. En effet, par décrets du 29 octobre 2003, le président de la République avait décidé de consulter les électeurs de la Martinique et de la Guadeloupe sur la création, dans chacun de ces territoires, d'une collectivité territoriale unique se substituant à la région et au département. Dans chacun de ces deux cas, la population a, par le référendum du 7 décembre 2003, rejeté la proposition qui lui était faite . Mais, par le référendum du 24 janvier 2010 la Martinique – modifiant donc sa position – et la Guyane ont voté pour la création d'une collectivité unique se substituant au département et à la région . À la suite de cette consultation la Martinique et la Guyane ont été rayées de la liste des départements d'Outre-Mer et leur statut, fort détaillé, est fixé par la loi n 2011884 du 27 juillet 2011 . 290 291 o 292 200 C. Le régime juridique ◊ L'article 73, 1 alinéa, Const. réaffirme le principe traditionnel : « Dans les départements et régions d'Outre-Mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. » L'adaptation pour tenir compte des « caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités » peut être le fait du législateur lui-même ou du pouvoir réglementaire. Mais l'adaptation peut également être le fait des collectivités, dans les matières où s'exercent leurs compétences, si elles y ont été habilitées par la loi. La demande doit en être faite par la collectivité concernée, l'habilitation n'étant pas possible lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. L'article 73, 3 alinéa, contient une innovation beaucoup plus audacieuse. En effet, pour tenir compte de leurs spécificités, et par dérogation à la disposition qui rend de plein droit applicables Outre-Mer les lois et règlements, les collectivités peuvent être habilitées à fixer elles-mêmes les règles applicables relevant du domaine de la loi, pour leur territoire . Il ne s'agit plus d'une simple adaptation ni même, comme en métropole, d'une expérimentation limitée 293 er e 294 dans le temps : il s'agit, bel et bien, de faire la loi. Ce pouvoir, bien sûr, fait l'objet d'importantes restrictions. Tout d'abord, la Constitution énumère une liste de matières exclues de cette faculté (droit civique, droit pénal, organisation de la justice…). D'autre part cette possibilité est exclue lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. À la demande d'un parlementaire réunionnais, rejetant ce qu'il appelle les « lois-pays », l'adaptation par les collectivités elles-mêmes et la possibilité de prendre en certaines matières des dispositions législatives est exclue en ce qui concerne la Réunion (art. 73, 5 al.). L'intention de l'auteur de cet amendement, qui a été voté, est de faire de la Réunion « un département français comme n'importe quel département métropolitain ». La loi organique n 2007-223 du 21 février 2007, portant dispositions statutaires relatives à l'Outre-Mer, est intervenue pour l'application des dispositions de l'article 73 de la Constitution . Comme toute loi organique ce texte a été examiné par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation (Cons. const. n 2007-547 DC, 15 févr. 2007, p. 60) : celui-ci en a déclaré deux dispositions contraires à la Constitution, mais, surtout, a énoncé de nombreuses réserves d'interprétation (v. ss 314) . Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ont fait l'objet d'une nouvelle loi organique, celle du 27 juillet 2011 , reconnue conforme à la Constitution à une réserve d'interprétation près . L'élection des conseillers à l'Assemblée de Guyane et à celle de la Martinique est régie par le décret n 2012-105 du 27 janvier 2012 . La loi 2015-1268 du 14 octobre 2015 « d'actualisation du droit des outremer » (JO 15 oct. 2015, texte n° 2) est un vaste « fourre-tout » sans aucune ambition . La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, contient un certain nombre de dispositions relatives à l'Outre-Mer . La loi du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales, pourrait constituer, selon la formule de Didier Blanc, « un nouvel instrument d'une diplomatie ultramarine ». e o 295 o 296 297 298 o 299 300 301 302 CHAPITRE 4 LA RÉGION 303 Section 1. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME RÉGIONAL Les premières ébauches La réforme de 1964 Le projet de réforme de 1969 La réforme de 1972 La loi du 2 mars 1982 La loi du 16 janvier 2015 Section 2. LES ASSEMBLÉES RÉGIONALES § 1. Le Conseil régional § 2. Le Conseil économique, social et environnemental régional Section 3. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL Section 4. LES RÉGIONS À STATUT PARTICULIER § 1. La Corse § 2. Les régions d'Outre-Mer La région est la dernière née de nos collectivités territoriales puisqu'elle n'a reçu la qualification de « collectivité territoriale » qu'en 1982 et qu'elle ne l'est devenue effectivement qu'en 1986, date de la première élection des conseils régionaux au suffrage universel. Mais, ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle les régions se sont imposées dans le paysage administratif français. On retracera l'évolution qui a conduit au système régional actuel (Section 1). La région, collectivité territoriale, comprend deux assemblées : le conseil régional et le conseil économique, social et environnemental régional (Section 2), ainsi qu'un exécutif, le président du Conseil régional (Section 3). Il y a également des régions à statut particulier (Section 4). SECTION 1. L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME RÉGIONAL § 1. Les premières ébauches 201 Si on laisse de côté le régionalisme de Vichy – qui rêvait d'un retour aux Provinces de l'Ancien Régime – les premières réalisations régionales sont intervenues pour les nécessités de la conduite de l'économie ; plus précisément la région est née des nécessités de la planification du développement économique et social et de l'aménagement du Territoire. Au moment de la préparation du 3 Plan de développement, on s'est rendu compte que le département était un cadre trop exigu pour la prospective économique. Le décret du 30 juin 1955 décida donc l'élaboration de « programmes d'action régionale » et pour cela un arrêté du 28 novembre 1956 divisa la France en 22 régions de programme. L'élaboration de ces programmes souleva d'ailleurs beaucoup de difficultés : en 1958, huit plans seulement étaient approuvés par le Gouvernement. Le décret du 2 juin 1960 pose le principe de l'harmonisation des circonscriptions des services extérieurs de l'État sur le découpage régional (v. ss 104) et le modifie en prévoyant 21 circonscriptions d'action régionale. e § 2. La réforme de 1964 202 Au moment de la préparation du 5 Plan (1966-1970) on se rendit compte qu'il ne suffisait pas d'avoir découpé le territoire en 21 circonscriptions ; encore fallait-il que celles-ci disposent de structures appropriées à leur action. On expérimenta donc une réforme régionale dans deux régions pilotes (v. ss 132), puis la réforme fut réalisée par un important décret du 14 mars 1964. On crée un préfet de région, qui est nécessairement le préfet du département chef-lieu de la région (v. ss 105) – afin de ne pas créer une administration supplémentaire – qui dispose d'un petit état-major : la mission régionale. On crée également une assemblée consultative, la Commission de développement économique régional (CODER), qui regroupe des politiques et des représentants des secteurs économiques et sociaux. La mission confiée au préfet de région est définie par l'article 2 du décret du 14 mars 1964 : mettre en œuvre la politique du gouvernement concernant le développement économique et l'aménagement du territoire. Mais la région n'a pas de budget propre. e § 3. Le projet de réforme de 1969 203 304 À partir de 1964, le problème de la région n'avait pas cessé d'être posé dans le débat politique. Le 24 mars 1968 le président de la République déclarait, à Lyon : « L'évolution générale porte, en effet, notre pays vers un équilibre nouveau. L'effort multiséculaire de centralisation, qui fut longtemps nécessaire pour réaliser et maintenir son unité malgré les divergences des provinces qui lui étaient successivement rattachées, ne s'impose plus désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales qui apparaissent comme les ressorts de la puissance économique de demain ». Dans cet esprit fut élaboré un projet de loi « relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat ». Il modifiait l'article 72 de la Constitution pour faire de la région une collectivité territoriale ; on conservait le découpage régional (donc les « petites » régions regroupant de 2 à 8 départements) ; une Assemblée unique comprenait les députés, des conseillers territoriaux et des socio-professionnels. Mais le projet était surtout important en ce qui concerne les pouvoirs de l'Assemblée : celle-ci recevait des pouvoirs de décision, elle votait le budget de la région alimenté par des ressources propres et elle réglait « les affaires de la région ». Le texte fut rejeté par le référendum du 27 avril 1969 non par hostilité envers la réforme régionale mais en raison de la « rénovation » du Sénat. § 4. La réforme de 1972 204 305 On aurait pu craindre que l'échec du référendum de 1969 entraîne la mise à l'écart, pour longtemps, de la réforme régionale. Ce n'est pas ce qui s'est produit mais le problème fut repris avec le régionalisme prudent et tempéré prôné par le Président Pompidou, ce qui aboutit à la loi du 5 juillet 1972 . Juridiquement la région n'est toujours pas une collectivité territoriale mais un établissement public, l'Établissement public régional, ayant donc la personnalité morale. En ce qui concerne ses organes on conserve, bien sûr, le préfet de région, mais la CODER fait place à deux assemblées : le Conseil régional et le Comité économique et social. Le Conseil régional est l'organe politique et a donc le pouvoir de décision ; il comprend trois séries de membres : – les parlementaires de la région ; – les représentants des collectivités locales, élus par les conseils généraux ; – les représentants des agglomérations. Le Comité économique et social, qui n'a qu'un pouvoir d'avis, représente les organismes et activités à caractère économique, social, professionnel, éducatif, scientifique, culturel et sportif de la région. Les attributions de la région, qui s'exercent dans le respect des attributions des départements et des communes, restent limitées au domaine économique et 306 social et consistent en études, propositions et participations à des financements. En revanche, et cela est important, le Conseil régional vote le budget de la région reposant sur des recettes fiscales propres (plafonnées à un certain montant). § 5. La loi du 2 mars 1982 Une étape importante est franchie avec la loi du 2 mars 1982 qui fait de la région une collectivité territoriale et décide le principe de l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel, qui ne sera organisée que par la loi du 10 juillet 1985, la première élection sur la base de ce texte ayant eu lieu le 16 mars 1986. § 6. La loi du 16 janvier 2015 205 La loi du 16 janvier 2015 a bouleversé la carte régionale de la France en réduisant le nombre des régions métropolitaines de 22 à 13, 6 de celles-ci conservant leur ancien périmètre, mais les 7 autres étant issues du regroupement de 16 anciennes régions (v. ss 104). Très malheureusement cette réforme si importante a été réalisée sans la moindre concertation, les régions n'ayant même pas été consultées sur leur future étendue. Un recours formé devant le Conseil d'État avait invoqué, non sans raison, sur cette question, l'exception d'inconventionnalité à l'encontre de la loi du 16 janvier 2015, comme contraire aux dispositions de la Charte européenne de l'autonomie locale élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe et approuvée par la France. En effet, l'article 5 de ce Traité dispose que « pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet ». Le Conseil d'État a rejeté le recours en estimant que cette disposition ne régit que les relations entre États signataires et ne produit donc pas d'effet direct à l'égard des particuliers qui ne peuvent donc pas l'invoquer (CE 27 oct. 2015, trois arrêts, AJDA 2015. 2005 et 2374, Chr. Dutheillet de Lamothe et Odinet). Autrement dit c'est le permis pour la France de violer en toute impunité les engagements qu'elle a pris en signant la Charte ! Le Conseil de l'Europe s'est ému de ce manquement. À l'heure actuelle, la région continue à être régie par la loi du 5 juillet 1972 modifiée, notamment, par la loi du 2 mars 1982 et les lois de décentralisation qui l'ont suivie, ainsi que par la loi du 16 janvier 2015 et par la loi NOTRe du 7 août 2015. Avant le 1 juillet 2016 le conseil régional des régions constituées par le regroupement de plusieurs anciennes régions devait voter une résolution comportant : – l'avis relatif à la fixation du nom définitif de la région ; – l'avis relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ; – l'emplacement de l'hôtel de la région ; – les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional. Sept décrets du 28 septembre 2016 ont fixé les noms et le chef-lieu des sept régions regroupant d'anciennes régions (la loi du 16 janvier 2015 avait fixé à Strasbourg le chef-lieu de la région désormais baptisée « Grand Est »). Le décret concernant l'Occitanie a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État : CE, ass., 19 juill. 2017, Association citoyenne « Pour Occitanie Pays Catalan », AJDA 2017. 1479, obs. de Montecler ; 1662, Chr. Odinet et Roussel. er SECTION 2. LES ASSEMBLÉES RÉGIONALES La région est la seule collectivité territoriale comportant deux assemblées : une assemblée délibérante, le Conseil régional (§ 1), une assemblée consultative, le Conseil économique, social et environnemental régional (§ 2). § 1. Le Conseil régional « Les régions sont administrées par un Conseil régional élu au suffrage universel direct » (CGCT, art. L. 4131-1). Les conseillers régionaux sont élus pou 6 ans ; ils sont rééligibles et les Conseils régionaux se renouvellent intégralement. L'élection a lieu en même temps que le renouvellement général des conseils départementaux (C. électoral, art. 336). On examinera successivement : – le mode d'élection (A) ; – le fonctionnement (B) ; – les attributions (C) du Conseil régional. 206 A. Mode d'élection ◊ On l'a vu (v. ss 181-182) la loi du 16 décembre 2010 avait prévu de faire siéger les conseillers territoriaux au conseil régional. Ce texte ayant été abrogé on en est revenu, pour l'élection du Conseil régional, au système de la loi du 11 avril 2003. Depuis 1985 on a modifié à deux reprises le mode d'élection du Conseil régional sans, malheureusement, trouver un système satisfaisant c'est-à-dire permettant de dégager des majorités « de gouvernement » au sein du conseil. La loi du 10 juillet 1985 prévoyait que les conseillers régionaux étaient élus dans chaque département de la région – ce qui n'était guère logique – au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les sièges étant répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Ce système s'était révélé assez catastrophique, notamment en 1988, car il empêchait trop souvent la constitution de majorités cohérentes pour l'administration des régions, avec toutes les conséquences que cela comporte. On avait donc remis l'ouvrage sur le métier en s'inspirant du système de la loi du 19 novembre 1982 utilisé pour les municipales mais en l'édulcorant. Tel fut l'objet de la loi du 19 janvier 1999. L'élection avait lieu à l'échelle de la région et non plus du département. Il s'agissait d'un scrutin de liste. Si, au premier tour, une liste obtenait la majorité absolue elle recevait seulement le quart des sièges arrondi à l'entier supérieur. Les autres sièges étaient répartis à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés. Sinon il y avait un deuxième tour auquel pouvaient se présenter les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages au 1 tour. Au 2 tour on utilisait le même système de répartition des sièges qu'au premier tour au bénéfice de la liste arrivée en tête. Un tel système ne permettait guère d'atteindre l'objectif que l'on se proposait. Le mode de scrutin a donc été, à nouveau, modifié par la loi du 11 avril 2003 , qui a soulevé de sérieuses polémiques lors de sa discussion au Parlement. Il reste un scrutin de liste à deux tours. Les listes continuent à être déposées au niveau régional mais elles comportent autant de « sections départementales » qu'il y a de départements dans la région. L'article 5 de la loi du 16 janvier 2015 fixe l'effectif des différents conseils régionaux (de 209 pour l'Ile de France à 77 pour le Centre) ainsi que le nombre de candidats par section départementale. Chaque liste doit respecter la stricte alternance des candidats de chaque sexe et comporter un nombre de candidats égal au nombre des conseillers à élire dans le département augmenté de deux (afin de pourvoir aux éventuelles vacances de sièges en cours de mandat). Quel que soit le département où il vote, l'électeur vote pour l'ensemble de la liste, c'est-à-dire que toutes les sections départementales doivent figurer sur le bulletin de vote ! Si, au premier tour de scrutin, une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés – ce qui est pratiquement une hypothèse d'école – elle reçoit le quart des sièges (arrondi à l'entier supérieur), à pourvoir au conseil régional. Les sièges restant étant répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Pour l'attribution du dernier siège, si plusieurs listes ont enregistré la même er 307 308 e moyenne, il revient à celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Ayant déterminé le nombre de sièges revenant à chaque liste, il reste à les répartir entre les sections départementales. Ceci se fait au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Si, par exemple, une liste a obtenu 20 sièges à l'échelle de la région, en recueillant la moitié de ses voix dans un département, 30 % de celles-ci dans un second département et 20 % dans un troisième département, la ventilation des sièges sera la suivante : 10 élus pour le premier département, 6 pour le second et 4 pour le troisième. S'il n'y a pas de résultat au premier tour de scrutin, se pose le problème des conditions exigées pour pouvoir se présenter au second tour. C'est sur cette question que la polémique avait fait rage. Après de multiples péripéties juridiques et la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2003 (n 2003468 DC, Rec. 325) il a été décidé que peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Dans cette décision du 3 avril 2003 le Conseil constitutionnel, se référant au principe d'intelligibilité de la loi avait souligné « la complexité que revêt ce mode de scrutin, s'agissant en particulier de la répartition des sièges entre sections départementales » et avait demandé au Gouvernement « de prévoir toutes dispositions utiles pour informer les électeurs et les candidats (sic) sur les modalités du scrutin et sur le fait que c'est au niveau régional que doit être appréciée la représentativité de chaque liste ». C'est ce que s'efforce de faire le décret 2004-30 du 9 janvier 2004. Il reste à préciser qu'il doit y avoir au moins deux listes au second tour (art. 4, loi 11 avril 2003) et que les candidats des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour, peuvent se reporter sur des listes du second tour. À l'issue du second tour, les sièges sont attribués selon le système qui a été exposé à propos du 1 tour de scrutin ; la prime du quart des élus allant à la liste qui a recueilli le plus de voix. Si, après cette répartition des sièges, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou deux sièges de la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la section départementale correspondante de cette liste. Il en va de même pour les départements de plus de 100 000 habitants s'ils ne comptent pas au moins quatre conseillers régionaux. Les conditions d'éligibilité, les incompatibilités, sont analogues à celles qu'on a rencontrées pour le conseil départemental (v. ss 182). Le contentieux de l'élection relève du Conseil d'État. o er 207 B. Fonctionnement ◊ Les règles sont calquées, pour l'essentiel, sur celles qui s'appliquent au conseil départemental (v. ss 187). Après l'élection de son Président (v. ss 210) le Conseil doit élire les Vice-présidents et la Commission permanente. Ces élections sont régies par l'art. 3 de la loi du 1 février 2007 qui organise un système d'une grande complexité et dont on ne décrira ici que les grandes lignes. Les membres de la Commission permanente sont élus selon un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne (sauf le cas où une seule liste a été déposée) ; mais les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe (et il a bien fallu prévoir l'hypothèse où un groupe ne disposerait pas de candidats de chaque sexe en nombre suffisant !). Le Conseil fixe ensuite le nombre des Vice-présidents (de 4 à 15 dans la limite de 30 % de l'effectif) et ceux-ci sont élus selon un scrutin de liste à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième. Le Conseil élabore son règlement intérieur et peut créer des commissions. Il se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, et en outre, à la demande de la Commission permanente , d'un tiers de ses membres, ou du gouvernement en cas de circonstances exceptionnelles. Tout membre d'un Conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le Conseil d'État. er 309 208 C. Attributions ◊ Traditionnellement le Conseil régional bénéficiait de la clause de compétence générale. : « Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région » Mais, comme pour le département, la loi NOTRe du 7 août 2015 l'a supprimée. Désormais « le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » (CGCT, art. L. 4433-1) . Comme le département, la région est maintenant une collectivité territoriale spécialisée à compétence d'attribution, même si celles-ci sont très importantes. Au départ (v. ss 201) la vocation de la région concernait presque exclusivement l'économie et l'aménagement du territoire. Son rôle en ces matières reste essentiel, mais il s'est très sensiblement élargi avec les lois du 2 mars 1982, 13 août 2014 et surtout la loi NOTRe du 7 août 2015. Désormais le Conseil régional a compétence : « pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des 310 311 communes » (CGCT, art. L. 4221-1, 2° al.). Tout simplement ! 1 Dans le domaine économique et l'aménagement du territoire . Dans ces secteurs l'art. 2 de la loi NOTRe consacre la région en tant que collectivité responsable de la définition des orientations en matière de développement économique et la charge d'élaborer le « Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation » (SRDEII), qui s'imposera aux autres collectivités sous l'angle de la compatibilité. Il définit les orientations en matière d'aide aux entreprises , de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier ainsi qu'à l'innovation des entreprises. Il organise la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec celles menées par les autres collectivités territoriales ou leurs groupements. Par ailleurs, la loi NOTRe procède à une clarification de la répartition des compétences en matière d'aide aux entreprises. La capacité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'octroyer des aides aux entreprises est strictement encadrée par ce texte . Les régions sont seules compétentes pour définir les aides et les régimes d'aide générale en faveur de la création ou de l'extension d'activités économiques ou des entreprises en difficulté. Le bloc communal (communes, EPCI à fiscalité propre et métropole de Lyon) est seul compétent pour définir les aides et leur régime à l'immobilier d'entreprises et le département n'a que des compétences résiduelles. Mais il y a des possibilités de délégations de compétences entre la région et soit le bloc communal, soit le département. Pour l'aménagement du territoire l'art. 10 de la loi NOTRe prévoit l'élaboration, par la région, d'un « Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires » (SRADDET) . Il a vocation à se substituer aux documents sectoriels régionaux tel, par exemple, que le schéma régional de cohérence écologique. Les modalités de son élaboration sont définies par délibération du Conseil régional. Il faut souligner l'importance de ce que l'on appelait depuis l'origine les contrats de plan « État-Régions », rebaptisés « contrats de projet » . Il s'agit de documents négociés entre l'État et les collectivités territoriales de la région, celle-ci jouant le rôle de chef de file. Le contrat fixe les objectifs à atteindre pendant la période qu'il couvre (les contrats actuels concernent la période 2014-2020) mais aussi, et surtout, les engagements financiers de l'État et des collectivités pour leur réalisation. Le Conseil d'État a reconnu à ces contrats le caractère de contrats administratifs (CE, Ass ; 8 janv. 1988, Communauté urbaine de Strasbourg, RFDA 1988. 25) ; mais un tel contrat n'emporte par luimême aucune conséquence directe (CE 25 oct. 1996, Assoc. Estuaire-Écologie, RFDA 1997. 339, concl. Stahl et note Madiot). 312 o 313 314 315 316 2 Le vote du budget. Le budget de la région a la même structure que celui des communes et des départements (v. ss 166). Il est alimenté par un certain nombre de ressources propres. Un débat d'orientation budgétaire a lieu dans les dix semaines précédant l'examen du budget. Le conseil régional établit son règlement budgétaire et financier. Le budget doit être voté en équilibre réel. 3 Les transports. La loi NOTRe transfère à la région les compétences des départements en matière de transports non urbains à compter du 1 janvier 2017. Pour les transports scolaires, le transfert des compétences des départements a eu lieu à compter du 1 septembre 2017. Il y a également la possibilité de transferts d'aérodromes de l'État et des ports départementaux. En ce qui concerne les transports ferroviaires régionaux , l'art. 67 de la loi du 4 février 1995 avait permis de tester, dans six régions, le transfert des lignes ferroviaires à la région. La loi du 13 décembre 2002 a décidé sa généralisation à toutes les régions. En dépit du bilan « mitigé » qu'en dresse la Cour des comptes (AJDA 2009. 2196) mon expérience m'a convaincu que ce transfert s'est révélé particulièrement heureux et a sauvé du désastre les lignes ferroviaires régionales . 4° Divers. Le Conseil a également compétence pour : – la construction et l'entretien des lycées et des établissements d'enseignement spécialisés ; la loi du 13 août 2004 (art. 82) confie aux régions le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service dans les lycées ; – l'art. 6 de la loi du 27 janvier 2014 prévoit que le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques ; – l'apprentissage et la formation professionnelle ; – certains équipements culturels (archives, bibliothèques, musées), ainsi que l'inventaire général du patrimoine culturel ; – l'art. 8 de la loi NOTRe prévoit qu'est élaboré, à l'initiative et sous la responsabilité du Président du Conseil régional, un « Plan régional de prévention et de gestion des déchets ». Il est établi en concertation avec les représentants des collectivités territoriales et est soumis à enquête publique ; – la création et la gestion de canaux et de ports fluviaux. Comme le département (v. ss 193) la région peut être candidate au transfert de monuments classés ou inscrits appartenant à l'État. o o er er 317 318 319 § 2. Le Conseil économique, social et environnemental régional 209 Il se compose de représentants des organismes et activités de la région dans les domaines économique, social, professionnel, familial, éducatif, scientifique, culturel et sportif. Les membres du CESER sont répartis en quatre collèges : les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées ; les représentants des organisations syndicales de salariés ; les représentants des organismes et associations agissant dans le domaine de l'environnement ; les personnalités concourant au développement de la région auxquelles le décret du 26 juillet 2017 ajoute des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ce même décret fixe les effectifs de chacun de ces collèges pour les 13 régions. Le mandat est de six ans, renouvelable. Le Conseil élit son bureau, se réunit en séances publiques, et se divise, pour l'étude des questions qui lui sont confiées, en sections, dont la liste est fixée par décret. Assemblée exclusivement consultative, « il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales » (CGCT, art. L. 4134-1). L'art. L. 4241-1 CGCT donne la liste des questions qui, outre le budget, doivent obligatoirement lui être soumises. . 320 SECTION 3. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL Depuis la loi du 2 mars 1982 le président du Conseil régional est substitué au préfet de région comme exécutif de la région, collectivité territoriale. 210 A. Élection ◊ Le mode de scrutin pour la désignation du président du Conseil départemental est le même que pour l'élection du maire et du président du Conseil départemental (v. ss 173) : scrutin majoritaire à trois tours, la majorité relative suffisant au 3 tour de scrutin. En cas d'égalité de voix c'est alors le plus âgé qui est élu . Mais, compte tenu de l'absence de majorité cohérente au sein de certains conseils régionaux, la loi du 7 mars 1998 a voulu faciliter la constitution d'une majorité autour du président. À cette fin « Nul ne peut être élu président, s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du Conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat » (CGCT, art. L. 4133-1). Les fonctions de Président du Conseil régional sont incompatibles avec le mandat de député ou de sénateur. Le président est également astreint au dépôt e 321 d'une déclaration de patrimoine. 211 B. Attributions ◊ Les attributions du Président du Conseil régional sont tout à fait similaires à celles du président du Conseil départemental (v. ss 195). Après l'élection de la Commission permanente, le Conseil peut lui déléguer l'exercice de certaines de ses attributions en vertu de l'article L. 42215 CGCT. Comme le président du Conseil départemental il est chargé, à l'égard du Conseil, de la préparation et de l'exécution de ses délibérations. Dans cette tâche il est assisté par des vice-présidents qui peuvent recevoir délégation. Les rapports du Président avec le Conseil sont régis par les mêmes règles que celles applicables dans le cadre du département. Le président a autorité sur les personnels de la région. Le transfert sous l'autorité du président des services de la préfecture nécessaires à l'exercice de ses attributions a été, comme pour le département, réglé par convention. SECTION 4. LES RÉGIONS À STATUT PARTICULIER Si l'on excepte la région parisienne, qui sera étudiée au chapitre suivant, la Corse (§ 1) et les régions d'Outre-Mer (§ 2) ont un statut particulier. § 1. La Corse L'article 30 de la loi NOTRe crée, à compter du 1 janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l'art. 72 de la Constitution, la « Collectivité de Corse » qui se substitue à la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. On rappellera les très grandes lignes du système antérieur avant d'évoquer le droit positif c'est-à-dire celui mis en place à compter du 1 janvier 2018. er er 212 A. Le système Corse jusqu'au 1 janvier 2018 ◊ L'article 1 de la loi er er du 13 mai 1991 voulait présenter le « peuple corse » comme une « composante du peuple français ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 mai 1991 (Rec. 50), a jugé que cette formule, mettant en cause l'unité du peuple français et l'indivisibilité de la République, était contraire à la Constitution. La Corse comportait trois organes : – une Assemblée élue pour six ans, la Corse constituant pour son élection une circonscription électorale unique ; – un Conseil exécutif élu par l'Assemblée ; – un Conseil économique, social et culturel. Le texte de loi voté par le Parlement prévoyait que le Parlement pouvait autoriser la collectivité territoriale Corse à procéder à des expérimentations comportant des dérogations aux règles législatives en vigueur. Dans sa décision du 17 janvier 2002 , le Conseil constitutionnel a jugé que cette possibilité donnée à la Corse de prendre des mesures relevant du domaine de la loi était contraire à la Constitution, ce qui est difficilement contestable. On l'a vu (v. ss 136), cela a entraîné la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui, sous certaines conditions, autorise, à titre expérimental, à déroger à la loi. Le décret du 1 août 2003 transférait un certain nombre de services de l'État à la collectivité territoriale de Corse. 322 er 213 B. Le système applicable à compter du 1 janvier 2018 ◊ Aux termes er de l'art. L. 4421-1 CGCT : « La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées au présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres 1 à III de la présente partie et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ». En effet, l'art. 72 de la Constitution, suite à la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, permet de réunir au sein d'une « collectivité à statut particulier » une région et les départements qu'elle comprend (v. ss 131). Rappelons, cependant, que par le référendum du 6 juillet 2003, les Corses avaient refusé la création d'une telle collectivité. L'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 (JO 22 nov. 2016, texte n° 18) porte diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et fait l'objet d'un Rapport au président de la République qui la précède (JO 22 nov. 2016, texte n° 17). La Corse comprend l'Assemblée de Corse, un Conseil exécutif et le Conseil économique, social et culturel de Corse (CGCT, art. L. 4422-1). 1° L'Assemblée de Corse. Elle comprend 63 membres qui sont rééligibles. Pour leur élection la Corse forme une circonscription électorale unique. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes. Au premier tour de scrutin il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages, les autres sièges étant répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages. Sinon on procède à un second tour selon les mêmes modalités (C. élect., art. L. 366). L'élection de la première Assemblée de Corse a eu lieu les 3 et 10 décembre 2017. La liste nationaliste a obtenu 56,5 % des voix (mais avec une abstention de 47 %) et les élus de cette er mouvance détiennent 41 des 63 sièges. Il resterait à préciser ce que recouvre exactement le concept « d'autonomie » dont ils se réclament. L'Assemblée élit son Président à la majorité absolue aux deux premiers tours du scrutin, à la majorité relative au troisième. « L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le Conseil exécutif » (CGCT, art. L. 4422-15). 2° Le Conseil exécutif. Le Conseil exécutif de Corse comprend 11 conseillers élus par l'Assemblée parmi ses membres. Ils sont élus au scrutin de liste et le Président est le candidat figurant en tête de liste. Le mandat de conseiller à l'Assemblée est incompatible avec les fonctions de conseiller exécutif. Le Conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, notamment dans les domaines économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace. Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en œuvre le « Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse » (CGCT, art. L. 4422-24). 3° Le Conseil économique, social et culturel de Corse. Il assiste l'Assemblée et le Conseil exécutif et son effectif ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections : une section économique et sociale ; une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie. L'article L. 4422-36 et 37 du CGCT énumère les affaires sur lesquelles il doit obligatoirement être consulté. L'art. L. 4421-3 CGCT crée une « Conférence de coordination des collectivités territoriales » qui se substitue à celle de l'art. L. 1111-9-1 CGCT. § 2. Les régions d'Outre-Mer 214 Le particularisme des régions d'Outre-Mer provient, en partie, du fait qu'il s'agit de régions mono-départementales. Le Gouvernement avait voulu en tirer les conséquences en faisant voter une loi substituant (à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion) au Conseil général et au Conseil régional, une assemblée unique élue dans une circonscription unique. Le Conseil constitutionnel avait estimé que ce texte était contraire à la Constitution (Cons. const. 2 déc. 1982, Rec. 70) car dépassant le stade de la simple adaptation prévue par la Constitution. Ceci est possible désormais, sur la base de loi constitutionnelle du 28 mars 2003, et, on l'a vu (v. ss 199) la Martinique et la Guyane ont adopté ce système. Le régime des régions d'Outre-Mer a été fixé par la loi du 31 décembre 1982, modifiée notamment par la loi du 6 janvier 1986, les attributions des régions d'Outre-Mer étant fixées par la loi du 2 août 1984. En ce qui concerne leur organisation il n'y a qu'une seule particularité : il y a, auprès du Conseil régional, deux assemblées consultatives : – le Comité économique et social ; – le Comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Les attributions des régions sont plus larges qu'en métropole. Ainsi, le schéma d'aménagement régional comporte des dispositions relatives à la destination des sols. La région a en charge, notamment, la mise en valeur des ressources de la mer et des ressources minières. Pour l'exercice de ses attributions, elle peut créer des agences, qui sont des établissements publics. Ce qui est le plus remarquable c'est que la région peut intervenir dans les relations internationales . En effet, elle peut être saisie, pour avis, de projets d'accords de coopération intéressant la zone géographique où elle se trouve. En ce qui concerne l'application des lois dans la région, leur adaptation, ou la possibilité de fixer des règles législatives propres à la région, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi organique du 21 février 2007 fixent exactement les mêmes règles que pour les DOM (v. ss 200). 323 CHAPITRE 5 LES COLLECTIVITÉS À STATUT PARTICULIER 215 Section 1. § 1. § 2. § 3. § 4. PARIS ET LA RÉGION D'ÎLE DE FRANCE L'évolution Les collectivités de la région parisienne Le régime de Paris L'administration régionale Section 2. § 1. § 2. § 3. LES RÈGLES COMMUNES À PARIS, LYON ET MARSEILLE Les organes de l'arrondissement Les moyens de l'arrondissement Le régime électoral applicable à Paris, Lyon et Marseille Vue d'ensemble ◊ On a déjà relevé l'uniformité traditionnelle de l'organisation administrative des collectivités territoriales (v. ss 152). Mais il existe depuis longtemps des situations qui s'accommodent mal du régime de droit commun et pour lesquelles des textes spécifiques sont nécessaires. À situation particulière, régime juridique particulier. Cette dérogation au droit commun est restée fort limitée en ce qui concerne les régions et les départements. Pour les premières, si l'on excepte le cas, à tous égards, fort particulier de la Corse, la diversification ne s'opère qu'en ce qui concerne l'Outre-Mer. Il en va de même pour les départements. Mais en ce qui concerne le régime municipal, les dérogations sont plus nombreuses et plus importantes. Il y a surtout les problèmes de l'agglomération parisienne qui ont entraîné, dans leur sillage, les villes de Lyon et de Marseille. Jusqu'à 1982, seules la ville et la région de Paris faisaient l'objet, parmi les collectivités décentralisées, d'un statut particulier. Celui-ci a été modifié par deux lois importantes du 31 décembre 1982 , ainsi que par la loi du 28 février 2017 et l'ordonnance du 8 février 2018. 324 L'ensemble de cette évolution s'est fait dans deux directions apparemment inverses. D'une part, le droit commun a fini par remplacer, pour Paris, le régime dérogatoire qu'elle avait longtemps connu. De même c'est le droit commun des régions qui s'est finalement appliqué à la région île de France. Mais, d'autre part, en sens inverse, le droit commun, dans les deux cas, laisse place à des dérogations importantes. Initialement celles-ci ne devaient concerner que la seule ville de Paris et, plus spécialement, les pouvoirs du maire de Paris. Pour apaiser les soupçons d'ordre politique qu'elles suscitaient – on est en 1982 et le maire de Paris est Jacques Chirac – elles ont été étendues, au moins en partie, à deux métropoles régionales, Lyon et Marseille. Il y a donc à la fois, pour ces collectivités, confirmation de la tradition administrative qui privilégiait l'uniformité du statut de chaque catégorie de collectivités et, à l'opposé, application de la tendance récente à différencier ce statut en fonction des situations concrètes et des dimensions des collectivités. Par ailleurs, et surtout, en dehors de leur régime municipal particulier les agglomérations de Paris, Lyon et Marseille ont fait l'objet de très importantes réformes avec la création, par la loi du 27 janvier 2014, de la Métropole du Grand Paris, de la Métropole de Lyon et de la Métropole d'Aix-MarseilleProvence. On les étudiera à propos de l'examen des établissements publics permettant le regroupement de collectivités territoriales (Sous-Titre 2, Chapitre 2 de la présente partie). On étudiera ici, d'une part les règles qui restent propres à Paris et à sa région (Section 1), d'autre part les règles communes à Paris, Lyon et Marseille (Section 2). SECTION 1. PARIS ET LA RÉGION D'ÎLE DE FRANCE 325 § 1. L'évolution 216 A. Le problème ◊ Il est double, politique d'une part, humain et économique d'autre part. Le problème politique, seul perçu jusqu'à une époque récente, est né de l'histoire. Paris, capitale de la France, est le siège des pouvoirs publics. Or, les révolutions, depuis 1789, ont toutes été, au départ, des révolutions parisiennes. Soucieux de durer, les divers régimes avaient donc refusé de donner à Paris une organisation municipale puissante, qui eût pu se poser en rivale des gouvernements, et surtout, d'abandonner à des autorités décentralisées le maintien de l'ordre dans la capitale ; par là s'expliquaient les particularités du régime municipal de Paris, et du régime de l'ancien département de la Seine. Le problème humain et économique est posé par l'agglomération parisienne. Elle forme un vaste ensemble de plus de douze millions d'habitants. Les questions qu'elle pose appellent des solutions d'ensemble. Or, l'agglomération n'avait pas d'unité administrative : elle relevait d'un grand nombre de communes, de plusieurs départements, ce qui interdisait toute unité de vue ; unité d'autant plus indispensable que le développement de l'agglomération parisienne est un phénomène d'importance nationale, et qu'il y a, dans sa croissance désordonnée, un risque grave pour l'équilibre du pays. Le tracé traditionnel des circonscriptions de la région parisienne (départements et arrondissements) ne répondait d'ailleurs plus à la situation démographique et économique, et aboutissait à la sous-administration de nombre de secteurs où se posent, pourtant, des problèmes administratifs aigus. 217 B. Les solutions ◊ 1 Contre la crainte historique d'un pouvoir parisien o susceptible de balancer le prestige des autorités nationales, un mouvement d'opinion réclamait depuis longtemps, au nom de la logique démocratique, l'application à Paris du droit municipal commun. C'est ce mouvement qui a inspiré, dans une large mesure, la loi du 31 décembre 1975, entrée en vigueur lors des élections municipales de 1977, qui a donné un maire à Paris. La tradition antérieure et la spécificité de la situation parisienne ont conduit cependant à maintenir au statut de Paris un certain particularisme, qui subsiste, bien qu'atténué, dans la loi du 2 mars 1982. 2 L'évolution, en ce qui concerne la région parisienne est plus récente. Mais elle s'est faite, comme la précédente, dans le sens d'un retour au droit commun. Le district de Paris, créé en 1959, devenu en 1961 District de la Région parisienne, était un établissement public appelé à une tâche de coordination. En 1964, un nouveau découpage des départements entourant Paris a eu pour but de remédier à la sous-administration de la banlieue. Un décret de 1966 a étendu la réforme régionale réalisée en 1964 pour le reste de la France (v. ss 202) à la région parisienne, qui s'ajoutait ainsi aux 21 régions déjà créées ; le District devenait, sous l'autorité du préfet de région, l'instrument d'étude et de réalisation de la politique régionale. L'alignement sur le droit commun est plus net encore avec la loi du 6 mai 1976, jumelle de la loi du 31 décembre 1975 réformant le statut de Paris : la région d'Ile-de-France (RIF), sous ce nom nouveau, est un établissement public dont les organes et les attributions sont voisins de ceux dont la loi de 1972 (v. ss 204) a doté les autres régions. La réforme a entraîné la suppression du District. Enfin, la loi du 2 mars 1982 a étendu à l'Ile-de-France la quasi-totalité des réformes apportées au statut des autres régions, réduisant ainsi à très peu de choses o son particularisme. § 2. Les collectivités de la région parisienne 218 1 Elle comprenait initialement : a) La ville de Paris, subdivisée depuis le XIX siècle en 20 arrondissements (à ne pas confondre avec les arrondissements départementaux, v. ss 114). b) Le département de la Seine, qui englobait, avec Paris, les communes de la proche banlieue. c) Le département de Seine-et-Oise et une partie de la Seine-et-Marne. Ces deux départements, et les communes qui les composent, étaient en principe soumis au droit commun. Par contre, Paris et la Seine obéissaient à un régime propre, qui se caractérisait par une centralisation accusée, et par une confusion partielle de leur administration. Paris élisait un Conseil municipal dont les compétences étaient limitativement énumérées. Son président, élu, n'avait ni le titre de maire, ni les compétences correspondantes. Son rôle se bornait à la présidence des séances. Le Conseil général de la Seine, comprenant les conseillers municipaux de Paris plus les élus des secteurs suburbains, exerçait sa compétence sur l'ensemble du département, Paris inclus. Les fonctions d'exécution étaient partagées, en ce qui concerne tant les délibérations du Conseil général de la Seine que celles du Conseil municipal de Paris, entre deux représentants de l'État, le préfet de la Seine investi, pour Paris, de l'ensemble des fonctions administratives dévolues ailleurs au maire, sauf la police, et le préfet de police, celui-ci exerçant à Paris l'ensemble des pouvoirs de police des maires, et dans les communes de la Seine, la police du maintien de l'ordre, les maires de ces communes conservant les autres attributions de police. 2 La loi du 10 juillet 1964 : a) Supprime les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. b) Répartit leurs territoires entre six départements nouveaux (Hauts-deSeine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise), soumis au droit commun, tel qu'il a été décrit (v. ss 179 s.). c) Fait de la ville de Paris, qui cesse d'être incluse dans un département, « une collectivité territoriale à statut particulier », à la fois commune et département, cumulant des compétences communales et départementales, exercées par le Conseil de Paris, qui succède au conseil municipal et au conseil général de la Seine, le Préfet de Paris (ancien préfet de la Seine) et le Préfet de police. 3 La loi du 31 décembre 1975, modifiant cette dernière solution, instaure, o e o o sur le territoire parisien, deux collectivités territoriales juridiquement distinctes, bien que gérées par la même assemblée élue : la commune de Paris et le département de Paris. 4 Ce sont ces collectivités – Paris, et les six nouveaux départements auxquels s'ajoute la Seine-et-Marne que la réforme de 1964 a laissé subsister – qui forment la région d'Ile-de-France. Dans cet ensemble, seuls les régimes de Paris et celui de la région présentent, par rapport au droit commun, certaines particularités. 5° La loi du 28 février 2017 a changé le statut de la Ville de Paris, en faisant de celle-ci « une collectivité à statut particulier » se substituant à la Ville et au Département de Paris. Mais cette nouvelle str...
Liens utiles
- DROIT ADMINISTRATIF - cours complet
- Droit administratif: le service public
- droit administratif: Les actes juridiques de l’administration sont-ils toujours unilatéraux ?
- 3 exo de droit administratif corrigés
- l'acte détachable et la nullité du contrat en droit administratif