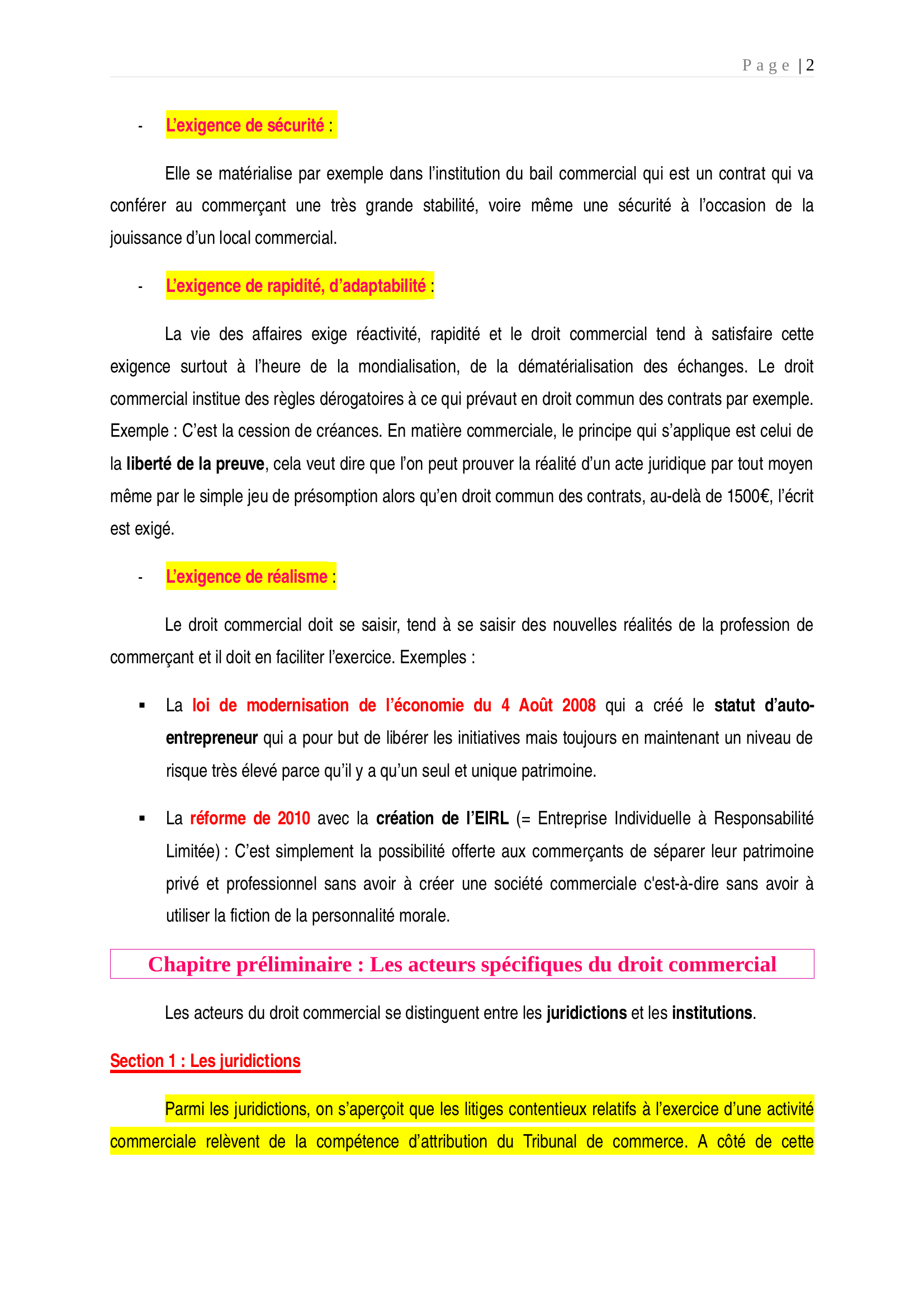Droit commercial Examen : 1 ou 2 questions de cours + 1 cas pratique Définition : Le droit commercial est la branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants soit entre eux soit avec leurs clients. Ce droit tend à couvrir la plus grande partie de l'activité économique puisqu'il va régir les activités de distribution de produits, de fabrication, toutes les activités relevant des prestations de service à caractère commercial à l'exclusion des activités agricoles, à l'exclusion des activités libérales, à l'exclusion des activités civiles et à l'exclusion des artisans. Les sources du droit commercial : Pendant longtemps, les sources du droit commercial relevaient des usages et de la coutume entre commerçants et puis en 1807, ce droit a été codifié et a été recodifié à droit constant en 1999. Parmi ses sources, aujourd'hui, on identifie les dispositions du Code de commerce mais aussi et surtout, le droit commun, le droit civil à savoir les dispositions du Code civil tout simplement parce que le droit commercial est un droit dérogatoire aux règles du Code civil qui tend à s'appliquer dès lors qu'une disposition du Code de commerce ne régit pas le cas de figure envisagé. Autrement dit, dans le silence du Code de commerce, c'est le Code civil qui régit. En cas de confrontation entre le Code de commerce et le Code civil, ce sont les dispositions du Code de commerce qui s'appliquent. A côté de ces dispositions législatives, il y a la jurisprudence des Tribunaux de commerce et les usages. Les Tribunaux de commerce sont des juridictions spécialisées composées de juges consulaires c'est-à-dire de juges élus par les commerçants. Les usages sont ceux du commerce international, c'est par exemple incoterms qui sont des usages qui ont cours dans le cadre des échanges internationaux entre commerçants. Ces usages sont sanctionnés par les Tribunaux de commerce lorsqu'ils sont violés. L'esprit du droit commercial : Le droit commercial, c'est un droit pragmatique qui cherche à faciliter l'exercice des affaires, c'est un droit qui est au service des commerçants tout simplement parce que derrière il y a l'intérêt général, l'intérêt de l'économie française. Le droit commercial essaie de remplir certaines exigences qui sont au nombre de trois : L'exigence de sécurité : Elle se matérialise par exemple dans l'institution du bail commercial qui est un contrat qui va conférer au commerçant une très grande stabilité, voire même une sécurité à l'occasion de la jouissance d'un local commercial. L'exigence de rapidité, d'adaptabilité : La vie des affaires exige réactivité, rapidité et le droit commercial tend à satisfaire cette exigence surtout à l'heure de la mondialisation, de la dématérialisation des échanges. Le droit commercial institue des règles dérogatoires à ce qui prévaut en droit commun des contrats par exemple. Exemple : C'est la cession de créances. En matière commerciale, le principe qui s'applique est celui de la liberté de la preuve, cela veut dire que l'on peut prouver la réalité d'un acte juridique par tout moyen même par le simple jeu de présomption alors qu'en droit commun des contrats, au-delà de 1500EUR, l'écrit est exigé. L'exigence de réalisme : Le droit commercial doit se saisir, tend à se saisir des nouvelles réalités de la profession de commerçant et il doit en faciliter l'exercice. Exemples : La loi de modernisation de l'économie du 4 Août 2008 qui a créé le statut d'auto-entrepreneur qui a pour but de libérer les initiatives mais toujours en maintenant un niveau de risque très élevé parce qu'il y a qu'un seul et unique patrimoine. La réforme de 2010 avec la création de l'EIRL (= Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée) : C'est simplement la possibilité offerte aux commerçants de séparer leur patrimoine privé et professionnel sans avoir à créer une société commerciale c'est-à-dire sans avoir à utiliser la fiction de la personnalité morale. Chapitre préliminaire : Les acteurs spécifiques du droit commercial Les acteurs du droit commercial se distinguent entre les juridictions et les institutions. Section 1 : Les juridictions Parmi les juridictions, on s'aperçoit que les litiges contentieux relatifs à l'exercice d'une activité commerciale relèvent de la compétence d'attribution du Tribunal de commerce. A côté de cette compétence d'attribution, on identifie les tribunaux d'arbitrages, les juridictions arbitrales qui peuvent être désignés par les parties au litige afin de trancher le contentieux. §1) Les tribunaux de commerce Aux termes de l'Article L411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, les Tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur toute contestation relative aux engagements entre commerçants, aux actes de commerce, au fonctionnement des sociétés commerciales et en matière de procédure collective. Cette compétence est une compétence d'attribution fixée par la loi, par les dispositions du Code et le Tribunal de commerce ne peut jamais statuer en dehors de cette compétence. Le Tribunal de commerce ne peut jamais statuer en dehors de sa compétence territoriale, en effet il faut que la société ait son siège dans le ressort du Tribunal de commerce. Ce Tribunal de commerce est une juridiction très particulière parce qu'elle composée de juges consulaires qui sont des magistrats élus par leurs pairs, non professionnels. Pour quelles raisons a-t-on opté pour cette composition ? Ils connaissent bien la vie des affaires, les contraintes qui pèsent sur les commerçants, ils sont à même de rendre une justice plus efficace, pragmatique mais la question de l'indépendance pose problème. En 1999, on a tenté d'introduire un magistrat professionnel au sein de ces juridictions par un projet de réforme mais tous les juges consulaires ont démissionné en cours de mandat. A l'heure actuelle, les Tribunaux de commerce sont toujours exclusivement composés de juges consulaires. Un deuxième risque se présente quant à la compétence des juges consulaires qui sont confrontés à des éléments techniques. Ces Tribunaux de commerce sont amenés à trancher les litiges en premier ressort. Cela veut dire que pour tous les litiges supérieurs à 4000EUR, l'une des parties ou les deux parties peuvent interjeter appel devant la Cour d'appel et là ce seront des magistrats de carrière qui seront amenés à trancher le litige en appel. La procédure devant ces juridictions est simplifiée, est allégée, d'une part le ministère d'avocat n'est pas obligatoire c'est-à-dire que le commerçant peut se présenter seul à l'audience et défendre sa cause tout seul et d'autre part, la procédure est orale (on peut s'en tenir à des explications orales). Ces juges consulaires ont une compétence d'attribution qui n'est pas d'ordre public, on peut donc y déroger par le biais du contrat et notamment en insérant une clause d'arbitrage qui désigne un Tribunal arbitral. §2) Les arbitres C'est quelque chose qui se développe beaucoup. C'est l'Article L411-4 du Code de commerce qui prévoit, qui offre la possibilité aux parties de donner compétence à une juridiction composée de tiers c'est-à-dire une juridiction non étatique pour trancher le litige. C'est vraiment une autre spécificité du droit commercial afin de répondre aux exigences de rapidité de la vie des affaires. Qu'est-ce que l'arbitrage ? L'arbitrage consiste à faire trancher le litige par de simples particuliers qui sont le plus souvent des experts choisis en raison de leur compétence. L'intérêt visé par les parties est la discrétion, l'autre avantage est que l'on peut aménager la procédure et limiter les voies de recours. On peut très bien préciser que la sentence arbitrale est rendue en premier et dernier ressort et la possibilité d'interjeter appel est écartée. L'inconvénient principal de l'arbitrage est le coût. Alors que la justice est gratuite, il faudra payer les arbitres et cela coûte extrêmement cher. Les deux voies d'accès à cette justice arbitrale sont : La clause compromissoire : Avant la survenance de tout litige, on prévoit dans le contrat par l'insertion d'une clause compromissoire de désigner une juridiction arbitrale et on renverra le plus souvent à la compétence d'une institution arbitrale telle que la CCI (= Chambre du Commerce International). Le médiateur essaye de trouver un compromis tandis que l'arbitre a pour mission de trancher le litige, on parle de sentence arbitrale et on peut recourir à l'exécution forcée. Cette clause compromissoire peut être insérée dans tous les contrats conclus entre commerçants en raison de leur activité professionnelle. Pendant longtemps, cette clause compromissoire était réservée aux seuls commerçants. La loi du 15 Mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a étendu cette possibilité, cette faculté à tous les professionnels en ce qui concerne les contrats conclus en raison de leur activité professionnelle. Par contre, on ne peut pas insérer une clause compromissoire dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel. Si c'est le cas, cette clause sera frappée de nullité. Le compromis : La possibilité d'insérer une composition arbitrale par la voie du compromis c'est-à-dire qu'après la survenance du litige, les parties désignent une juridiction arbitrale afin de trancher le litige et dérogent ainsi à la compétence d'attribution des Tribunaux de commerce. Le compromis peut être signé par un non-professionnel à la différence de la clause compromissoire. C'est l'Article 1447 du Code de procédure civile qui prévoit le compromis. Une fois que le Tribunal arbitral est saisi, il va rendre une sentence arbitrale et pour que cette sentence soit appliquée sur le territoire, pour qu'elle devienne exécutoire, il faut obtenir l'exequatur c'est-à-dire l'aval, l'autorisation du juge de l'exécution. A partir du moment où l'exequatur est obtenue, la sentence arbitrale devient exécutoire. Section 2 : Les institutions administratives Ce sont celles qui vont faciliter l'exercice de la profession de commerçant, elles vont poursuivre parfois la mission d'information des tiers. On en distingue quatre à savoir le registre du commerce et des sociétés, les centres de formalité des entreprises, les chambres de commerce et de l'industrie et l'Institut National de la Propriété Industrielle. §1) Le registre du commerce et des sociétés (RCS) Le registre concerne à la fois les commerçants-personne morale et les commerçants-personne physique. Au-delà de l'immatriculation, il contient tous les actes relatifs à la vie des commerçants. Quels peuvent être les actes les plus importants ? Les cessions-part, la modification des statuts, la démission d'un gérant, l'augmentation du capital, le redressement judiciaire. Quel est l'objectif de ce registre ? Toutes ces informations sont mises en ligne sur www.infogreffe.fr. Le registre du commerce et des sociétés a pour fonction sociale d'informer les tiers. C'est un registre officiel tenu par le greffier du Tribunal de commerce qui est un officier ministériel comme les notaires. C'est également un registre public (toute personne y a accès) qui a été créé en 1919, au départ seuls les commerçants étaient tenus de s'y immatriculer puis suite à la réforme de 1978, l'obligation d'immatriculation pèse désormais sur toutes les sociétés commerciales et les sociétés civiles (ainsi, les sociétés civiles ou immobilières sont toutes immatriculées au RCS). Toute personne ayant un statut de commerçant et réalisant une activité commerciale sur le territoire doit être enregistrée au RCS. Sa deuxième fonction est une fonction de police administrative tout simplement parce que le greffier va vérifier la régularité des actes qui vont être déposés et il va vérifier surtout que le commerçant qui s'y immatricule n'est pas frappé d'une interdiction d'exercer le commerce. Dans quelles circonstances peut-on être frappé d'une telle interdiction d'exercer le commerce ? C'est lorsque le gérant a commis des fautes de gestion extrêmement graves. Le RCS va également vérifier que le commerçant est majeur. §2) Les centres de formalité des entreprises On les retrouve sur internet. Ces centres ont été créés afin de faciliter la création d'entreprises et de simplifier les démarches administratives des commerçants. En fait, il s'agit en un même lieu et sur un même document de procéder à l'ensemble des déclarations auxquelles sont assujettis les commerçants et notamment auprès des organismes sociaux, du RCS etc. §3) Les chambres de commerce et d'industrie Ce sont des établissements publics économiques gérés par des commerçants élus par leurs pairs dont la mission principale est de gérer, de promouvoir les infrastructures essentielles à la vie des commerçants (port, aéroport). Exemple : On peut mettre en place, lancer un projet de construction de l'aéroport. La deuxième mission, plus en relation avec le droit commercial, est que ces chambres de commerce et d'industrie sont amenées à délivrer des parères c'est-à-dire des attestations destinées à établir l'existence d'un usage propre à une profession commerciale dans une zone géographique déterminée. §4) L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) Quelle est la mission de l'INPI ? L'INPI est un établissement public qui a vocation à enregistrer les marques déposées par les commerçants et les marques sont tous les signes distinctifs (un slogan, un son à condition qu'il s'agisse d'une partition) destinées à individualiser les produits ou services d'une entreprise. Il faut déjà vérifier que ce signe ne soit pas utilisé par une autre société et une fois que ce signe est déposé, ce monopole est valable 10 ans. Cette protection est donc renouvelable indéfiniment sous réserve de payer tous les 10 ans une taxe d'enregistrement. A côté de cela, il y a les brevets d'invention délivrés par l'INPI. Qu'est-ce qu'un brevet d'invention ? Le brevet d'invention est un monopole d'exploitation, ce qui donne le droit d'exclure un tiers de l'exploitation. Ce sont les droits conférés à l'inventeur d'exclure les tiers de la jouissance de son invention et à ce titre, l'inventeur va interdire la détention, la fabrication, l'importation, l'exportation à des fins commerciales de son invention. Dans les droits de la propriété industrielle, les dessins et modèles sont des droits qui portent sur le design d'un produit. TITRE 1 : LA DELIMITATION JURIDIQUE DE LA SPHERE COMMERCIALE Ce corps de règle spécifique dérogatoire aux règles du droit civil n'a vocation à s'appliquer qu'aux commerçants c'est-à-dire à s'appliquer que dans la sphère commerciale. Délimiter la sphère de commercialité, c'est déterminer quelles sont les parties (personnes morales ou personnes physiques) assujetties aux règles du droit commercial. Pour quelles raisons ? Parce que tantôt certaines personnes souhaiteront se prévaloir des règles du droit commercial parce qu'elles sont plus protectrices, elles vont dans le sens de ses intérêts, c'est le cas par exemple du bail commercial, tantôt on peut essayer d'échapper à l'application des règles du droit commercial parce qu'elles sont défavorables à telle ou telle partie. Exemple : C'est le principe de la solidarité des dettes contractées par les commerçants et qui s'opposent au principe de l'obligation conjointe en matière civile. Deux critères existent, permettent d'atteindre cette mission de qualification : Celui mis en avant par le Code de commerce historiquement : Tout acte de commerce est régi par le droit commercial en raison de sa nature, en raison de sa forme ou en fonction de la personne qui l'accompli. C'est un critère qui est plus subjectif, c'est une vision plus subjective de la commercialité c'est-à-dire tous les actes accomplis par des commerçants relèvent, sont régis par le droit commercial. Exemple : Quelqu'un souscrit un emprunt pour son activité professionnelle et une assurance. Il y a un problème à l'occasion de l'exécution du contrat d'assurance. Il s'agit d'un acte civil par nature mais puisque c'est un commerçant qui a conclu ce contrat pour les besoins de son activité commerciale, grâce à ce second critère, le droit commercial s'applique. Chapitre 1 : La notion d'acte de commerce ou la délimitation objective de la sphère commerciale Qui dit délimitation objective dit définition, caractérisation de l'acte de commerce. Il sera question de s'intéresser à l'objet de l'opération litigieuse, à sa nature, à sa finalité pour déterminer si elle relève ou non de la catégorie des actes de commerce. Pour nous faciliter la tâche, le Code de commerce énumère une liste de ce qu'il convient de qualifier d'acte de commerce (liste légale des actes de commerce) aux Articles L110-1 et L110-2. On voit que cette liste posée par le Code civil n'est pas exhaustive, elle est simplement indicative. Cette liste n'est pas limitative puisqu'elle a vocation à évoluer dans le temps au gré des évolutions techniques, économiques et sociales. La doctrine, pour classer ces différentes opérations commerciales, opère une distinction entre d'une part les actes de commerce à titre principal et les actes de commerce à titre accessoire. Section 1 : Les actes de commerce à titre principal Ce sont ceux qui sont au coeur de la sphère commerciale, ils portent en eux les caractères de la commercialité. Parmi ces actes de commerce principal, on trouve d'une part les actes de commerce par nature et les actes de commerce par la forme. §1) Les actes de commerce par nature L'Article L110-1 et L110-2 du Code de commerce en donne une liste non exhaustive. On va chercher à les classer en général en quatre catégories : les activités de distribution, les activités industrielles, les activités financières et les activités de service. Il faut d'abord définir les critères de l'opération qui justifient une telle classification. L'un des critères forts de cette classification est l'idée de spéculation. On va spéculer soit sur la valeur d'une marchandise soit sur le travail d'autrui. Exemple : Un garagiste qui emploie plusieurs employés spécule sur le travail d'autrui. Les activités de distribution Cette catégorie permet de regrouper les actes de commerce par nature qui relèvent de la distribution et produits et actes de service. Les activités d'achat pour revendre L'achat de bien mobilier ou immobilier dans l'optique de les revendre est un acte de commerce par nature. Il faut tout de même apporter une précision fondamentale. Relève de cette catégorie des actes de commerce par nature exclusivement les opérations d'achat revente au cours desquelles l'auteur de l'acte était animé par le désir de revendre le bien au jour de l'achat. Si on achète un bien pour l'utiliser (mais qu'on pense le revendre plus tard), ce n'est pas un acte de commerce par nature. Si on achète un bien et qu'on ne souhaite pas l'utiliser mais le revendre immédiatement, c'est un acte de commerce par nature. La motivation de l'auteur de l'acte permet de qualifier l'opération de commerciale ou non. La grosse difficulté de la motivation, c'est la preuve. La jurisprudence pose une présomption de commercialité des opérations d'achat revente effectuées par une personne physique lorsque manifestement elles sont répétées dans le temps et que la personne en dégage un revenu substantiel. Il s'agit d'une présomption de commercialité à partir des faits constatés. Des limites à cette qualification existent. En effet, l'activité de celui qui vend sa propre production n'est pas commerciale aux yeux de la jurisprudence et cela concerne notamment les activités agricoles mais aussi les activités exercées par les professions libérales et ce qui relève de l'activité de création (invention +/ oeuvre). De la même manière, le consommateur qui achète un produit en vue de l'utiliser et ensuite de le revendre n'accomplit pas un acte de commerce par nature, mais un acte de consommation et le fait qu'il revende le produit après utilisation n'emporte pas requalification de l'opération en opération commerciale. En matière immobilière, est-ce que le fait d'acheter un appartement, de le rénover et de le revendre constitue une action commerciale ? Depuis une loi du 13 Juillet 1967, l'achat d'immeuble afin de le revendre relève de la catégorie des actes de commerce par nature. Une exception est apportée à ce principe de la commercialité, elle a été posée par une loi du 9 Juillet 1970 sous la pression du lobby de la promotion immobilière. En effet, l'achat d'un terrain en vue de bâtir et de revendre le tout est une activité civile par nature au sens de la loi. En matière de location de meubles, l'Article L110-1 alinéa 4 pose le principe qu'une telle activité est par nature commerciale, cela concerne les loueurs d'automobiles, de ménagers. Les activités des intermédiaires du commerce C'est l'acte d'entremise (= Fait de rapprocher un acheteur et un vendeur). L'intermédiaire est celui qui va aider un acheteur et un vendeur à conclure une convention. Parmi ces intermédiaires du commerce, on identifie tout d'abord les agents d'affaires (sont en charge de gérer les affaires d'autrui). Exemple : Les agences de recouvrement de créance accomplissent une activité de gestion d'affaires et sont des commerçants. C'est le cas de l'agent artistique, de l'agent sportif. On a ensuite le commissionnaire, sa particularité est d'être un « mandataire « qui va passer un contrat en son nom propre mais pour le compte d'autrui sans révéler l'identité du donneur d'ordre, ce commissionnaire est un commerçant et on le retrouve notamment en matière de bourse, de vente aux enchères. L'activité de courtage est visée à l'Article L110-1. Le courtier est celui qui va rapprocher deux autres personnes en vue de la conclusion d'un contrat et à cette occasion, il est tenu à une obligation de moyens. Surtout, le courtier ne devient en aucune manière partie au contrat bien qu'il sera signé entre l'acheteur et le vendeur. Il assiste seulement les parties. On doit distinguer ces intermédiaires commerçants des mandataires qui ne sont pas des commerçants. Pour quelles raisons le mandataire n'est-il pas un commerçant ? Il n'est jamais un commerçant tout simplement parce qu'il agit au nom et pour le compte d'un mandant, il n'engage pas son patrimoine mais celui du mandant. C'est pour cette raison que l'agent commercial, qui est un professionnel indépendant, n'est pas un commerçant. Les activités industrielles L'Article L110-1 vise toutes les entreprises de manufacture qui se caractérisent essentiellement par une spéculation sur le travail d'autrui. Par ces entreprises industrielles, il faut entendre toutes celles qui transforment les matières premières et vendent les produits finis. Exemple : L'usine de chaussures est une activité commerciale par nature. Cette notion de transformation est entendue très largement et elle inclut l'amélioration voire la rénovation d'un bien meuble ou d'un immeuble. Ces activités de rénovation, de construction sont commerciales dès lors qu'elles induisent une spéculation sur le travail d'autrui. Les activités financières Cela relève du domaine traditionnel du commerce et cela recouvre toutes les opérations de banque et d'assurance. Les activités de service Cela recouvre tout le secteur dit tertiaire, c'est une catégorie fourre-tout. Dès lors que l'on ne peut pas classer l'acte dans les activités de distribution, industrielles ou financières, on sera tenté de la classer dans cette catégorie. Cela concerne notamment la publicité, l'activité hôtelière, les agences d'intérim, les pompes funèbres. Seuls sont exclus de cette catégorie les services fournis par les professions libérales. §2) Les actes de commerce par la forme Dans le cas présent, on ne va pas chercher à s'intéresser à la nature de l'opération litigieuse, on va s'intéresser avant tout au formalisme du contrat litigieux et ces actes de commerce par la forme sont toujours commerciaux peu importe la qualité des parties en présence. On distingue deux types d'actes de commerce par la forme : la lettre de change et les actes des sociétés commerciales. La lettre de change C'est un contrat à trois parties par lequel une personne - le tireur - demande à une autre personne - le tiré - qui est son débiteur souvent de payer une somme d'argent à une certaine date à une troisième personne - le bénéficiaire - qui est souvent le créancier du tireur. La finalité est un moyen de paiement qui éteindra deux dettes. La lettre de change est une qualité commerciale peu importe la qualité des parties. Les actes des sociétés commerciales par la forme Ce sont tous les actes relatifs à la création d'une société commerciale au fonctionnement de la société et à la dissolution de la société. Quel est l'acte qui est relatif à la création d'une société commerciale ? Le contrat de société. De la même manière, tous les actes accomplis par la société commerciale et qui entrent dans son objet social seront qualifiés automatiquement d'actes de commerce. Une exception : Les actes accomplis entre les associés non-commerçants d'une société commerciale. C'est le cas de la SARL (Société A Responsabilité Limitée) et notamment les cessions de part sociale demeurent civiles dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de transférer le contrôle de l'entreprise. Section 2 : Les actes de commerce par accessoire La distinction entre actes civils et de commerce, loin de s'en tenir à la liste posée par l'Article L110-1 du Code de commerce, est plus subtile. En effet, le Code de commerce et la jurisprudence n'hésitent pas à qualifier de commercial un acte civil par nature lorsqu'il est accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce. Ainsi, sous certaines conditions, la profession de l'auteur de l'acte peut emporter une requalification d'un acte civil par nature en acte de commerce. Ce processus de requalification est extrêmement fréquent et présente un avantage à savoir celui d'unifier le régime juridique des actes accomplis par les commerçants pour les besoins de leur activité. §1) L'influence de la profession sur la qualification d'acte de commerce C'est l'Article L110-1 du Code qui dispose que la loi répute acte de commerce toute obligation entre commerçants. Par cette formule, on en déduit que les actes civils par nature accomplis par les commerçants pour les besoins de leur commerce seront qualifiés d'actes de commerce par accessoire et cela regroupe notamment tous les contrats passés par le commerçant dans l'intérêt de son commerce. Exemple : Le cautionnement. L'Article L721-6 du Code de commerce précise que les achats de marchandises, de denrées fais par un commerçant pour son usage particulier ne sont pas des actes de commerce. Il faut savoir que cette théorie de l'accessoire est appliquée par la jurisprudence à toutes les applications du commerçant qu'elles soient d'origine contractuelle ou délictuelle. Cette théorie de l'accessoire touche toutes les obligations du commerçant qu'elles soient d'origine contractuelle ou délictuelle. Elle joue dans le sens de la commercialité et elle joue également dans le sens inverse. Dans la grande majorité des activités civiles, le professionnel est amené à opérer des actions d'achat-revente. Cette opération, par nature commerciale, basculera dans la catégorie des actes civils par le jeu de l'accessoire. §2) Une présomption de commercialité des actes accomplis par le commerçant Lorsque le jeu de l'accessoire est mis en oeuvre, le Code de commerce institue une présomption de commercialité de l'acte accompli par le commerçant. Cela veut dire que l'on va présumer que l'opération, l'acte litigieux a été accompli par le commerçant pour les besoins de son commerce, il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable. En effet, le commerçant peut rapporter la preuve contraire pour ramener l'acte litigieux dans le giron de l'acte civil. Chapitre 2 : Une délimitation subjective de la sphère commerciale : Le commerçant En réalité, la notion de commerçant est un pivot lorsqu'il est question de qualifier juridiquement une opération d'acte de commerce ou civil. C'est vrai que l'on va se poser deux questions : Qu'est-ce qu'un commerçant ? Existe-t-il des caractères généraux propres à la profession de commerçant ? Quel est le statut juridique du commerçant ? Quels sont ses droits et obligations ? Section 1 : La qualité de commerçant Quelle est la grande distinction que l'on doit opérer ? Le commerçant est soit une personne physique qui exerce une activité commerciale en nom propre soit une personne morale qui prendra la forme le plus souvent d'une société commerciale. Le choix entre ces deux modes d'exercice est dicté par des considérations fiscales, patrimoniales et de gestion. §1) Le commerçant, personne physique C'est l'Article L121-1 du Code de commerce qui en donne une définition : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle «. La jurisprudence a ajouté un troisième critère important : Le commerçant est celui qui accomplit ses actes à titre personnel et indépendant. Lorsque le commerçant accomplit de tels actes de commerce et en fait sa profession habituelle, cela va avoir des répercussions, des effets sur sa vie civile et notamment sur son patrimoine. L'activité commerciale Etre commerçant au sens de l'Article L121-1, c'est accomplir des actes de commerce dans le dessein, dans le but d'en tirer profit. Les deux critères retenus sont ceux de la spéculation sur la valeur d'une marchandise (achat/revente) et sur la spéculation sur le travail d'autrui. C'est l'Article L110-1 qui donne une liste des actes de commerce par nature (cf. Actes de commerce par nature). La profession habituelle C'est la jurisprudence, dans un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 30 Avril 1906, qui est venue préciser que la profession de commerçant s'entend d'une occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l'existence. On comprend que l'activité commerciale doit s'inscrire dans le temps et présenter une certaine stabilité. Exemple : Dans un arrêt du 18 Mai 1995 : La Cour d'Appel de Pau a précisé que l'acte isolé de marchand de biens non renouvelé ne conférait pas la qualité de commerçant. De la même manière, le fait d'émettre régulièrement des lettres de change n'emporte pas requalification en commerçant de fait. L'exercice à titre personnel et indépendant C'est la jurisprudence qui a ajouté cette condition qui n'est pas présente dans le Code et qui conduit à exclure certaines personnes de la profession de commerçant et plus particulièrement trois catégories de personnes à savoir : Première catégorie : Les salariés car ils sont dans une situation de subordination par rapport aux employeurs. Deuxième catégorie : Les mandataires car ils agissent au nom et pour le compte du mandant et ne s'engagent jamais personnellement. Troisième catégorie : Les dirigeants de société car ils agissent au nom de la société dont ils sont les représentants légaux. Donc finalement le critère de l'indépendance, c'est celui de la possibilité de s'engager personnellement sur son patrimoine personnel. Lorsque l'on accomplit des actes de commerce, que l'on en fait sa profession habituelle à titre indépendant, cela va avoir automatiquement des répercussions sur la vie civile du commerçant c'est-à-dire sur l'état de la personne. Les effets de la qualité de commerçant sur l'état de la personne A ce niveau, on va s'intéresser à la dimension patrimoniale de l'exercice de la profession de commerçant lorsque l'on est personne physique. Sur le plan patrimonial, ce qui caractérise l'exercice individuel de la profession de commerçant, c'est l'exposition du patrimoine du commerçant aux actions engagées par les créanciers professionnels sur la base d'un principe, celui de l'unicité du patrimoine qui connait une exception aujourd'hui en vigueur depuis le 1er Janvier 2011, c'est-à-dire depuis la création de l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL). Voir distinction EIRL et l'EURL Depuis le 1er Janvier 2011, il existe deux types d'entreprises commerciales individuelles à savoir l'EIRI et d'autre part, l'EIRL. L'Entreprise commerciale Individuelle à Responsabilité Illimitée C'est traditionnellement le mode d'exercice choisi par le commerçant, personne physique, et ce mode d'exercice présente la caractéristique d'engager le patrimoine privé et professionnel (qui ne fait qu'un) du commerçant envers les créanciers professionnels. De la même manière, les créanciers privés (non-professionnels) du commerçant ont le pouvoir, la capacité de se désintéresser sur le patrimoine professionnel de ce dernier. Face à ce risque important auquel s'expose le commerçant, personne physique, le législateur a souhaité lui offrir un minimum de protection et c'est la Loi du 1er Août 2003 sur l'initiative économique qui a mise en place la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur. Comment cela fonctionne ? Dès lors que l'entrepreneur a effectué cette déclaration, sa résidence principale est mise à l'écart des poursuites des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à l'acte déclaratif. Dans le prolongement de la déclaration d'insaisissabilité et afin de renforcer la protection du patrimoine privé du commerçant, le législateur par une Loi du 15 Juin 2010, a créé l'EIRL. L'EIRL Ce nouveau statut est en vigueur depuis le 1er Janvier 2011. Il permet au commerçant, personne physique, d'affecter une partie de son patrimoine à l'exercice de son activité professionnelle. Ainsi, en cas de défaillance, les créanciers professionnels ne pourront saisir que les biens logés dans ce patrimoine d'affectation. On comprend aujourd'hui que le principe d'unité est battu...