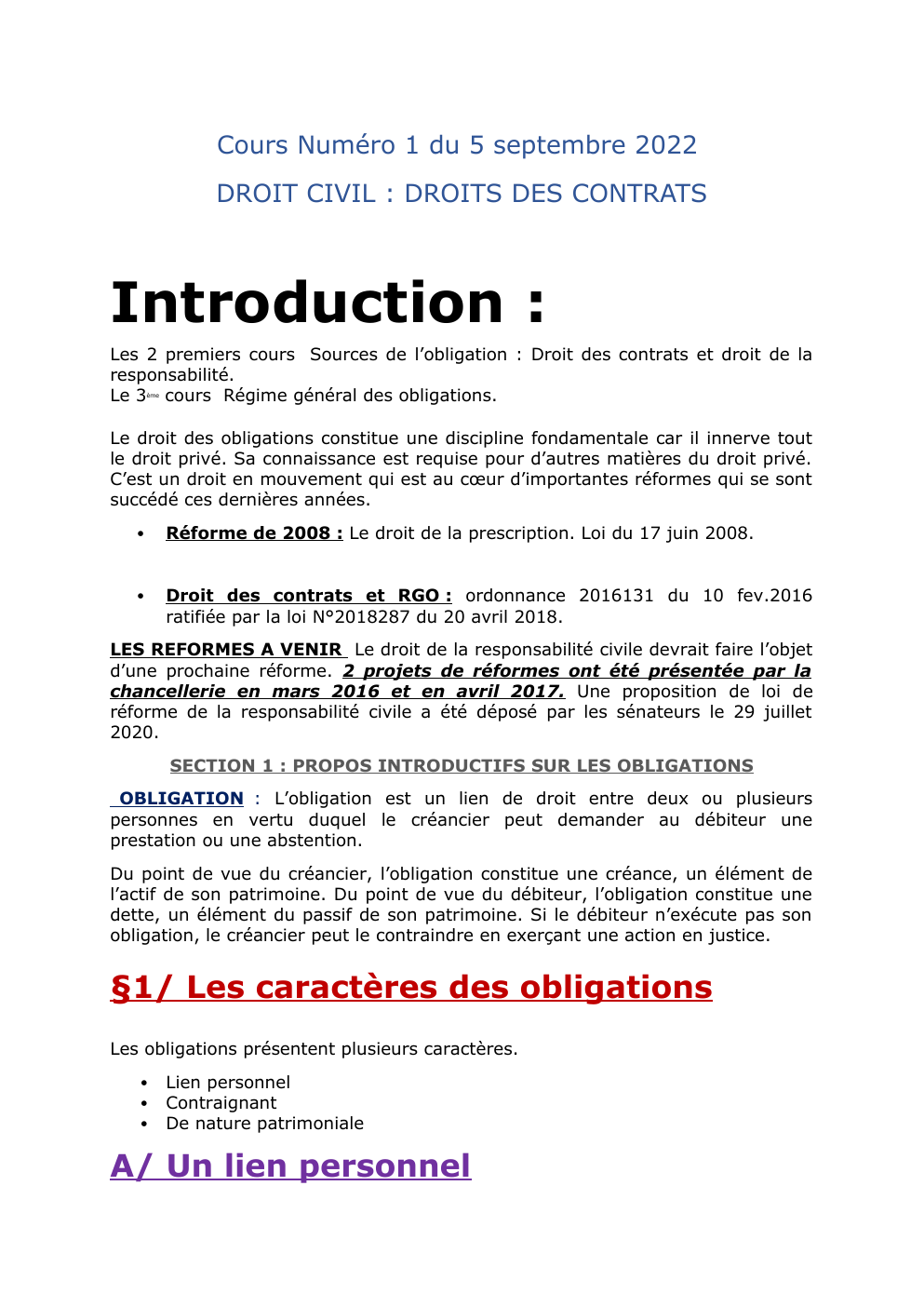DROIT DES CONTRATS
Publié le 17/10/2023
Extrait du document
«
Cours Numéro 1 du 5 septembre 2022
DROIT CIVIL : DROITS DES CONTRATS
Introduction :
Les 2 premiers cours 🡺 Sources de l’obligation : Droit des contrats et droit de la
responsabilité.
Le 3 cours 🡺 Régime général des obligations.
ème
Le droit des obligations constitue une discipline fondamentale car il innerve tout
le droit privé.
Sa connaissance est requise pour d’autres matières du droit privé.
C’est un droit en mouvement qui est au cœur d’importantes réformes qui se sont
succédé ces dernières années.
Réforme de 2008 : Le droit de la prescription.
Loi du 17 juin 2008.
Droit des contrats et RGO : ordonnance 2016131 du 10 fev.2016
ratifiée par la loi N°2018287 du 20 avril 2018.
LES REFORMES A VENIR 🡺 Le droit de la responsabilité civile devrait faire l’objet
d’une prochaine réforme.
2 projets de réformes ont été présentée par la
chancellerie en mars 2016 et en avril 2017.
Une proposition de loi de
réforme de la responsabilité civile a été déposé par les sénateurs le 29 juillet
2020.
SECTION 1 : PROPOS INTRODUCTIFS SUR LES OBLIGATIONS
🡺 OBLIGATION : L’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs
personnes en vertu duquel le créancier peut demander au débiteur une
prestation ou une abstention.
Du point de vue du créancier, l’obligation constitue une créance, un élément de
l’actif de son patrimoine.
Du point de vue du débiteur, l’obligation constitue une
dette, un élément du passif de son patrimoine.
Si le débiteur n’exécute pas son
obligation, le créancier peut le contraindre en exerçant une action en justice.
§1/ Les caractères des obligations
Les obligations présentent plusieurs caractères.
Lien personnel
Contraignant
De nature patrimoniale
A/ Un lien personnel
Le lien personnel entre 2 personnes entraîne en vérité
L’obligation est un droit personnel et non un droit réel.
deux
choses :
🡺 Un droit réel s’exerce directement sur une chose et non sur une
personne
(EX : droit de propriété 🡪 Le propriétaire use de son bien comme bon lui
semble).
🡺 Un droit personnel s’exerce sur une personne et non sur une chose .
Le
créancier d’une somme d’argent exerce son droit de créance directement sur son
débiteur en lui demandant de s’exécuter.
L’obligation est un lien personnel et cela signifie que l’obligation est un droit
individuel qui n’engage que le débiteur et non le groupe social auquel il
appartient.
De même, la dette d’une société n’engage pas par principe d’autres
société du même groupe.
(Ex : Dette d’une personne n’engage qu’elle-même et non sa famille).
/! \ : Cela ne signifie pas pour autant que l’obligation n’engage ou ne
profite qu’à une seule personne.
L’obligation peut être plurale en vertu
d’un contrat ou de la loi.
B/ Un lien contraignant
L’obligation civile est contraignante.
Elle s’oppose à l’obligation naturelle qui ne
l’est pas malgré le fait qu’elle puisse entraîner des conséquences juridiques.
1.
L’obligation civile contraignante
Le créancier peut saisir le juge pour qu’il sanctionne l’inexécution de l’obligation.
Les modes de contraintes du débiteur ont connu une évolution au cours de
l’histoire.
Dans les droits primitifs, la contrainte était exercée sur la personne
même du débiteur.
EX : La loi des 12 tables 🡪 Le débiteur défaillant et insolvable était réduit
en esclavage au profit de son créancier.
Il était attaché par une corde ou
une chaine d’un poids minimum de 15 litres.
A défaut d’arrangement
amiable avec le créancier, le débiteur défaillant était présenté à 3
marchés d’esclave consécutif.
Au bout de 3 marchés « non-vendu », il
était vendu au-delà des frontières ou condamné à la peine capitale.
Son
corps était divisé en autant de part qu’il y avait de créancier.
En France, jusqu’à une loi du 22 juillet 1867, le débiteur d’une dette privée
d’origine civile ou commerciale pouvait être emprisonné en cas de défaillance.
C’est la contrainte par corps ou encore la prison pour dette.
AUJOURD’HUI, seul
subsiste à l’art.749 du Code de procédure pénal la contrainte judiciaire, une
condamnation à une peine d’amende prononcée en matière criminelle ou
correctionnelle.
Désormais pour les dettes civiles et commerciales, la contrainte ne s’exerce plus
que sur le patrimoine du débiteur.
Les moyens de contraintes sont assez larges.
(Ex : Le créancier peut procéder à une saisie).
Cette grande diversité est liée au fait que l’obligation donne naissance à un droit
personnel et qu’en conséquence, le créancier dispose d’un droit de gage général
sur le patrimoine de son débiteur Art.2284 CC « Quiconque s’est obligé
personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens
mobiliers et immobiliers présent et à venir ».
Le créancier peut aussi chercher à garantir sa créance par une sûreté.
Il sera
alors privilégié par rapport aux autres créanciers.
(Ex : hypothèque sur
l’immeuble du débiteur ; cautionnement pars un tiers aux côtés du
débiteur).
2.
L’obligation naturelle non-contraignante
Les obligations naturelles sont non-contraignantes d’un point de vue juridique et
ne sont donc pas assorties d’une sanction juridique.
2A/ Conception de l’obligation naturelle
Le Code civil ne définit pas l’obligation naturelle mais il ne l’ignore pas
totalement.
C’est donc à la doctrine et à la jurisprudence d’identifier les cas dans
lesquels on peut tenir compte de l’obligation naturelle.
1 conception AUBRY et ROU(XIX) : L’obligation naturelle est une
obligation civile imparfaite ou avortée qui a perdu son caractère obligatoire
en raison d’une disposition législative ou d’un vice lors de sa formation ou,
d’un événement postérieur.
ère
Dépourvu de son caractère obligatoire, l’obligation juridique imparfaite ne peut
exister qu’en tant qu’obligation naturelle.
Ex 1 : obligation civile prescrite.
Elle n’est plus obligatoire à la suite de la
prescription mais elle reste une obligation naturelle.
EX 2 : Art.
1965 CC dispose que la loi n’accorde aucune action pour une
dette de jeu ou pour le paiement d’un pari.
Sauf dans les cas prévus par l’art.1966 les dettes de jeux ne peuvent faire l’objet
d’une demande de paiement en justice.
2 conception RIPERT : L’obligation naturelle correspond à un devoir
moral, monté à la vie juridique.
En ce sens, lorsqu’une personne s’engage
nde
volontairement à exécuter un devoir moral, ce devoir moral monte à la vie
juridique et il est alors perçu par le droit comme une obligation naturelle.
Il est ainsi transformé en obligation civile contraignante.
L’obligation
naturelle répond à un devoir de conscience.
Dès lors qu’une personne s’engage à aider financièrement son frère par exemple,
il y a obligation civile.
Cette conception est plus large car la morale varie en
fonction des époques.
Le nouvel art.1100 al 2.
Du CC dispose que « les
obligations peuvent naître de l’exécution au volontaire ou de la
promesse d’exécution.
»
2B/ Le régime juridique de l’obligation naturelle
Le Code civil comporte des règles spécifiques aux obligations naturelles.
L’obligation naturelle ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée mais
si le débiteur s’engage à l’exécuter, elle se transforme en obligation
juridique.
Ainsi le créancier peut en demander l’exécution forcée Art.
1100 al.
2 CC
L’obligation naturelle ne peut pas faire l’objet d’une restitution en cas
d’exécution volontaire.
Cette règle est envisagée à l’Art.1302 al.2 CC qui
dispose que la restitution n'est pas admise Allevard des obligations
naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Ainsi le débiteur ne peut
pas revenir sur son exécution et en demander la restitution.
C/ Un lien patrimonial
L’obligation est en principe évaluable en argent, en monnaie et constitue un
élément de l’actif ou du passif du patrimoine du créancier ou de celui du
débiteur.
Parce l’obligation à caractère patrimonial, qu'elle peut donc être transmise entre
vifs (personne vivante) par contrat ou par cession de créance, ou encore, par
décès.
§2/ Les classifications des obligations
A/ Les classifications fondées sur le contenu des obligations
1.
Obligation de faire, de ne pas faire et de donner
Cette distinction était retenue par les Art.1101 et 1126 du CC de 1804.
L’ancien art.
1126 « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à
donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
» Cet article n’a pas
été repris par l’ordonnance du 10 fév.
2016 mais la distinction entre ces 3
obligations demeure pertinente.
L’intérêt de distinction résidait dans les modes
de sanction de l’inexécution qui différait du type d’obligation.
Obligation de faire : obligation positive d’accomplir une prestation (Ex :
médecin qui doit soigner le patient) ou obligation du salarié qui
s’engage à travailler pour son employeur.
Obligation de pas faire : Obligation négative de s’abstenir (Ex : nonconcurrence) ou obligation de non-construction, obligation de nondivulgation d’une information
Obligation de donner : Obligation de transférer la propriété d’une chose
par exemple lors d’une donation ou d’une vente (Aujourd’hui disparu
dans le CC).
L'intérêt de ces distinctions résidait dans les modes
de sanctions de l’inexécution.
L'ancien art.1142 disposait que tout obligation de faire ou de ne pas faire se
résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Les 2
premiers types d’obligations ne pouvaient pas faire l’objet d’une
obligation forcée, seuls les dommages....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « En quoi le régime juridique des contrats administratifs est-il dérogatoire au droit commun ? »
- Cours droit des contrats spéciaux
- Fiche droit des contrats
- Le contexte réglementaire Les sources du droit du travail 3 niveaux : les lois, les conventions collectives et les contrats.
- droit des contrats publics