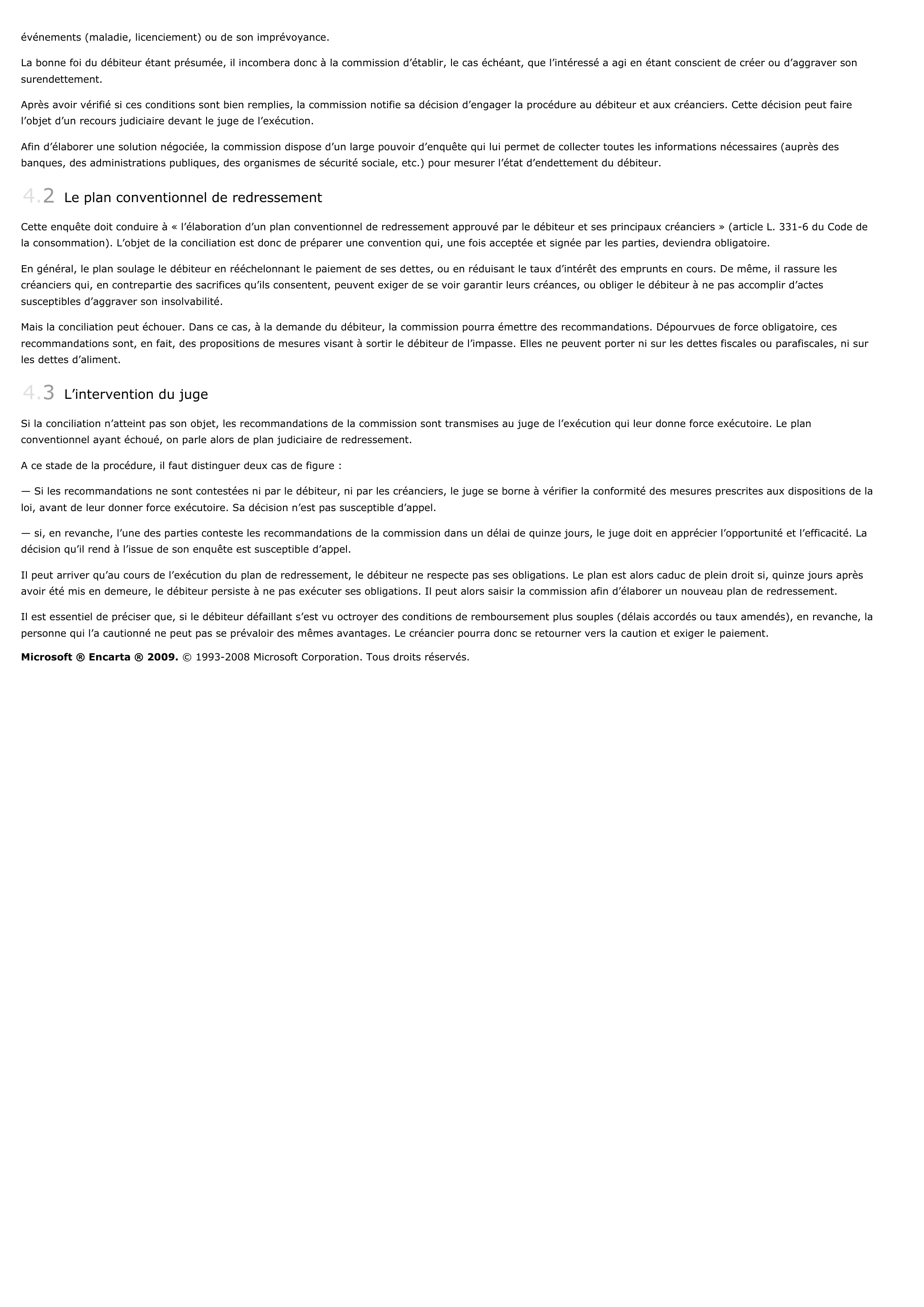surendettement des particuliers (cours de droit des affaires).
Publié le 20/05/2013

Extrait du document


«
événements (maladie, licenciement) ou de son imprévoyance.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombera donc à la commission d’établir, le cas échéant, que l’intéressé a agi en étant conscient de créer ou d’aggraver sonsurendettement.
Après avoir vérifié si ces conditions sont bien remplies, la commission notifie sa décision d’engager la procédure au débiteur et aux créanciers.
Cette décision peut fairel’objet d’un recours judiciaire devant le juge de l’exécution.
Afin d’élaborer une solution négociée, la commission dispose d’un large pouvoir d’enquête qui lui permet de collecter toutes les informations nécessaires (auprès desbanques, des administrations publiques, des organismes de sécurité sociale, etc.) pour mesurer l’état d’endettement du débiteur.
4.2 Le plan conventionnel de redressement
Cette enquête doit conduire à « l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (article L.
331-6 du Code dela consommation).
L’objet de la conciliation est donc de préparer une convention qui, une fois acceptée et signée par les parties, deviendra obligatoire.
En général, le plan soulage le débiteur en rééchelonnant le paiement de ses dettes, ou en réduisant le taux d’intérêt des emprunts en cours.
De même, il rassure lescréanciers qui, en contrepartie des sacrifices qu’ils consentent, peuvent exiger de se voir garantir leurs créances, ou obliger le débiteur à ne pas accomplir d’actessusceptibles d’aggraver son insolvabilité.
Mais la conciliation peut échouer.
Dans ce cas, à la demande du débiteur, la commission pourra émettre des recommandations.
Dépourvues de force obligatoire, cesrecommandations sont, en fait, des propositions de mesures visant à sortir le débiteur de l’impasse.
Elles ne peuvent porter ni sur les dettes fiscales ou parafiscales, ni surles dettes d’aliment.
4.3 L’intervention du juge
Si la conciliation n’atteint pas son objet, les recommandations de la commission sont transmises au juge de l’exécution qui leur donne force exécutoire.
Le planconventionnel ayant échoué, on parle alors de plan judiciaire de redressement.
A ce stade de la procédure, il faut distinguer deux cas de figure :
— Si les recommandations ne sont contestées ni par le débiteur, ni par les créanciers, le juge se borne à vérifier la conformité des mesures prescrites aux dispositions de laloi, avant de leur donner force exécutoire.
Sa décision n’est pas susceptible d’appel.
— si, en revanche, l’une des parties conteste les recommandations de la commission dans un délai de quinze jours, le juge doit en apprécier l’opportunité et l’efficacité.
Ladécision qu’il rend à l’issue de son enquête est susceptible d’appel.
Il peut arriver qu’au cours de l’exécution du plan de redressement, le débiteur ne respecte pas ses obligations.
Le plan est alors caduc de plein droit si, quinze jours aprèsavoir été mis en demeure, le débiteur persiste à ne pas exécuter ses obligations.
Il peut alors saisir la commission afin d’élaborer un nouveau plan de redressement.
Il est essentiel de préciser que, si le débiteur défaillant s’est vu octroyer des conditions de remboursement plus souples (délais accordés ou taux amendés), en revanche, lapersonne qui l’a cautionné ne peut pas se prévaloir des mêmes avantages.
Le créancier pourra donc se retourner vers la caution et exiger le paiement.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- administrateur judiciaire (cours de droit des affaires).
- gérant de société (cours de droit des affaires).
- fusion (cours de droit des affaires).
- entreprises en difficultés (droit de la faillite) (cours de droit des affaires).
- contrefaçon (cours de droit des affaires).