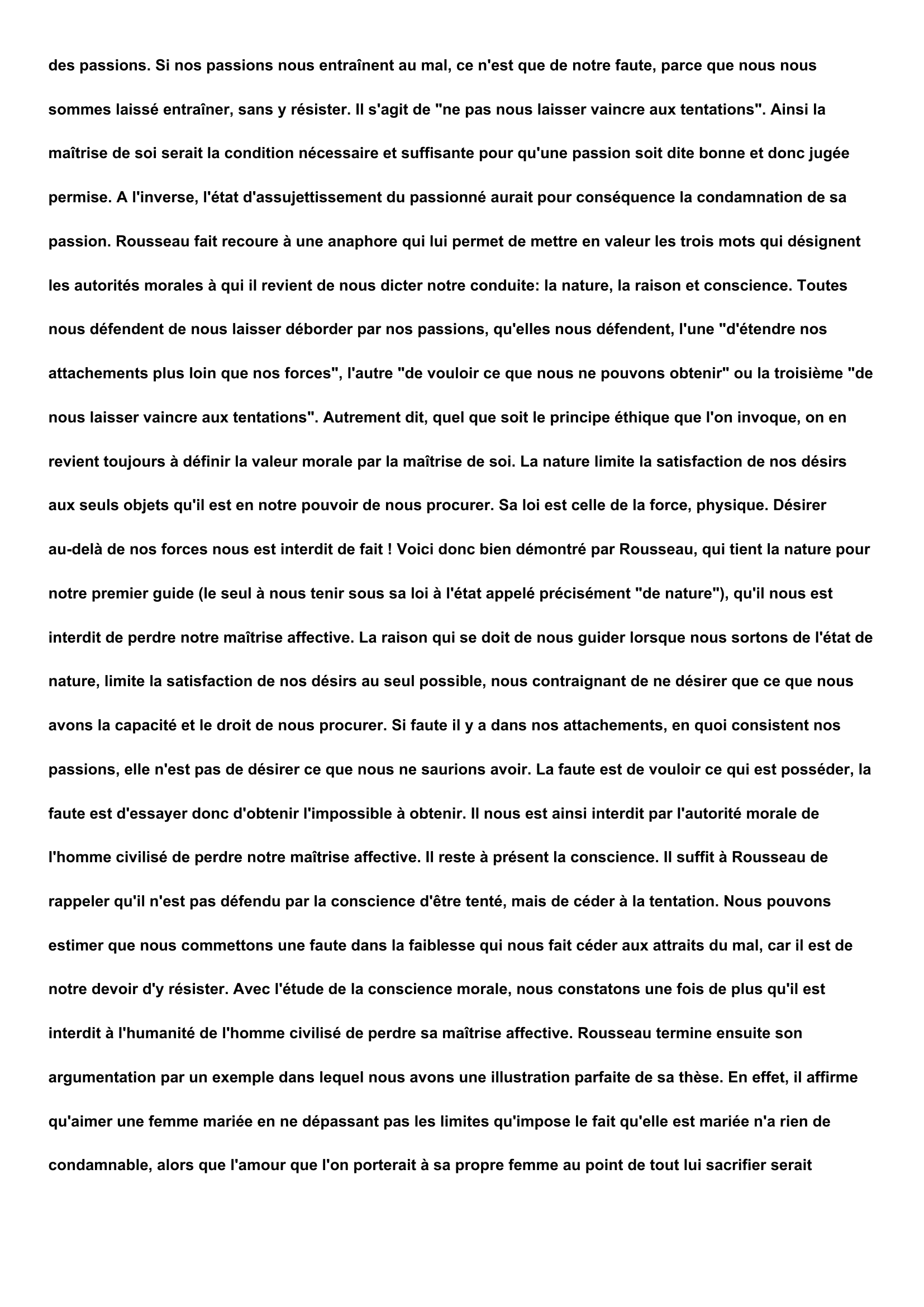Commentaire de texte de Rousseau
Publié le 17/05/2014

Extrait du document


«
des passions.
Si nos passions nous entraînent au mal, ce n'est que de notre faute, parce que nous nous
sommes laissé entraîner, sans y résister.
Il s'agit de "ne pas nous laisser vaincre aux tentations".
Ainsi la
maîtrise de soi serait la condition nécessaire et suffisante pour qu'une passion soit dite bonne et donc jugée
permise.
A l'inverse, l'état d'assujettissement du passionné aurait pour conséquence la condamnation de sa
passion.
Rousseau fait recoure à une anaphore qui lui permet de mettre en valeur les trois mots qui désignent
les autorités morales à qui il revient de nous dicter notre conduite: la nature, la raison et conscience.
Toutes
nous défendent de nous laisser déborder par nos passions, qu'elles nous défendent, l'une "d'étendre nos
attachements plus loin que nos forces", l'autre "de vouloir ce que nous ne pouvons obtenir" ou la troisième "de
nous laisser vaincre aux tentations".
Autrement dit, quel que soit le principe éthique que l'on invoque, on en
revient toujours à définir la valeur morale par la maîtrise de soi.
La nature limite la satisfaction de nos désirs
aux seuls objets qu'il est en notre pouvoir de nous procurer.
Sa loi est celle de la force, physique.
Désirer
au-delà de nos forces nous est interdit de fait ! Voici donc bien démontré par Rousseau, qui tient la nature pour
notre premier guide (le seul à nous tenir sous sa loi à l'état appelé précisément "de nature"), qu'il nous est
interdit de perdre notre maîtrise affective.
La raison qui se doit de nous guider lorsque nous sortons de l'état de
nature, limite la satisfaction de nos désirs au seul possible, nous contraignant de ne désirer que ce que nous
avons la capacité et le droit de nous procurer.
Si faute il y a dans nos attachements, en quoi consistent nos
passions, elle n'est pas de désirer ce que nous ne saurions avoir.
La faute est de vouloir ce qui est posséder, la
faute est d'essayer donc d'obtenir l'impossible à obtenir.
Il nous est ainsi interdit par l'autorité morale de
l'homme civilisé de perdre notre maîtrise affective.
Il reste à présent la conscience.
Il suffit à Rousseau de
rappeler qu'il n'est pas défendu par la conscience d'être tenté, mais de céder à la tentation.
Nous pouvons
estimer que nous commettons une faute dans la faiblesse qui nous fait céder aux attraits du mal, car il est de
notre devoir d'y résister.
Avec l'étude de la conscience morale, nous constatons une fois de plus qu'il est
interdit à l'humanité de l'homme civilisé de perdre sa maîtrise affective.
Rousseau termine ensuite son
argumentation par un exemple dans lequel nous avons une illustration parfaite de sa thèse.
En effet, il affirme
qu'aimer une femme mariée en ne dépassant pas les limites qu'impose le fait qu'elle est mariée n'a rien de
condamnable, alors que l'amour que l'on porterait à sa propre femme au point de tout lui sacrifier serait.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte Du contrat social de Rousseau: Pourquoi la représentation du peuple est un frein à la souveraineté ?
- Commentaire de texte, Les Confessions de Rousseau (livre IV)
- Commentaire du texte de Rousseau : Julie ou la Nouvelle Héloïse, Lettre VIII
- COMMENTAIRE DE TEXTE DE ROUSSEAU.
- COMMENTAIRE DE TEXTE - ROUSSEAU. Le droit ; la justice.