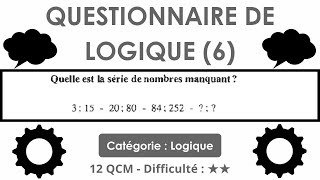Dans leur course à l'illusion romanesque, nombre d'auteurs poussent l'art du récit et de la symbolique jusque dans les noms et les dénominations des personnages.
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
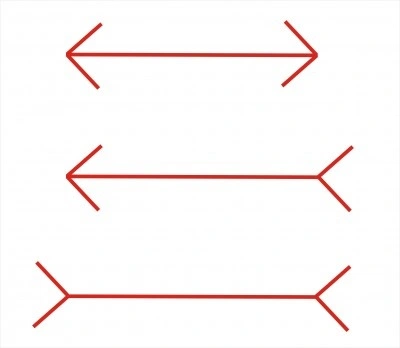
Ainsi, en 1833, Balzac dans son roman Eugénie Grandet brosse le portrait du personnage éponyme, une jeune femme très fortunée. L'appellation « Eugénie » se rattache en grec à l'expression « bien né[e] », effectivement il s'agit de la fille d'un maître des affaires : Félix Grandet. Cet homme doué d'une volonté de puissance exceptionnelle consacre toute son énergie à sa passion pour l'argent, il a fait fortune en profitant des évènements de cette période instable que constitue la Restauration Française. Le prénom « Félix » aux connotations de chance et de bonheur en latin renvoie à une vision du monde opportuniste, représentative des années 1820 et fait allusion à une poursuite de grandeur. Par ailleurs, le terme « Grandet » reflète aussi un caractère à la recherche de puissance et de pouvoir. Cependant, le suffixe « -et », assez réducteur, peut être interprété pour désigner avec reproche une petitesse paradoxale. Balzac critiquerait-il par là un comportement pétri d'avarice de part son obsession du succès ?
Toujours dans le thème de la quête de la réussite, Stendhal retrace à travers son roman d'apprentissage, Le Rouge et le Noir, le parcours initiatique de Julien Sorel. Le jeune homme, entré comme secrétaire au service du marquis de La Mole, découvre un monde nouveau. Le nom à particule n'est pas sans évoquer une appartenance à l'aristocratie. Le marquis est une illustre personne, très influente dans la vie politique de part son siège à la Chambre des pairs. L'allusion « Mole » peut être rattachée à la langueur qui règne dans les salons : en effet l'auteur dépeint dans son ½uvre un « siècle ennuyé » où le poids des conventions et la liberté d'expression sont tels que ne peut-avoir lieu le moindre débat politique et que l'apathie s'empare des discussions. Les dénominations contribuent à décrire l'univers qui entoure le néophyte Julien. L'apogée sociale de l'aristocratie est démystifiée par l'ennui ; le héros se retrouvera tiraillé entre un monde de réussite, peu reluisant dans ce passage, et sa passion envers madame de Rênal.
L'amour est d'ailleurs le sujet central de La Princesse de Clèves, roman où Mme de la Fayette propose en 1678 le personnage d'une femme aristocrate. Cette appartenance à un statut social, suggérée par la désignation « Princesse », annonce le respect d'un certain code d'honneur. En effet, la bienséance est de mise dans la conduite de la femme qui s'efforce de s'exprimer avec pudeur et de voiler ses sentiments. En outre, le mot « de », qui souligne une certaine appartenance à un mari défunt, peut évoquer le devoir de fidélité de la veuve à la mémoire du disparu. Enfin, l'expression « Clèves » sonne véritablement comme le mot "enclave'' pour mieux décrire les barrières à la passion entre la Princesse et M. de Nemours.
Plus largement, ce sont les obstacles à la vie auxquels s'intéresse Le Clézio à travers la figure centrale de Adam Pollo. Le Procès-Verbal dresse en 1963 le portrait d'un marginal énigmatique et solitaire, incompris de la société. Rien qu'à la vue de son nom, on devine que ce n'est pas une coïncidence si l'auteur a ainsi choisit de le nommer. Adam est le prénom du premier homme venu sur Terre, qui est donc hors du commun. Touché par la folie, abandonné par la vie, le personnage représente peut-être comme le suggère son prénom, tout homme. ¼uvre pleine de mélancolie, Le Procès-Verbal, de part la dimension symbolique d'Adam Pollo invite plus que jamais à la méditation et aux questionnements existentialistes.
Liens utiles
- A propos de la notion de réalisme, un critique contemporain, Albert Béguin, nous livre cette réflexion : « Le liseur de romans applaudit : "C'est comme dans la vie. " Il prouve par là qu'il est étranger à toute forme d'art. Les personnages d'une œuvre ne ressemblent pas davantage à ceux de la réalité que les habitants des songes. La Clytemnestre d'Eschyle, don Quichotte, les frères Karamazov, Mme Bovary, le Grand Méaulnes sont "vrais" justement parce qu'ils ne sont pas comme nous autre
- A propos de la notion du réalisme, un critique contemporain, Albert Béguin, nous livre cette réflexion : «Le liseur de romans applaudit: «C'est comme dans la vie. » Il prouve par là qu'il est étranger à toute forme d'art. Les personnages d'une œuvre ne ressemblent pas davantage à ceux de la réalité que les habitants des songes. La Clytemnestre d'Eschyle, don Quichotte, les frères Karamazov, Mme Bovary, le Grand Meaulnes sont « vrais » justement parce qu'ils ne sont pas comme nous autre
- ► Un roman doit-il chercher à faire oublier au lecteur que ses personnages sont fictifs ? Vous fonderez votre réflexion sur les textes du corpus, sur ceux que vous avez étudiés en classe et sur vos lectures r ujet - Objet d’étude : « roman », « personnages [...] fictifs » -» le roman. - Thème précis : « Un roman doit-il... » vous devez parler des caractéristiques que l’on peut attendre d’un roman, mais précisément en ce qui concerne les « personnages » (et non pas tous les éléments
- Lire un récit policier (4) : étudier la progression du récit 2 Découvrir L'évolution des personnages Mettre en évidence qu'entre le début et la fin du roman, beaucoup de choses ont changé : les personnages ne sont plus tout à fait les mêmes, les rôles se sont parfois inversés.
- vanité (art) 1 PRÉSENTATION vanité (art), type de peintures illustrant, de façon symbolique,