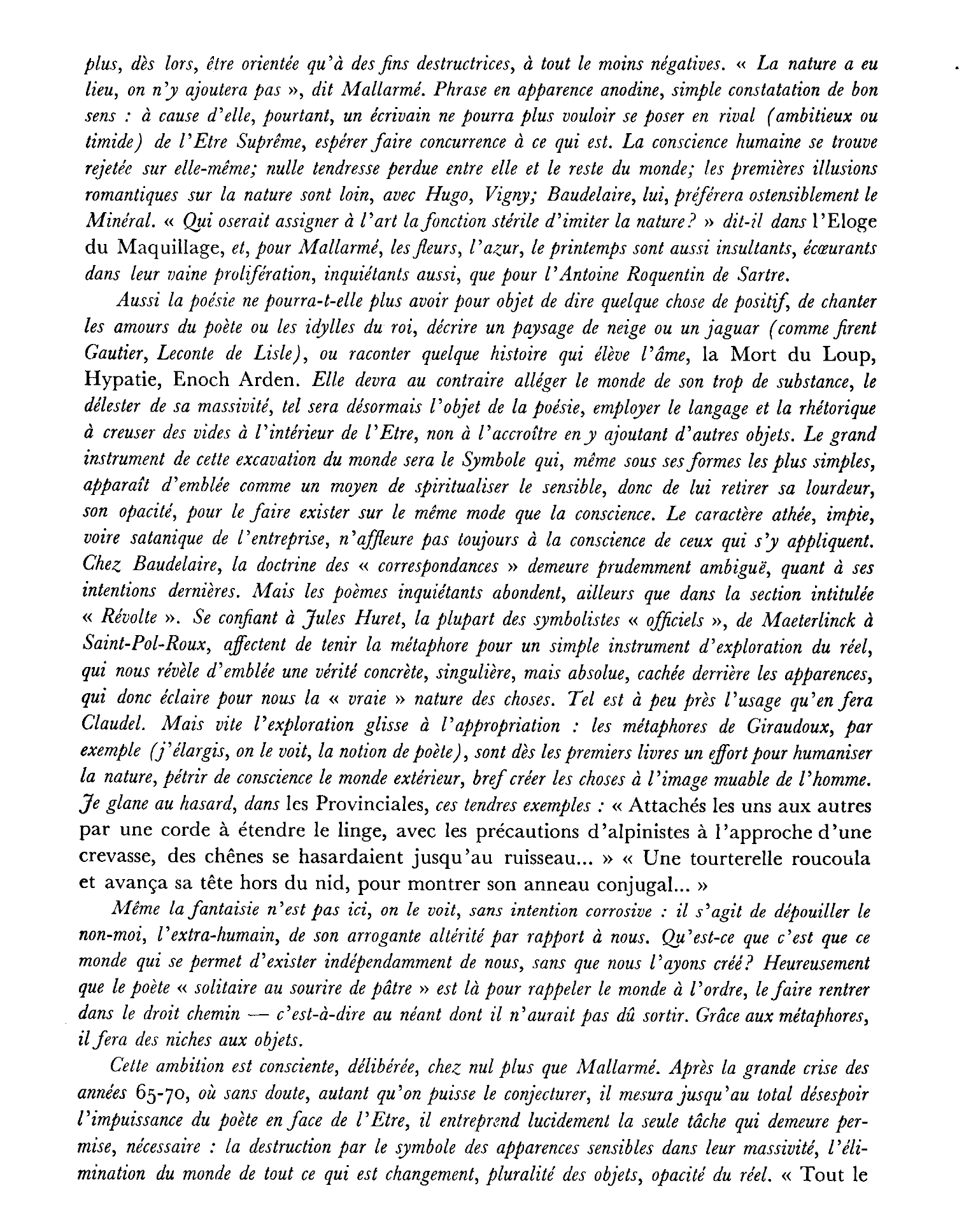DU SYMBOLISME AU SURRÉALISME
Publié le 22/04/2012

Extrait du document
Michaux se préoccupe d'exorcismes : on ne sait ce qui le gêne le plus, des vocables ou des choses. Grâce à la limpidité cruelle de sa langue, il parvient à les user, les uns par les autres. Ses inventions les plus folles, les plus convaincantes aussi sont évidemment mal disposées pour le réel. Mais son hostilité reste timide, onirique. Bien dijférente de la persévérante franchise avec laquelle Raymond Queneau s'attache (dans ses romans comme dans ses poèmes) à dire le Rien, excavant par l'ironie ou le calembour ce qui semblerait affirmé de trop positif, abolissant sitôt posée, en un glissement perpétuel, toute métaphore à laquelle l'esprit pourrait se retenir (l'Explication des Métaphores)
«
plus, dès lors, être orientée qu'à des fins destructrices, à tout le moins négatives.
« La nature a eu
lieu, on n y ajoutera pas », dit Mallarmé.
Phrase en apparence anodine, simple constatation de bon
sens : à cause d'elle, pourtant, un écrivain ne pourra plus vouloir se poser en rival (ambitieux ou
timide) de l' Etre Suprême, espérer faire concurrence à ce qui est.
La conscience humaine se trouve
rejetée sur elle-même; nulle tendresse perdue entre elle et le reste du mondeJ· les premières illusions
romantiques sur la nature sont loin, avec Hugo, VignyJ· Baudelaire, lui, préférera ostensiblement le
Minéral.« (Lui oserait assigner à l'art lafonction stérile d'imiter la nature?» dit-il dans l'Eloge
du Maquillage, et, pour Mallarmé, les fleurs, l'azur, le printemps sont aussi insultants, écœurants
dans leur vaine prolifération, inquiétants aussi, que pour l'Antoine Roquentin de Sartre.
Aussi la poésie ne pourra-t-elle plus avoir pour objet de dire quelque chose de positif, de chanter
les amours du poète ou les idylles du roi, décrire un paysage de neige ou un jaguar (comme firent
Gautier, Leconte de Lisle), ou raconter quelque histoire qui élève l'âme, la Mort du Loup,
Hypatie, Enoch Arden.
Elle devra au contraire alléger le monde de son trop de substance, le
délester de sa massivité, tel sera désormais l'objet de la poésie, employer le langage et la rhétorique
à creuser des vides à l'intérieur de l'Etre, non à l'accroître eny ajoutant d'autres objets.
Le grand
instrument de cette excavation du monde sera le Symbole qui, même sous ses formes les plus simples,
apparaît d'emblée comme un moyen de spiritualiser le sensible, donc de lui retirer sa lourdeur,
son opacité, pour le faire exister sur le même mode que la conscience.
Le caractère athée, impie,
voire satanique de l'entreprise, n' aifieure pas toujours à la conscience de ceux qui s y appliquent.
Chez Baudelaire, la doctrine des « correspondances » demeure prudemment ambiguë, quant à ses
intentions dernières.
Mais les poèmes inquiétants abondent, ailleurs que dans la section intitulée
« Révolte ».
Se confiant à Jules Huret, la plupart des symbolistes « officiels », de Maeterlinck à
Saint-Pol-Roux,
affectent de tenir la métaphore pour un simple instrument d'exploration du réel,
qui nous révèle d'emblée une vérité concrète, singulière, mais absolue, cachée derrière les apparences,
qui donc éclaire pour nous la « vraie » nature des choses.
Tel est à peu près l'usage qu'en fera
Claudel.
Mais vite l'exploration glisse à l'appropriation : les métaphores de Giraudoux, par
exemple (j'élargis, on le voit, la notion de poète), sont dès les premiers livres un effort pour humaniser
la nature, pétrir de conscience le monde extérieur, bref créer les choses à l'image muable de l'homme.
Je glane au hasard, dans les Provinciales, ces tendres exemples : «Attachés les uns aux autres
par une corde à étendre le linge, avec les précautions d'alpinistes à l'approche d'une
crevasse, des chênes se hasardaient jusqu 'au ruisseau ...
» « Une tourterelle roucoula
et avança sa tête hors du nid, pour montrer son anneau conjugal...
»
Même la fantaisie n'est pas ici, on le voit, sans intention corrosive : il s'agit de dépouiller le
non-moi, l'extra-humain, de son arrogante altérité par rapport à nous.
(Lu' est-ce que c'est que ce
monde qui se permet d'exister indépendamment de nous, sans que nous l'ayons créé? Heureusement
que le poète « solitaire au sourire de pâtre » est là pour rappeler le monde à l'ordre, le faire rentrer
dans le droit chemin - c'est-à-dire au néant dont il n'aurait pas dû sortir.
Grâce aux métaphores,
il fera des niches aux objets.
Cette ambition est consciente, délibérée, chez nul plus que Mallarmé.
Après la grande crise des
années 65-70, où sans doute, autant qu'on puisse le conjecturer, il mesura jusqu'au total désespoir
l'impuissance du poète en face de l' Etre, il entreprend lucidement la seule tâche qui demeure per
mise, nécessaire : la destruction par le symbole des apparences sensibles dans leur massivité, l'éli
mination du monde de tout ce qui est changement, pluralité des objets, opacité du réel.
« Tout le
257.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Du symbolisme au surréalisme par Claude-Edmonde Magny Poetry is a divine instinct and unnatural rage passing the reach of common reason.
- Du symbolisme au surréalisme
- Les mouvements littéraires : Symbolisme et surréalisme
- La beauté dans la laideur en poésie _ Séance 14 : Du Parnasse ... au Symbolisme
- Dictionnaire abrégé du surréalisme, d'André Breton et Paul Eluard