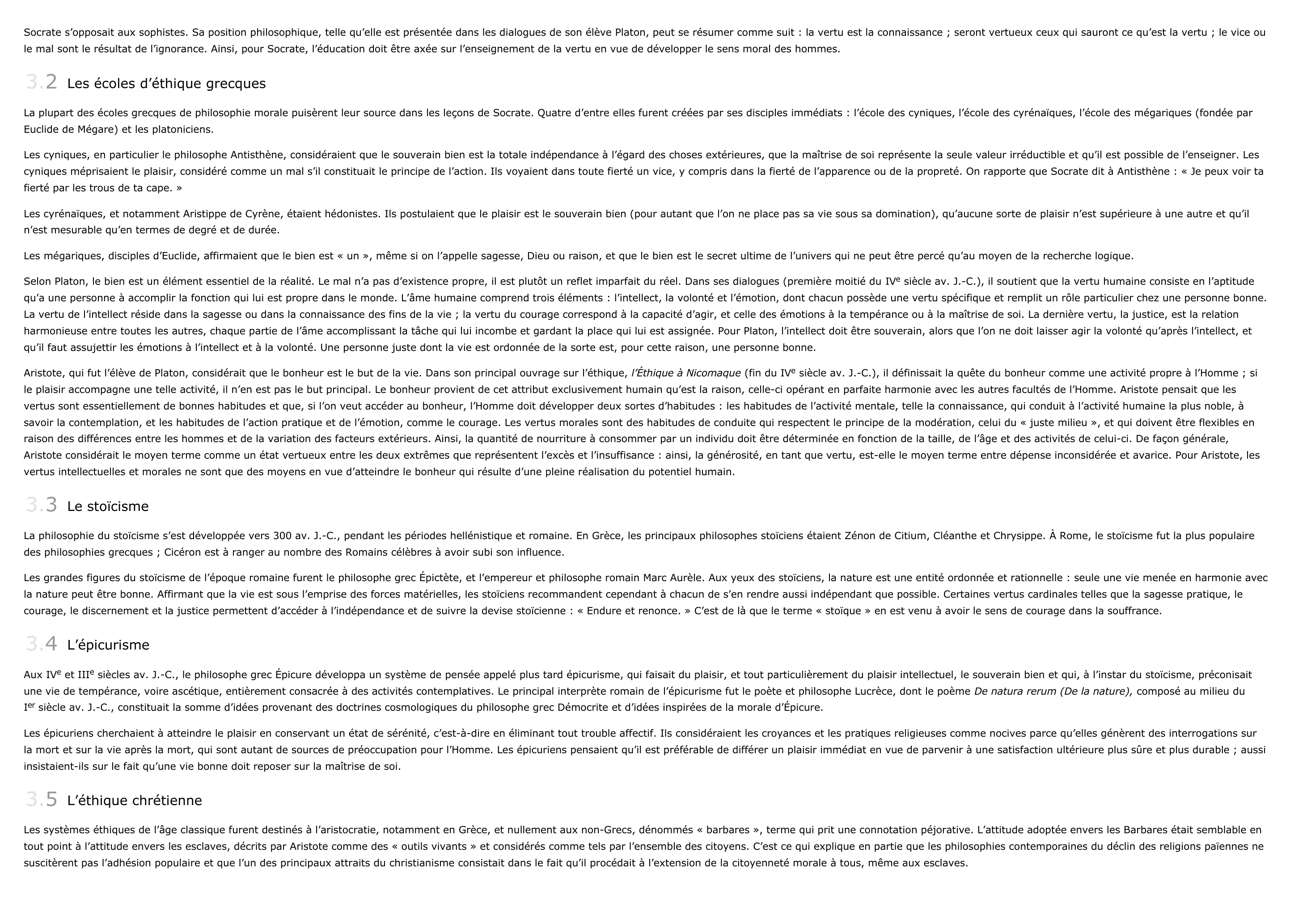éthique - sciences et techniques. 1 PRÉSENTATION éthique (du grec ethos, « coutume «, « usage «, « caractère «), principes ou critères d'évaluation de la conduite humaine, parfois appelés moeurs (latin mores) et, par extension, étude de tels principes. Le terme latin ethica désigne la philosophie morale, qui relève des sciences sociales, par opposition aux sciences exactes (mathématiques, logique) et aux sciences empiriques (chimie, physique). Axée sur le concept de responsabilité, l'éthique s'inscrit dans l'histoire des idées. La philosophie grecque la conçut comme une réflexion sur la recherche du bonheur, alors que la pensée chrétienne fit de l'amour son fondement. L'époque contemporaine en a renouvelé l'approche en intégrant dans l'éthique les interrogations sur le développement des différentes branches du savoir. Cette évolution se justifie à cause de l'impossibilité, soulignée par Albert Jacquard dans sa Petite Philosophie à l'usage des non-philosophes (1997), de mesurer les conséquences des progrès des sciences et des techniques, notamment dans le domaine de la physique nucléaire, de la génétique ou de la communication. Robert Misrahi propose dans la Signification de l'éthique (1995) de définir la discipline comme « l'ensemble des principes purement humains qui devraient permettre au plus grand nombre d'accéder à une existence pleinement satisfaisante et pleinement significative, c'est-àdire à une réalisation heureuse de la personnalité «. 2 PRINCIPES ÉTHIQUES Les philosophes ont cherché à définir la valeur positive ou négative de la conduite humaine en se rapportant à deux principes majeurs : ils ont considéré certains types de conduite comme bons en soi ou bons parce que conformes à une norme morale particulière. Le premier type de conduite est choisi en vertu d'une valeur fondamentale (summum bonum), c'est-à-dire désirable en soi, il n'est donc pas conçu comme un moyen pour arriver à une fin. Dans l'histoire de l'éthique, on trouve trois critères de conduite du second type qui ont été tenus chacun pour le souverain bien par différents groupes ou individus : le bonheur ou le plaisir ; le devoir, la vertu ou l'obligation ; la perfection, le développement le plus parfaitement harmonieux du potentiel humain. L'autorité à laquelle doit obéir la conduite humaine change selon les écoles de pensée : la volonté divine, les lois de la nature et les règles de la raison apparaissent tour à tour comme le fondement de la régulation morale. Pour la pensée religieuse, selon laquelle la volonté divine représente l'autorité suprême, les actions humaines doivent obéir aux commandements consignés dans les textes sacrés. Pour les tenants de la théorie du droit naturel, qui accordent la même autorité à la nature qu'à Dieu, il convient de juger le comportement des individus selon sa conformité à la nature humaine. Pour le rationalisme, enfin, qui s'en remet aux facultés intellectuelles de l'Homme pour distinguer le Bien du Mal, les choix moraux doivent être dictés par la raison humaine. Certains principes moraux ne font pas appel à des valeurs fondamentales, car les adeptes du relativisme moral sont convaincus que toute tentative d'établir de telles valeurs est vouée à l'échec. Ce type de doctrine morale, qui érige l'épanouissement naturel de l'Homme en souverain bien, considère la sagesse, le plaisir ou le pouvoir comme la seule source de la satisfaction naturelle de l'Homme. L'hédonisme est la philosophie qui enseigne que le souverain bien est le plaisir. L'hédoniste doit faire un choix entre les plaisirs les plus durables et les plaisirs les plus intenses ; il doit décider s'il est souhaitable de refuser des plaisirs immédiats par égard pour le bien général et si les plaisirs intellectuels sont préférables aux plaisirs physiques. De nombreux courants philosophiques présentent la quête du pouvoir comme une inclination naturelle de l'Homme. Pour eux, les individus se livrent en fait une lutte sans merci pour s'accaparer les biens matériels et pour assujettir leurs semblables (Hobbes), sans se soucier des préceptes moraux (Machiavel). La morale catholique et les idéologies égalitaires (rousseauisme, marxisme), qui condamnent la poursuite des intérêts privés susceptibles de nuire à autrui et à la communauté, prônent le renoncement au pouvoir, considérant celui-ci comme dégradant et étranger à la nature humaine. 3 HISTOIRE Du jour où les Hommes vécurent en groupes, une régulation morale du comportement devint nécessaire au bien-être du groupe. Bien que les moeurs aient été formalisées et transformées en critères de conduite arbitraires, elles évoluèrent, parfois irrationnellement, à la suite de violations de tabous religieux ou, par hasard, lorsqu'un comportement d'abord devenu habituel se transforma en coutume, ou encore en raison des lois que les chefs imposèrent à leurs tribus pour prévenir la discorde. Même les grandes civilisations anciennes d'Égypte et de Sumer n'ont pas élaboré une éthique systématisée. Aux maximes et préceptes consignés par les chefs séculiers comme Ptahhotep se mêlait une religion stricte qui façonnait le comportement de tout Égyptien. Dans la Chine ancienne, les maximes de Confucius devinrent un code moral reconnu. À partir du VIe siècle av. J.-C., les philosophes grecs ont consacré une large part de leurs théories au comportement moral, contribuant ainsi au futur essor de l'éthique en tant que philosophie. 3.1 Les premières éthiques grecques Au VIe siècle av. J.-C., Pythagore élabora l'une des plus anciennes philosophies morales à partir de l'orphisme. Persuadé que la nature intellectuelle est supérieure à la nature sensuelle, et que la meilleure vie est une vie consacrée à la discipline mentale, il fonda un ordre semi-religieux dont les règles préconisaient la simplicité du parler, du vêtement et de la nourriture. Les rituels auxquels étaient soumis les membres furent conçus dans le but de rendre manifestes les croyances éthiques prescrites. Au Ve siècle av. J.-C., les philosophes grecs, connus sous le nom de sophistes qui enseignaient la rhétorique, la logique et l'éducation civique, furent sceptiques à l'égard des principes moraux absolus. Le sophiste Protagoras considérait que le jugement humain est subjectif et que la perception d'un individu n'a de valeur que pour celui-ci. Gorgias alla même jusqu'à défendre l'idée extrême que rien n'existe : s'il existait quoi que ce soit, les êtres humains ne pourraient le connaître ; s'ils le connaissaient, ils ne pourraient pas communiquer cette connaissance. D'autres sophistes, comme Thrasymaque, se laissèrent gagner à cette thèse. Socrate s'opposait aux sophistes. Sa position philosophique, telle qu'elle est présentée dans les dialogues de son élève Platon, peut se résumer comme suit : la vertu est la connaissance ; seront vertueux ceux qui sauront ce qu'est la vertu ; le vice ou le mal sont le résultat de l'ignorance. Ainsi, pour Socrate, l'éducation doit être axée sur l'enseignement de la vertu en vue de développer le sens moral des hommes. 3.2 Les écoles d'éthique grecques La plupart des écoles grecques de philosophie morale puisèrent leur source dans les leçons de Socrate. Quatre d'entre elles furent créées par ses disciples immédiats : l'école des cyniques, l'école des cyrénaïques, l'école des mégariques (fondée par Euclide de Mégare) et les platoniciens. Les cyniques, en particulier le philosophe Antisthène, considéraient que le souverain bien est la totale indépendance à l'égard des choses extérieures, que la maîtrise de soi représente la seule valeur irréductible et qu'il est possible de l'enseigner. Les cyniques méprisaient le plaisir, considéré comme un mal s'il constituait le principe de l'action. Ils voyaient dans toute fierté un vice, y compris dans la fierté de l'apparence ou de la propreté. On rapporte que Socrate dit à Antisthène : « Je peux voir ta fierté par les trous de ta cape. « Les cyrénaïques, et notamment Aristippe de Cyrène, étaient hédonistes. Ils postulaient que le plaisir est le souverain bien (pour autant que l'on ne place pas sa vie sous sa domination), qu'aucune sorte de plaisir n'est supérieure à une autre et qu'il n'est mesurable qu'en termes de degré et de durée. Les mégariques, disciples d'Euclide, affirmaient que le bien est « un «, même si on l'appelle sagesse, Dieu ou raison, et que le bien est le secret ultime de l'univers qui ne peut être percé qu'au moyen de la recherche logique. Selon Platon, le bien est un élément essentiel de la réalité. Le mal n'a pas d'existence propre, il est plutôt un reflet imparfait du réel. Dans ses dialogues (première moitié du IVe siècle av. J.-C.), il soutient que la vertu humaine consiste en l'aptitude qu'a une personne à accomplir la fonction qui lui est propre dans le monde. L'âme humaine comprend trois éléments : l'intellect, la volonté et l'émotion, dont chacun possède une vertu spécifique et remplit un rôle particulier chez une personne bonne. La vertu de l'intellect réside dans la sagesse ou dans la connaissance des fins de la vie ; la vertu du courage correspond à la capacité d'agir, et celle des émotions à la tempérance ou à la maîtrise de soi. La dernière vertu, la justice, est la relation harmonieuse entre toutes les autres, chaque partie de l'âme accomplissant la tâche qui lui incombe et gardant la place qui lui est assignée. Pour Platon, l'intellect doit être souverain, alors que l'on ne doit laisser agir la volonté qu'après l'intellect, et qu'il faut assujettir les émotions à l'intellect et à la volonté. Une personne juste dont la vie est ordonnée de la sorte est, pour cette raison, une personne bonne. Aristote, qui fut l'élève de Platon, considérait que le bonheur est le but de la vie. Dans son principal ouvrage sur l'éthique, l'Éthique à Nicomaque (fin du IVe siècle av. J.-C.), il définissait la quête du bonheur comme une activité propre à l'Homme ; si le plaisir accompagne une telle activité, il n'en est pas le but principal. Le bonheur provient de cet attribut exclusivement humain qu'est la raison, celle-ci opérant en parfaite harmonie avec les autres facultés de l'Homme. Aristote pensait que les vertus sont essentiellement de bonnes habitudes et que, si l'on veut accéder au bonheur, l'Homme doit développer deux sortes d'habitudes : les habitudes de l'activité mentale, telle la connaissance, qui conduit à l'activité humaine la plus noble, à savoir la contemplation, et les habitudes de l'action pratique et de l'émotion, comme le courage. Les vertus morales sont des habitudes de conduite qui respectent le principe de la modération, celui du « juste milieu «, et qui doivent être flexibles en raison des différences entre les hommes et de la variation des facteurs extérieurs. Ainsi, la quantité de nourriture à consommer par un individu doit être déterminée en fonction de la taille, de l'âge et des activités de celui-ci. De façon générale, Aristote considérait le moyen terme comme un état vertueux entre les deux extrêmes que représentent l'excès et l'insuffisance : ainsi, la générosité, en tant que vertu, est-elle le moyen terme entre dépense inconsidérée et avarice. Pour Aristote, les vertus intellectuelles et morales ne sont que des moyens en vue d'atteindre le bonheur qui résulte d'une pleine réalisation du potentiel humain. 3.3 Le stoïcisme La philosophie du stoïcisme s'est développée vers 300 av. J.-C., pendant les périodes hellénistique et romaine. En Grèce, les principaux philosophes stoïciens étaient Zénon de Citium, Cléanthe et Chrysippe. À Rome, le stoïcisme fut la plus populaire des philosophies grecques ; Cicéron est à ranger au nombre des Romains célèbres à avoir subi son influence. Les grandes figures du stoïcisme de l'époque romaine furent le philosophe grec Épictète, et l'empereur et philosophe romain Marc Aurèle. Aux yeux des stoïciens, la nature est une entité ordonnée et rationnelle : seule une vie menée en harmonie avec la nature peut être bonne. Affirmant que la vie est sous l'emprise des forces matérielles, les stoïciens recommandent cependant à chacun de s'en rendre aussi indépendant que possible. Certaines vertus cardinales telles que la sagesse pratique, le courage, le discernement et la justice permettent d'accéder à l'indépendance et de suivre la devise stoïcienne : « Endure et renonce. « C'est de là que le terme « stoïque « en est venu à avoir le sens de courage dans la souffrance. 3.4 L'épicurisme Aux IVe et IIIe siècles av. J.-C., le philosophe grec Épicure développa un système de pensée appelé plus tard épicurisme, qui faisait du plaisir, et tout particulièrement du plaisir intellectuel, le souverain bien et qui, à l'instar du stoïcisme, préconisait une vie de tempérance, voire ascétique, entièrement consacrée à des activités contemplatives. Le principal interprète romain de l'épicurisme fut le poète et philosophe Lucrèce, dont le poème De natura rerum (De la nature), composé au milieu du Ier siècle av. J.-C., constituait la somme d'idées provenant des doctrines cosmologiques du philosophe grec Démocrite et d'idées inspirées de la morale d'Épicure. Les épicuriens cherchaient à atteindre le plaisir en conservant un état de sérénité, c'est-à-dire en éliminant tout trouble affectif. Ils considéraient les croyances et les pratiques religieuses comme nocives parce qu'elles génèrent des interrogations sur la mort et sur la vie après la mort, qui sont autant de sources de préoccupation pour l'Homme. Les épicuriens pensaient qu'il est préférable de différer un plaisir immédiat en vue de parvenir à une satisfaction ultérieure plus sûre et plus durable ; aussi insistaient-ils sur le fait qu'une vie bonne doit reposer sur la maîtrise de soi. 3.5 L'éthique chrétienne Les systèmes éthiques de l'âge classique furent destinés à l'aristocratie, notamment en Grèce, et nullement aux non-Grecs, dénommés « barbares «, terme qui prit une connotation péjorative. L'attitude adoptée envers les Barbares était semblable en tout point à l'attitude envers les esclaves, décrits par Aristote comme des « outils vivants « et considérés comme tels par l'ensemble des citoyens. C'est ce qui explique en partie que les philosophies contemporaines du déclin des religions païennes ne suscitèrent pas l'adhésion populaire et que l'un des principaux attraits du christianisme consistait dans le fait qu'il procédait à l'extension de la citoyenneté morale à tous, même aux esclaves. L'apparition du christianisme marqua une révolution en morale, dans la mesure où elle introduisit une conception religieuse du bien dans la pensée occidentale. Dans la perspective chrétienne, l'Homme dépendait entièrement de Dieu et ne pouvait parvenir à l'excellence ni au moyen de la volonté, ni au moyen de l'intelligence, mais seulement avec l'aide de la grâce divine. La doctrine de la morale chrétienne primitive établit plusieurs règles d'or : « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous « (Évangile selon saint Matthieu, VII, 12), formule des injonctions d'aimer son prochain comme soi-même (Lévitique, XIX, 18), d'aimer ses ennemis (Évangile selon saint Matthieu, V, 44) et ordonne selon la parole de Jésus : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu « (Évangile selon saint Matthieu, XXII, 21). Jésus pensait que le sens de la loi juive était pour l'essentiel contenu dans le commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même « (Évangile selon saint Luc, X, 27). Le christianisme primitif insistait sur les valeurs telles que l'ascétisme, le martyre, la foi, l'indulgence, le pardon, la chasteté -- autant de vertus considérées souvent comme centrales par les philosophes grecs et romains de l'Antiquité. 3.6 L'éthique des Pères de l'Église L'éthique chrétienne se constitua dans un contexte intellectuel marqué par la rivalité que le christianisme entretenait avec le manichéisme, religion d'origine perse, qui voyait dans le bien et le mal (la lumière et l'obscurité) des forces opposées engagées dans la conquête du monde. Le manichéisme connut un immense retentissement aux IIIe et IVe siècles. Saint Augustin, que l'on considère comme le fondateur de la théologie chrétienne, était à l'origine un adepte du manichéisme, qu'il abandonna sous l'influence de la pensée platonicienne. Après s'être converti au christianisme en 387, il chercha à intégrer les conceptions platoniciennes au concept chrétien de bien, conçu en tant qu'attribut de Dieu, et à celui du péché, représenté par la chute d'Adam dont la culpabilité est rachetée en l'Homme par la miséricorde de Dieu. La croyance manichéenne dans le mal ne fut pas ébranlée pour autant : saint Augustin lui-même demeura convaincu que la nature humaine est foncièrement marquée par le péché. Cette conviction qui l'emporta dans le christianisme primitif peut expliquer en partie l'importance que celui-ci accordait à la chasteté et au célibat. À la fin du Moyen Âge, les oeuvres d'Aristote, que les textes et commentaires d'érudits arabes avaient rendu disponibles, exercèrent une influence considérable sur la pensée européenne. En opposant la connaissance empirique à la révélation, l'aristotélisme menaçait l'autorité intellectuelle de l'Église. Le théologien chrétien saint Thomas d'Aquin parvint néanmoins à réconcilier l'aristotélisme avec l'autorité de l'Église en reconnaissant à la fois la vérité de l'expérience sensorielle et sa complémentarité avec la vérité de la foi. C'est ainsi que la grande autorité intellectuelle d'Aristote fut mise au service de l'autorité de l'Église, et que la logique aristotélicienne fut utilisée pour défendre les concepts de péché originel et de rédemption par la grâce divine. Cette synthèse constitue la substance de l'oeuvre majeure de saint Thomas d'Aquin, Summa theologica (Somme théologique, 1266-1273). 3.7 Éthique et pénitence Au fur et à mesure que s'accroissait le pouvoir de l'Église médiévale, le système éthique évolua, sanctionnant de punitions le péché, et de récompenses après la mort la vie vertueuse. Les plus hautes vertus étaient l'humilité, la continence, la bienfaisance et l'obédience. L'intériorité, ou bonté de l'esprit, était indispensable à la moralité. Toutes les actions, bonnes et mauvaises, furent hiérarchisées par l'Église, qui institua un système de pénitence temporelle pour l'expiation des péchés. Les croyances morales de l'Église médiévale trouvèrent une expression littéraire dans la Divine Comédie de Dante, qui fut influencé par les philosophies de Platon, d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Dans la partie de la Divine Comédie intitulée « Enfer «, Dante ordonne les péchés en trois catégories principales, elles-mêmes divisées en sous-catégories. Dans l'ordre croissant du mal, il place en tête les péchés d'incontinence (péchés sensuels ou émotionnels), suivis de la violence ou de la bestialité (péchés de la volonté) et de la fraude ou de la malveillance (péchés de l'intellect). Il s'agit donc d'une reprise des trois facultés établies par Platon dans leur ordre d'importance, les péchés étant considérés comme la corruption de l'une ou l'autre de ces facultés. 3.8 L'éthique après la Réforme L'influence des croyances et pratiques chrétiennes faiblit durant la Renaissance. La Réforme protestante opéra un puissant retour aux principes de base de la tradition chrétienne, mettant l'accent sur certaines conceptions existantes et introduisant de nouvelles idées. Selon Martin Luther, la bonté de l'esprit est l'essence de la piété chrétienne. Si la conduite morale ou les bonnes oeuvres sont exigées du chrétien, le salut ne vient que par la foi, et la rédemption par la grâce. Luther lui-même se maria et le célibat cessa d'être imposé au clergé protestant. Jean Calvin acceptait la doctrine théologique du salut par la seule foi et maintenait la doctrine augustinienne du péché originel. Les puritains étaient calvinistes et adhéraient aux thèses de Calvin en faveur de la sobriété, de la diligence, de l'économie et de l'absence d'ostentation. La contemplation n'était à leurs yeux que pure paresse et la pauvreté, soit la punition du péché, soit la preuve de l'absence de grâce divine. Les puritains croyaient que seuls les élus pouvaient attendre le salut. Ils se considéraient eux-mêmes comme élus mais ne pouvaient en avoir la certitude à moins d'en avoir reçu un signe. Ils jugeaient leur mode de vie conforme à l'éthique et propre à leur assurer la prospérité sur terre. Aussi la prospérité matérielle était-elle considérée comme un signe. La bonté en vint ainsi à être associée à la richesse, et la pauvreté au mal. L'échec d'une vocation semblait être le signe évident du refus de l'assentiment divin. La conduite qui avait été censée ouvrir la voie à la sainteté mena les descendants des puritains à la richesse terrestre. Dans l'ensemble, pendant la Réforme, la responsabilité individuelle avait plus d'importance que l'obéissance à l'autorité ou à la tradition. Ce déplacement d'accent qui a indirectement conduit au développement de l'éthique séculière moderne est illustré dans De jure belli ac pacis (« Sur le droit en temps de guerre et en temps de paix «, 1625) de Hugo Grotius. Bien que son oeuvre adhère à certaines doctrines de saint Thomas, elle traite des devoirs politiques et civils de l'Homme dans l'esprit de l'ancienne loi romaine. Grotius avançait que le droit naturel fait partie de la loi divine et qu'il est fondé sur la nature humaine, dans laquelle il voyait un désir d'association pacifique avec les autres et une tendance à se conduire selon des principes généraux. Il trouvait donc normal que la société soit fondée sur la loi naturelle. 3.9 Les philosophies morales séculières Dans le Léviathan (1651), Thomas Hobbes accorde la plus grande importance à la société organisée et au pouvoir politique. Il soutient que la vie humaine « à l'état de nature « (en dehors de l'institution de l'État ou antérieurement à celui-ci) est « solitaire, pauvre, dangereuse, bestiale et courte « et que c'est l'état de « guerre de tous contre tous «. En conséquence, les hommes recherchent la sécurité en passant un contrat social dans lequel chacun renonce à son pouvoir originel en faveur d'un souverain qui règle la conduite de chacun. Cette position conservatrice en politique présuppose que les hommes sont mauvais par nature et qu'ils doivent être soumis à la répression exercée par un État fort. Néanmoins, Hobbes affirmait que si un souverain incapable d'assurer la sécurité et l'ordre est détrôné par ses sujets, ceux-ci retournent à l'état de nature et concluent alors un nouveau contrat social. La doctrine de Hobbes relative à l'État et au contrat social a influencé la pensée de John Locke. Dans ses Deux Traités sur le gouvernement (1690), Locke soutient cependant que le contrat social a pour but de réduire le pouvoir absolu de l'autorité et de favoriser la liberté individuelle. La raison humaine est le fondement d'une conduite bonne dans le système développé par Baruch Spinoza. Dans son oeuvre majeure l'Éthique démontrée selon la méthode géométrique, (Ethica ordine geometrico demonstrata, 1674), Spinoza déduit l'éthique de la psychologie, et la psychologie de la métaphysique. Il soutient la neutralité morale de toute chose du point de vue de l'éternité (« sub specie aeternitatis « ; seuls les besoins et les intérêts humains déterminent ce qui est considéré comme bon ou mal, juste ou faux. Tout ce qui aide l'humanité à connaître la nature ou tout ce qui est en accord avec la raison humaine est reconnu comme bon. Comme on peut raisonnablement supposer que ce que les hommes ont en commun est aussi ce qui est le meilleur pour chacun d'eux, le bien auquel ils devraient aspirer pour les autres est le bien auquel ils aspirent pour eux-mêmes. La raison est en outre nécessaire pour tenir les passions en échec et pour connaître le plaisir et le bonheur en évitant la douleur. Aux yeux de Spinoza, l'état suprême pour l'Homme est l'« amour intellectuel de Dieu « dérivé de l'entendement intuitif, cette faculté supérieure à la raison ordinaire. L'usage adéquat de cette faculté permet de contempler la totalité de l'univers mental et physique, et de comprendre qu'il contient une substance infinie que Spinoza nomme « Dieu «. 3.9.1 Les lois de Newton La plupart des découvertes scientifiques majeures eurent des répercussions sur l'éthique. Les découvertes d'Isaac Newton au XVIIe siècle furent parmi les premières à en fournir un des exemples les plus éloquents. Les lois de Newton étaient généralement considérées comme la preuve de la rationalité de l'ordre divin. Ce sont les découvertes de Newton qui entraînèrent les philosophes à faire confiance à un système éthique aussi rationnel et ordonné qu'était supposée l'être la nature. 3.9.2 Les philosophies morales avant le darwinisme Au XVIIIe siècle, David Hume, dans ses Essais moraux et politiques (1741-1742) et Adam Smith, qui fut par ailleurs le défenseur de la théorie économique du « laisser-faire «, dans sa Théorie des sentiments moraux (1759), ont élaboré des systèmes de morale subjective similaires. Ils assimilaient tous deux le bien à tout ce qui suscitait des sentiments de satisfaction et le mal à tout ce qui suscitait des sentiments douloureux. Pour Hume et pour Smith, les idées relatives à la morale et à l'intérêt public proviennent des sentiments de sympathie que les hommes se portent mutuellement même en dehors de liens de parenté ou d'autres liens directs. En France, Jean-Jacques Rousseau adhéra, dans son oeuvre majeure intitulée Du contrat social (1762), à la théorie hobbienne. Cependant, dans Émile (1762) et dans d'autres ouvrages, il attribue le mal aux anomalies inhérentes à toute organisation sociale et juge les hommes bons par nature. L'anarchiste, philosophe, romancier et économiste politique britannique William Godwin a poussé cette idée à l'extrême dans son Enquête sur la justice politique (1793), où il rejette toutes les institutions sociales, y compris celle de l'État, considérant que par leur existence même, elles constituent une source du mal. Opérant une « révolution copernicienne « en philosophie, Emmanuel Kant apporta une contribution majeure à l'éthique avec le Fondement de la métaphysique des moeurs (1785). Pour Kant, aussi judicieusement que l'on agisse, les résultats des actions humaines sont exposés aux accidents et aux aléas. Par conséquent, il ne faut pas juger la moralité d'un acte par ses conséquences mais seulement par la motivation qui y a présidé. Seule est bonne l'intention parce qu'elle conduit l'Homme à agir non par inclination mais par devoir, lequel repose sur un principe général qui est juste en soi. Quant au principe moral de base, Kant reprend la règle d'or sous une forme logique : « Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. « Cette règle est appelée impératif catégorique, parce qu'elle est inconditionnelle et qu'elle a la forme d'un commandement. Aussi, Kant insiste-t-il sur le fait que l'on doit traiter autrui « en toute circonstance comme une fin et jamais seulement comme un moyen «. 3.9.3 L'utilitarisme La doctrine morale et politique connue sous le nom d'utilitarisme fut formulée par Jeremy Bentham vers la fin du XVIIIe siècle et exposée plus tard par James Mill ainsi que par son fils John Stuart Mill. Dans son Introduction aux principes de morale et de législation (1789), Bentham présente le principe d'utilité comme le moyen d'augmenter le bonheur de la communauté. Il pensait que toute action est motivée par le désir de procurer du plaisir et d'éviter la douleur. L'utilitarisme étant un hédonisme universel et non pas égoïste comme l'épicurisme, il considérait le plus grand bonheur du plus grand nombre comme le bien suprême. 3.9.4 L'éthique hégélienne G. W. F. Hegel, dans les Principes de la philosophie du droit (1821), reprit à son compte l'impératif catégorique de Kant en le plaçant dans une théorie universelle de l'évolution qui conçoit toute l'histoire comme une succession de stades menant vers la manifestation d'une réalité fondamentale à la fois spirituelle et rationnelle. Pour Hegel, la morale n'est pas le résultat d'un contrat social mais relève d'un développement naturel qui prend son essor dans la famille et culmine historiquement dans l'État prussien de son temps. L'histoire du monde, selon Hegel, se développe sous l'impulsion d'une volonté naturelle incontrôlée, qui obéit à un principe universel et qui la dirige vers la liberté subjective. Søren Kierkegaard s'opposa violemment au système hégélien. Dans Ou bien ... ou bien, (1843), il exposa ce qu'il considérait comme le principal problème en éthique, à savoir celui du choix. Il était convaincu que les systèmes philosophiques comme celui de Hegel obscurcissaient ce problème crucial en lui donnant l'apparence d'un problème objectif, susceptible d'être résolu universellement, au lieu de le présenter comme un problème subjectif auquel chacun est confronté individuellement. Le choix personnel de Kierkegaard a consisté à vivre à l'intérieur du cadre de l'éthique chrétienne. En insistant sur la nécessité du choix, il influença plusieurs philosophes associés au mouvement de l'existentialisme, ainsi qu'un certain nombre de philosophes juifs et chrétiens. 3.9.5 L'éthique après Darwin Après l'ère newtonienne, la découverte scientifique qui marqua le plus l'éthique fut la théorie de l'évolution élaborée par Charles Darwin. Les découvertes de Darwin fournirent un appui au système nommé parfois éthique évolutionniste que défendait le philosophe britannique Herbert Spencer. Pour celui-ci, la morale n'est rien d'autre que le résultat de certaines habitudes acquises par l'humanité au cours de l'évolution. On doit à Friedrich Nietzsche une interprétation surprenante mais logique de la thèse darwinienne selon laquelle la survie des plus forts est la loi fondamentale de la nature. Le philosophe allemand affirmait que ce que l'on appelle la conduite morale n'est nécessaire qu'aux faibles. La conduite morale -- en particulier celle que préconise l'éthique judéo-chrétienne qui, pour Nietzsche, est une morale d'esclave -- tend à autoriser le faible à empêcher le fort de se réaliser. Pour Nietzsche, chaque action devrait être orientée vers le développement de l'individu supérieur, l'Übermensch (« surhomme «) qu'il appelle de ses voeux et qu'il décrit comme le seul type d'Homme capable de réaliser dans l'avenir les plus nobles possibilités de la vie. Nietzsche trouvait les meilleurs exemples de cet individu idéal dans chacun des philosophes grecs antérieurs à Socrate ainsi que dans les dictateurs militaires tels que Jules César et Napoléon. Opposé à la thèse qui fait de la lutte impitoyable et incessante la loi de la nature, le prince Petr Kropotkine, théoricien anarchiste et réformateur russe, présenta, entre autres, des études sur le comportement des animaux vivant en liberté qui révèlent le rôle de l'entraide dans la nature. Kropotkine soutenait que l'entraide favorise la survie de l'espèce et que les êtres humains ont acquis leur supériorité sur les animaux au cours de l'évolution grâce à leur capacité de coopération. Kropotkine exposa ses idées dans de nombreux ouvrages, parmi lesquels une place singulière revient à l'Entraide (1892) et à une oeuvre inachevée, l'Éthique. Persuadé que les gouvernements sont fondés sur la violence et que leur élimination permettrait aux hommes de donner libre cours à leurs instincts de coopération et d'instaurer un ordre coopératif, Kropotkine défendait l'anarchisme. Les anthropologues ont appliqué les principes évolutionnistes à l'étude des sociétés et des cultures humaines. Entreprenant des analyses comparatives portant sur les concepts du vrai et du faux, du juste et de l'injuste dans les différentes sociétés, ils contribuèrent à diffuser l'idée que la plupart de ces concepts avaient une valeur relative et non universelle. Parmi les concepts éthiques fondés sur une approche anthropologique, il faut retenir ceux de l'anthropologue finlandais Edvard A. Westermarck, auteur de la Relativité éthique (1932). 3.10 Psychanalyse et béhaviorisme L'éthique moderne est profondément influencée par la psychanalyse de Sigmund Freud et de ses disciples, ainsi que par les doctrines béhavioristes inspirées des découvertes du physiologiste russe Ivan Pavlov. Freud attribuait le problème du bien et du mal en chaque individu au conflit entre la pulsion du moi instinctuel visant à satisfaire tous ses désirs et le besoin du moi social qui consiste à contrôler ou réprimer la plupart de ces impulsions afin de permettre à l'individu de fonctionner en société. Bien que l'influence freudienne n'ait pas entièrement été assimilée par la pensée morale, la psychanalyse freudienne a montré que la culpabilité, fondamentalement sexuelle, sous-tend pour une grande part le discours sur le bien et le mal. Des philosophes contemporains comme Paul Ricoeur ont contribué à envisager la morale sous l'éclairage freudien. Par l'observation du comportement animal, le béhaviorisme renforça la croyance qu'il est possible de changer la nature humaine à condition de réunir les conditions favorables aux changements escomptés. Dans les années 1920, le béhaviorisme était largement répandu aux États-Unis, principalement dans les théories sur la pédiatrie, la formation de l'enfant et l'éducation en général. Cependant, le pays où il exerça la plus grande influence sur les consciences fut l'Union soviétique, où l'« Homme nouveau « fut forgé selon des principes béhavioristes : les esprits furent conditionnés par une propagande incessante et aucun citoyen ne devait échapper à ce contrôle mental. L'éthique soviétique identifiait le bien avec tout ce qui était favorable à l'État, et le mal avec tout ce qui s'y opposait. Dans ses écrits datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, le philosophe et psychologue américain William James devança, dans une certaine mesure, Freud et Pavlov. James est connu comme fondateur du pragmatisme, théorie pour laquelle la valeur des idées est déterminée par leurs conséquences. Mais c'est en insistant sur l'importance des relations réciproques entre les idées que James a apporté sa plus grande contribution à la théorie morale. 3.11 Tendances récentes Le philosophe britannique Bertrand Russell exerça une influence considérable sur la pensée morale au cours des dernières décennies. Critiquant violemment la morale conventionnelle, il considérait que les jugements moraux expriment des désirs individuels ou des habitudes ancrées. À ses yeux, le saint ascétique, tout comme le sage détaché du monde, sont de piètres spécimens de l'humanité parce qu'ils sont des êtres humains incomplets. Les êtres humains complets prennent pleinement part à la vie de la société et donnent libre cours à leur nature. Certaines impulsions doivent être réprimées dans l'intérêt de la société, d'autres, dans l'intérêt de l'épanouissement individuel, mais c'est la croissance naturelle et relativement libre, ainsi que la réalisation de soi, qui mènent à une vie bonne et à une société harmonieuse. Un certain nombre de philosophes du XXe siècle, dont ceux qui avaient épousé les théories de l'existentialisme, se sont penchés sur les problèmes du choix moral individuel soulevés par Kierkegaard et Nietzsche. Certains d'entre eux avaient une orientation religieuse, comme le philosophe russe Nikolaï Aleksandrovitch Berdiaiev, qui insistait sur la liberté de l'esprit individuel, ou comme le philosophe israélien d'origine autrichienne Martin Buber, qui s'intéressait à la morale dans les relations individuelles, ou comme le théologien protestant américain d'origine allemande Paul Tillich, qui insistait sur le courage d'être soi-même ; de même, le philosophe et dramaturge catholique français Gabriel Marcel et le philosophe protestant et psychiatre allemand Karl Jaspers s'intéressaient tous deux à l'unicité de l'individu et à l'importance de la communication entre individus. Une autre tendance de la pensée morale moderne se profile dans les écrits des philosophes Jacques Maritain et Étienne Gilson, qui s'inscrivent dans la tradition de saint Thomas d'Aquin. D'autres philosophes modernes n'acceptent aucune des religions traditionnelles. Martin Heidegger soutint qu'aucun Dieu n'existe, bien qu'un jour, il puisse en advenir un. Selon lui, les êtres humains sont seuls dans l'univers et doivent prendre leurs décisions morales dans la conscience perpétuelle de la mort. Jean-Paul Sartre, penseur athée, reprit la formule d'Heidegger, « l'Homme est un être pour la mort «, et développa dans l'Être et le Néant une philosophie de la liberté totale : je suis libre d'« être « ce garçon de café ou encore ce salaud que les autres voient en moi ou de ne pas l'« être «. Dans la Critique de la raison dialectique, il oriente cette optique radicale dans le sens de l'engagement : l'Homme est responsable moralement dans l'action politique et sociale. Plusieurs philosophes modernes, tel l'Américain John Dewey, se sont intéressés à l'éthique du point de vue de l'instrumentalisme. Dewey définit le bien comme ce que l'on choisit après avoir réfléchi à la fois aux moyens et aux conséquences probables de sa réalisation. La discussion philosophique contemporaine sur l'éthique a connu un prolongement dans les écrits de George Edward Moore, en particulier dans ses Principia ethica. Moore soutenait que les termes moraux sont définissables en fonction du mot bon, alors que « bon « est indéfinissable. Il en est ainsi parce que le bien est une qualité simple, non décomposable. Les philosophes en désaccord avec Moore sur ce point, qui pensent que l'on peut définir « bon «, sont appelés naturalistes ; Moore est appelé intuitionniste. Naturalistes et intuitionnistes considèrent les propositions morales comme des descriptions du monde, c'est-à-dire des propositions vraies ou fausses. Les philosophes qui récusent cette position forment une troisième grande école, le non-cognitivisme, qui considère que la morale n'est pas une forme de connaissance et que le langage de l'éthique n'est pas descriptif. Une branche importante de cette école non-cognitiviste constitue l'empirisme logique ou positivisme logique, qui interroge la validité des énoncés moraux en les comparant à des énoncés de faits ou de logique. Certains empiristes logiques soutiennent que les assertions morales n'ont qu'une signification émotionnelle ou persuasive. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.