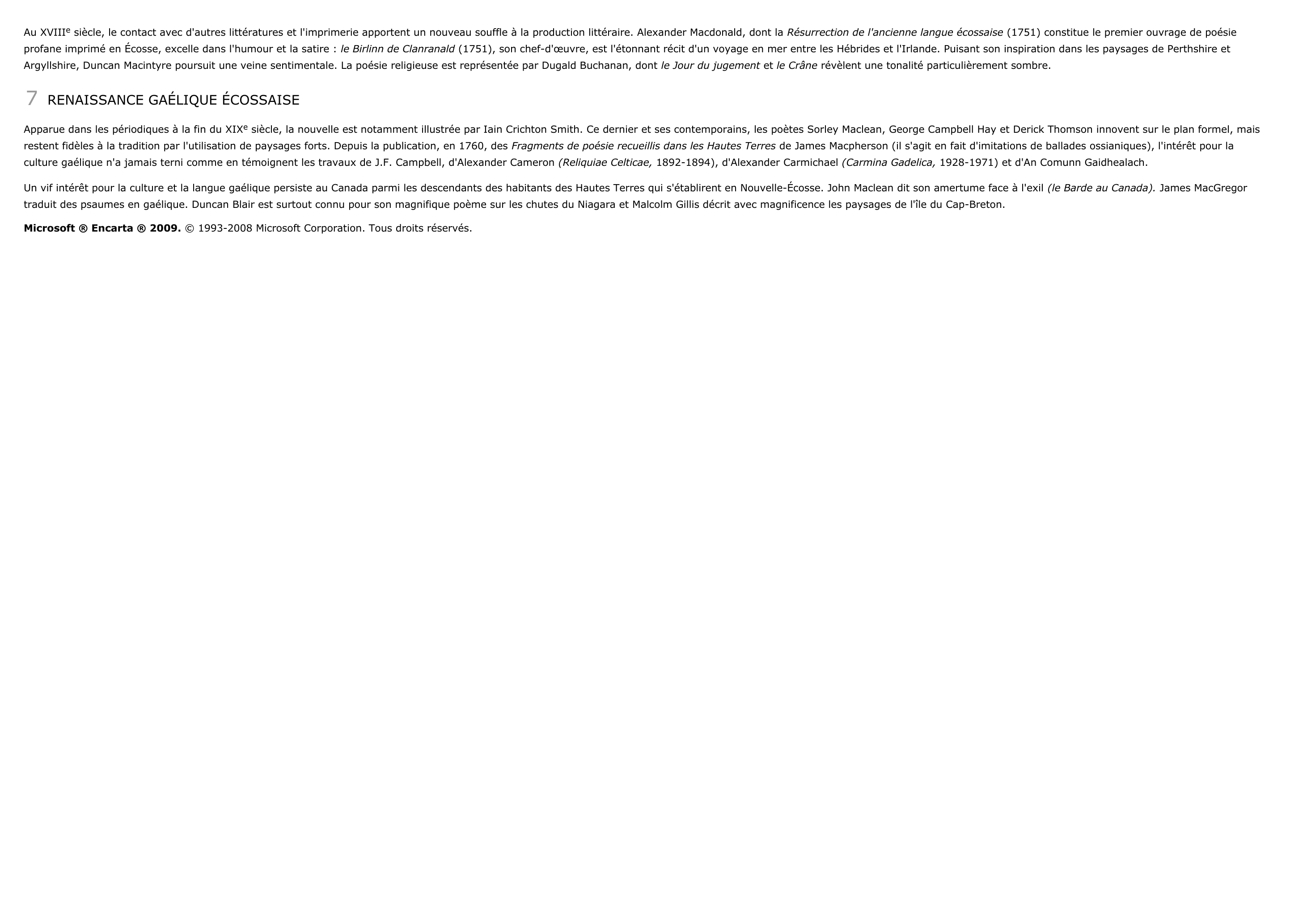gaélique, littérature.
Publié le 06/05/2013

Extrait du document
«
Au XVIII e siècle, le contact avec d'autres littératures et l'imprimerie apportent un nouveau souffle à la production littéraire.
Alexander Macdonald, dont la Résurrection de l'ancienne langue écossaise (1751) constitue le premier ouvrage de poésie
profane imprimé en Écosse, excelle dans l'humour et la satire : le Birlinn de Clanranald (1751), son chef-d'œuvre, est l'étonnant récit d'un voyage en mer entre les Hébrides et l'Irlande.
Puisant son inspiration dans les paysages de Perthshire et
Argyllshire, Duncan Macintyre poursuit une veine sentimentale.
La poésie religieuse est représentée par Dugald Buchanan, dont le Jour du jugement et le Crâne révèlent une tonalité particulièrement sombre.
7 RENAISSANCE GAÉLIQUE ÉCOSSAISE
Apparue dans les périodiques à la fin du XIX e siècle, la nouvelle est notamment illustrée par Iain Crichton Smith.
Ce dernier et ses contemporains, les poètes Sorley Maclean, George Campbell Hay et Derick Thomson innovent sur le plan formel, mais
restent fidèles à la tradition par l'utilisation de paysages forts.
Depuis la publication, en 1760, des Fragments de poésie recueillis dans les Hautes Terres de James Macpherson (il s'agit en fait d'imitations de ballades ossianiques), l'intérêt pour la
culture gaélique n'a jamais terni comme en témoignent les travaux de J.F.
Campbell, d'Alexander Cameron (Reliquiae Celticae, 1892-1894), d'Alexander Carmichael (Carmina Gadelica, 1928-1971) et d'An Comunn Gaidhealach.
Un vif intérêt pour la culture et la langue gaélique persiste au Canada parmi les descendants des habitants des Hautes Terres qui s'établirent en Nouvelle-Écosse.
John Maclean dit son amertume face à l'exil (le Barde au Canada). James MacGregor
traduit des psaumes en gaélique.
Duncan Blair est surtout connu pour son magnifique poème sur les chutes du Niagara et Malcolm Gillis décrit avec magnificence les paysages de l'île du Cap-Breton.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Littérature irlandaise DE LANGUE GAÉLIQUE et ANGLAISE
- Madame Bovary et la littérature sentimentale
- l'histoire de la littérature
- En quoi la littérature et le cinéma participent-ils à la construction de la mémoire de la Shoah ? (exemple du journal d'Hélène Berr)
- Fiche pédagogique Littérature francophone