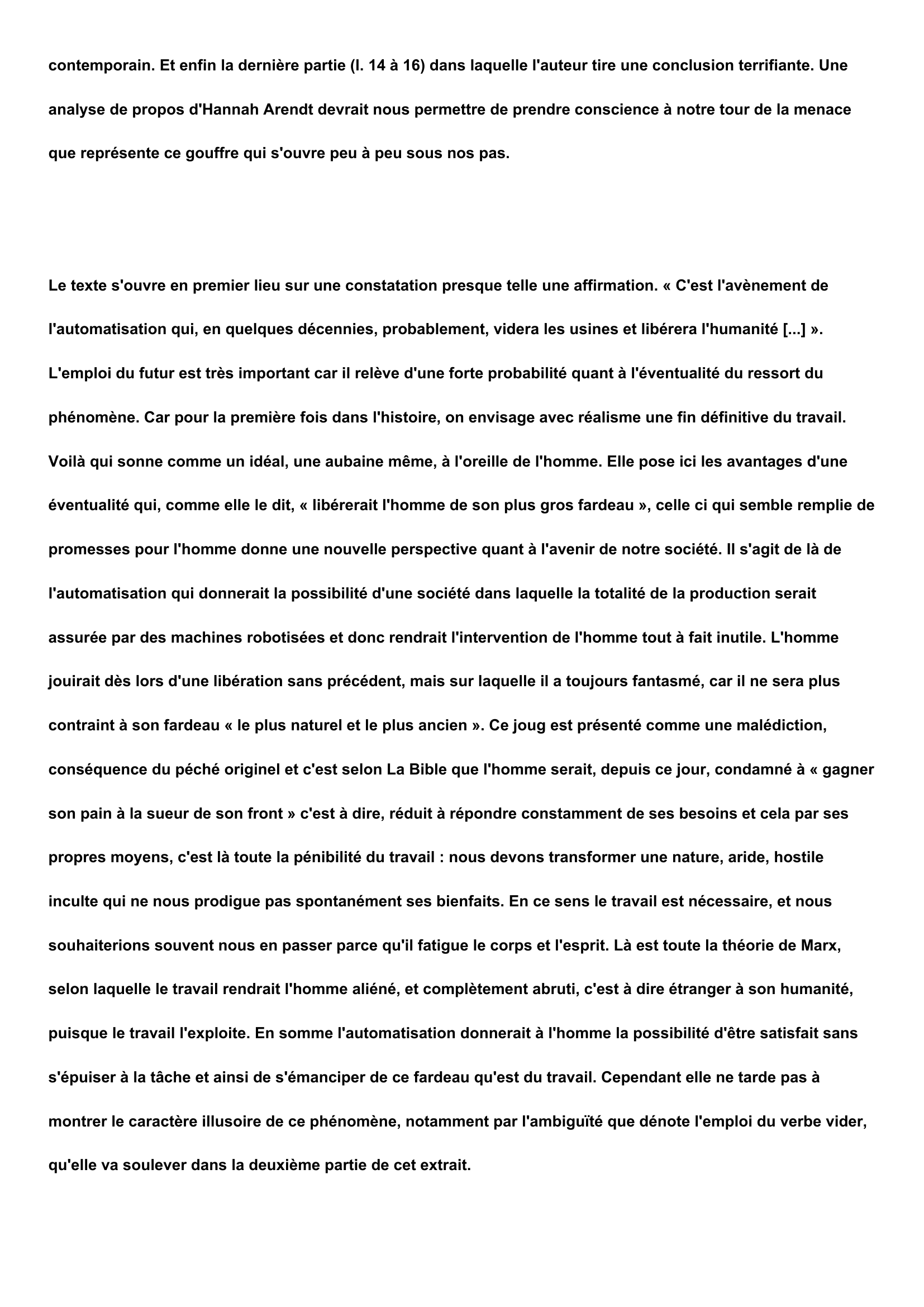Hannah Arendt évoque dans cet extrait de La Condition de l'homme moderne les conséquences qu'auraient un affranchissement définitif du travail par l’automatisation de la production. Cependant le sens qu'a pris le travail pose problème dans notre société postmoderne. Infiniment plus que dans une société où par exemple, la religion avait une place beaucoup plus importante et un pouvoir beaucoup plus puissant sur les sociétés. L'occident n'a cessé depuis – d'inculquer aux masses une définition qui vend le travail comme une, ou plutôt comme la, grande nécessité à la vie, de même que les certains sociologues tiennent pour seul discours que le travail est un facteur « d'insertion sociale «. Le paradoxe c'est que l'automatisation, abordée ici par Hannah Arendt, consiste à remplacer dans l'usine, l'ouvrier par une machine, un robot, de sorte qu'il n'y ai plus d'intervention de l'homme. Mais faudrait-il craindre une délivrance du travail sur le comportement de la société ? Si cela semble éliminer le fardeau et la contrainte que représente le travail pour l'homme comme le décrit La Bible quand elle parle d'une « malédiction « (conséquence du péché originel) mais aussi au sens grec de cette soumission à la nécessité qui oblige l’homme à travailler pour satisfaire ses besoins, il semblerait néanmoins que priver l'homme de travail serait lui ôter le sens de sa vie et ainsi l'exclure de la société. C'est ce que dit ici Arendt en soutenant que la libération du travail n'est pas une bonne idée. Pourtant c'est là tout le processus engendré depuis que le progrès technique est ; la facilitation du travail, par le progrès lui même, qui libérerait l'homme de sa malédiction, de cet asservissement. Mais ce que dénonce ici Arendt c'est ce qui pourrait nous mener vers une catastrophe sociale. Le texte se divise en trois parties : dans un premier temps (l. 1 à 4) elle énonce l'idée positive que l'on serait tenté de croire comme bénéfique : celle-ci libérerait l'homme de la nécessité ancestrale de subvenir à ses besoins vitaux en le dispensant de travailler. Mais elle s'empresse immédiatement de ruiner ce bel optimisme en montrant, dans un deuxième temps (l. 5 à 14) ce qu'impliquerait une telle libération : alors même qu'il serait libéré de l'asservissement à la nécessité du travail, l'homme serait privé de la seule activité qui lui reste, du fait de la prépondérance du travail dans le monde industriel contemporain. Et enfin la dernière partie (l. 14 à 16) dans laquelle l'auteur tire une conclusion terrifiante. Une analyse de propos d’Hannah Arendt devrait nous permettre de prendre conscience à notre tour de la menace que représente ce gouffre qui s'ouvre peu à peu sous nos pas. Le texte s'ouvre en premier lieu sur une constatation presque telle une affirmation. « C'est l'avènement de l'automatisation qui, en quelques décennies, probablement, videra les usines et libérera l'humanité [...] «. L'emploi du futur est très important car il relève d'une forte probabilité quant à l'éventualité du ressort du phénomène. Car pour la première fois dans l'histoire, on envisage avec réalisme une fin définitive du travail. Voilà qui sonne comme un idéal, une aubaine même, à l'oreille de l'homme. Elle pose ici les avantages d'une éventualité qui, comme elle le dit, « libérerait l'homme de son plus gros fardeau «, celle ci qui semble remplie de promesses pour l'homme donne une nouvelle perspective quant à l'avenir de notre société. Il s'agit de là de l'automatisation qui donnerait la possibilité d'une société dans laquelle la totalité de la production serait assurée par des machines robotisées et donc rendrait l'intervention de l'homme tout à fait inutile. L'homme jouirait dès lors d'une libération sans précédent, mais sur laquelle il a toujours fantasmé, car il ne sera plus contraint à son fardeau « le plus naturel et le plus ancien «. Ce joug est présenté comme une malédiction, conséquence du péché originel et c'est selon La Bible que l'homme serait, depuis ce jour, condamné à « gagner son pain à la sueur de son front « c'est à dire, réduit à répondre constamment de ses besoins et cela par ses propres moyens, c'est là toute la pénibilité du travail : nous devons transformer une nature, aride, hostile inculte qui ne nous prodigue pas spontanément ses bienfaits. En ce sens le travail est nécessaire, et nous souhaiterions souvent nous en passer parce qu'il fatigue le corps et l'esprit. Là est toute la théorie de Marx, selon laquelle le travail rendrait l'homme aliéné, et complètement abruti, c'est à dire étranger à son humanité, puisque le travail l'exploite. En somme l'automatisation donnerait à l'homme la possibilité d'être satisfait sans s'épuiser à la tâche et ainsi de s'émanciper de ce fardeau qu'est du travail. Cependant elle ne tarde pas à montrer le caractère illusoire de ce phénomène, notamment par l'ambiguïté que dénote l'emploi du verbe vider, qu'elle va soulever dans la deuxième partie de cet extrait. Car à vider nos usines, nous risquons de faire dérailler une société de travailleurs, c'est à dire une société que l'on a préalablement formatée à travailler. Le bien-être escompté, lié à la libération de l'homme du travail, n'a de chance d'être efficace que si l'homme trouve à s'employer à bien en dehors des usines. C'est là toute la difficulté de cette contingence qui se présente à nous. Encore faut-il que l'homme transcende la seule fonction dont on ne cesse de louer ses bienfaits comme seule et unique utilité à sa vie. C'est bien là l'hypocrisie de la chose car si il s'avère que notre société « ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. « ce n'est pas par hasard. En effet Hannah Arendt fait ici allusion à la thèse grecque par excellence, car pour l'aristocratie antique le but réel de la vie résidait dans les activités supérieurs, qui nous élevaient, comme la philosophie, la politique, les arts et même l'amitié. Bref autant d'activité synonymes de quête du plaisir de la vie heureuse et de l'accomplissement de notre humanité. C'est ce que les grecs avaient nommé le loisir. Cependant celui ci n'a plus la place conséquente et absolue qu'il avait autrefois, ce qui pourrait s'expliquer notamment par la portée du travail au sein de notre société. En devenant industrielle, elle a mis tous ses membres au travail, ne leur laissant plus le loisir de s'adonner aux activités réservées à ceux qui s’étaient libérés de la nécessité du travail, les activités de l'esprit. Quand on sait que le travail, aussi abrutissant et aliéné qu'il ne puisse être, peut demander jusqu'à 76h par semaine pour un ouvrier, le temps libre que représente le loisir, est un luxe dont l'homme ne peut plus se permettre de jouir. Il s'enferme ici dans un cercle vicieux destiné à le détourner de son humanité : vivre pour travailler, travailler pour vivre. C'est la thèse qu'expose Nietzsche quand il explique dans Aurores que « le travail est la meilleure des polices «. Le seul plaisir de se cultiver, d'apprendre, de voyager, de découvrir sont autant d'activités qui se sont éteintes avec l’avènement des valeurs marchandes dans notre société, celles du travail ayant au passage détruit les disparités entre les classes sociales, mettant alors sur un pied d'égalité toute une société. L'aristocratie et sa conception de la vie disparaissent peu à peu. C'est ce que Hannah Arendt veut signifier quand elle dit « Dans cette société qui est égalitaire, car c'est le travail qui fait vivre ensemble tous les hommes, il ne reste plus de classe, plus d'aristocratie politique et spirituelle, qui puisse provoquer une restauration des autres facultés de l'homme. « ; telles ont été les conséquences du travail sur le train de vie de notre société postmoderne, à vouloir que les uns comme les autres et que les uns pour les autres se consacrent, tous ensemble, à leur subsistance. C'est ce que l'auteur dénonce ici : à travailler, l'homme s'aliène et s'efface. Il s'efface car il oublie le loisir, en ce sens il néglige son temps libre. Elle souligne cette idée en prenant les élites d'une société comme « les présidents, les rois, les premiers ministres « symbole, à ses yeux, d'une classe dirigeante héritière de l'aristocratie antique, et dont le métier est exercé par des hommes libérés, qui ne devraient pas être concernés par cette égalisation, voir même par cette abaissement quant à l'élévation aux activités supérieures, dites nobles, c'est à dire à l'accomplissement de notre humanité, comme les grecs se plaisaient à s'y consacrer des heures durant. Il y aurait comme un processus de « désapprentissage «. Enfin dans la dernière phrase de cette deuxième partie elle tire de son analyse une triste réalité qui donne au lecteur les moyens de s'adonner à une réflexion non seulement sur la société mais aussi sur lui même. En pointant du doigt cette minorité lorsqu'elle dit « et parmi les intellectuels il ne reste que quelques solitaires pour considérer ce qu'ils font comme des œuvres et non comme un moyen de gagner leur vie. « indubitablement on pense à la thèse de Marx selon laquelle le travail ne serait devenu qu'une marchandise pour laquelle le travailleur ne vend plus le produit de son travail, mais bel et bien la force de son travail en échange d'un salaire seule motivation pour lequel l'homme travaille, dans l'unique optique de subvenir à ses besoins afin de se maintenir en vie. C'est là toute la régression, puisque le travail n'est dès lors plus un moyen d'exprimer son essence, son humanité. L'homme est exploité et en ce sens c'est le travail qui domine indéniablement la société actuelle. De plus que le choix du mot « œuvre « est plus judicieux qu'il n'y paraît. En effet il se substitue là du mot « travail «, de manière à s'en distinguer. Une œuvre et, à la différence d'un travail, une fin en soi et non un moyen. L'œuvre constitue l'accomplissement d'un travail et, dans cet accomplissement, c'est l'auteur de l'œuvre qui s'accomplit. Quand s'achève le travail d'une œuvre, il reste son auteur. Quand disparaît le « travail pour vivre «, il reste un travailleur sans emploi. « Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. « C'est là la conclusion alarmante de cet extrait qu'elle tire dans la troisième partie. En employant le terme « ce que nous avons devant nous «, elle signifie bel et bien que ce gouffre est inévitable si nous ne changeons rien au processus qui nous y amène. « Cette perspective « comme Arendt s'emploie à le dire, se fonderait sur un paradoxe singulier selon lequel notre société serait constituée d'une société de « travailleurs sans travail «. Et donc d'homme, sans plus aucune utilité sociale. Concluant ainsi son analyse et reprenant dans le même mouvement, son constat initial qui portait sur les effets de l'automatisation, Hannah Arendt met en évidence le vide sur lequel déboucherait ce progrès technique, celui d'une liberté sans emploi, qui n'est autre que l'oisiveté, source potentielle de tous les maux : la haine, la violence, comme seuls remparts, seuls langages, seuls issus à cette impasse. Car des hommes vidés, sont des hommes désespérés, angoissés et dans ces conditions, il est difficile d'échapper à la folie destructrice. Hannah Arent tire ici la sonnette d'alarme « On ne peut rien imaginer de pire. «. Si l'automatisation libérerait l'homme en lui accordant un temps libre, mais que celui ci serait incapable de le combler à bon escient, n'allons nous pas vers une catastrophe sociale ? Force est de constater que le loisir tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce que Cicéron appelait «la cultura animi « (culture de l'esprit). Le problème que nous avons à résoudre sera non seulement de réintroduire les « activités plus hautes et plus enrichissantes «, mais aussi de les revaloriser, sans pour autant restaurer un système aristocratique inégalitaire et oppressif. Comment penser une société qui combinerait ces deux exigences tout en diminuant la prépondérance du travail dans notre société. Prépondérance qui a montré les dommages qu'elle pouvait engendrer sur notre comportement. Notre siècle a totalement transformé le statut de l'homme ; celui-ci est désormais un membre d'un ensemble qui le dépasse, et dont il ne peut s'échapper. Il vit dans un monde où la technique prend de plus en plus d'importance. Ce monde, qui est également celui des pires violences, de la barbarie généralisée... Dans lequel il serait risquer de priver les hommes du travail tant qu'ils se penseront eux-mêmes comme « travailleurs «. Hannah Arendt pose les bases d'une réflexion qui permettra, peut-être, de se donner les moyens d'éviter les dérapages vers la violence, en comprenant en profondeur la dimension de « l'homme moderne «.