Idées comentaire composé Mme Bovary
Publié le 31/03/2012
Extrait du document
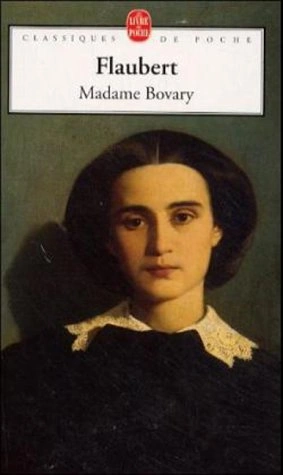
L’action se passe dans un bourg de la campagne française (Normandie) au milieu du XIXe siècle. L’apparence physique extérieure donne des indications sur le caractère et le milieu social du personnage décrit. Austère, travailleuse, de petite condition humble, mal à l’aise, craintive. Cette vieille femme qui n’a pas l’habitude des honneurs et a passé sa vie dans l’anonymat de sa fonction. Elle est en public, lors d’une grande cérémonie à son échelle, et tout le monde est tourné vers elle, l’encourage. Elle n’est pas dans son élément. Il se peut qu’elle ne comprenne pas la situation. Mme Leroux est récompensée au même titre que les vaches de prix et le meilleur fumier. Recevoir une médaille d’un prix insignifiant par rapport à une vie de dévouement semble dérisoire. Bourgeois sont épanouis, condescendants et impatientés . le contraste des costumes est frappant Les bourgeois sont venus pour l’occasion, pas pour la personne, d’où l’impatience, qui pourtant mérite leur respect. Ils ne saisissent pas l’ironie et la noirceur de la situation. Une première question pourrait conduire à s’intéresser à la façon dont sont présentés les vêtements de la servante ; le relevé des groupes nominaux (\"pauvres vêtements\", \"grosses galoches de bois\", \"grand tablier bleu\", \"béguin sans bordure\", \"camisole rouge\") conduit à mettre en évidence, dans l’identification des expansions du nom, l’importance des adjectifs qualitatifs (cinq). Dans ce corpus, il sera capital de mesurer la différence entre le premier \"pauvres\", subjectif, et qui trahit l’intervention du narrateur, et les quatre autres, objectifs. Dans un second temps, l’on examinera les lignes consacrées à la description des mains : pourquoi une telle insistance sur cette partie du corps ? Parce qu’elles sont emblématiques de la servante elle-même, parce qu’elles sont l’expression la plus évidente d’\"une vie\" (comment ne pas évoquer ici Maupassant ?). Les procédés stylistiques peuvent être aisément identifiés, tant ils sont évidents : double construction ternaire, des groupes nominaux sujets, d’abord (\"poussière des granges, la potasse des lessives et le suint des laines\"), des participes passés ensuite (\"encroûtées, éraillées, durcies\"). Mais aussi la relation cause/conséquence, qui trouve une double expression grammaticale, en premier à travers la subordonnée consécutive \"qu’elles semblaient sales\", puis à travers le groupe prépositionnel à l’infinitif \"à force d’avoir servi\". Cet examen juxtalinéaire conduit tout naturellement le bon lecteur et le prépare à un jugement sur le personnage de la servante : sa \"placidité\", son \"mutisme\", son effarouchement et son immobilité ne sont que la manifestation du déterminisme social qui domine tant de romans réalistes du XIXe siècle, de Flaubert à Maupassant, de Balzac à Hugo, l’expression, \"devant ces bourgeois réjouis\", d’\"un demi-siècle de servitude\". Là encore, nous souhaitons citer, dans les Objectifs de la classe de Troisième, l’expression \"dimension sociale et culturelle\" au sein de la \"prise en compte d’autrui, troisième direction\" : il s’agit bien de comprendre comment, au siècle précédent, le statut social détermine l’individu, dans son physique, dans son comportement, et surtout dans son caractère, et de mesurer par quels procédés un auteur peut arriver à dénoncer ce déterminisme social des \"pauvres gens\". Un écrivain aussi minutieux ne consacre pas une quinzaine de pages à un sujet sans qu'il le juge important. Que représente les Comices agricoles ? Sûrement une satire des paysans et des bourgeois - à ce titre, cette majestueuse kermesse aurait pu s'intégrer au chapitre sur le ridicule de la paysannerie et des bourgeois. Il reste qu'il s'agit d'un extrait homogène, qu'il paraît préférable de traiter spécifiquement. Deux éléments forment des harmoniques à ce morceau. Ce sont le dialogue entre Emma et Rodolphe, et d'autre part, les réactions des paysans. L'attitude des deux amants en puissance présente un effet de contre-point au discours de Lieuvain : les échanges romantiques de Roméo et Juliette pendant que le crapaud coasse. Flaubert a d'ailleurs placé les deux tourtereaux à l'étage de la mairie, surplombant, position symbolique, la foule suspendue aux paroles de Lieuvain :\"[...] Toutes les bouches de la multitude se tenaient ouvertes, comme pour boire ses paroles.\" (p. 178). Le contraste met en lumière le désir d'Emma pour Rodolphe, ce prince charmant tellement plus raffiné et romantique que la masse fade qui se gave des banalités du délégué de l'administration. L'autre élément consiste dans les réactions des paysans. L'auteur insiste pour montrer leur manque de discrimination, fascinés qu'ils sont par les clichés de l'orateur. Même, ils admireront le feu d'artifice bien qu'il soit raté. On sent même que la description de Catherine Leroux est représentative de cette foule : \"Dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité.\" (p. 184). Il demeure que le discours de Lieuvain (un vain lieu !) forme l'essentiel de ce passage. On remarque à la fois le caractère artificiel de son style et le message politique sous-jacent à ses éloges de la gente paysanne, message qui n'a rien d'innocent, mais qui se réfère à un programme politique facilement décelable à l'analyse. Les artifices du style sautent aux yeux. Les phrases lourdes et pompeuses défilent devant nos yeux. La première des celles-ci forme un paragraphe de 12 lignes ! On y trouve ce qu'on constate dans le reste de son allocution : des retours mythomaniaques sur sa propre pensée (\"Qu'il me soit permis d'abord (avant de vous entretenir de l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis sûr, sera partagé par vous tous), qu'il me soit permis, dis-je[...]\"; des comparaisons d'un goût grossier et incohérent : \"[...]et qui dirige à la fois d'une main si ferme et si sage le char de l'État parmi les périls incessants d'une mer orageuse,[...]\" (p. 178). Ou encore : \"[...]en s'endormant le soir d'un sommeil paisible, tremblaient de se voir réveillés tout à coup au bruit des tocsins incendiaires[...]\"(pp.178-179). On rencontrera aussi un abus évident du singulier collectif : l'agriculteur, le commerçant, le propriétaire, le négociant, l'ouvrier. De même, son style ampoulé le pousse même à définir la poule de la manière suivante : \"Qui n'a souvent réfléchi àtoute l'importance que l'on retire de ce modeste animal, ornement de nos basses-cours, qui fournit à la fois un oreiller moelleux pour nos couches, sa chair succulente pour nos tables, et des oeufs\" (p. 178). De même que la publicité bien orchestrée entre par notre porte, entendons : par nos désirs et intérêts, et nous conduit aux desseins mercantiles du producteur, ainsi Lieuvain livre à la foule, sous ses hommages fleuris et ses tournures alambiquées, le message de la droite politique. Il porte essentiellement sur trois points : la défense de l'état contre les forces subversives ou les armées étrangères; la soumission aux dures conditions du travail industriel; la nécessité de demeurer dans la paix et la noblesse du travail des champs, au lieu de se faire embobiner par la gauche urbaine. La conclusion s'impose : il faut aimer, chérir même le divin souverain au coeur duquel aucune des entreprises françaises n'est indifférente.
Liens utiles
- Mme Bovary commentaire composé Iere partie VIII chapitre extrait II
- Introduction d'un commentaire composé madame bovary
- Ce corpus est composé de trois extraits, Le Rouge et le Noir écrit en 1830 par Stendhal, Le père Goriot écrit en 1835 par Honoré de Balzac, Madame Bovary écrit en 1857 par Gustave Flaubert.
- Mme Bovary, une heroine complexe
- Commentaire composé sur La Princesse de Clèves, Mme de la Fayette






