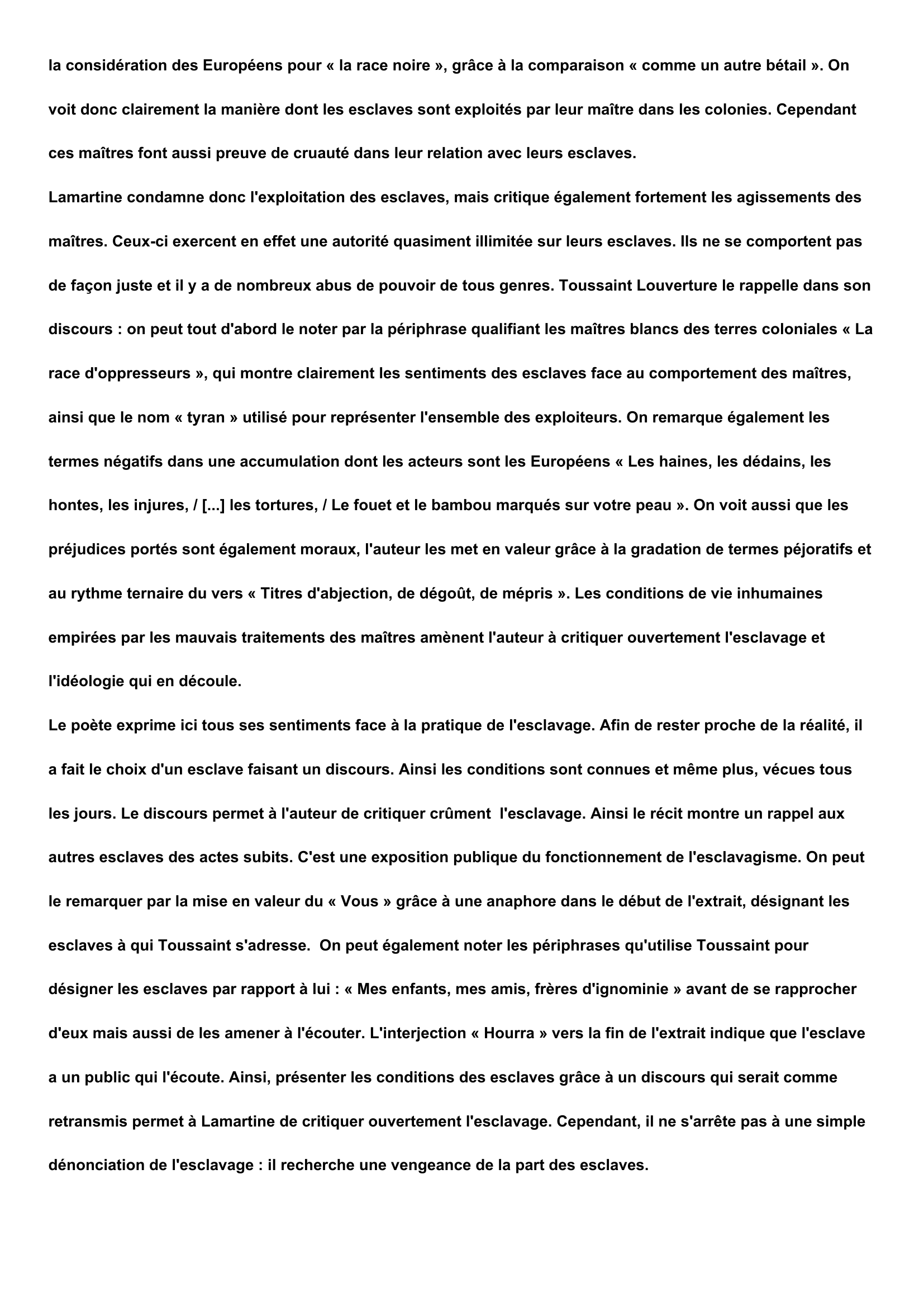La vision de l'esclavage par Lamartine
Publié le 01/11/2014

Extrait du document
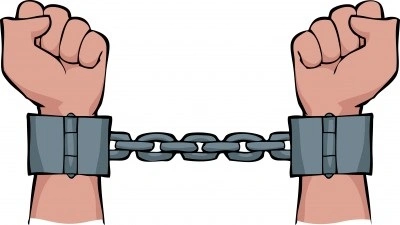
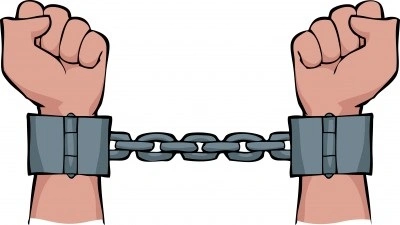
«
la considération des Européens pour « la race noire », grâce à la comparaison « comme un autre bétail ».
On
voit donc clairement la manière dont les esclaves sont exploités par leur maître dans les colonies.
Cependant
ces maîtres font aussi preuve de cruauté dans leur relation avec leurs esclaves.
Lamartine condamne donc l'exploitation des esclaves, mais critique également fortement les agissements des
maîtres.
Ceux-ci exercent en effet une autorité quasiment illimitée sur leurs esclaves.
Ils ne se comportent pas
de façon juste et il y a de nombreux abus de pouvoir de tous genres.
Toussaint Louverture le rappelle dans son
discours : on peut tout d'abord le noter par la périphrase qualifiant les maîtres blancs des terres coloniales « La
race d'oppresseurs », qui montre clairement les sentiments des esclaves face au comportement des maîtres,
ainsi que le nom « tyran » utilisé pour représenter l'ensemble des exploiteurs.
On remarque également les
termes négatifs dans une accumulation dont les acteurs sont les Européens « Les haines, les dédains, les
hontes, les injures, / [...] les tortures, / Le fouet et le bambou marqués sur votre peau ».
On voit aussi que les
préjudices portés sont également moraux, l'auteur les met en valeur grâce à la gradation de termes péjoratifs et
au rythme ternaire du vers « Titres d'abjection, de dégoût, de mépris ».
Les conditions de vie inhumaines
empirées par les mauvais traitements des maîtres amènent l'auteur à critiquer ouvertement l'esclavage et
l'idéologie qui en découle.
Le poète exprime ici tous ses sentiments face à la pratique de l'esclavage.
Afin de rester proche de la réalité, il
a fait le choix d'un esclave faisant un discours.
Ainsi les conditions sont connues et même plus, vécues tous
les jours.
Le discours permet à l'auteur de critiquer crûment l'esclavage.
Ainsi le récit montre un rappel aux
autres esclaves des actes subits.
C'est une exposition publique du fonctionnement de l'esclavagisme.
On peut
le remarquer par la mise en valeur du « Vous » grâce à une anaphore dans le début de l'extrait, désignant les
esclaves à qui Toussaint s'adresse. On peut également noter les périphrases qu'utilise Toussaint pour
désigner les esclaves par rapport à lui : « Mes enfants, mes amis, frères d'ignominie » avant de se rapprocher
d'eux mais aussi de les amener à l'écouter.
L'interjection « Hourra » vers la fin de l'extrait indique que l'esclave
a un public qui l'écoute.
Ainsi, présenter les conditions des esclaves grâce à un discours qui serait comme
retransmis permet à Lamartine de critiquer ouvertement l'esclavage.
Cependant, il ne s'arrête pas à une simple
dénonciation de l'esclavage : il recherche une vengeance de la part des esclaves..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Histoire de l'esclavage
- Analyse du poème "La Charité" des Méditations Poétiques de Lamartine
- dissertation en HLP: Que pensez-vous de la vision que donne Bougainville du peuple tahitien?
- lecture méthodique du poème le vallon de lamartine
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire : De quel manière Voltaire dénonce-t-il l’esclavage ?