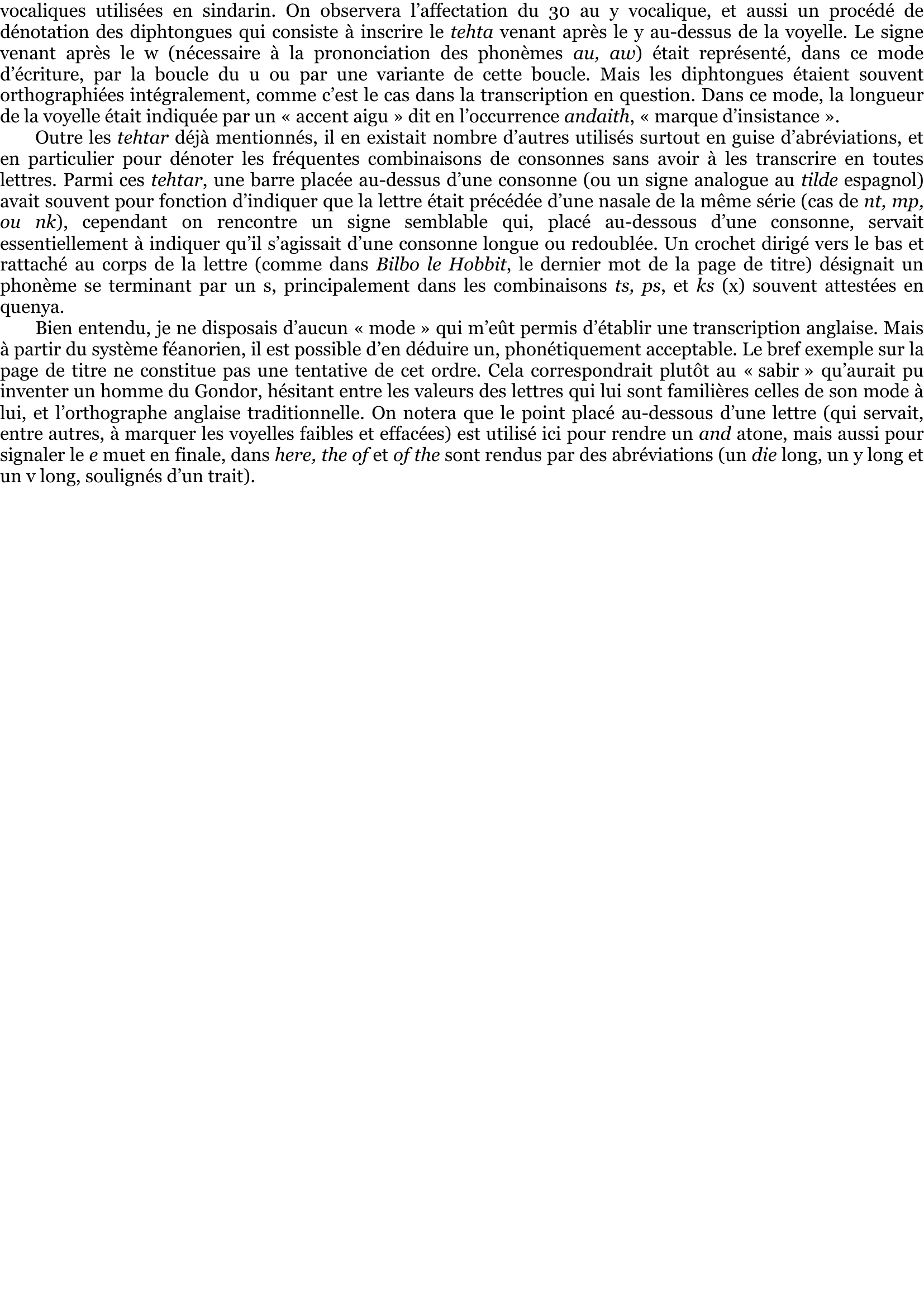LES LETTRES FËANORIENNES
Publié le 31/03/2014

Extrait du document
LES LETTRES FËANORIENNES
La Table ci-jointe donne, calligraphiées avec soin, les lettres d’usage courant au Troisième Âge, en Terres d’Occident. L’ordre est celui communément admis à l’époque, et celui adopté d’ordinaire lors de toute récitation nominative.
En fait, il ne s’agissait pas à l’origine d’un « alphabet « proprement dit, c’est-à-dire d’une série fortuite de lettres, ayant chacune sa valeur propre, et que l’on débite à la suite les unes des autres selon un ordre traditionnel, sans rapport manifeste avec leur forme ou leurs fonctions (La seule connexion que les Eldar auraient jugée intelligible entre deux lettres de notre propre alphabet, aurait été celle que l’on peut établir entre P et B, et le fait que dans l’ordre alphabétique en usage chez nous, ces deux lettres soient à distance l’une de l’autre et séparées également de F, M et V, leur aurait paru absurde). C’était plutôt un système de signes consonantiques, analogue pour la forme et pour le style, qui pouvait servir, au choix et selon les nécessités du moment, à la notation de consonnes figurant dans les langues rencontrées occasionnellement (ou inventées) par les Eldar. Aucune de ces lettres n’avait en elle-même de valeur fixe. Mais certains rapports entre elles vinrent graduellement à s’imposer.
Le système contenait vingt-quatre lettres primaires, de 1 à 24, disposées en quatre témar (ou séries), comportant chacune six tyeller (on degrés). Il y avait aussi des « lettres supplémentaires « dont 25-36 offrent des exemples. Parmi celles-ci, 27 et 29 sont les seules « lettres « véritablement indépendantes : les autres sont toutes des modifications de lettres existantes. Il y avait aussi un certain nombre de tehtar (de signes) d’usage divers. Ils ne figurent pas sur le tableau (On peut en voir un exemple sur l’inscription reproduite p.67 et retranscrite p.282. Ces signes servaient surtout à exprimer des voyelles, considérées en quenya comme des modifications de la consonne adjacente, ou comme moyen d’exprimer sous forme abrégée certaines combinaisons de consonnes particulièrement fréquentes).
Les lettres primaires étaient composées chacune d’un telco (jambage) et d’un luva (corps). Les formes de 1 à 4 étaient considérées normales. Le jambage pouvait être dressé (lettres 9 à 16), ou ramassé (lettres 17 à 24), quant au corps, il pouvait être ouvert, comme dans les séries I et III, ou fermé, comme dans les séries II et IV, et dans les deux cas, il y avait possibilité de redoublement (voir, par exemple, 5-8).
Au Troisième Âge, cette liberté théorique d’application avait été plus ou qui en avaient l’usage. Les formes inversées, 30 et 32, bien que disponibles en tant que signes distincts, étaient généralement utilisées comme simples variantes de 29 et de 31, selon les exigences de l’écriture. C’est dire que coiffées d’un tehta, elles étaient d’un usage fréquent.
Le N°33 représentait à l’origine une variante (plus faible) du 11, au Troisième Âge, il servait principalement à dénoter le h. Le 34, en ces rares occurrences, exprimait le w muet (kw). Le 35 et le 36, utilisés en tant que consonnes, s’appliquaient communément au y ou au w.
Quant aux voyelles, elles étaient indiquées, dans de nombreux modes, par des tehtar placés d’ordinaire au-dessus de la consonne. Dans les langues comme le quenya où presque tous les mots s’achèvent sur une oyelle, le tehta coiffait la consonne précédente, mais en sindarin et autres langues de même type où presque tous les mots se terminent sur une consonne, le tehta était placé au-dessus de la consonne suivante. Lorsqu’il n’y avait pas de consonne en position requise, le tehta était placé au-dessus du « signe bref « dont une forme usuelle figurait un i sans son point. Les tehtar utilisés effectivement dans les différentes langues comme signes ocaliques revêtaient diverses formes. Les plus communes, affectées ordinairement à des variétés de e, i, o, u, se retrouvent dans les exemples donnés. Les trois points, fort courants dans la graphie du a, pouvaient être tracés de façon plus cursive et prendre alors l’aspect d’un accent circonflexe (En quenya où le a était extrêmement fréquent, on omettait purement et simplement le signe vocalique le désignant. Ainsi calma « lampe « pouvait s’écrire clm). On recourait souvent au point unique et à l’« accent aigu « mot qui se lisait tout naturellement comme calma, car en quenya cl n’était pas une combinaison possible en début de mot, et ne figurait jamais en finale. On aurait pu lire aussi calama, mais ce mot n’existait pas.
On recourait souvent au point unique et à l’accent aigu pour rendre le i et le e (mais aussi, dans certains modes d’écriture, le e et le u). L’inscription gravée sur l’Anneau comporte une boucle ouverte sur la droite, laquelle a valeur d’un u. Mais sur la page de titre cette boucle doit se lire comme un o, et c’est la boucle ouverte sur la gauche qui représente un u. On marquait une préférence pour la boucle ouverte sur la droite, mais son occurrence variait selon le langage en cause, le o était peu usité dans le Noir Parler.
On dénotait généralement les voyelles longues en plaçant le tehta sur le « signe long «, dont une forme courante ressemblait à un j sans son point. On pouvait aussi, à mêmes fins, redoubler les tehtar, mais ça ne se faisait qu’avec les boucles et parfois avec l’« accent «. On employait plus souvent les deux points comme signes enant après le y.
L’inscription que l’on peut lire sur le Fronton de la Porte Ouest (Livre II, p.336) illustre un mode d’écriture « en toutes lettres «, chaque voyelle étant représentée par un caractère distinct. Y figurent toutes les lettres
ocaliques utilisées en sindarin. On observera l’affectation du 30 au y vocalique, et aussi un procédé de dénotation des diphtongues qui consiste à inscrire le tehta venant après le y au-dessus de la voyelle. Le signe enant après le w (nécessaire à la prononciation des phonèmes au, aw) était représenté, dans ce mode d’écriture, par la boucle du u ou par une variante de cette boucle. Mais les diphtongues étaient souvent orthographiées intégralement, comme c’est le cas dans la transcription en question. Dans ce mode, la longueur de la voyelle était indiquée par un « accent aigu « dit en l’occurrence andaith, « marque d’insistance «.
Outre les tehtar déjà mentionnés, il en existait nombre d’autres utilisés surtout en guise d’abréviations, et en particulier pour dénoter les fréquentes combinaisons de consonnes sans avoir à les transcrire en toutes lettres. Parmi ces tehtar, une barre placée au-dessus d’une consonne (ou un signe analogue au tilde espagnol) avait souvent pour fonction d’indiquer que la lettre était précédée d’une nasale de la même série (cas de nt, mp, ou nk), cependant on rencontre un signe semblable qui, placé au-dessous d’une consonne, servait essentiellement à indiquer qu’il s’agissait d’une consonne longue ou redoublée. Un crochet dirigé vers le bas et rattaché au corps de la lettre (comme dans Bilbo le Hobbit, le dernier mot de la page de titre) désignait un phonème se terminant par un s, principalement dans les combinaisons ts, ps, et ks (x) souvent attestées en quenya.
Bien entendu, je ne disposais d’aucun « mode « qui m’eût permis d’établir une transcription anglaise. Mais à partir du système féanorien, il est possible d’en déduire un, phonétiquement acceptable. Le bref exemple sur la page de titre ne constitue pas une tentative de cet ordre. Cela correspondrait plutôt au « sabir « qu’aurait pu inventer un homme du Gondor, hésitant entre les valeurs des lettres qui lui sont familières celles de son mode à lui, et l’orthographe anglaise traditionnelle. On notera que le point placé au-dessous d’une lettre (qui servait, entre autres, à marquer les voyelles faibles et effacées) est utilisé ici pour rendre un and atone, mais aussi pour signaler le e muet en finale, dans here, the of et of the sont rendus par des abréviations (un die long, un y long et un v long, soulignés d’un trait).
«
vocaliques utilisées en sindarin.
On observera l’affectation du 30 au y vocalique, et aussi un procédé de
dénotation des diphtongues qui consiste à inscrire le tehta venant après le y au - dessus de la voyelle.
Le signe
venant après le w (nécessaire à la prononciation des phonèmes au, aw ) était représenté, dans ce mode
d’écriture, par la boucle du u ou par une variante de cette boucle.
Mais les diphtongues étaient souvent
orthographiées intégralement, comme c’est le cas dans la transcription en question.
Dans ce mode, la longueur
de la voyelle était indiquée par un « accent aigu » dit en l’occurrence andaith, « marque d’insistance ».
Outre les tehtar déjà mentionnés, il en existait nombre d’autres utilisés surtout en guise d’abr éviations, et
en particulier pour dénoter les fréquentes combinaisons de consonnes sans avoir à les transcrire en toutes
lettres.
Parmi ces tehtar , une barre placée au -dessus d’une consonne (ou un signe analogue au tilde espagnol)
avait souvent pour foncti on d’indiquer que la lettre était précédée d’une nasale de la même série (cas de nt, mp,
ou nk ), cependant on rencontre un signe semblable qui, placé au - dessous d’une consonne, servait
essentiellement à indiquer qu’il s’agissait d’une consonne longue ou re doublée.
Un crochet dirigé vers le bas et
rattaché au corps de la lettre (comme dans Bilbo le Hobbit , le dernier mot de la page de titre) désignait un
phonème se terminant par un s, principalement dans les combinaisons ts, ps, et ks (x) souvent attestées e n
quenya.
Bien entendu, je ne disposais d’aucun « mode » qui m’eût permis d’établir une transcription anglaise.
Mais
à partir du système féanorien, il est possible d’en déduire un, phonétiquement acceptable.
Le bref exemple sur la
page de titre ne constitu e pas une tentative de cet ordre.
Cela correspondrait plutôt au « sabir » qu’aurait pu
inventer un homme du Gondor, hésitant entre les valeurs des lettres qui lui sont familières celles de son mode à
lui, et l’orthographe anglaise traditionnelle.
On notera que le point placé au - dessous d’une lettre (qui servait,
entre autres, à marquer les voyelles faibles et effacées) est utilisé ici pour rendre un and atone, mais aussi pour
signaler le e muet en finale, dans here, the of et of the sont rendus par des abré viations (un die long, un y long et
un v long, soulignés d’un trait)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- lecture linéaire lettres 24 lettres persanes
- Fiche de Lecture Résumé Les Lettres Persanes
- LETTRES ANGLAISES ou Lettres philosophiques sur l'Angleterre, ouvrage de Voltaire
- Lettres philosophiques de Voltaire (résumé)
- LETTRES de Guez de Balzac (résumé)