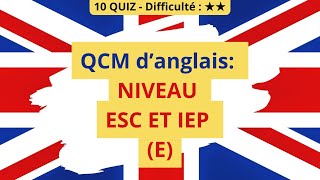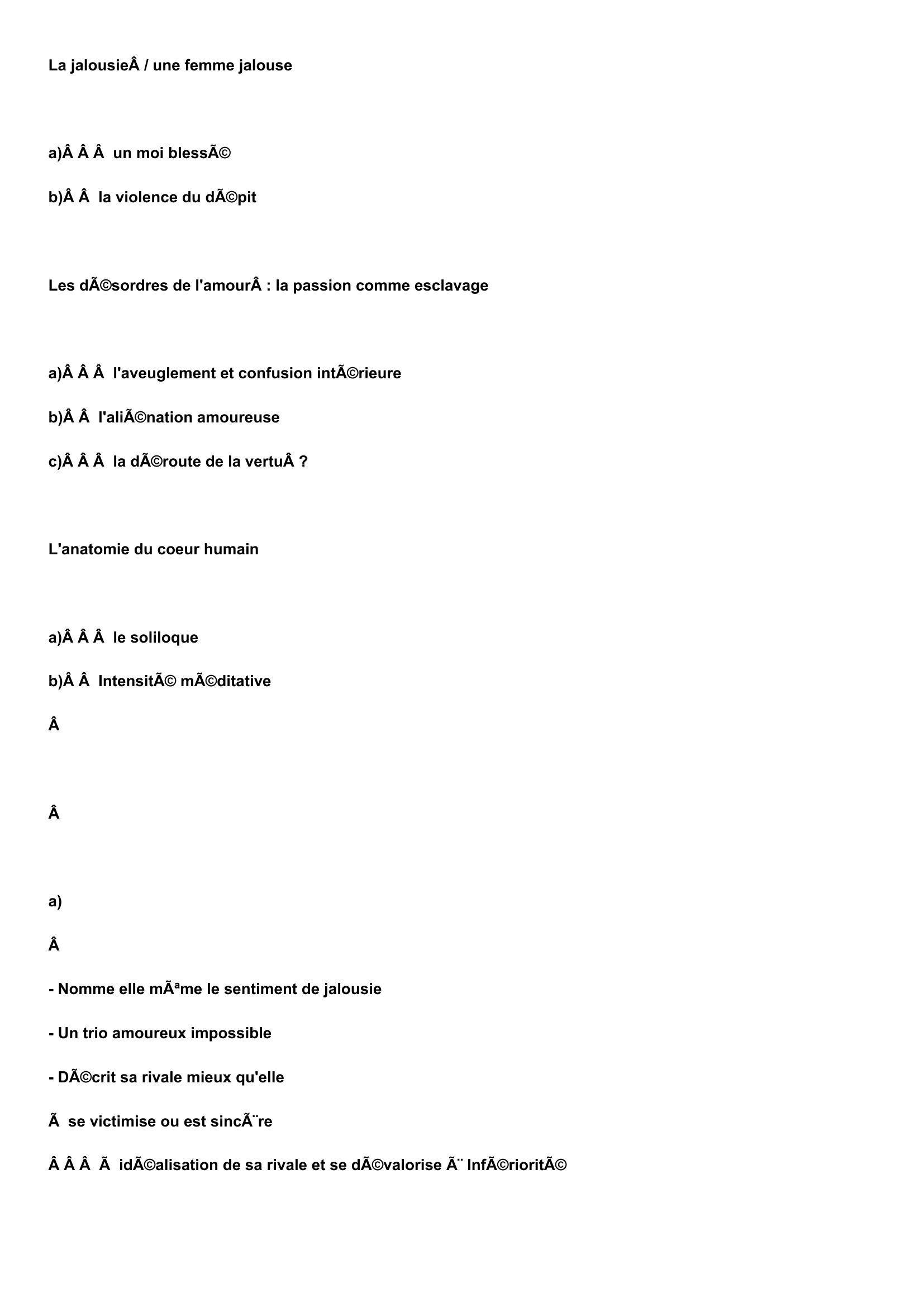Princesse de Clèves: Le personnage face à l’histoire au XIXe Siècle, en quoi la construction du personnage du roman au fil des siècles nous permet-elle de mieux comprendre le monde ?
Publié le 28/12/2015

Extrait du document


« La jalousie / une femme jalouse a) un moi blessé b) la violence du dépit Les désordres de l'amour : la passion comme esclavage a) l'aveuglement et confusion intérieure b) l'aliénation amoureuse c) la déroute de la vertu ? L'anatomie du coeur humain a) le soliloque b) Intensité méditative a) - Nomme elle même le sentiment de jalousie - Un trio amoureux impossible - Décrit sa rivale mieux qu'elle à se victimise ou est sincère à idéalisation de sa rivale et se dévalorise è Infériorité. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation: personnage de roman et vertu dans« La Princesse de Clèves » (Madame de La Fayette, 1678) La vertu est un sujet qui se retrouve au cœur des récits du XVIIe siècle.
- NEMOURS (le duc de). Personnage du roman de Mme de La Fayette, la Princesse de Clèves
- Léon XIII 1810-1903 Léon XIII s'est acquis dans l'Histoire la réputation d'avoir été le premier pape du XIXe siècle à essayer de comprendre son époque.
- Léon XIII Philippe Levillain Assistant en Histoire contemporaine à l'Université de Paris X Léon XIII s'est acquis dans l'Histoire la réputation d'avoir été le premier pape du XIXe siècle à essayer de comprendre son époque.
- Que ce soit dans le domaine du roman, de l'autobiographie, du théâtre ou de la poésie, la littérature fait souvent de larges emprunts à l'Histoire : Corneille fait revivre dans ses pièces des héros romains, Mme de La Fayette nous dépeint dans La Princesse de Clèves une fresque de la Cour d'Henri II, Ronsard, d'Aubigné, Hugo, et bien d'autres rehaussent parfois leur lyrisme de souvenirs ou de témoignages historiques ; en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures, vous