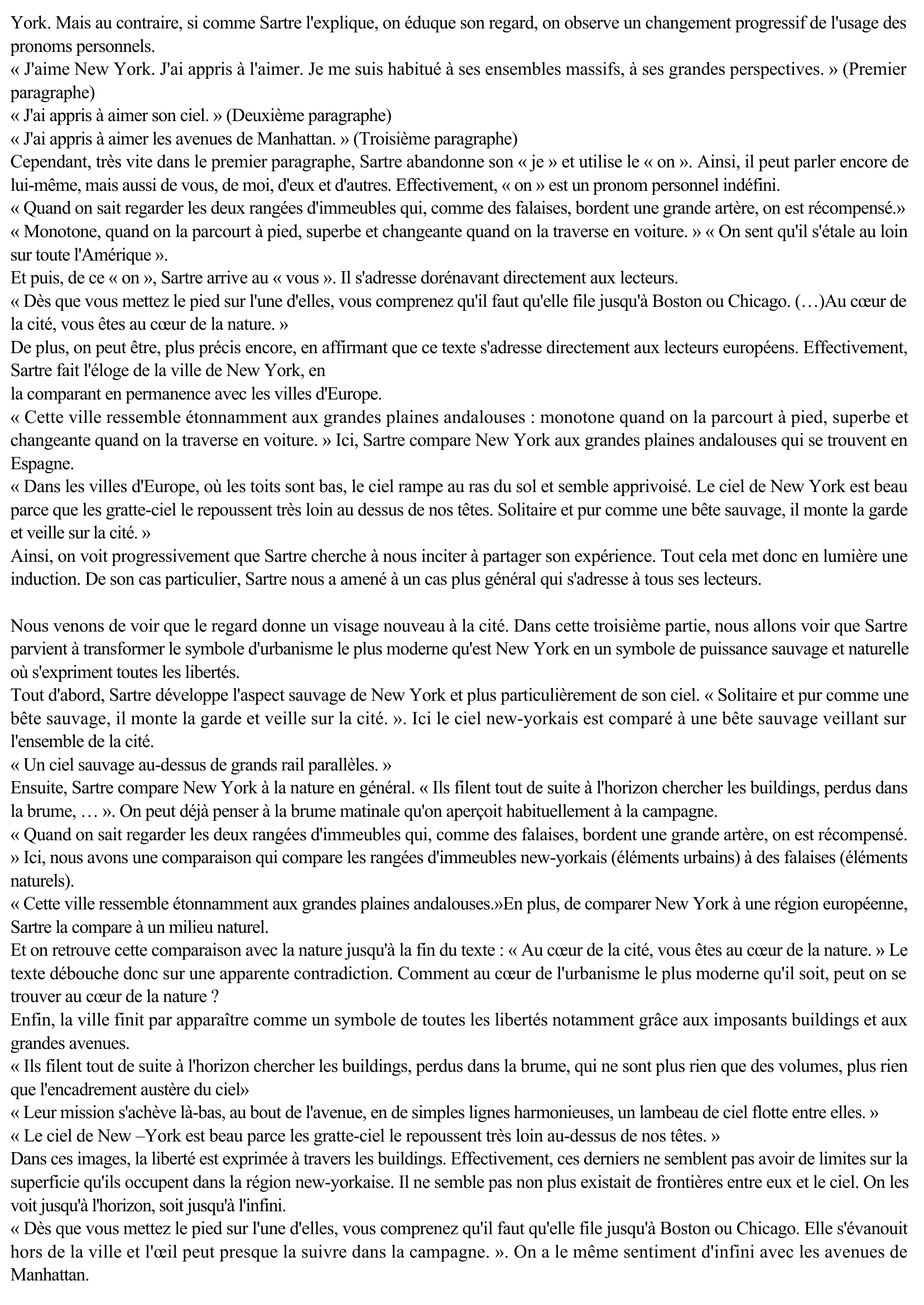Situations de Sartre: New-York
Publié le 12/09/2006

Extrait du document

Dans ses Situations, Sartre a regroupé l’ensemble des essais qu’il a rédigés entre 1947 et 1976. Le titre de ce recueil renvoie parfaitement à la philosophie qu’il a développée toute sa vie : l’homme vit dans un monde absurde, la seule façon qu’il a de donner un sens à sa vie est d’agir, agir c’est être et pour être, il faut se situer car se situer c’est interpréter l’environnement (politique, social, économique, affectif, …) Le texte que nous proposons d’étudier est extrait des Situations, III, 2 où Sartre a rendu compte des impressions que lui ont laissées les grandes villes américaines. C’est à New York, capitale par excellence, qu’il s’attache particulièrement ici. Son approche est pour le moins surprenante. En effet, d’abord, elle est très « impressionniste « : sa déclaration d’amour à la ville est extrêmement sensuelle. Mais surtout, il parvient à y transformer ce symbole d’urbanisation qu’est New-York en un symbole de puissance sauvage et naturelle. Nous montrerons donc dans une première partie, comment Sartre est tombé amoureux de New York. Ensuite, nous verrons dans une deuxième partie qu’il cherche à partager et généraliser son expérience avec le lecteur (surtout européen). Enfin, dans une troisième partie, nous verrons comment Sartre, parvient à transformer le symbole d’urbanisme le plus moderne qu’est New York, en un symbole de puissance sauvage et naturelle. Ce texte nous raconte d’abord comment Sartre est tombé amoureux de la ville de New York. Effectivement, le texte s’ouvre directement sur une anaphore qui reprend trois fois de suite le pronom personnel « j’ «/ « je «, qui désigne évidemment Sartre lui-même. A ce stade de la lecture, on peut donc imaginer qu’il va s’agir d’une histoire d’amour personnelle. « J’aime New York. J’ai appris à l’aimer. Je me suis habitué à ses ensembles massifs, à ses grandes perspectives. « On a ici une gradation qui se développe sous deux formes. C’est tout d’abord une gradation sur le plan mélodique, car les phrases se prolongent progressivement. C’est aussi une gradation pour la façon progressive avec laquelle Sartre a apprit à aimer New York. « J’aime New York. « C’est un présent de l’indicatif à valeur énonciative. « J’ai appris à l’aimer. « et « Je me suis habitué à ses ensembles massifs, à ses grandes perspectives. «. Ce sont là, deux passés composés qui permettent d’évoquer des actions accomplies au moment de l’énonciation, limitées dans le passé et antérieures au présent. De plus, quand Sartre dit « J’ai appris à l’aimer. «, on n’a l’impression pas que l’amour qu’il a pour New York, relève du coup de foudre traditionnel qui engendre l’amour, puisque ici l’amour semble avoir nécessité un apprentissage progressif. Cette thèse se confirme à la phrase suivante. « Je me suis habitué à ses ensembles massifs, à ses grandes perspectives. « Sartre, nous livre ici la première notion d’habitude qui s’est apparemment développée à travers le regard. C’est donc avec l’habitude que Sartre a appris à aimer New York. Il n’y a pas eu de coup de foudre. Cependant, on peut penser que son amour pour New York est tel à présent, qu’il nécessite le besoin de personnifier la ville. « J’aime New York «. Effectivement, on dit aussi « j’aime « pour caractériser une relation que l’on a avec quelqu’un. On voit donc qu’il existe une véritable histoire d’amour entre Sartre et New York, principalement développée grâce à l’éducation du regard et de l’esprit. « Mes regards ne s’attardent plus sur les façades, en quête d’une maison qui, par impossible, ne serait pas identique aux autres maisons. « On retrouve tout d’abord la notion d’habitude qui a permis à Sartre d’apprendre à aimer New York mais aussi l’évocation du rôle du regard. Effectivement, selon Sartre, « Quand on sait regarder les deux rangées d’immeubles qui comme des falaises, bordent une grande artère, on est récompensé. «. Ici, le verbe « savoir « suggère qu’il faut avoir une véritable connaissance de la vue pour aimer New York. « Ils filent tout de suite à l’horizon chercher les buildings, perdus dans la brume, qui ne sont plus rien que des volumes, plus rien que l’encadrement austère du ciel. « Ici, Sartre personnifie ses yeux. Par ailleurs, on remarque qu’il donne une vision très géométrique de New York car les buildings sont comparés à des volumes, le ciel est encadré par ces buildings et les maisons semblent toutes identiques. De manière générale, New York est pour lui un ensemble de « grandes perspectives «. « Elle s’évanouit hors de la ville et l’œil peut presque la suivre dans la campagne. « Le champ lexical de la vue est donc très présent du début jusqu’à la fin du texte, si bien qu’on pourrait croire que New York est une ville sans bruit. Ainsi, Sartre nous explique que c’est avec l’habitude mais surtout avec l’éducation du regard, qu’il est progressivement tombé amoureux de New York. Pourtant, Sartre ne se contente pas de nous raconter une histoire personnelle à visée anecdotique. Il s’arrange effectivement pour que le lecteur se sente concerné et entreprenne aussi une modification de sa façon de regarder le monde. Certes, chacun des trois paragraphes de ce texte commencent par le même pronom personnel « j’ «, ce qui laisserait penser si on se contentait uniquement de survoler rapidement du regard le texte, que tout tourne autour de Sartre et de son amour pour New York. Mais au contraire, si comme Sartre l’explique, on éduque son regard, on observe un changement progressif de l’usage des pronoms personnels. « J’aime New York. J’ai appris à l’aimer. Je me suis habitué à ses ensembles massifs, à ses grandes perspectives. « (Premier paragraphe) « J’ai appris à aimer son ciel. « (Deuxième paragraphe) « J’ai appris à aimer les avenues de Manhattan. « (Troisième paragraphe) Cependant, très vite dans le premier paragraphe, Sartre abandonne son « je « et utilise le « on «. Ainsi, il peut parler encore de lui-même, mais aussi de vous, de moi, d’eux et d’autres. Effectivement, « on « est un pronom personnel indéfini. « Quand on sait regarder les deux rangées d’immeubles qui, comme des falaises, bordent une grande artère, on est récompensé.« « Monotone, quand on la parcourt à pied, superbe et changeante quand on la traverse en voiture. « « On sent qu’il s’étale au loin sur toute l’Amérique «. Et puis, de ce « on «, Sartre arrive au « vous «. Il s’adresse dorénavant directement aux lecteurs. « Dès que vous mettez le pied sur l’une d’elles, vous comprenez qu’il faut qu’elle file jusqu’à Boston ou Chicago. (…)Au cœur de la cité, vous êtes au cœur de la nature. « De plus, on peut être, plus précis encore, en affirmant que ce texte s’adresse directement aux lecteurs européens. Effectivement, Sartre fait l’éloge de la ville de New York, en la comparant en permanence avec les villes d’Europe. « Cette ville ressemble étonnamment aux grandes plaines andalouses : monotone quand on la parcourt à pied, superbe et changeante quand on la traverse en voiture. « Ici, Sartre compare New York aux grandes plaines andalouses qui se trouvent en Espagne. « Dans les villes d’Europe, où les toits sont bas, le ciel rampe au ras du sol et semble apprivoisé. Le ciel de New York est beau parce que les gratte-ciel le repoussent très loin au dessus de nos têtes. Solitaire et pur comme une bête sauvage, il monte la garde et veille sur la cité. « Ainsi, on voit progressivement que Sartre cherche à nous inciter à partager son expérience. Tout cela met donc en lumière une induction. De son cas particulier, Sartre nous a amené à un cas plus général qui s’adresse à tous ses lecteurs. Nous venons de voir que le regard donne un visage nouveau à la cité. Dans cette troisième partie, nous allons voir que Sartre parvient à transformer le symbole d’urbanisme le plus moderne qu’est New York en un symbole de puissance sauvage et naturelle où s’expriment toutes les libertés. Tout d’abord, Sartre développe l’aspect sauvage de New York et plus particulièrement de son ciel. « Solitaire et pur comme une bête sauvage, il monte la garde et veille sur la cité. «. Ici le ciel new-yorkais est comparé à une bête sauvage veillant sur l’ensemble de la cité. « Un ciel sauvage au-dessus de grands rail parallèles. « Ensuite, Sartre compare New York à la nature en général. « Ils filent tout de suite à l’horizon chercher les buildings, perdus dans la brume, … «. On peut déjà penser à la brume matinale qu’on aperçoit habituellement à la campagne. « Quand on sait regarder les deux rangées d’immeubles qui, comme des falaises, bordent une grande artère, on est récompensé. « Ici, nous avons une comparaison qui compare les rangées d’immeubles new-yorkais (éléments urbains) à des falaises (éléments naturels). « Cette ville ressemble étonnamment aux grandes plaines andalouses.«En plus, de comparer New York à une région européenne, Sartre la compare à un milieu naturel. Et on retrouve cette comparaison avec la nature jusqu’à la fin du texte : « Au cœur de la cité, vous êtes au cœur de la nature. « Le texte débouche donc sur une apparente contradiction. Comment au cœur de l’urbanisme le plus moderne qu’il soit, peut on se trouver au cœur de la nature ? Enfin, la ville finit par apparaître comme un symbole de toutes les libertés notamment grâce aux imposants buildings et aux grandes avenues. « Ils filent tout de suite à l’horizon chercher les buildings, perdus dans la brume, qui ne sont plus rien que des volumes, plus rien que l’encadrement austère du ciel« « Leur mission s’achève là-bas, au bout de l’avenue, en de simples lignes harmonieuses, un lambeau de ciel flotte entre elles. « « Le ciel de New –York est beau parce les gratte-ciel le repoussent très loin au-dessus de nos têtes. « Dans ces images, la liberté est exprimée à travers les buildings. Effectivement, ces derniers ne semblent pas avoir de limites sur la superficie qu’ils occupent dans la région new-yorkaise. Il ne semble pas non plus existait de frontières entre eux et le ciel. On les voit jusqu’à l’horizon, soit jusqu’à l’infini. « Dès que vous mettez le pied sur l’une d’elles, vous comprenez qu’il faut qu’elle file jusqu’à Boston ou Chicago. Elle s’évanouit hors de la ville et l’œil peut presque la suivre dans la campagne. «. On a le même sentiment d’infini avec les avenues de Manhattan. « On sent qu’il s’étale au loin sur toute l’Amérique : c’est le ciel du monde entier. « Ici, on pourrait dire que le ciel New-yorkais est glorifié. Ainsi, voilà comment à l’aide de comparaisons, d’images et d’une personnification, Sartre est parvenu à transformer New York en un milieu sauvage et naturel. Pour conclure, ce texte est d’abord une induction, car Sartre adopte un raisonnement qui va d’un cas particulier (comment il est tombé amoureux de New York) à un cas plus général (comment le lecteur peut changer son regard sur le monde). Et c’est aussi une incitation à éduquer son regard. C’est ainsi que Sartre arrive naturellement à comparer New York à la nature.

«
York.
Mais au contraire, si comme Sartre l'explique, on éduque son regard, on observe un changement progressif de l'usage despronoms personnels.« J'aime New York.
J'ai appris à l'aimer.
Je me suis habitué à ses ensembles massifs, à ses grandes perspectives.
» (Premierparagraphe)« J'ai appris à aimer son ciel.
» (Deuxième paragraphe)« J'ai appris à aimer les avenues de Manhattan.
» (Troisième paragraphe)Cependant, très vite dans le premier paragraphe, Sartre abandonne son « je » et utilise le « on ».
Ainsi, il peut parler encore delui-même, mais aussi de vous, de moi, d'eux et d'autres.
Effectivement, « on » est un pronom personnel indéfini.« Quand on sait regarder les deux rangées d'immeubles qui, comme des falaises, bordent une grande artère, on est récompensé.»« Monotone, quand on la parcourt à pied, superbe et changeante quand on la traverse en voiture.
» « On sent qu'il s'étale au loinsur toute l'Amérique ».Et puis, de ce « on », Sartre arrive au « vous ».
Il s'adresse dorénavant directement aux lecteurs.« Dès que vous mettez le pied sur l'une d'elles, vous comprenez qu'il faut qu'elle file jusqu'à Boston ou Chicago.
(…)Au cœur dela cité, vous êtes au cœur de la nature.
»De plus, on peut être, plus précis encore, en affirmant que ce texte s'adresse directement aux lecteurs européens.
Effectivement,Sartre fait l'éloge de la ville de New York, enla comparant en permanence avec les villes d'Europe.« Cette ville ressemble étonnamment aux grandes plaines andalouses : monotone quand on la parcourt à pied, superbe etchangeante quand on la traverse en voiture.
» Ici, Sartre compare New York aux grandes plaines andalouses qui se trouvent enEspagne.« Dans les villes d'Europe, où les toits sont bas, le ciel rampe au ras du sol et semble apprivoisé.
Le ciel de New York est beauparce que les gratte-ciel le repoussent très loin au dessus de nos têtes.
Solitaire et pur comme une bête sauvage, il monte la gardeet veille sur la cité.
»Ainsi, on voit progressivement que Sartre cherche à nous inciter à partager son expérience.
Tout cela met donc en lumière uneinduction.
De son cas particulier, Sartre nous a amené à un cas plus général qui s'adresse à tous ses lecteurs.
Nous venons de voir que le regard donne un visage nouveau à la cité.
Dans cette troisième partie, nous allons voir que Sartreparvient à transformer le symbole d'urbanisme le plus moderne qu'est New York en un symbole de puissance sauvage et naturelleoù s'expriment toutes les libertés.Tout d'abord, Sartre développe l'aspect sauvage de New York et plus particulièrement de son ciel.
« Solitaire et pur comme unebête sauvage, il monte la garde et veille sur la cité.
».
Ici le ciel new-yorkais est comparé à une bête sauvage veillant surl'ensemble de la cité.« Un ciel sauvage au-dessus de grands rail parallèles.
»Ensuite, Sartre compare New York à la nature en général.
« Ils filent tout de suite à l'horizon chercher les buildings, perdus dansla brume, … ».
On peut déjà penser à la brume matinale qu'on aperçoit habituellement à la campagne.« Quand on sait regarder les deux rangées d'immeubles qui, comme des falaises, bordent une grande artère, on est récompensé.» Ici, nous avons une comparaison qui compare les rangées d'immeubles new-yorkais (éléments urbains) à des falaises (élémentsnaturels).« Cette ville ressemble étonnamment aux grandes plaines andalouses.»En plus, de comparer New York à une région européenne,Sartre la compare à un milieu naturel.Et on retrouve cette comparaison avec la nature jusqu'à la fin du texte : « Au cœur de la cité, vous êtes au cœur de la nature.
» Letexte débouche donc sur une apparente contradiction.
Comment au cœur de l'urbanisme le plus moderne qu'il soit, peut on setrouver au cœur de la nature ?Enfin, la ville finit par apparaître comme un symbole de toutes les libertés notamment grâce aux imposants buildings et auxgrandes avenues.« Ils filent tout de suite à l'horizon chercher les buildings, perdus dans la brume, qui ne sont plus rien que des volumes, plus rienque l'encadrement austère du ciel»« Leur mission s'achève là-bas, au bout de l'avenue, en de simples lignes harmonieuses, un lambeau de ciel flotte entre elles.
»« Le ciel de New –York est beau parce les gratte-ciel le repoussent très loin au-dessus de nos têtes.
»Dans ces images, la liberté est exprimée à travers les buildings.
Effectivement, ces derniers ne semblent pas avoir de limites sur lasuperficie qu'ils occupent dans la région new-yorkaise.
Il ne semble pas non plus existait de frontières entre eux et le ciel.
On lesvoit jusqu'à l'horizon, soit jusqu'à l'infini.« Dès que vous mettez le pied sur l'une d'elles, vous comprenez qu'il faut qu'elle file jusqu'à Boston ou Chicago.
Elle s'évanouithors de la ville et l'œil peut presque la suivre dans la campagne.
».
On a le même sentiment d'infini avec les avenues deManhattan..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jean-Paul SARTRE (Situations III,2): J'aime New York... "
- SITUATIONS de Jean-Paul Sartre : Fiche de lecture
- SITUATIONS, de J.-P. Sartre
- « UN THÉÂTRE DE SITUATIONS » (Sartre)
- Le Procès Rosenberg I) Biographie à la première personne Je m'appelle Julius Rosenberg, je suis né à New York, aux États-Unis, en 1918, dans une famille juive.