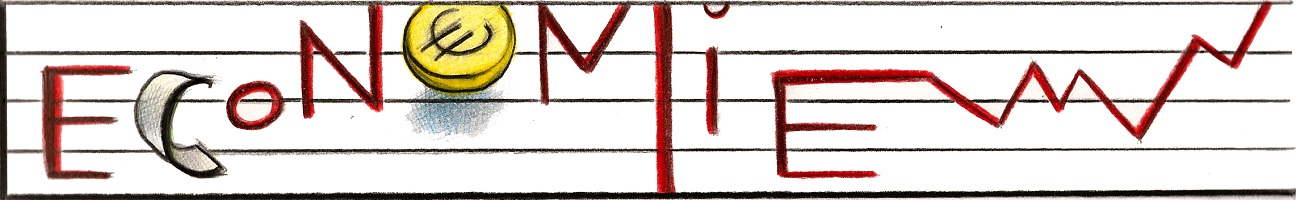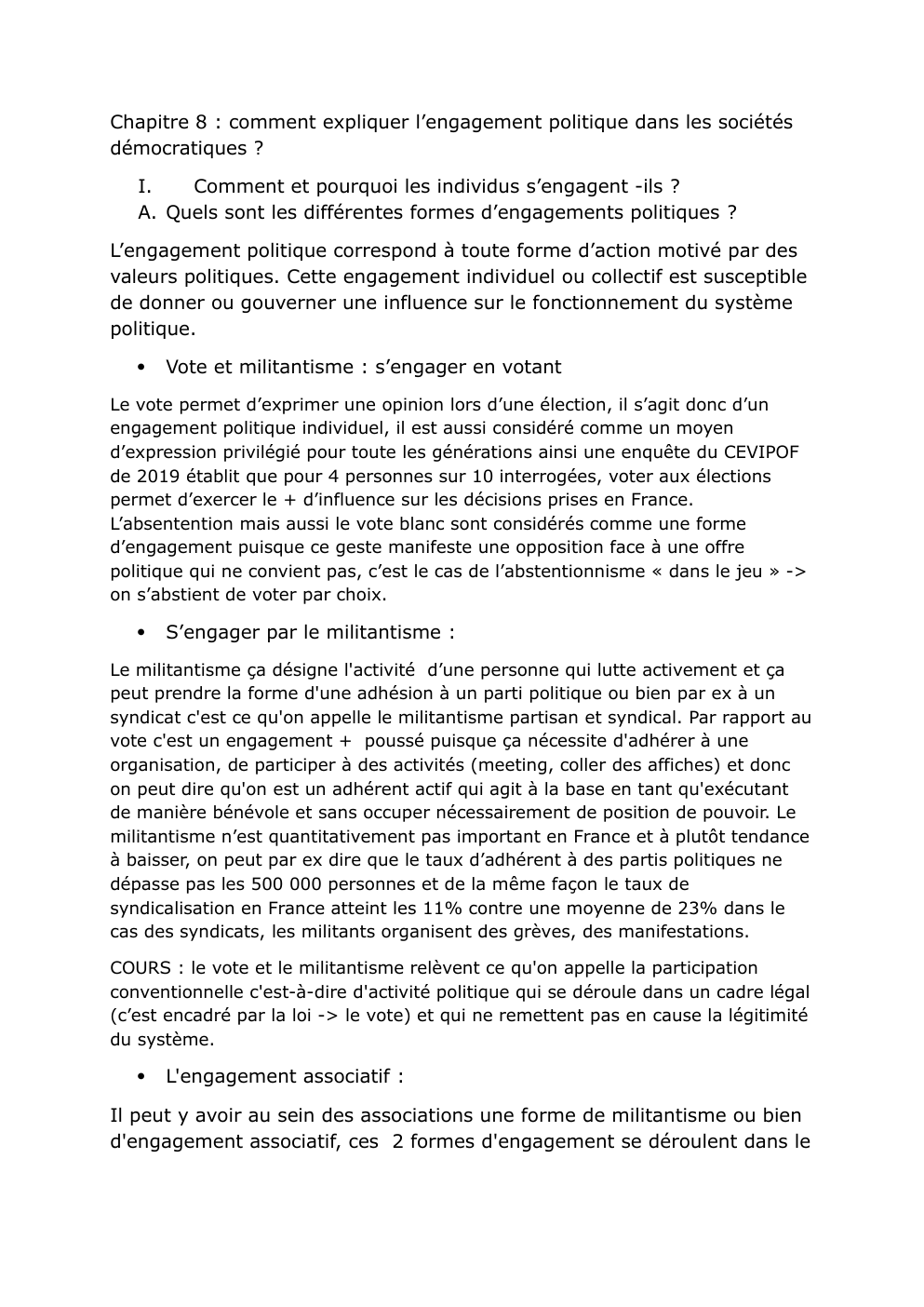Cours de l'ensemble du chapitre sur l'engagement politique SES
Publié le 16/06/2025
Extrait du document
«
Chapitre 8 : comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés
démocratiques ?
I.
Comment et pourquoi les individus s’engagent -ils ?
A.
Quels sont les différentes formes d’engagements politiques ?
L’engagement politique correspond à toute forme d’action motivé par des
valeurs politiques.
Cette engagement individuel ou collectif est susceptible
de donner ou gouverner une influence sur le fonctionnement du système
politique.
Vote et militantisme : s’engager en votant
Le vote permet d’exprimer une opinion lors d’une élection, il s’agit donc d’un
engagement politique individuel, il est aussi considéré comme un moyen
d’expression privilégié pour toute les générations ainsi une enquête du CEVIPOF
de 2019 établit que pour 4 personnes sur 10 interrogées, voter aux élections
permet d’exercer le + d’influence sur les décisions prises en France.
L’absentention mais aussi le vote blanc sont considérés comme une forme
d’engagement puisque ce geste manifeste une opposition face à une offre
politique qui ne convient pas, c’est le cas de l’abstentionnisme « dans le jeu » ->
on s’abstient de voter par choix.
S’engager par le militantisme :
Le militantisme ça désigne l'activité d’une personne qui lutte activement et ça
peut prendre la forme d'une adhésion à un parti politique ou bien par ex à un
syndicat c'est ce qu'on appelle le militantisme partisan et syndical.
Par rapport au
vote c'est un engagement + poussé puisque ça nécessite d'adhérer à une
organisation, de participer à des activités (meeting, coller des affiches) et donc
on peut dire qu'on est un adhérent actif qui agit à la base en tant qu'exécutant
de manière bénévole et sans occuper nécessairement de position de pouvoir.
Le
militantisme n’est quantitativement pas important en France et à plutôt tendance
à baisser, on peut par ex dire que le taux d’adhérent à des partis politiques ne
dépasse pas les 500 000 personnes et de la même façon le taux de
syndicalisation en France atteint les 11% contre une moyenne de 23% dans le
cas des syndicats, les militants organisent des grèves, des manifestations.
COURS : le vote et le militantisme relèvent ce qu'on appelle la participation
conventionnelle c'est-à-dire d'activité politique qui se déroule dans un cadre légal
(c’est encadré par la loi -> le vote) et qui ne remettent pas en cause la légitimité
du système.
L'engagement associatif :
Il peut y avoir au sein des associations une forme de militantisme ou bien
d'engagement associatif, ces 2 formes d'engagement se déroulent dans le
cadre d'une association et peuvent prendre différentes formes comme les
dons, le bénévolat, mais aussi le service civique.
Les associations réunissent majoritairement des bénévoles autour de
projets ou d'activité dans un but non lucratif, seulement certaines
associations ont des objectifs politiques -> leur but c'est de rendre visible
leur cause dans le débat public et c'est par ex le cas de Greenpeace ou
d'Agir contre le chômage et donc par ex pour Greenpeace il modélise 3
millions d'adhérents, 36000 bénévoles à travers le monde pour défendre
l'environnement et la biodiversité.
Souvent les associations ont des
actions + originales et parfois non conventionnelles comme la chaîne
humaine, le citi-in, ou le fait de se menotter à certains endroits.
En France
les associations sont au nombre de 1,3 millions et elles comptent environ
19 millions de bénévoles en 2019.
La consommation engagée :
La consommation engagée c'est un choix de consommation d'un individu
qui cherche à être en accord avec ses valeurs ou ses convictions et donc
ça veut dire qu'ici l'engagement politique va s'inviter dans les échanges et
sur le marché, les individus vont boycotter certains produits pour des
raisons environnementales, animales, de justice sociale, éthique et
morale, l'idée ici c'est de provoquer un changement dans l'organisation
sociale ou influencer le pouvoir politique.
L'engagement peut aussi passer par un achat engagé, c'est le buycotte
dans l'objectif de promouvoir une cause politique ou morale.
On peut
quand même dire que la consommation engagée c'est une forme de
résistance et de contestation du pouvoir, mais c'est aussi une recherche
de moralisation des marchés et du capitalisme.
Cette forme d'engagement
(la consommation engagée) concerne en France un groupe social plutôt
restreint d'individus d'environ 35 ans, avec un niveau de diplôme élevé,
appartenant aux classes moyennes, supérieures, plutôt les femmes ->
c'est elles qui font davantage les courses.
Le végétarisme c'est une forme de politique engagée.
Avec la
consommation engagée il s'agit d'un acte réalisé individuellement mais ça
peut aussi s'inscrire dans une action collective portée par des groupes
d'intérêts (des associations qui peuvent par ex vous inciter à boycotter) on
est dans la participation politique non conventionnelle qui s’inscrit dans les
pratiques constétataires (contestataires ?) mais légal.
B.
Pourquoi s'engage t-on dans les actions politiques ?
Le paradoxe de l'action collective :
Une action collective c'est une mobilisation commune et concertée d'un
groupe d'individus afin d'obtenir des objectifs communs.
COURS : En s'appuyant sur le modèle de rationalité économique
(comparaison coûts-avantage) , Mancur Olsan va montrer qu'il n'est pas
rationnel de s'engager dans une action collective en raison de la possibilité
de passager clandestin.
En effet en raison des coûts individuels (perte de
salaire, grève -> perte de temps) liées à l'action collective certains
membres d'un groupe vont préférer se comporter en passagers clandestin
et attendre que d'autres s'engagent dans une action qui profite à tous, si
tout le monde agit comme ça l'action collective ne ne va pas avoir lieu, et
donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'action collective.
Comment surmonter la tendance des individus à jouer la stratégie du
passager clandestin.
Les incitations sélectives :
Les groupes mobilisés doivent garantir des incitations sélective (des
récompenses financières ou matérielles) à ceux qui s'engagent afin
d'augmenter pour eux les bénéfices individuels de la participation par ex
leur donner droit à une mutuelle, une assistance juridique, et puis ça peut
aussi permettre d'abaisser les coûts individuels de la participation c'est
par ex les cagnottes de grève -> on récompense uniquement ceux qui se
mobilisent et on peut également noter que les incitations peuvent aussi
être négatives ça veut dire qu'on peut augmenter les coûts individuels de
ceux qui ne participent pas à l'activité économique collective, il s'agit de
menaces, d'incitation, de piquage, ça peut aussi être la stigmatisation.
En
raison de toutes les incitations sélectives les comportements de passagers
clandestins deviennent – intéressantes.
2e possibilité les rétributions symboliques :
La participation à une action collective ne se résume pas à un intérêt
strictement économique ça veut dire qu'il y a aussi des satisfactions
symboliques (l'honneur, l'utilité, la notoriété, l'idée de donner un sens à sa
vie) qui contribuent à renforcer l'investissement dans l'activité collective.
Avoir le sentiment de ne pas subir, d'agir en faveur d'une juste cause, de
pouvoir transformer la réalité et parfois même de faire l'histoire -> donne
des raisons de militer, et même de rentrer dans l'histoire.
Ça permet en
même temps la construction d'une identité valorisante (sentiment d'utilité,
de reconnaissance, d'estime de soi) et en même temps elle est créateur
de lien social, ça peut aussi être l'occasion d'exercer des rôles sociaux +
gratifiants.
Pour certains ça peut être une revanche contre les expériences
de la précarité, du chômage et donc ça permet de « retourner le
stigmate », c'est le cas notamment des gilets jaunes.
Les structures de l'opportunité politique (SOP) :
Les SOP reposent à la fois sur le contexte politique des caractéristiques de
système politique et de l'environnement.
Le degré d'ouverture du système politique : On tient compte des
régions politiques mais aussi par ex du positionnement du
gouvernement ça va encourager ou au contraire décourager les
mouvements sociaux.
Le degré de stabilité des alliances politiques : + les rapports entre
les parties politiques sont conflictuels et concurrentiels + les
groupes mobilisés peuvent tirer partie de ces divisions par ex c’est
ce qui s'est passé en 1986 avec le mouvement étudiant contre la loi
devaquet qui profite du moment de la cohabitation.
L'existence ou non de relais politiques : L'existence de
gouvernements sensibles à une cause peut freiner le développement
de la mobilisation.
La capacité d'un système politique à apporter des réponses aux
mouvements sociaux : L'idée c'est que les gouvernements sont
capables de mettre en place des politiques publiques pour traiter le
problème.
S'ils n'y répondent pas il va y avoir mobilité, s'ils y
arrivent il n'y a pas mobilité.
Des facteurs liés à l'environnement politique et au contexte politique
influencent les conditions d'émergence et les probabilités de réussite où
d'échec d'une d'émergence et les probabilités de réussite où d'échec d'une
action collective.
L'environnement politique comme par ex le degré
d'ouverture ou de fermeture du système politique, l'état des alliances au
champ politique, les relais au sein du système politique administratif (le
fait que dans le gouvernement quelqu’un soit proche de votre cause ou
pas) ou alors par le type de réponse apportée par le système politique va
conditionner la mise en place de l'action collective.
II.
De quelles variables dépend l'engagement politique ?
A.
L'engagement politique dépend des variables sociaux....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 1: Le Bonheur (notes de cours)
- Chapitre 2 : Les régimes totalitaires (cours)
- chapitre 1 vie politique contemporaine
- Chapitre 4 : La liberté « La liberté comme fait démontrable et la politique coïncident et son relatives l’une à l’autre comme deux côtés d’une même chose.
- COURS D’ÉCONOMIE POLITIQUE, 1896. Vilfredo Pareto (exposé de l’oeuvre)