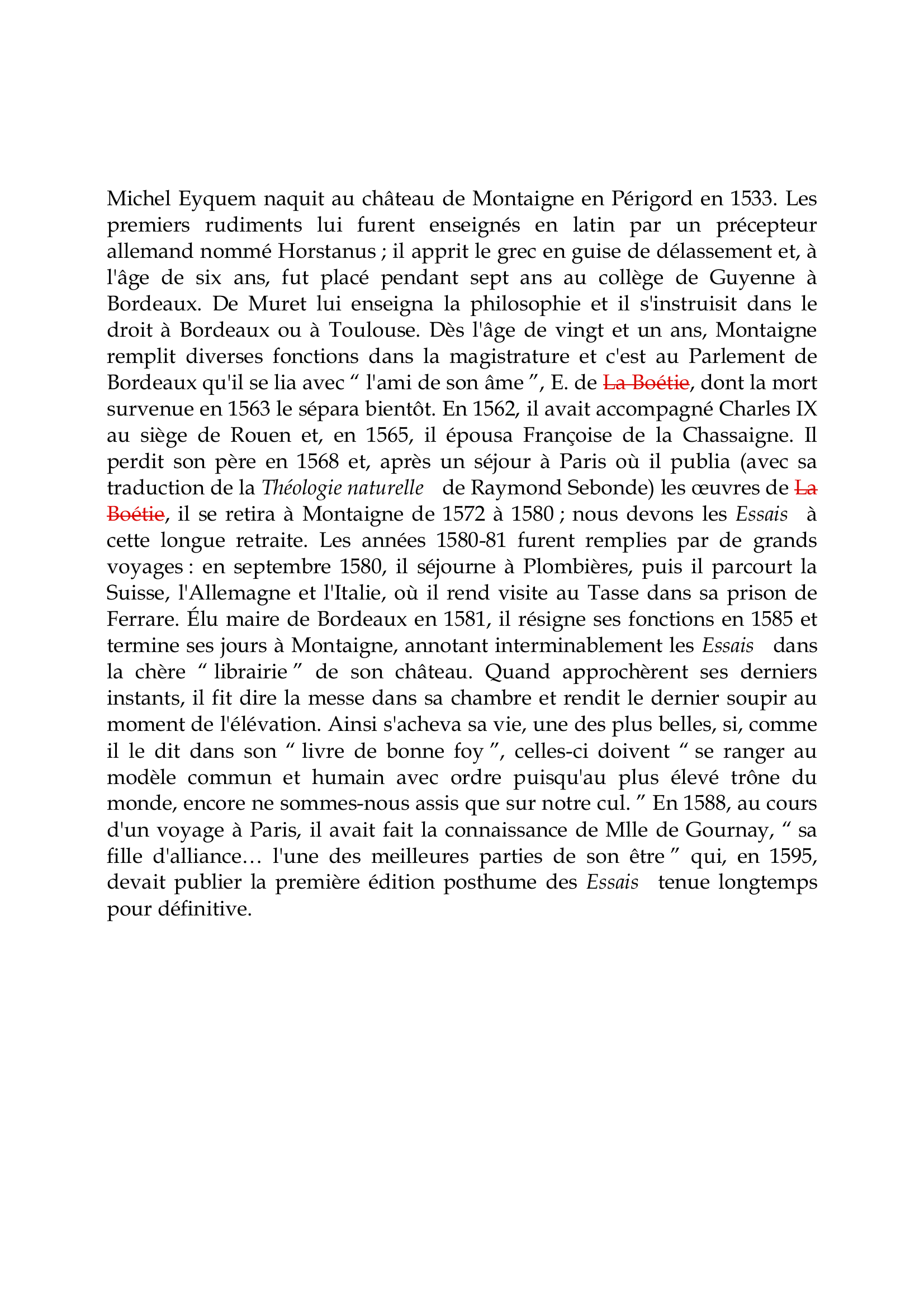MONTAIGNE (Michel de)
Publié le 27/01/2019

Extrait du document
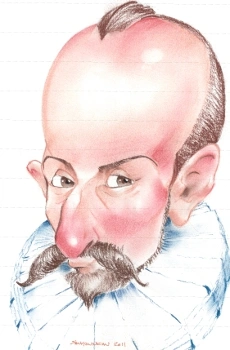
MONTAIGNE (Michel de), écrivain français (château de Montaigne, Périgord, 1533 - id. 1592). D'abord, en guise de vie, quelques repères (« biographèmes », eût dit Barthes). 1. Montaigne : c'est d'abord une maison noble, située entre Dordogne et Lidoire sur une hauteur baptisée (à la gasconne) montagne. Ramon Eyquem l'achète, terre et nom, en 1477. Ce riche marchand bordelais (poisson salé, pastel, vins) est l'arrière-grand-père de celui qui, sur la page de titre des Essais, signera « de Montaigne » sans le moindre relent d'Eyquem. Entre-temps, trois générations de vie de plus en plus noble auront veillé à faire prescription : à Ramon succède Grimon (qui quitte le commerce pour entrer dans la politique municipale bordelaise), puis Pierre qui entre dans la carrière des armes, vit dans son domaine, sera maire de Bordeaux. 2. La mère juive : Une hypothèse récente, datée (Malvezin la formule en 1875), veut qu'Antoinette de Louppes, femme de Pierre (la mère de Michel, par conséquent), ait été d'origine juive sous prétexte qu'elle était d'origine espagnole (Lopez). Au pays de Taine, cette hypothèse, qui attendait les années où l'affaire Dreyfus se prépare pour voir le jour, aura de singulières vertus explicatives. Thibaudet lui-même y puisera une bonne part de son argumentation (« La goutte de sang juif est aussi sensible dans le mobilisme de Montaigne que dans celui de Bergson ou de Proust » ). Le livre de R. Trinquet [la Jeunesse de Montaigne, 1972) établit de manière définitive ce que, en dehors de toute preuve, cette hypothèse a de gratuit, de hautement improbable. 3. L'éducation : elle se répartit en deux actes. Le premier est précoce, d'un humanisme presque utopique, tout en douceur : le latin (que tout le monde, domestiques compris, a ordre d'utiliser à portée des oreilles de l'enfant) est la langue maternelle du petit Michel. Le second acte commence à dix ans. Il est plus sombre car il se passe à Bordeaux, au collège de Guyenne, où son père l'envoie, peut-être pour remédier à une certaine torpeur. Montaigne y restera au moins sept ans. Il en tirera le jugement très négatif qu'il porte sur la pédanterie, le monde de l'enseignement et ce qu'on y vend sous l'étiquette de savoir ; il y aura pourtant des professeurs aussi fameux que Buchanan, Muret, Gérente. 4. L'amitié : il est probable que, vers 1554, Montaigne se trouve pour la première fois, et oisif, à Paris. C'est là qu'il entendra aussi le nom de La Boétie, dont le Discours de la servitude volontaire circulait dans les cercles gascons de la capitale. Mais ce n'est qu'en 1558 qu'il en rencontre
l'auteur, au parlement de Bordeaux où ils deviennent collègues lorsqu'un édit y incorpore la cour des aides de Périgueux (Montaigne y avait une charge de conseiller). L'amitié qui lia immédiatement les deux hommes est légendaire : elle l'a été aussi pour eux. Elle fera le sujet du plus célèbre chapitre des Essais (I, 28). Mais elle fut brève : six ans après leur rencontre, La Boétie meurt dans les bras de son ami, qui envoie, aussitôt, à son père un rapport sur cette mort socratique ; cette lettre, premier texte de Montaigne (18 août 1563), est aussi son Criton; on peut dater de lui la décision qu'il prend d'être le Platon de cet ami qui, en mourant, lui a légué la totalité de ses livres et papiers. 5. La retraite : en 1570, Montaigne se retire, non sans solennité, dans le château dont il porte maintenant le nom et où il s'est fait aménager, dans une tour d'angle, une « librairie », c'est-à-dire une bibliothèque. Son père vient de mourir (1568) et il liquide quelques obligations : publier la traduction qu'il a faite de la Théologie naturelle de Raymond Sebond, éditer les opuscules dont La Boétie lui avait légué le manuscrit, vendre sa charge au parlement. Cette retraite spectaculaire ne doit pourtant pas être prise trop littéralement. La grande affaire de la vie de Montaigne est désormais la composition des Essais, mais les ponts ne seront pas totalement coupés pour autant avec la vie publique et qu'il ait décidé de « ménager sa volonté » ne l'empêchera pas de recevoir l'ordre de Saint-Michel, de participer en 1562 à une campagne contre les insurgés protestants, d'être à la cour en 1574. 6. Le voyage : la première édition des Essais paraît en 1580 à Bordeaux ; Montaigne se rend à Paris pour présenter son livre au roi, puis part pour l'Allemagne et l'Italie en une tournée des villes d'eau qui devrait le soulager de la pierre dont il souffre depuis plusieurs années. Il tient (ou fait tenir par son secrétaire) un Journal de ce voyage dont le manuscrit sera découvert en 1774 ; il s'interrompt à Lucques, où Montaigne reçoit la nouvelle qu'en son absence il a été élu à la mairie de Bordeaux. 7. Les mairies : la première mairie de Montaigne (1582-1584) sera calme ; ses concitoyens lui renouvelant leur confiance, elle est suivie d'un second mandat plus mouvementé : les guerres de Religion ravagent le Sud-Ouest et Montaigne, contre les ligueurs qui menacent Bordeaux, sert d'intermédiaire entre le protestant Henri de Navarre et le maréchal de Matignon, gouverneur de la province dévoué à Henri III. La peste éclate à Bordeaux, en son absence, alors que son mandat allait prendre fin. 8. Les huit dernières années : en 1586-87, à Montaigne, il met au point le troisième livre et les six cents additions dont il augmentera les Essais dans l'édition de 1588, qui paraît à Paris. Montaigne y rencontrera, à cette occasion, son admiratrice, Marie de Gournay. Inquiété par les ligueurs, il y passera aussi un jour à la Bastille. Sur le chemin du retour, il s'arrêtera à Blois, pour assister aux états généraux, juste avant que le duc de Guise n'y soit assassiné. À Montaigne, il lit abondamment et remplit les marges de son livre de notes destinées à une nouvelle édition. Mais il meurt en 1592 — d'une mort on ne peut plus catholique : on était en train de célébrer la messe dans sa chambre. Lui survivent sa mère, sa femme, sa fille. C'est donc une édition posthume qui publiera ses dernières pensées. Elle paraît en 1595, mise au point par M,le de Gournay à partir des notes manuscrites de Montaigne transcrites par Pierre de Brach. La retraite de 1571 n'appartient pas seulement à la vie de Montaigne : en la désœuvrant, elle l'ouvre à la possibilité de ce qui deviendra une œuvre ; les Essais sont la mise en œuvre de l'oisiveté à laquelle sa retraite l'initie. Cinq ans plus tard, à l'occasion de son quarante-deuxième anniversaire, Montaigne fait graver (en grec) sur un jeton : « Je m'abstiens. » L'écriture programmée dans le geste de la retraite opère, en effet, une soustraction du sujet qui se déduit du monde, s'en décompte en le mettant entre parenthèses : quelque chose comme une épochè phénoménologique (mais sans ego transcendantal) s'y effectue avant la lettre. Noli foras ire, in te redi, dit saint Augustin (cité par Husserl
à la dernière ligne des Méditations cartésiennes}.
Dans un geste analogue, Descartes doutera de la réalité du monde extérieur dans le poêle hivernal où il s'est retiré. Une double défection objective peut être assignée à l'origine de la retraite de Montaigne : la perte de deux objets (La Boétie, puis son père) qui le mettront en position mélancolique («C'est une humeur mélancolique... produite par le chagrin de la solitude en laquelle il y a quelques années que je m'étais jeté, qui m'a pris premièrement en tête cette rêverie de me mêler d'écrire », II, 8). Écrire correspond par conséquent au « travail du deuil ». Mais ce n'est pas seulement sur le plan ontologique que l'extérieur verra dénoncés son inconstance, son instabilité, son peu de réalité. S'il est douteux, c'est peut-être d'abord sur le plan moral. C'est ainsi que Montaigne justifie son départ en invoquant les vices d'un siècle auquel il préfère ne pas être mêlé : le pire et le plus rentable d'entre eux étant le mensonge, le faux-semblant (« La dissimulation est des plus notables qualités de ce siècle », II, 18 ; « Il ne se reconnaît plus d'action vertueuse : celles qui en portent le visage, elles n'en ont pas pourtant l'essence » (I, 37). La vertu est « un affiquet à pendre en un cabinet, ou au bout de la langue, comme au bout de l'oreille, pour parement » : au bout de la langue — elle n'est plus qu'un mot, ne se distingue plus de son nom. Ce siècle qui a oublié ce qu'elle est n'honore plus que son nom. En choisissant la solitude, Montaigne se désolidarise d'une telle vulgarisation de la vertu réduite à s'afficher, marginalisée en position décorative, comme un faire-valoir. Il ne veut plus paraître dans un monde qui ne distingue pas entre vertu et comédie de vertu.
« Dernièrement... je me retirai chez moi, délibéré autant que je pourrai ne me mêler d'autre chose que de passer en repos et à part ce peu qui me reste de vie » (I, 8). La physique antique (Zénon d'Élée) accordait plus de réalité objective au repos qu'au mouvement, concevait celui-ci comme une dégradation, un accident survenu à celui-là. Tout mouvement serait mû par le désir de s'arrêter. Le repos dans son lieu naturel (son assiette) est la perfection vers laquelle tend tout objet. Avant d'être l'apôtre du mobilisme, Montaigne (dans un siècle postcopernicien où le « branle » est en voie de généralisation) exprime d'abord le désir d'échapper aux infinies agitations mondaines, de « s'arrêter et se rasseoir en soi ». S'il se fixe à Montaigne, c'est pour y fixer son image par écrit : juste avant de s'y retirer, pour ses trente-huit ans, il a fait peindre sur les murs de sa bibliothèque une inscription latine ; il y affirme déjà la décision de passer le temps qu'il lui reste à vivre « en repos et en sécurité ». Il ne s'ensuit pas que l'écriture satisfera ce désir de stabilité. Au contraire, elle l'amènera à prendre goût à une mobilité qui était à l'origine l'objet d'une condamnation morale. Cette condamnation n'en reste pas moins ce à partir de quoi Montaigne se décide à écrire. C'est d'ailleurs au même désir qu'il faut sans doute rattacher l'indéniable (même si modéré) conservatisme de Montaigne, qui n'implique pas la reconnaissance de la rationalité du réel mais simplement la conviction que le statu quo est, en tout état de cause, la plus raisonnable des options (« Le pire que je trouve en notre état, c'est l'instabilité, et que nos lois, non plus que nos vêtements, ne peuvent prendre aucune forme arrêtée » (II, 17). A ce même goût de la stabilité se rattache un trait psychologique sur lequel Montaigne aime revenir : son inertie liée à son naturel « pesant, mol et endormi », à sa « complexion molle et pesante », c'est-à-dire son oisiveté constitutive. Le registre de la « gravité » l'assure contre le mouvement en général, contre la chute en particulier : les lieux où il se trouve sont ceux « d'où je ne puisse aller plus bas... La plus basse marche est la plus ferme. C'est le siège de la constance » (II, 17). On connaît, ne serait-ce que par Pascal, ses pages sur le vertige. L'humilité a du bon pour qui craint de tomber.
« Je ne me soucie pas tant quel je sois chez autrui, comme je me soucie quel je sois en moi-même » ; « Moi, je tiens que
je ne suis que chez moi » (II, 16) : ces formules, bien qu'elles dénoncent, dans leur contexte d'origine, l'aliénation glorieuse, doivent aussi être prises à la lettre ; elles décrivent, en effet, le mouvement de retraite par lequel Montaigne, se soustrayant à la servitude de qui se soumet à la dépendance d'autrui, quitte le monde pour se replier chez lui, en lui, dans ses propriétés ou du moins ce qu'il a de plus propre. Car, sans aller jusqu'à invoquer l'hypocrisie qui, dehors, fait triompher les dehors et les apparences, la vie sociale est par elle-même le règne de passions qui toutes sont des modalités d'existence dominées par ce qu'on appellerait, en termes sartriens, le pour-autrui. Chacun s'y perd en perdant le repos, s'oublie, s'égare. Un des tout premiers chapitres (« Que nos affaires s'emportent au-delà de nous ») décrit ainsi l'aliénation où se perdent les victimes vaniteuses de l'amour du plus lointain. Montaigne y passe en revue des vies préoccupées par une passion pour ainsi dire posthume : l'organisation de leurs funérailles, les plans de leur tombeau. Le retour à soi de la retraite oppose à ces égarements la proximité du pour-soi, voire la suffisance de l'en-soi (« Retirez-vous en vous », I, 39). Le sujet s'y propose en effet de se contenir et de se contenter soi-même, d'être à lui-même à la fois son contenu et son contenant : content de soi, content par soi. Mais c'est une double stratégie qui est ici nécessaire : il ne faudrait pas, en quittant la société, substituer une aliénation domestique à l'aliénation mondaine. L'extérieur, en effet, n'a pas l'exclusivité de l'étranger qui peut fort bien s'insinuer au sein du propre, l'exproprier du dedans, l'occuper. C'est ainsi que « De la solitude » dénonce les tracas de la « ménagerie » ou de l'« économie », aussi aliénants (et aussi serviles) que ceux de l'ambition. En se retirant à Montaigne, c'est le nom plutôt que le bâtiment que Montaigne prend en charge et s'approprie. La localisation de la retraite restera toujours quelque peu nominale, voire métaphorique. L'essentiel est de sauver son oisiveté, qui consiste d'abord dans le refus de toute occupation puisque toutes sont étrangères.
Avant que la mort de son père ne lui laisse la place libre, il n'était — pour autrui (au parlement de Bordeaux, par exemple) — que le « conseiller Ey-quem ». C'est en se retirant à Montaigne qu'il s'en fait un nom. Sans doute n'a-t-on pas entièrement tort d'ironiser sur les prétentions nobiliaires de l'auteur des Essais. Pourtant, indépendamment de tout travers imputable au futur auteur de « De la vanité », il faut voir que la problématique de la vie noble, imposée à Montaigne par ses aïeux, implique toute une négociation avec le monde des noms, des signes, avec le langage dont les rapports de Montaigne avec son propre nom propre constituent un symptôme, mais qui de manière beaucoup plus générale se décide dans l'entreprise des Essais.
La gloire est sans doute la plus violente forme de l'aliénation qui déporte au-delà d'elles-mêmes les victimes de la mondanité : au comble de la perversion posthume, l'homme qui sacrifie sa vie à sa mort, son être à son nom n'a plus d'intérêt que pour son absence. « Il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même » (III, 10). Celui qui tient à la gloire adopte l'attitude opposée. Alors qu'il est essentiel de ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de nous, le souci de la gloire nous livre à autrui, puisque son objet est ce qu'on dira de nous quand nous ne serons plus là pour nous défendre, pas même pour l'entendre (« Nous appelons agrandir notre nom, l'étendre en plusieurs bouches... Il semble que l'être connu, ce soit aucunement avoir sa vie et durée en la garde d'autrui. Moi, je tiens que je ne suis que chez moi », II, 16). « Nom » et « gloire » sont synonymes dans la langue du xvie s. Montaigne, qui dénonce les vanités de la gloire, s'est pourtant soucié de son nom noble. Un vieux débat recoupe ces problèmes : il porte sur l'étymologie qui rattacherait l'être noble (nobilis) à l'être connu (noscibilis). A. Compagnon a rappelé l'inspiration nominaliste de la critique du langage à l'œuvre chez Montaigne : elle implique une impropriété
fondamentale du nom par rapport à la chose. D'où il s'ensuit qu'une noblesse digne de ce nom ne saurait tenir à un nom ( « Il y a le nom et la chose ; le nom c'est une voix qui remarque et signifie la chose ; le nom, ce n'est pas une partie de la chose ni de la substance, c'est une pièce étrangère jointe à la chose et hors d'elle », II, 16). La condamnation générale de ce qui n'est ni proche ni propre, de ce qui est d'origine étrangère et qu'il faut donc emprunter, par quoi on s'endette, implique donc la dévaluation du monde du langage, du monde des signes en général. Elle joue en deux temps : 1. Seule compte la chose et le signe lui est extérieur. 2. Mais le signe (dans sa bassesse et servilité) est acceptable s'il reste à sa place, c'est-à-dire ne prétend pas prendre celle de la chose. Le signe est donc condamné et pardonné pour la même extériorité : il serait impardonnable s'il avait l'ambition d'y mettre fin. Une telle attitude proprement inflationniste entraînerait la dépréciation de la chose : une chose, en effet, n'a de valeur (de vertu) que dans la mesure où elle parvient à maintenir son signe hors d'elle-même, à l'exemple de Dieu qui ne se laisse pas affecter par sa gloire et, de ce fait, la mérite. Inversement, le vice de l'homme, son défaut de substance se trahissent d'abord dans l'intérêt qu'il prend à sa gloire.
De cette éthique sémiologique découle une alternative entre vanité et silence. La vanité s'imagine que son nom peut bénéficier à la chose, que l'être a un intérêt réel dans ce qu'on dit de lui. La vertu, au contraire, reste sourde aux effets qu'elle produit. Mais il faut aller plus loin : l'indifférence aux signes, qui est effectivement le propre de la vertu, se transforme aussitôt en une véritable allergie à l'égard de l'aliénation sémiotique. Car le signe, sauf exception, est toujours un parasite qui vit aux dépens de la chose. Dès qu'il apparaît, incipit comoedia : c'est l'hystérie ou le reportage, le spectaculaire ou le sensationnel. L'élément de la vertu est davantage le silence tragique. Tout un stoïcisme en découle : l'homme vertueux ne trahit pas ses émotions, il n'a pas besoin d'adresser ses affections. Curae leves loquuntur : les petits ennuis sont les plus bavards (I, 2). Loin de gagner à être connue, la vertu ne peut ainsi qu'y perdre. Le simple fait qu'il a eu un témoin qui a pu en parler fait peser un soupçon d'exhibitionnisme sur l'acte vertueux : peut-être ce témoin en était-il le destinataire en l'absence duquel il ne se serait pas produit (« À mesure qu'un bon effet est plus éclatant, je rabats de sa bonté le soupçon en quoi j'entre qu'il soit produit plus pour être éclatant que pour être bon », III, 10). D'où suit, en bonne logique, l'attribution d'une plus haute teneur en vertu aux actes qui ont dû se perdre sans témoin : les exemples se portent ombrage à eux-mêmes. Allergique à la phénoménalité, la vertu ne paraît pas : elle ne se publie pas.
Le paraître étant solidaire du pour-autrui, la critique qu'en fait Montaigne prend volontiers la forme d'une promotion de l'autotélie. Ce qui trouve sa fin en soi, qui ne tient qu'à soi, disparaît en soi en même temps. La vertu inaugure la série, elle qui « n'avoue rien que ce qui se fait pour elle et pour elle seule » (I, 37). Mais, très généralement, Montaigne ne concevra rien de plus haut que ce geste par lequel quelque chose disparaît en soi, disparaît en se contenant, en se retenant de paraître. Le suicide du jeune Caton est accompli « pour la beauté de la chose en elle-même » (II, 11). L'amitié « n'a affaire et commerce que d'elle-même » (I, 28). L'amour
« hait qu'on se tienne par ailleurs que par lui » (III, 5). Le repli autotélique sur soi est le repos où disparaît ce qui atteint sa forme parfaite. « Les plus délicieux plaisirs, si se digèrent-ils au-dedans, fuyent à laisser trace de soi, et fuyent la vue non seulement du peuple, mais d'un autre » (II, 18) : cette dernière remarque mérite qu'on s'y arrête. Non pas tant en raison de ce qu'elle dit, mais plutôt à cause du fait qu'elle le dit et à cause du fieu où elle le fait. C'est en effet son activité d'écrivain, le fait même qu'il a passé tant de temps à écrire le livre où il le dit, que Montaigne offre comme exemple de plaisir qui fuit à « laisser trace de soi ». Un ventriloquisme analo
gue, dans lequel l'énonciation apporte un démenti à l'énoncé qu'elle profère, s'était déjà fait entendre à la fin de « De la solitude ». Montaigne, qui vient d'exclure les travaux domestiques d'une sage oisiveté, examine ce qu'il en est des livres. Faut-il, comme le conseillent Pline et Cicéron, profiter de la solitude pour écrire ? Montaigne s'indigne de préoccupations aussi déplacées. « C'est une lâche ambition de vouloir tirer gloire de son oisiveté et de sa cachette. Il faut faire comme les animaux qui effacent la trace à la porte de leur tanière » (I, 39). Ces mots pourraient, eux aussi, paraître déplacés dans un livre où l'auteur met en œuvre son oisiveté. Mais peut-être préférera-t-on dire qu'ils sont métaphoriques, comme le sera le mot livre appliqué aux Essais. « Nous sommes, je ne sais comment, doubles en nous-mêmes, qui fait que ce que nous croyons, nous ne le croyons pas, et ne nous pouvons défaire de ce que nous condamnons » (I, 16).
C'est ici, dans ce déni d'un auteur qui dit ne pas tenir à ce qu'il dit, que se décide l'invention d'un rapport noble avec le monde des signes qui fait l'objet des soins les plus constants de Montaigne. Elle met en place un discours palinodique où l'arbitraire du signe devient la pièce maîtresse d'une écriture aristocratique, d'une aristographie. Un bref chapitre en décrit l'économie : « Ç'a été une belle invention, et reçue en la plupart des polices du monde, d'établir certaines marques vaines et sans prix pour en honorer et récompenser la vertu, comme sont les couronnes de laurier, de chêne, de myrte... » (II, 7). Des marques vaines : c'est précisément là leur qualité principale, peut-être unique. Seuls des signes qui affichent leur vanité peuvent remarquer la vertu sans la trahir : sans rapport avec ce qu'ils signifient, ils ne lui rapportent rien ; signes qui ont la vertu de ne pas prétendre augmenter la vertu, qui ne l'intéressent pas, ne lui profitent pas. Telle serait, en effet, la seule marque que, d'après Montaigne, la vertu puisse considérer comme « purement sienne », la seule marque qui l'honore, c'est-à-dire la maintienne du côté de l'honnête plutôt que de l'utile : le chapitre s'intitule « Des récompenses d'honneur ».
« Mémoires d'un amnésique » : ce titre d'Erik Satie n'aurait pas disconvenu aux Essais, dont l'auteur, en effet, revendique un défaut de mémoire si spectaculaire qu'il serait son seul titre sérieux à demeurer dans la mémoire des hommes, à être emporté au-delà de lui-même. Ce défaut de mémoire, qui est intervenu dans la décision de la retraite, n'est pas sans rapport, de ce fait, avec l'écriture des Essais. Une bonne mémoire est la condition nécessaire des ambitieuses carrières courtisanes dont le succès implique l'art du mensonge diplomatique. Condamné à la franchise par la nature qui l'en a totalement privé, Montaigne n'a pas le choix : il doit renoncer à la scène politique et s'essayer, chez lui, à un exercice de sincérité prolongé. Car, si cet amnésique prend la plume, ce n'est pas (comme, dans le Phèdre de Platon, Theuth le propose à Thamous) avec l'intention d'utiliser l'écriture comme un aide-mémoire, c'est au contraire pour pousser à bout ce défaut et en faire vertu. Platon, dans un autre dialogue (le Théé-tète), compare la mémoire à un morceau de cire sur lequel les perceptions impriment leur marque. Il suffira ici de rappeler l'étymologie (prétendue) de sincérité pour voir quel lien serré associe, chez Montaigne, le projet de se peindre et l'absence de mémoire : since-ritas viendrait en effet de sine cera, « sans cire ». L'écriture de Montaigne entend ainsi échapper à la suppléance pharmaceutique. Quand il veut vraiment se souvenir de quelque chose, il le « donne en garde à quelqu'autre » (II, 17).
Quelle que soit, du reste, la réalité de ce défaut de mémoire (le livre de Montaigne est truffé de milliers de rappels aussi bien personnels qu'historiques ou érudits), il s'agit d'un trait psychologique qui fait système, lui aussi, avec l'ensemble des gestes par lesquels l'écriture de Montaigne se définit. L'amnésie (variante du scepticisme à cet égard) est impliquée et, en quelque sorte programmée, par le projet d'une pratique aristo
964
cratique de l'écriture qui permettrait de distinguer, à la lecture, les têtes bien faites (c'est-à-dire bien nées) et les têtes bien pleines. Car la vénalité est, en dernière instance, la cible qu'attaque la pédagogie négative de Montaigne (« Ô que c'est un doux et mol chevet, et sain, que l'ignorance et l'incuriosité, à reposer une tête bien faite!», III, 13), cet apprentissage du non-savoir qui, plus qu'à rien d'autre, tient à se démarquer de l'ignoble étalage pédantesque auquel s'abaissent ceux qui vivent de leur plume. Écrire noblement exclut le projet roturier d'en faire un métier (« Une fin si abjecte est indigne de la grâce des Muses » I, 26). Une écriture honorable (dont l'honnêteté ne dérogerait pas avec les exigences d'une vie noble) doit être aussi « vaine » que les marques d'honneur : oisive et sans profit.
« C'est ici purement l'essai de mes facultés naturelles, et nullement des acquises » (II, 10). Conformément au programme des Essais eux-mêmes, la pédagogie de Montaigne — qui vise à former « non un grammairien ou logicien, mais un gentilhomme » (I, 26) — déprécie tout ce qui concerne l'ameublement de la mémoire, faculté acquise, valorise en revanche tout ce qui aide à exercer le jugement, faculté naturelle. Car l'aliénation doctrinale est la plus insinuante des occupations étrangères : exogène par son origine, la science reste extérieure à l'esprit qui s'en remplit la mémoire. Loin que je me l'approprie, c'est elle qui m'exproprie. Le scepticisme de Montaigne, en ce sens, n'est pas seulement un doute par lequel il suspend son adhésion à tel ou tel et même à la totalité des énoncés philosophiques, par cette suspension même il produit le « je » comme sujet de la phrase : «je ne sais pas ». Il en va de même de la mémoire : « Je » ne me souviens pas. Et, derechef, de la sincérité : « Les abeilles pillotent deçà delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur ; ce n'est plus thym ni marjolaine : ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et les confondra, pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement » (I, 26). Les Essais : jouissance amnésique de ce miel sans cire.
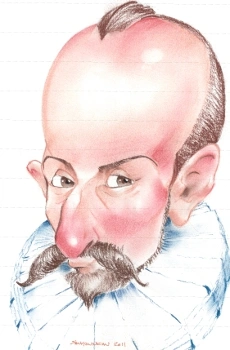
«
Michel Eyquem naquit au château de Montaigne en Périgord en 1533.
Les
premiers rudiments lui furent enseignés en latin par un précepteur
allemand nommé Horstanus ; il apprit le grec en guise de délassement et, à
l'âge de six ans, fut placé pendant sept ans au collège de Guyenne à
Bordeaux.
De Muret lui enseigna la philosophie et il s'instruisit dans le
droit à Bordeaux ou à Toulouse.
Dès l'âge de vingt et un ans, Montaigne
remplit diverses fonctions dans la magistrature et c'est au Parlement de
Bordeaux qu'il se lia avec “ l'ami de son âme ”, E.
de La Boétie , dont la mort
survenue en 1563 le sépara bientôt.
En 1562, il avait accompagné Charles IX
au siège de Rouen et, en 1565, il épousa Françoise de la Chassaigne.
Il
perdit son père en 1568 et, après un séjour à Paris où il publia (avec sa
traduction de la Théologie naturelle de Raymond Sebonde) les œ uvres de La
Boétie , il se retira à Montaigne de 1572 à 1580 ; nous devons les Essais à
cette longue retraite.
Les années 1580-81 furent remplies par de grands
voyages : en septembre 1580, il séjourne à Plombières, puis il parcourt la
Suisse, l'Allemagne et l'Italie, où il rend visite au Tasse dans sa prison de
Ferrare.
Élu maire de Bordeaux en 1581, il résigne ses fonctions en 1585 et
termine ses jours à Montaigne, annotant interminablement les Essais dans
la chère “ librairie ” de son château.
Quand approchèrent ses derniers
instants, il fit dire la messe dans sa chambre et rendit le dernier soupir au
moment de l'élévation.
Ainsi s'acheva sa vie, une des plus belles, si, comme
il le dit dans son “ livre de bonne foy ”, celles-ci doivent “ se ranger au
modèle commun et humain avec ordre puisqu'au plus élevé trône du
monde, encore ne sommes-nous assis que sur notre cul.
” En 1588, au cours
d'un voyage à Paris, il avait fait la connaissance de Mlle de Gournay, “ sa
fille d'alliance… l'une des meilleures parties de son être ” qui, en 1595,
devait publier la première édition posthume des Essais tenue longtemps
pour définitive..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- J'aime mieux forger mon âme, que la meubler - Michel de Montaigne (1533-1592)
- ESSAIS, Montaigne (Michel Eyquem de)
- Essais 1580-1588 Michel Eyquem de Montaigne (résume et analyse complète)
- ESSAIS. Ouvrage de Michel Eyquem, seigneur de Montaigne (analyse détaillée)
- ESSAIS (Les) Michel de Montaigne (résumé & analyse)