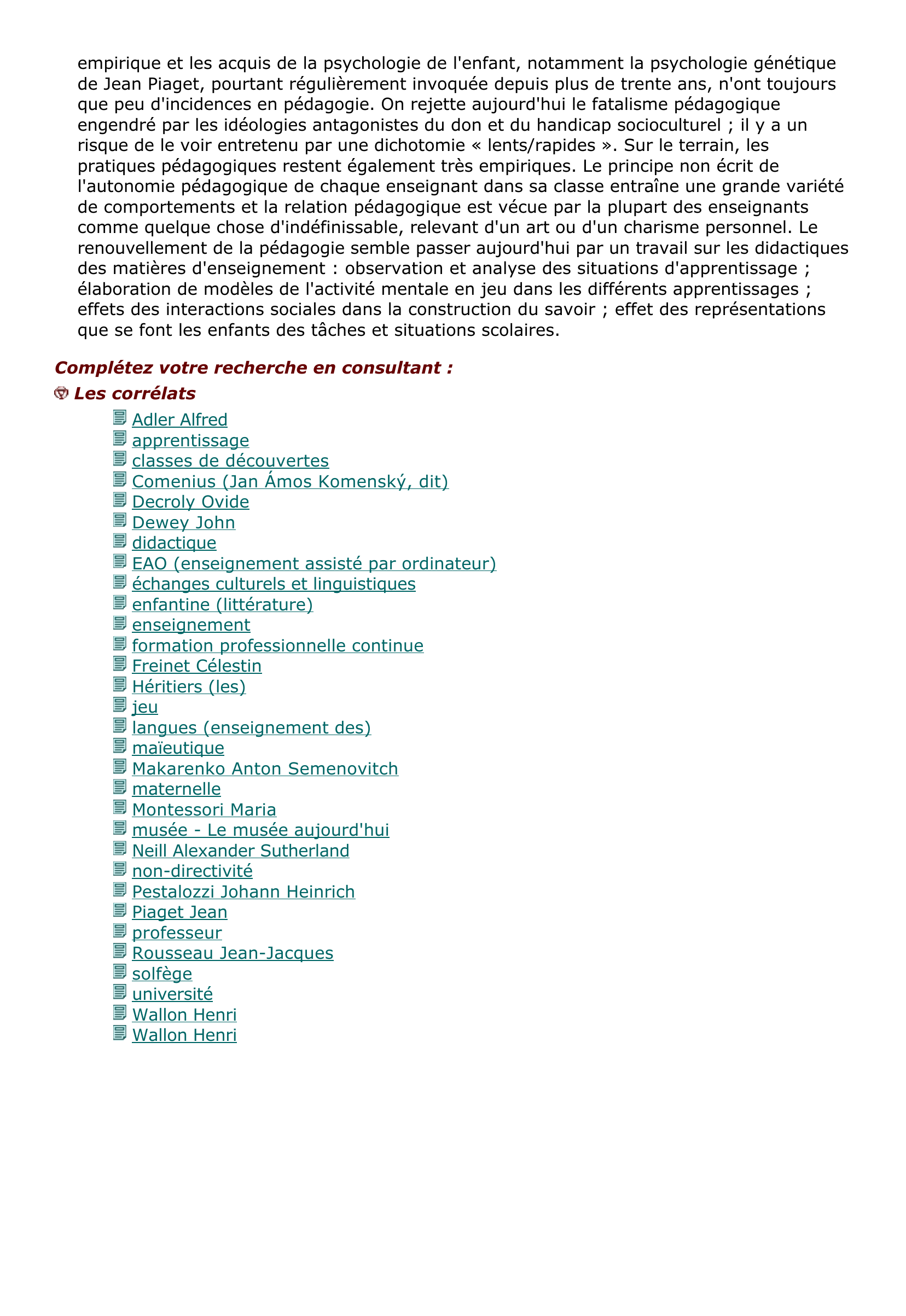pédagogie, n.
Publié le 18/11/2013

Extrait du document
«
empirique et les acquis de la psychologie de l'enfant, notamment la psychologie génétique
de Jean Piaget, pourtant régulièrement invoquée depuis plus de trente ans, n'ont toujours
que peu d'incidences en pédagogie.
On rejette aujourd'hui le fatalisme pédagogique
engendré par les idéologies antagonistes du don et du handicap socioculturel ; il y a un
risque de le voir entretenu par une dichotomie « lents/rapides ».
Sur le terrain, les
pratiques pédagogiques restent également très empiriques.
Le principe non écrit de
l'autonomie pédagogique de chaque enseignant dans sa classe entraîne une grande variété
de comportements et la relation pédagogique est vécue par la plupart des enseignants
comme quelque chose d'indéfinissable, relevant d'un art ou d'un charisme personnel.
Le
renouvellement de la pédagogie semble passer aujourd'hui par un travail sur les didactiques
des matières d'enseignement : observation et analyse des situations d'apprentissage ;
élaboration de modèles de l'activité mentale en jeu dans les différents apprentissages ;
effets des interactions sociales dans la construction du savoir ; effet des représentations
que se font les enfants des tâches et situations scolaires.
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
Adler Alfred
apprentissage
classes de découvertes
Comenius (Jan Ámos Komenský, dit)
Decroly Ovide
Dewey John
didactique
EAO (enseignement assisté par ordinateur)
échanges culturels et linguistiques
enfantine (littérature)
enseignement
formation professionnelle continue
Freinet Célestin
Héritiers (les)
jeu
langues (enseignement des)
maïeutique
Makarenko Anton Semenovitch
maternelle
Montessori Maria
musée - Le musée aujourd'hui
Neill Alexander Sutherland
non-directivité
Pestalozzi Johann Heinrich
Piaget Jean
professeur
Rousseau Jean-Jacques
solfège
université
Wallon Henri
Wallon Henri.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Sujet de pédagogie générale
- TRAITÉ DE PÉDAGOGIE d’Emmanuel Kant (résumé et analyse)
- Pour Montaigne « la vraie éducation doit être la conquête de la vraie liberté ». Pensez-vous que cette formule de M. Pierre Moreau résume bien la pédagogie de Montaigne ?
- pédagogie des compétences
- Pédagogie nouvelle et ancienne Synthèse construite par Sylvain sylvain.