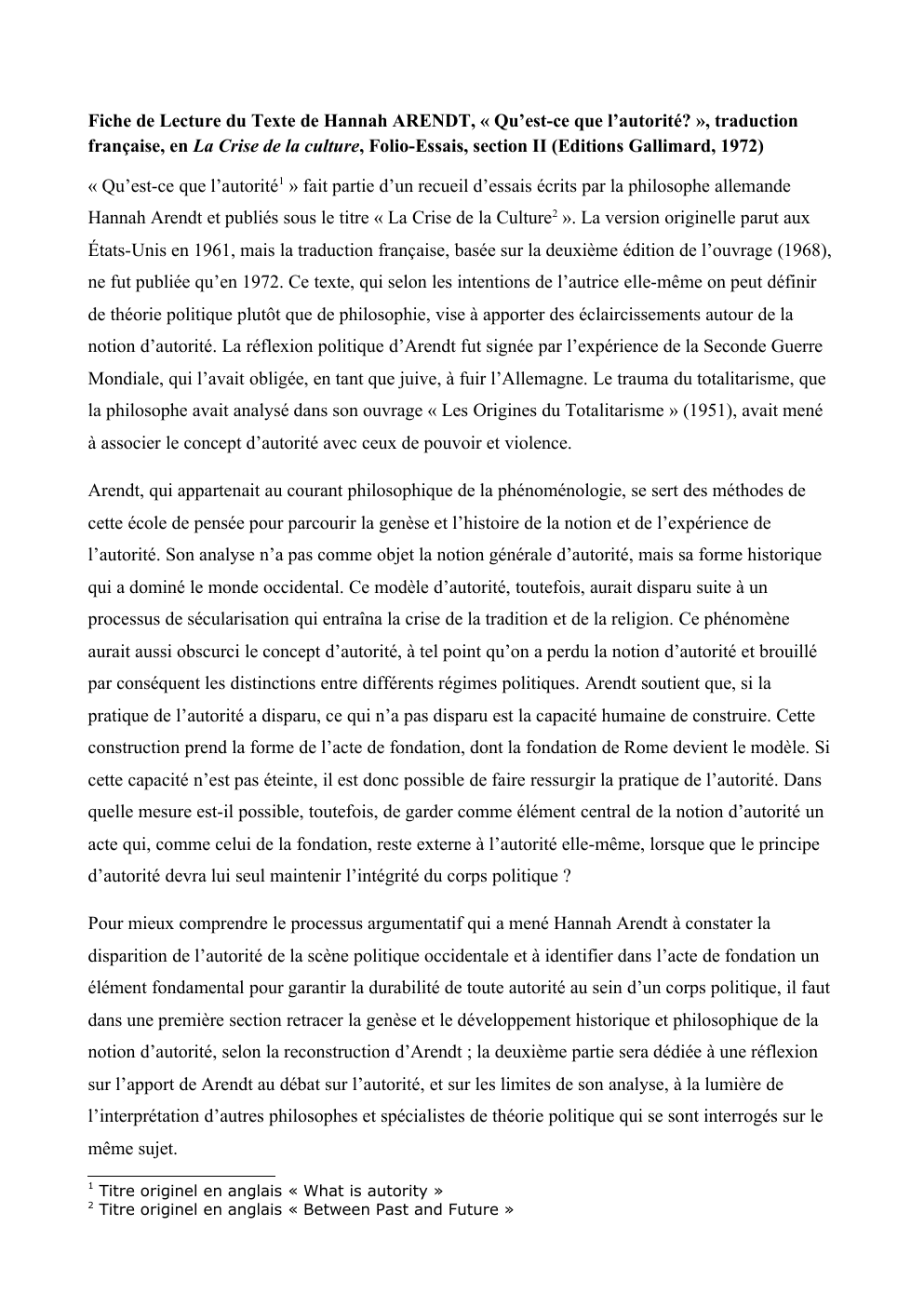Fiche de Lecture du Texte de Hannah ARENDT, « Qu’est-ce que l’autorité? »
Publié le 06/10/2025
Extrait du document
«
Fiche de Lecture du Texte de Hannah ARENDT, « Qu’est-ce que l’autorité? », traduction
française, en La Crise de la culture, Folio-Essais, section II (Editions Gallimard, 1972)
« Qu’est-ce que l’autorité1 » fait partie d’un recueil d’essais écrits par la philosophe allemande
Hannah Arendt et publiés sous le titre « La Crise de la Culture2 ».
La version originelle parut aux
États-Unis en 1961, mais la traduction française, basée sur la deuxième édition de l’ouvrage (1968),
ne fut publiée qu’en 1972.
Ce texte, qui selon les intentions de l’autrice elle-même on peut définir
de théorie politique plutôt que de philosophie, vise à apporter des éclaircissements autour de la
notion d’autorité.
La réflexion politique d’Arendt fut signée par l’expérience de la Seconde Guerre
Mondiale, qui l’avait obligée, en tant que juive, à fuir l’Allemagne.
Le trauma du totalitarisme, que
la philosophe avait analysé dans son ouvrage « Les Origines du Totalitarisme » (1951), avait mené
à associer le concept d’autorité avec ceux de pouvoir et violence.
Arendt, qui appartenait au courant philosophique de la phénoménologie, se sert des méthodes de
cette école de pensée pour parcourir la genèse et l’histoire de la notion et de l’expérience de
l’autorité.
Son analyse n’a pas comme objet la notion générale d’autorité, mais sa forme historique
qui a dominé le monde occidental.
Ce modèle d’autorité, toutefois, aurait disparu suite à un
processus de sécularisation qui entraîna la crise de la tradition et de la religion.
Ce phénomène
aurait aussi obscurci le concept d’autorité, à tel point qu’on a perdu la notion d’autorité et brouillé
par conséquent les distinctions entre différents régimes politiques.
Arendt soutient que, si la
pratique de l’autorité a disparu, ce qui n’a pas disparu est la capacité humaine de construire.
Cette
construction prend la forme de l’acte de fondation, dont la fondation de Rome devient le modèle.
Si
cette capacité n’est pas éteinte, il est donc possible de faire ressurgir la pratique de l’autorité.
Dans
quelle mesure est-il possible, toutefois, de garder comme élément central de la notion d’autorité un
acte qui, comme celui de la fondation, reste externe à l’autorité elle-même, lorsque que le principe
d’autorité devra lui seul maintenir l’intégrité du corps politique ?
Pour mieux comprendre le processus argumentatif qui a mené Hannah Arendt à constater la
disparition de l’autorité de la scène politique occidentale et à identifier dans l’acte de fondation un
élément fondamental pour garantir la durabilité de toute autorité au sein d’un corps politique, il faut
dans une première section retracer la genèse et le développement historique et philosophique de la
notion d’autorité, selon la reconstruction d’Arendt ; la deuxième partie sera dédiée à une réflexion
sur l’apport de Arendt au débat sur l’autorité, et sur les limites de son analyse, à la lumière de
l’interprétation d’autres philosophes et spécialistes de théorie politique qui se sont interrogés sur le
même sujet.
1
2
Titre originel en anglais « What is autority »
Titre originel en anglais « Between Past and Future »
Hannah Arendt ouvre son essai « Qu’est-ce que l’autorité » avec une constatation sur la disparition
du concept d’autorité dans le monde moderne3, et affirme que cette situation rend nécessaire une
investigation sur ce sujet, car « le mot lui-même a été obscurci par la controverse et la confusion4 ».
La cause d’une telle incompréhension est l’effondrement des autorité traditionnelles - notamment la
tradition et la religion - ce qui a culminé par l’expérience des régimes totalitaires.
Arendt d’abord
nous offre une définition négative de ce qui l’autorité n’est pas : elle affirme que « l’autorité
requiert toujours l’obéissance5 », mais ajoute que l’autorité est exercée « sans recourir à la
contrainte par la force ou à la persuasion par arguments5 ».
Certes, l’histoire du XX siècle nous a
mené à assimiler l’autorité à la force, à la violence, au pouvoir : au contraire, « l’autorité implique
une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté6 ».
Mais comment récupérer la notion
d’autorité, lorsque que la religion et la tradition ont disparu, et on doit survivre à l’absurdité d’un
monde sans vérité ? Selon Arendt, si c’est vrai que l’homme a perdu cette solidité cognitive après
siècles de sécularisation, ce qui lui reste est la « capacité humaine de construire7 ».
Il faut d’abord
procéder avec une reconstruction généalogique du concept d’autorité pour récupérer sa notion et sa
pratique.
Arendt nous met en garde contre le danger de l’oubli, et nous rappelle l’importance de la
mémoire comme « profondeur de l’existence humaine8 ».
La genèse du concept d’autorité passe à
travers une réflexion sur la philosophie grecque.
Même si les Grecs n’avaient une expérience
directe de l’autorité, Platon et Aristote ont jeté les bases théorétiques de ce concept.
Platon avait
cherché dans La République un principe d’autorité cohérent avec sa conception d’une vérité
absolue, qui existe dans le monde des idées, et qui peut être connue seulement par le philosophe, à
travers la raison.
L’acte de gouverner requiert un savoir de spécialiste, ce qui rend le roi-philosophe
un être apte à gouverner par nature.
Arendt lui reproche de chercher « une relation où l’élément de
contrainte résidait dans la relation elle-même antérieurement à l’expression effective du
commandement9 ».
Le problème est que la fonction des idées, chez Platon, était originairement celle
d’illuminer, pas de gouverner, et ce changement représente un coup de force.
La philosophie et les
idées sont considérées supérieures à la politique et à l’action, et le projet « politique » de Platon se
transforme en une domination de la raison.
Où la raison n’arrive pas à convaincre, Platon utilise le
3
Hannah Arendt, La Crise de La Culture
c’est, à mon avis, le fait que l’autorité a
fonde à soulever cette question »
4
Hannah Arendt, La Crise de La Culture
5
Hannah Arendt, La Crise de La Culture
6
Hannah Arendt, La Crise de La Culture
7
Hannah Arendt, La Crise de La Culture
8
Hannah Arendt, La Crise de La Culture
9
Hannah Arendt, La Crise de La Culture
(Edition Gallimard, Paris, 1972), page 121: « Car
disparu du monde moderne qui nous incite et nous
(Edition
(Edition
(Edition
(Edition
(Edition
(Edition
Gallimard,
Gallimard,
Gallimard,
Gallimard,
Gallimard,
Gallimard,
Paris,
Paris,
Paris,
Paris,
Paris,
Paris,
1972),
1972),
1972),
1972),
1972),
1972),
page
page
page
page
page
page
121
123
140
126
125
144
mythe, et conçoit une vie après la morte où les actions humaines sont punies ou récompensées, un
élément qui retournera dans la religion chrétienne.
La distinction platonicienne entre vie politique et
vie théorétique persiste chez Aristote, qui introduit les concept de hiérarchie et de domination dans
la polis comme une chose naturelle.
Il affirme que « tout corps politique est composé de ceux qui
commandent et de ceux qui sont commandés10 ».
Même si tous les hommes libres sont égaux, cette
différence est basée sur la distinction entre vieux et jeunes.
La place des « vieux » retourne dans le
contexte romain, qui représente le modèle pour la pratique de l’autorité.
La République romaine
enracine dans l’expérience politique l’héritage intellectuel grec, et légitime son autorité grâce au
caractère sacré de la fondation de la cité et des ancêtres (les maiores).
La mission de préserver et
augmenter le pouvoir de Rome devient donc une obligation pour les générations futures.
L’autorité
dérive du passé, et les anciens dans le Senat sont ceux qui gardent l’autorité, même s’il n’ont pas de
pouvoir.
Le passé est donc sanctifié par la tradition, et les Romains créent une religion politique qui
efface le conflit entre philosophie et politique.
Après la chute de l’Empire romain, l’Eglise
Chrétienne récupère l’héritage romain11 de la fondation à travers la figure de Christ, et l’image
platonicienne de l’Enfer,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt
- Hannah Arendt, La crise de la culture, Huit exercices de pensée politique (fiche de lecture)
- Fiche de lecture « La condition de l'homme moderne», Hannah Arendt
- fiche de lecture sur un texte de Gargantua (fin du roman)
- explication de texte hannah Arendt violence et histoire