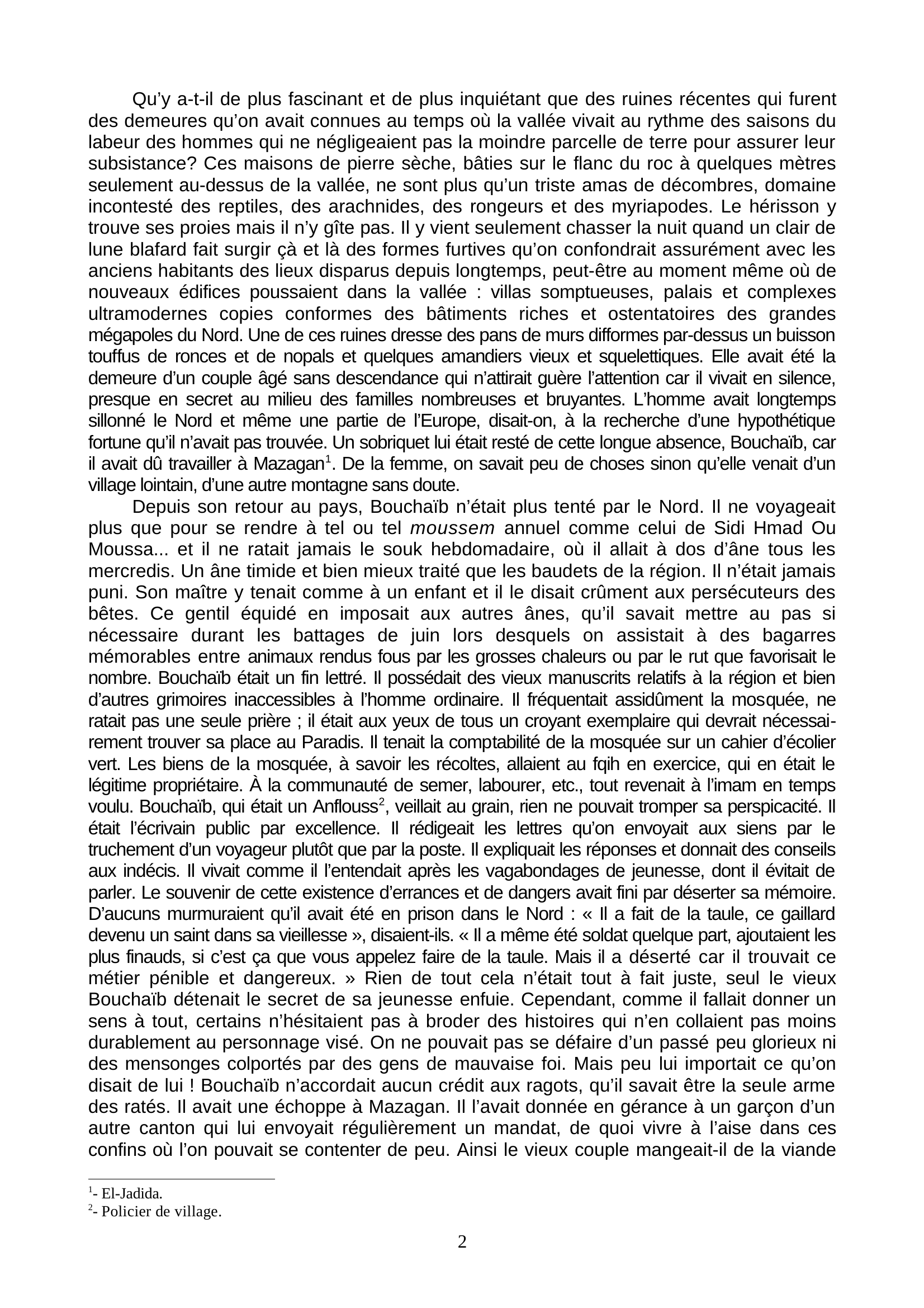MOHAMMED KHAÏR-EDDINE IL ÉTAIT UNE FOIS UN VIEUX COUPLE HEUREUX Récit ÉDITIONS DU SEUIL 27, rue Jacob, Paris Vie Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant que des ruines récentes qui furent des demeures qu'on avait connues au temps où la vallée vivait au rythme des saisons du labeur des hommes qui ne négligeaient pas la moindre parcelle de terre pour assurer leur subsistance? Ces maisons de pierre sèche, bâties sur le flanc du roc à quelques mètres seulement au-dessus de la vallée, ne sont plus qu'un triste amas de décombres, domaine incontesté des reptiles, des arachnides, des rongeurs et des myriapodes. Le hérisson y trouve ses proies mais il n'y gîte pas. Il y vient seulement chasser la nuit quand un clair de lune blafard fait surgir çà et là des formes furtives qu'on confondrait assurément avec les anciens habitants des lieux disparus depuis longtemps, peut-être au moment même où de nouveaux édifices poussaient dans la vallée : villas somptueuses, palais et complexes ultramodernes copies conformes des bâtiments riches et ostentatoires des grandes mégapoles du Nord. Une de ces ruines dresse des pans de murs difformes par-dessus un buisson touffus de ronces et de nopals et quelques amandiers vieux et squelettiques. Elle avait été la demeure d'un couple âgé sans descendance qui n'attirait guère l'attention car il vivait en silence, presque en secret au milieu des familles nombreuses et bruyantes. L'homme avait longtemps sillonné le Nord et même une partie de l'Europe, disait-on, à la recherche d'une hypothétique fortune qu'il n'avait pas trouvée. Un sobriquet lui était resté de cette longue absence, Bouchaïb, car il avait dû travailler à Mazagan[1]. De la femme, on savait peu de choses sinon qu'elle venait d'un village lointain, d'une autre montagne sans doute. Depuis son retour au pays, Bouchaïb n'était plus tenté par le Nord. Il ne voyageait plus que pour se rendre à tel ou tel moussem annuel comme celui de Sidi Hmad Ou Moussa... et il ne ratait jamais le souk hebdomadaire, où il allait à dos d'âne tous les mercredis. Un âne timide et bien mieux traité que les baudets de la région. Il n'était jamais puni. Son maître y tenait comme à un enfant et il le disait crûment aux persécuteurs des bêtes. Ce gentil équidé en imposait aux autres ânes, qu'il savait mettre au pas si nécessaire durant les battages de juin lors desquels on assistait à des bagarres mémorables entre animaux rendus fous par les grosses chaleurs ou par le rut que favorisait le nombre. Bouchaïb était un fin lettré. Il possédait des vieux manuscrits relatifs à la région et bien d'autres grimoires inaccessibles à l'homme ordinaire. Il fréquentait assidûment la mosquée, ne ratait pas une seule prière ; il était aux yeux de tous un croyant exemplaire qui devrait nécessairement trouver sa place au Paradis. Il tenait la comptabilité de la mosquée sur un cahier d'écolier vert. Les biens de la mosquée, à savoir les récoltes, allaient au fqih en exercice, qui en était le légitime propriétaire. À la communauté de semer, labourer, etc., tout revenait à l'imam en temps voulu. Bouchaïb, qui était un Anflouss[2], veillait au grain, rien ne pouvait tromper sa perspicacité. Il était l'écrivain public par excellence. Il rédigeait les lettres qu'on envoyait aux siens par le truchement d'un voyageur plutôt que par la poste. Il expliquait les réponses et donnait des conseils aux indécis. Il vivait comme il l'entendait après les vagabondages de jeunesse, dont il évitait de parler. Le souvenir de cette existence d'errances et de dangers avait fini par déserter sa mémoire. D'aucuns murmuraient qu'il avait été en prison dans le Nord : « Il a fait de la taule, ce gaillard devenu un saint dans sa vieillesse «, disaient-ils. « Il a même été soldat quelque part, ajoutaient les plus finauds, si c'est ça que vous appelez faire de la taule. Mais il a déserté car il trouvait ce métier pénible et dangereux. « Rien de tout cela n'était tout à fait juste, seul le vieux Bouchaïb détenait le secret de sa jeunesse enfuie. Cependant, comme il fallait donner un sens à tout, certains n'hésitaient pas à broder des histoires qui n'en collaient pas moins durablement au personnage visé. On ne pouvait pas se défaire d'un passé peu glorieux ni des mensonges colportés par des gens de mauvaise foi. Mais peu lui importait ce qu'on disait de lui ! Bouchaïb n'accordait aucun crédit aux ragots, qu'il savait être la seule arme des ratés. Il avait une échoppe à Mazagan. Il l'avait donnée en gérance à un garçon d'un autre canton qui lui envoyait régulièrement un mandat, de quoi vivre à l'aise dans ces confins où l'on pouvait se contenter de peu. Ainsi le vieux couple mangeait-il de la viande plusieurs fois par mois. Des tagines préparés par la vieille, qui s'y connaissait. Cela donnait lieu à un rituel extrêmement précis. Seul le chat de la maison y assistait car il était tout aussi intéressé que le vieux couple. Après avoir mis un énorme quignon à cuire sous la cendre, la vieille femme allumait un brasero et attendait que les braises soient bien rouges pour placer dessus un récipient de terre dans lequel elle préparait soigneusement le mets. Allongé sur un tapis noir rugueux en poils de bouc, le Vieux sirotait son verre de thé et fumait ses cigarettes, qu'il roulait lui-même. Ni l'un ni l'autre ne parlaient à ce moment-là. Chacun appréciait ce calme crépusculaire qui baignait les environs d'une étrange douceur et que seul le bruit des bêtes rompait par intermittence. On avait apprêté les lampes à carbure et l'on attendait patiemment le déclin du jour pour les allumer. On pouvait manger et passer la nuit sur la terrasse car l'air était agréable et le ciel prodigieusement étoilé ; on voyait nettement la Voie lactée, qui semblait un plafond de diamants rayonnants. En observant cette fantastique chape de joyaux cosmiques, le Vieux louait Dieu de lui avoir permis de vivre des moments de paix avec les seuls, êtres qu'il aimât : sa femme, son âne et son chat, car aucun de ces êtres n'était exclu de sa destinée, pensait-il. De temps en temps, il se remémorait les vieilles légendes, mais sa pensée allait surtout s'égarer parmi ces feux chatoyants à la fois proches et lointains. « Est-ce là que se trouve le fameux Paradis? se demandait-il. Et l'Enfer? Où serait donc l'Enfer? « Comme il n'y avait aucune réponse, il oubliait vite la question. Inutile de fouiller dans les mystères célestes pour savoir où est ceci ou cela. L'air devenait de plus en plus agréable à mesure que la nuit tombait. C'était l'heure où la vieille allumait les deux lampes et où les insectes, appelés comme par un signal, tombaient lourdement sur la terrasse. La vieille s'installait à son tour à côté du Vieux, prenait son thé sans rien dire. On écoutait les mille et un petits bruits de la nature : le jappement lointain du chacal, la plainte du hibou, le crissement des insectes et parfois le sifflement reconnaissable de certains serpents. Tous les prédateurs se préparaient à la chasse, une chasse risquée où le plus fort pouvait survivre bien que le sort de la proie fût scellé d'avance. Dans l'étable, la vache avait fini de manger et, comme elle ne meuglait pas, la vieille femme pouvait la croire endormie. C'était sa bête favorite. Elle faisait comme elle les labours dès les primes pluies d'octobre. Elle produisait un bon lait que la maîtresse de maison barattait dès la traite matinale. Ensuite, elle le mettait au frais pour le repas de midi. Elle obtenait un petit-lait légèrement aigrelet qu'elle parfumait d'une pincée de thym moulu et de quelques gouttes d'huile d'argan. Le couscous d'orge aux légumes de saison passait bien avec cela. Un couscous sans viande que le vieux couple appréciait par-dessus tout. Pour la corvée d'eau, la vieille allait au puits deux fois le matin. À son retour, elle ne manquait jamais d'arroser copieusement un massif de menthe et d'absinthe dont elle découpait quelques tiges pour le thé qu'on consommait matin, midi et soir. Les voisins avaient pris la fâcheuse habitude de venir quémander quelques brins de ces plantes, mais rien n'irritait le vieux couple, qui aimait rendre ces menus services. On les aimait parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, aucun litige avec les gens et que, après eux, leur lignée serait définitivement éteinte, ce que tout le monde regretterait sans doute... oui on aimait ces deux vieillards. Mais personne n'osait aborder ce sujet tabou car l'homme stérile se considérait à tort moins qu'un homme vu que son sperme n'était qu'une eau sans vie. Le Vieux ne pensait plus à cela. Il savait que toute lignée avait une fin et il s'accommodait de cette évidence. « C'est ailleurs que je recommencerai une autre jeunesse, ailleurs qu'aura lieu le nouveau départ. Ici, c'est fini. Mais est-ce qu'il est permis de se reproduire au Paradis ? « se disait-il. Des questions cul- de-sac qui ne menaient qu'à un mur infranchissable. Il n'avait donc aucun regret, pas la moindre amertume. Au contraire, il se sentait en paix avec son âme, heureux et totalement éloigné de certaines vanités terrestres comme de posséder une nichée bruyante et batailleuse qui vous attire surtout les remontrances et la hargne du voisinage. Il n'avait donc jamais envié les pères de famille nombreuse et encore moins ces pauvres hères qui alignaient tellement d'enfants qu'ils en étaient accablés. Il savait aussi que la plupart d'entre eux n'avaient aucun avenir et qu'ils répéteraient fatalement le même processus de misère en ce monde frénétique et dur. Beaucoup quittaient le pays et allaient s'échouer dans un quelconque bidonville du Nord. Ils ne revenaient plus au village. Les plus chanceux étaient engagés en Europe comme mineurs de fond. Et ceux qui trimaient à Casablanca ne relevaient la tête que s'ils étaient soutenus par les épiciers. Ils apprenaient alors le métier sur le tas et finissaient souvent par ouvrir un magasin d'alimentation. Non ! Décidément, je n'envie pas le sort de ces reproducteurs. Sa vieille femme interrompit ses réflexions. - À quoi penses-tu donc ? dit-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il s'écoula un bon moment puis il dit : - À quoi je pense ? Eh bien, à tous ces gens qui ont trop d'enfants et qui ne peuvent même pas les nourrir. - Eh bien, moi, je suis une grand-mère sans petits-enfants, mais je suis heureuse. - C'est ce que je pense moi-même. Sers-nous donc à dîner. Non, attends un peu ! Je dois d'abord faire ma prière. Il se leva, fit sa prière, puis revint. Ils mangèrent calmement en devisant. Il lui parla de sa journée à la mosquée. Elle l'entretint de la vache, de ses poules bonnes pondeuses, qu'un chat sauvage égorgeait depuis peu. - Qu'est-ce que tu peux faire contre lui ? dit-elle. - Lui tendre un piège. Après quoi... - Mais tu as déjà essayé ! Au lieu de ce maudit chat, c'est le coq blanc, ton préféré, qui a été pris. - Je mettrai le piège où la volaille ne peut pas aller, c'est tout. J'ai mon idée là-dessus. - Merci. - Ton tagine est fameux. Et le pain aussi. Elle rit. - Dieu nous en fasse profiter, dit-elle. Ils se resservirent du thé. - Cette année a été bénéfique, il a beaucoup plu. Il est même tombé de la neige sur les hauteurs. Les moissons approchent. Tout le monde s'y prépare. As-tu pensé aux moissons ? demanda le Vieux. - Oui, j'y pense. Je trouverai bien quelqu'un pour m'aider. Il y a un tas de jeunes filles disponibles et serviables. - Que Dieu t'entende! Ils parlèrent encore un bon moment. Le Vieux fumait en avalant de toutes petites gorgées de ce thé vert de Chine qu'un ami lui envoyait de France. Un thé prohibé qu'il appréciait plus que tout au monde. Plus tard, ils s'allongèrent côte à côte et s'endormirent sous le ciel étoilé du Sud. « Mais qu'est-ce que vous nous dites là ? Des gens d'ici seraient-ils recherchés par la police? Mais qu'ont-ils donc fait et qui sont-ils ? « Un Mokhazni armé d'un M.A.S. 36 était venu ce jour-là à la mosquée en compagnie du Mokaddem. Il exhibait une liste de noms de gens recherchés Casablanca pour faits de résistance - ce qu'on appelait le terrorisme à l'époque. Et c'est en sa qualité d'Anflouss que Bouchaïb le reçut. Dans toutes les villes du Nord, la résistance à l'occupation était très active. Il y avait des attentats à la bombe, des rafles massives et des exécutions sommaires. Les traîtres étaient châtiés sans pitié mais les feddaïns payaient de leur vie leurs exploits. Comme Zerktouni ou Allal ben Abdallah... Certains commerçants nationalistes qui aidaient financièrement la résistance étaient connus des services secrets mais on ne pouvait pas les arrêter car ils s'étaient fondus dans la nature. On pensait donc qu'ils étaient allés se cacher dans leur village d'origine. Certains d'entre eux s'y trouvaient bel et bien mais nul n'osait les dénoncer, pas même le Mokaddem ni le Cheik, qui les fréquentaient quotidiennement, déjeunaient ou jouaient aux cartes avec eux. Le Cheik était lui-même un résistant notoire, il militait pour l'indépendance. « Non ! On ne les a pas vus ici depuis des années, dit Bouchaïb. Vous perdez votre temps et vous nous faites perdre le nôtre. Retournez plutôt chez votre capitaine et faites-lui savoir que ces gens-là ne sont pas revenus ici depuis des années. - D'accord. Mais on croit que... - On peut croire ce qu'on veut. Ils ne sont pas ici, un point c'est tout. « Le Mokhazni repartit sans avoir obtenu le moindre renseignement ni le plus petit indice de leur présence. Il reprit le chemin du bureau en jurant avoir reconnu en la personne d'Untel l'un de ces fugitifs, mais il n'en était pas vraiment sûr. « Nous ne sommes pas des traîtres, dit Bouchaïb au Mokaddem. - Ah, ça non ! « Cependant, il informa les intéressés de cette visite, mais ils ne s'inquiétèrent pas. « Tout ça, c'est du vent. Qui peut nous atteindre ici ? Il faudrait une armée. Quand on est dans la montagne, on est insaisissable «, dirent-ils. Cet incident n'eut pas de suite. Les résistants continuèrent de vivre leur exil chez eux jusqu'à l'indépendance. Ce souvenir était si cher au vieil homme qu'il en reparlait souvent. « Cette époque était celle de l'enthousiasme, du sacrifice et de l'honneur. Où est tout cela, à présent ? « affirmait-il, puis il revenait au quotidien. Un quotidien calme qu'il appréciait car il n'avait aucun souci à se faire, et sa seule obligation était de vivre et de prier. Ses journées se passaient entre la mosquée, les champs et la maison où, après le repas de midi, il faisait une longue sieste, à l'abri de la canicule qui régnait dehors. Il dormait dans un coin frais du rez-de-chaussée où seul le bourdonnement des mouches prises dans des toiles d'araignée se faisait entendre. Ce bruit ne le dérangeait pas. Il représentait pour lui l'une des musiques secrètes de la vie, un langage essentiel adapté à l'univers des êtres qui luttent contre la mort omniprésente. - Ce soir, j'irai mettre des pièges. On mangera du lièvre demain. Il avait plusieurs assortiments de pièges et il savait où les tendre pour capturer tel ou tel gibier. Il aimait bien la chair du porc-épic, mais il lui préférait celle du lièvre, qui sentait bon les aromates. Et c'est sans surprise que le lendemain à l'aube il rapporta deux lièvres qu'ils dégustèrent, sa femme et lui, le soir même sur la terrasse. Le chat eut une grosse part. - J'ai donné un peu de ce gibier à la voisine, dit la voisine, dit la vieille. - Tu as bien fait. Elle ne mange pratiquement pas de viande. Une fois l'an peut-être, à l'occasion de l'Aïd, si des gens charitables lui en offrent. Il y a longtemps qu'elle vit seule. Elle n'a personne au monde. Il faut penser à cette femme de temps en temps, recommanda le Vieux. - Je pense souvent à elle, je ne la néglige pas. Cette pauvre vieille vivait dans une immense bâtisse en partie délabrée parmi des multitudes de rats et de chauves-souris. Elle était encore assez vigoureuse pour entretenir une vache et s'occuper des corvées journalières. Tout le voisinage la respectait et l'aidait. Elle ne manquait de rien, en vérité. On la surnommait Talouqit[3] sans trop savoir pourquoi. Il y avait ainsi de ces noms bizarres que les gens portaient comme une tunique élimée et dont ils ignoraient la provenance. Pendant les fêtes, elle faisait elle- même le pain communautaire car elle avait dans la cour de sa maison un grand four en terre battue qu'elle utilisait à merveille. Les enfants qui venaient là ne repartaient pas sans emporter une galette rembourrée d'un oeuf dur en coque cuit à l'intérieur de la pâte. On aimait cette femme dont on savait seulement qu'elle était une sainte et qu'elle lisait et écrivait couramment en arabe classique et en berbère[4]. Elle tenait ces connaissances de ses ancêtres, qui étaient des cheiks vénérés; fait rare dans le clan des Aït Al Hassan, qui préféraient la guerre à la science. C'était donc une Tagourramte[5] capable d'engager une joute verbale avec n'importe quel alim[6]. Mais elle évitait de passer pour une guérisseuse, même occasionnellement, alors qu'elle n'ignorait rien des vertus des simples, seule pharmacopée de l'époque. Cependant, elle dut parfois soigner des enfants atteints de typhoïde ou de toute autre maladie grave. « Les enfants sont des anges, disait-elle. Je peux les soigner mais c'est Dieu qui les guérit. « Elle ne vendait donc pas son savoir au premier venu comme ces charlatans qui infestaient les souks et les rassemblements saisonniers. Elle s'occupait tout particulièrement des maâroufs[7] comme celui de Sidi Bourja, dont le monument funéraire dominait l'entrée d'un ancien cimetière ceint d'un mur de pierre et d'épineux, à l'écart du village et tout à côté de ruines presque entièrement effacées, si bien qu'on ne savait rien du nom du site. Au vrai, personne ne connaissait l'histoire de la région. Les écrits qui lui étaient consacrés étaient rares et indécryptables. Il aurait fallu le concours d'experts pour les traduire en clair, ce qui n' intéressait personne vu l'insignifiance historique de ces lieux reculés où l'on avait coutume de se réfugier pour fuir les envahisseurs de tout poil qui s'emparaient surtout des plaines côtières et des ports. Ces peuples des montagnes n'avaient connu que des guerres, des vendettas, et quand l'étranger ne les inquiétait pas ils s'étripaient entre eux, s'engageant ainsi dans des luttes intestines sanglantes et interminables. - Talouqit est une sainte femme, dit le Vieux. - Tout le monde en convient, répondit la vieille. Elle est capable de réciter le Coran d'une seule traite. - Elle me fait penser à Lalla Tiizza Tasemlalt, sainte et savante dont on dit peut-être à tort qu'elle fut la maîtresse attitrée de Sidi Hmad Ou Moussa n'Zzaouit, le saint aux mille et un miracles et prodiges. - Que ne dit-on pas ! On fabrique des histoires à défaut de détenir la stricte vérité, rétorqua la vieille. Les gens sont plus mauvais que la teigne. Pire ! On peut soigner la teigne mais on ne peut changer les mentalités. - En tout cas, il n'y a plus de femme de ce genre, précisa la vieille. Il n'y a plus que des ignorantes bâtées qui triment sous le soleil ou dans la tourmente. - C'est vrai ! L'ignorance fait des ravages. Nous n'appartenons pas à cette époque. Nous ne créons rien, mais nous consommons tout. Serions-nous donc inutiles ? Nous ne valons pas grand-chose, crois-moi. Un jour, peut- être... Les peuples du monde entier avancent dans la lumière d'un jour nouveau pendant que nous stagnons au fond d'une obscurité semblable à une eau croupie qui déjà pue la vermine. Mais ce n'est pas à ça que je pense. Je ne pense qu'à moi seul en ce moment. Je ne laisserai rien derrière moi en disparaissant. Le monde peut très bien se passer de moi, car même ceux qui m'enterreront ne seront pas de mon sang. C'est aussi bien comme ça. On est venu tout nu, on repart tout nu. C'est de l'autre côté du visible qu'existe le miracle tant espéré même par les Prophètes, et c'est pourquoi je prie Dieu de me préserver des turpitudes d'ici-bas. - C'est de la tristesse, dit la vieille. - Eh non ! Je suis logique avec moi-même, c'est tout. Tu sais, il y a quand même de très bonnes choses, comme ce dîner par exemple. Mais avant de nous coucher, j'aimerais t'apprendre une chose... ou plutôt deux. Tout d'abord, demain nous offrons un grand sacrifice à la mosquée. Deux boeufs seront égorgés. Chaque famille aura sa part de viande et il y aura un repas commun auquel seuls les hommes participeront. Ce sera magnifique. Et maintenant, voici l'autre chose : depuis quelque temps, je fais un rêve absurde, toujours le même. Il y a là un grand arbre, un amandier vénérable plus haut que tous les autres... et sur ses branches supérieures beaucoup d'amandes qu'il est impossible de gauler sans grimper. Fasciné par elles, je n'hésite pas, je monte... et c'est au moment où je lève le bras pour gauler que je perds l'équilibre et tombe. Et puis, plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? - Je ne sais pas. Mais tu devrais faire attention. À ton âge, on ne grimpe plus aux arbres. Dors bien et rêve d'autre chose. Cette nuit-là encore, il rêva du même arbre. C'était le même scénario. Ce qui le turlupinait, c'était de ne pas pouvoir donner un sens à ce songe obsédant. Il aurait pu en toucher un mot au fqih, mais il ne le fit pas. « Après tout, presque tous les rêves relèvent de l'absurdité pure et simple, pensait-il. Mais pourquoi celui-ci fausse-t-il ma gaieté ? « En se rendant à la mosquée, il oublia complètement cet incident. Il rencontra le boucher et un vénérable vieillard qui ne sortait de chez lui qu'occasionnellement. Ils empruntèrent le même chemin montant, aidant le vieux à avancer, et ce, jusqu'à la mosquée située tout en haut du village, raison pour laquelle on l'appelait Timzguid n't Gadirt[8]. Cette mosquée, aujourd'hui désaffectée, a été remplacée par un édifice en béton doté de panneaux solaires et situé sur le sol ferme et non plus sur la roche granitique. Elle ne désemplit pas car son accès est aisé. On ne s'essouffle pas pour y parvenir. Même les plus réfractaires à la marche à pied s'y rendent. Arrivés tout en haut, à destination, Bouchaïb et le boucher quittèrent le vieillard et allèrent voir les bêtes du sacrifice. C'étaient deux boeufs énormes, un noir et un rouquin. Dès qu'ils les virent, les bovins s'agitèrent et tentèrent de se relever, mais ils ne le purent car ils portaient des noeuds de corde aux quatre pattes. Leurs naseaux fumaient sous le soleil matinal et l'on sentait une odeur âcre de bouse et d'urine. Les bêtes avaient passé la nuit ici même sous la surveillance d'un gardien. ' - Ils ont coûté cher, dit Bouchaïb, mais la mosquée a les moyens et les commerçants du Nord sont généreux, quoi qu'on dise. Ailleurs, il y a des mosquées tellement pauvres que leur imam porte des guenilles pouilleuses. Il lui arrive même parfois de jeûner faute d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. - C'est bien ennuyeux, dit le boucher. Il y avait foule sur la place. Certains hommes fumaient de longues pipes en bavardant pendant qu'un groupe de Noirs leur servaient le thé. Des enfants morveux et dépenaillés couraient les uns après les autres, crâne rasé et houppe au vent. Ils avaient congé ce jour-là, mais ils préféraient assister au sacrifice qu'aller se baigner dans le torrent. Leurs criailleries exaspéraient certains fumeurs qui les vouaient à tous les diables, mais ces effrontés n'en avaient cure. Le goût du sang et de la fête était plus fort qu'une admonestation ou même une gifle. Aussi ne pleuraient-ils pas quand ils en recevaient une. Ils s'empourpraient seulement et se remettaient à crier plus fort qu'auparavant. On les verrait tout à l'heure courir après les boeufs, auxquels on faisait faire plusieurs fois le tour de la mosquée avant le sacrifice. Au moment décisif, ils regarderaient couler le sang à gros bouillons sans éprouver d'effroi. Ils trouveraient naturel qu'on égorgeât d'aussi grosses bêtes, et ils se délecteraient de leur viande rouge après avoir joué au ballon avec leur vessie encore humide. De grands kanouns[9] étaient déjà allumés à l'écart. On avait apporté d'énormes marmites pour la cuisson du repas communautaire. Il n'y aurait pas de couscous vu le temps que sa préparation demandait, mais on servirait un énorme tagine agrémenté de légumes divers. Le pain viendrait des fours du voisinage où les femmes s'activaient depuis le lever du jour. Après cette grande agape, les inflass procéderaient au partage équitable de la viande destinée aux familles, puis tous rentreraient chez eux, repus et satisfaits. Ainsi se passa cette mémorable fête qui n'eut pas d'équivalent par la suite. Le vieux Bouchaïb raconta l'événement à sa femme, mais cette affaire d'hommes ne l'intéressait pas. Elle apprécia néanmoins le lot de viande que le Vieux avait rapportée. - Tiens ! Pour une fois, tu n'iras pas au souk, dit-elle. - C'est aussi bien, répondit le Vieux. Nous avons tout ce qu'il faut ici pour au moins quinze jours. - Qu'est-ce que tu veux pour ce soir ? Du lièvre ? - Il en reste encore ? - Oui. - Alors prépare-le. Ils étaient assis sur une natte de jonc dans une petite pièce rectangulaire qui donnait directement sur la vallée. On voyait nettement la cime des grands palmiers-dattiers et quelques vieux caroubiers plus près de la maison... On entendait le croassement des corbeaux réfugiés sur les palmes, le roucoulement des tourterelles dans les oliviers et les arganiers, et la stridulation insistante des cigales. À un moment donné, un coup de feu claqua. Bouchaïb alla regarder par la fenêtre, puis il dit : - C'est Hmad qui chasse le corbeau. Sa femme est malade, elle besoin de la chair de ce volatile. - La pauvre ! - Elle est plus jeune que toi mais si épuisée par ses grossesses qu'elle tient à peine debout. - On ne la voit jamais. On ne sait pas à quoi elle ressemble. - C'est une recluse. Hmad n'aime pas voir traîner ses femmes dehors. Il les saignerait plutôt ! - Ce serait dommage ! Ses filles sont belles. - Personne ne peut leur manquer d'égards, on connaît l'esprit de vengeance de Hmad. Il va donc les vendre au plus offrant. - On dit de lui qu'il a tué au moins cent personnes avant l'arrivée des Français. - Oh! Beaucoup plus ! Nul ne connaît le nombre exact de ses victimes. Il était le maître de la région, pour ainsi dire. Mais aujourd'hui il ne lui reste que son fusil de chasse. Comme les temps ont changé, hein ! - Mais il est toujours craint. - Oui. Aussi ne fréquente-t-il personne. Qui fréquenterait un ancien tueur ? Ses semblables sont morts depuis longtemps. Il est tout seul maintenant. Tout seul, certes, mais solide et dangereux, aussi dangereux qu'un cobra d'Égypte. Assez parlé de ça! Prépare-nous donc un bon thé. Celui que j'ai pris à la mosquée était infect. - Tu n'entends pas chanter la bouilloire? - Si. - Veux-tu des amandes grillées ? - Des amandes et des dattes. Elle apporta les friandises. Il aimait les fruits secs. - Ces dattes viennent d'Algérie, plus exactement de Biskra. Elles sont de loin les meilleures. - Trop sucrées. - C'est ce qui les différencie des dattes locales. Celles-là valent très cher. On ne peut les manger qu'en buvant du lait. C'est ce que font les Touaregs. As-tu déjà vu des Touaregs ? Elle ne répondit pas. - Non ! Ce sont des nomades qui possèdent d'immenses troupeaux, mais ils ne mangent pratiquement pas de viande. Ils vivent seulement de lait de chamelle et de dattes. Ils sont particulièrement rudes. Des Berbères comme nous. Leurs femmes seules sont lettrées. Elles lisent et elles écrivent. Elles connaissent la vieille écriture berbère, le Tifinagh... et elles composent des poèmes et des chansons. - On dirait que tu les connais bien. - Oui. J'ai été spahi au Sahara, mais j'ai déserté. Et quand on m'a rattrapé, on m'a jeté en prison. J'ai passé cinq ans de ma vie dans les prisons militaires. J'ai cassé des pierres sous le soleil ardent. J'ai tenté maintes fois de m'évader mais on m'a repris, roué de coups et enchaîné à des boulets lourds que je traînais derrière moi. Quand j'avais soif, on me refusait l'eau. « On n'en a pas pour toi «, me répondait-on. - Tu ne m'avais jamais raconté ça, dit la vieille. - À quoi bon! Tu sais, ce sont des choses sans importance. - Des choses sans importance ? Tu aurais pu y laisser ta peau. - D'autres ont souffert plus que moi, ils n'en sont point morts. Va, c'est le moral qui compte. Elle servit le thé. La pièce était fraîche bien qu'il fît dehors une température d'enfer. - Tu penses toujours à ton rêve ? demanda la vieille. - Maudit soit-il ! Il revient toutes les nuits comme un vautour prêt à fondre sur un malheureux blessé. - Oublie-le donc ! - C'est lui qui ne m'oublie pas, dit-il. Il but son thé à petites gorgées, fuma plusieurs cigarettes. Cette brusque escapade dans le passé avait rouvert certaines plaies qu'il croyait cicatrisées depuis longtemps. Il se revit errant de ville en ville à la recherche d'un travail, mais il n'y avait rien. La misère régnait partout et une grande épidémie de typhus emportait les plus faibles. Seuls les Européens étaient soignés à temps. Cette maladie sévissait surtout dans le peuple, chez les indigènes comme on les appelait alors. Il y avait des poux partout. Chez les Européens, les poux n'existaient pas. Certains esprits moqueurs disaient : « Qui n'a pas de poux n'est pas musulman... « Les Français vivaient dans la propreté tandis que les indigènes s'entassaient les uns sur les autres dans des gourbis confinés. Plusieurs années de sécheresse avaient appauvri la campagne jadis riche en céréales qu'on exportait vers l'Europe. Maintenant, les paysans se nourrissaient de racines et de tubercules, eux aussi très rares. Les morts se chiffraient par milliers : « C'est la racaille qui crève, disait-on. Bon débarras ! « Les colons récupéraient ainsi des terres abandonnées. Ils foraient des puits, plantaient des orangers, semaient du blé. Ils prospéraient sur ces terres qui n'avaient vu que des cadavres. Les humbles fellahs d'autrefois se voyaient contraints de travailler au service des nouveaux maîtres pour survivre. Ceux qui avaient eu la chance d'être engagés pouvaient compter sur l'aide du maître. Ils étaient alors pris en charge, soignés, bien nourris et ils pouvaient échapper au sort tragique qui décimait les gens des noualas[10] et autres hameaux qu'on finissait par déserter pour fuir une mort certaine. Des masses d'hommes envahissaient les villes et se retrouvaient parqués dans des bidonvilles déjà surpeuplés. Rares étaient ceux qui travaillaient. En Europe, la Guerre durait depuis deux ans. Seules les usines d'armement allemandes fonctionnaient. La France était sous la botte nazie, mais les autorités coloniales, qui étaient vichystes, envoyaient tout en métropole. Il n'y avait donc rien à manger pour les autochtones. Avec le débarquement américain de 1942, qui cloua au sol la flotte aérienne française fidèle au maréchal Pétain, les choses se remirent à fonctionner à peu près normalement. On ouvrit des chantiers, le dollar coula à flot. Les bases militaires américaines employant beaucoup de Marocains, l'arrière-pays en profita. On soignait les malades. Du jour au lendemain, le typhus disparut. Et, comme par hasard, la pluie se remit à tomber. Les campagnes reverdirent. On se remit à procréer. L'armée française engagea des jeunes qu'on envoya sur les fronts d'Europe, en Italie et ailleurs. On rendit hommage à la bravoure du Marocain tout en oubliant qu'on l'avait jusque-là méprisé. On promit même l'indépendance à Mohammed V, lorsque la Guerre serait finie, mais on oublia ce serment. L'euphorie des lendemains de la Guerre était telle qu'on recommença à traiter le colonisé de sous-homme, de turbulent et d'ignorant congénital. D'arriéré pathologique, en quelque sorte. Le Marocain ouvrit des écoles privées pour instruire ses enfants. Il lutta fermement pour sa liberté. Les prisons étaient pleines à craquer de résistants. Les exécutions sommaires étaient monnaie courante. On en était là au moment où le Mokhazni était venu se renseigner sur les fugitifs recherchés par la police. Bouchaïb l'avait renvoyé sans autre forme de procès. Ils étaient bel et bien au village. Ils se rendaient même au souk de temps en temps, mais ils savaient se fondre dans la foule et disparaître au bon moment. On entendait depuis quelques jours l'explosion de mines... C'était l'un de ces recherchés qui brisait un flanc de la montagne pour agrandir sa maison. Il avait besoin de pierre pour cela. Il avait réussi le tour de force de se faire délivrer par le capitaine commandant le canton une autorisation d'achat d'explosifs. Il avait dû fournir une fausse identité sans doute. Ou soudoyer un fonctionnaire... Nul n'en savait rien. Bouchaïb, qui allait chez lui pour écouter la radio, la seule radio du village, était au courant de ce qui se passait dans les villes du Nord. Chaque jour, des traîtres étaient exécutés, des bombes explosaient dans les marchés européens et aux terrasses de certains cafés à l'heure de l'apéritif. Des journaux interdits se vendaient sous le manteau. On écoutait comme une parole sacrée La Voix des Arabes émise depuis Le Caire. On avait le moral car on estimait qu'on pouvait gagner. En Algérie même et après la défaite de Diên Biên Phu, la guerre de libération avait commencé. Le colonialiste était aux abois mais il ne l'admettait pas encore. On n'en était pas encore là. Il allait se ruiner dans cette aventure et accepter l'inacceptable, à savoir l'indépendance des opprimés. Bouchaïb, qui aurait pu prendre du galon dans l'armée comme tant d'autres, préféra la vie simple aux risques et aux honneurs. C'est pourquoi il s'était retiré chez lui après s'être démené comme un diable dans les provinces du Nord. Il s'était donc marié avec une cousine lointaine et s'était mis à cultiver la terre des ancêtres. Il avait trouvé là une paix royale, car il adorait la nature vierge. Et quand il pleuvait, c'était l'abondance. La vie reprenait toujours le dessus. On était loin de l'agitation des villes, des massacres et autres règlements de comptes. Ici, on était en sûreté, on pouvait sortir, vaquer à ses occupations sans risquer de recevoir une balle dans la peau. Bouchaïb aimait jardiner. Il avait planté des arbres fruitiers : des oliviers, des amandiers, et même un bananier, chose inconnue dans la région. Quand il trouvait un nid dans un arbre, il était heureux. Il considérait les oiseaux qui venaient dans ses champs comme ses protégés. Il avait chassé les gosses qui s'en prenaient à ces oiseaux paisibles et mis durement à l'amende leurs parents en tant qu'anflouss. Ceux-ci durent morigéner leur progéniture car plus personne ne pilla les nids. Attenant à sa maison, un petit verger produisait des clémentines, des oranges et des figues, ces petites figues noires dont les merles se régalent dès qu'elles commencent à mûrir. Bouchaïb permet-tait à ces oiseaux dont il appréciait le chant de partager sa subsistance. Aussi ne fuyaient-ils jamais à son approche. Comme les oiseaux ne le redoutaient pas, on le prenait à tort pour un saint ou un magicien. Lui seul savait que l'amour était le lien qui l'unissait à ces êtres peureux et fragiles. Un animal reconnaît très vite la bonté chez l'homme. Il sait aussi discerner le mal là où il se trouve. D'aucuns croient que la huppe, l'oiseau de Salomon, y voit à vingt pieds sous terre. Les gens de Mogador[11] avalent tout cru son coeur palpitant pour acquérir encore plus de perspicacité. Superstition? Sans doute. Cependant, ce bel oiseau si rare et solitaire fascine encore tous ceux qui le regardent. On n'en voit que rarement. Mais on se sent tout à coup heureux quand on en voit un' dans un pré. Un oiseau seigneurial. - Tu ne voudrais pas faire ta sieste ? dit la vieille. - Hein ? Ma sieste ! Eh bien, pourquoi pas ? Comme tu me vois, j'étais en train de rêver. - De ton arbre ? - Dieu m'en garde ! Non ! Du passé et de certaines autres choses. De la vie, quoi. - Tu revis ton passé? - Oui. Mais il est si effrayant, si misérable qu'il serait peut-être préférable de l'oublier. - Ton passé ? - Le mien, celui des autres. Les grandes misères de l'époque, la famine, les épidémies, l'anéantissement collectif. - Je n'ai jamais connu ça, moi. Les gens d'ici ne connaissent rien. Ils ont toujours relativement bien vécu. Ce sont ceux du Nord qui ont souffert. Dans les montagnes, on est habitué à vivre à la dure. Quand une chose vient à manquer, on lui trouve tout de suite un substitut. Là-bas, quand une chose s'épuise, tout s'épuise, y compris le corps. Qu'il y ait une guerre par exemple, et tout est remis en cause. Le sort implacable qui a mille tours dans son sac s'en mêle. Tous les malheurs s'abattent sur ces pauvres gens en même temps. Les familles se disloquent, les maladies minent la population, on erre sans but, on mendie, on perd toute dignité humaine. - On ne connaît pas ça ici, dit la vieille. - Eh non ! Ici, on est tranquille. On vit avec les saisons et au jour le jour, on apprécie l'instant à sa juste mesure. Chaque minute de la vie compte. N'est-ce pas le bonheur suprême? - Bien sûr que oui. - C'est pour cette raison que je n'aime plus le Nord, ni ses villes tonitruantes ni ses campagnes. Et pourtant, que n'ai-je chapardé dans les fermes uniquement pour survivre ! La famine était terrible. Les gens mouraient en masse. Des dizaines et des dizaines s'en allaient comme ça... Moi, je trouvais toujours le moyen de voler quelque chose, n'importe quoi pour ne pas crever de faim... C'était le vol ou la mort! J'ai moins souffert en prison qu'en liberté. Elle était tout le contraire de ce qu'elle signifiait alors. Être libre et crever de faim, merci ! Redonne-moi donc un peu de thé et quelques amandes grillées. Elle le servit. Il alluma sa énième cigarette et reprit : - À cette époque sombre, seuls les Européens vivaient bien. Ils avaient des médecins, des aliments. Ils savaient vivre. Mais ils vivaient entre eux et pour eux-mêmes. Les autres ne les intéressaient pas. Ils pouvaient bien crever, ça ne les dérangeait pas. Seuls quelques Marocains très riches vivaient aussi bien qu'eux. Le sort du peuple ? Ils s'en foutaient muant aux juifs, ils croupissaient dans les Mellahs. Ils étaient aussi misérables que les musulmans les plus misérables. Les uns et les autres priaient le même dieu mais ils ne se comprenaient pas. Chacun suspectait l'autre de félonie, de mauvaise foi, de filouterie... Et cette discorde profitait surtout aux plus riches, à ceux qui tiraient les ficelles. On dressait le Berbère contre l'Arabe, le juif contre les deux autres au moment même où Hitler en massacrait des millions. Six millions de juifs en tout, c'est ce qu'on dit. Partis en fumée dans les fours crématoires d'Allemagne et de Pologne. Le juif était alors l'ennemi numéro un, le suppôt d'Iblis, le sinistre usurier, le pendard, etc. Quelqu'un dont il fallait à tout prix se débarrasser pour la tranquillité universelle. On voulait purifier la planète. Le bouc émissaire, c'était le juif. On était devenu fou à lier mais cette folie payait. Voilà pourquoi je rejette cette humanité avilie. Mais j'aimerais bien faire ma sieste à présent. Et comme il fait frais, je m'allonge ici même. Il dit et s'endormit aussitôt, mais il se réveilla en sursaut et maudit cent fois ce rêve qui l'obsédait, le poursuivant partout comme une malédiction. Il fit le serment solennel qu'il ne se rendrait plus à la récolte des amandes. Lui qui aimait tant y participer, il devrait désormais se contenter d'observer cette besogne de loin. « Après tout, je n'aurai qu'à prendre des précautions. Comme je ne suis plus un jeunot, je dois éviter certaines tentations. Que diable vais-je chercher là? On n'échappe pas à son destin. On est voué d'avance à la destruction et, comme tel, on ignore parfaitement où et quand et comment... Mais où est donc ma femme? Ah ! Elle est encore allée chouchouter les bêtes, je présume. Eh bien! Reprenons du thé et fumons. Si le sommeil revient, qu'il soit le bienvenu, je suis toujours prêt à dormir un brin. « Il reprit du thé et fuma. Par la fenêtre ouverte, on voyait distinctement le sommet du massif montagneux aussi pelé qu'une dune. Pas un seul arbre visible de ce côté-ci de la chaîne. Mais il devait y avoir là- haut une certaine végétation puisqu'on y chassait le mouflon. On y braconnait même, car il n'existait dans le pays aucune surveillance et il n'y avait pas de garde forestier à cent lieues à la ronde. Mais il fallait être un fin tireur et un grimpeur émérite pour abattre un mouflon. Rares étaient les gens capables d'un tel exploit. On pouvait les compter sur les doigts d'une seule main. En traquant le gibier des hauteurs, des chasseurs confirmés avaient perdu la vie en tombant dans le précipice - une seule pierre descellée et l'on allait éclater comme un fruit trop mûr trois cents mètres plus bas sur une saillie ou une plate-forme. Aussi se faisait-on généralement accompagner d'un guide pour qui ces lieux tortueux n'avaient aucun secret. Et même alors, il y avait encore des risques liés au travail des roches... personne ne pouvait prévoir un drame toujours possible. « Une demi-journée est nécessaire pour atteindre ce sommet, se dit le Vieux. Je connais bien cet endroit, il est truffé de pièges naturels. « Autrefois, il avait chassé le mouflon. La traque durait parfois plusieurs jours mais c'était souvent payant. On mangeait alors l'un des meilleurs gibiers du monde. La nuit, on bivouaquait dans un creux. Après un dîner frugal, on dormait jusqu'à l'aube et l'on se remettait en marche. On jouait sa vie comme sur un fil ténu qu'un rien pouvait rompre à tout moment. Mais un sentiment puissant anesthésiait durablement la peur du vide. Seul le mouflon comptait, cet animal plus gros qu'un bélier domestique et qui sautait d'une roche à l'autre comme un oiseau, grimpait lestement, se recevait sur une saillie et disparaissait aussitôt qu'il était apparu. « Impossible de suivre un tel gibier si l'on n'est pas maître absolu de ses nerfs. C'est quand on perd cet équilibre que l'accident survient. Le bon chasseur est celui qui n'éprouve aucun sentiment, celui qui se fond dans la pierre, devient pierre à son tour... « Bouchaïb avait passé d'excellents moments en haut avec des amis aujourd'hui disparus et qui étaient de véritables guerriers de la montagne, des connaisseurs d'armes et des tireurs d'élite. C'étaient aussi des gens d'honneur... Il y avait parmi eux quelques bandits qui ne l'étaient devenus que par la force des choses. Ils allaient piller d'autres villages et ils rentraient armés jusqu'aux dents en conduisant des bêtes de somme surchargées de butin. On volait n'importe quoi car tout avait de la valeur. On pouvait tout écouler dans les souks sans encombre. Bouchaïb se souvenait de cette époque où la rapine était de&l...