Les « chroniques » de Giono (résumé & analyse)
Publié le 13/12/2018

Extrait du document
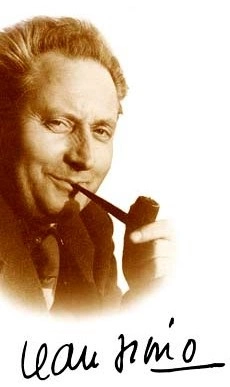
Les « chroniques »
Après la Seconde Guerre mondiale, le style de Giono devait résolument changer, pour des raisons pratiques d’abord : la nécessité d’écrire vite des œuvres plus courtes, essentiellement narratives, dont la traduction et la publication éventuelle à l'étranger poseraient moins de problèmes. A partir de 1946, l’œuvre de Giono va donc se scinder en deux : d'une part, les « chroniques », suite de récits aux modes narratifs variés qu’il poursuivra jusqu'à la fin de sa vie; d'autre part, la geste du Hussard, vaste cycle romanesque qu’il mènera parallèlement à d'autres activités « gratuites » (à tous les sens du terme) : projets et compositions de scénarios, essais divers, etc. D’ailleurs, ces « chroniques » elles-mêmes devaient constituer une sorte de série plus ou moins homogène, mais le fil d’intrigues qui relie chacune d’entre elles à la première, Un roi sans divertissement (1946), allait se dénouer rapidement. Ainsi, tout en respectant l’autonomie de chaque livre, Giono fera néanmoins alterner chroniques du xixe siècle, tel Un roi sans divertissement, et récits modernes, comme Mort d'un personnage (1948). Dans leur conception, les chroniques ont au moins deux points communs qui les distinguent des œuvres précédentes : elles se veulent davantage l’histoire (au sens d'annales) d’une époque précise, et le lieu de leur action se situe dans un cadre géographiquement déterminé. Giono, dans des récits plus ramassés, proches du style elliptique d'un Stendhal, renonce donc aux créations mythiques, intemporelles, localisées dans un « Sud imaginaire », qui caractérisaient sa vision du monde antérieure à la guerre. Désormais, le protagoniste essentiel
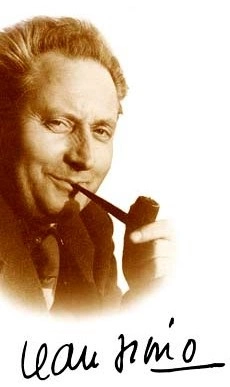
«
n'est
plus la nature, mais l'homme dans ses rapports
interpersonnels; la violence, toujours présente, n'est plus
dans le cosmos mais dans le cadre social où se joue le
drame du salut, le lyrisme s'intériorisant ainsi en roman
tisme de 1' action.
Noé, paru en 1947 aux Éditions de la Table ronde,
marque une étape décisive dans l'évolution du système
narra ti( de Giono, tout en en révélant la profonde origi
nalité.
Ecrit à la première personne, ce« récit» est avant
tout le roman d'un roman en train de se faire.
En ce sens,
Giono y subit l'influence du Gide des Faux-Monnayeurs
tout en annonçant les « audaces » du « nouveau roman »
dont par ailleurs il méprisera l'absence de créativité nar
rative (cf.
sa Préface aux «chroniques» réunies, en
1962, chez Gallimard).
Cependant, il y démontre surtout
sa conception d'un réalisme spécifique, essentiellement
subjectif, où le monde extérieur, pourtant si dense et si
riche dans sa pesanteur matérielle, apparaît comme une
création idéale, à la limite de l'onirisme : « Quoi qu'on
fasse, c'est toujours le portrait de l'artiste par lui-même
qu'on fait.
Cézanne, c'était une pomme de Cézanne».
Giono éclaire ainsi à la fois les personnages du roman
précédent, tels Langlois, M.V., Saucisse, Delphine ...
,
dont il prolonge l'existence passée et fictive en la mêlant
à son propre présent de personnage-auteur bien réel
( « Or, depuis deux mois, il fait bon soleil et très calme.
Pendant que je marche à flanc de coteau, à travers les
olivaies, je vois, dans la vallée, des cocons de brume qui
enveloppent les grandes fermes » ), tout en remettant en
question l'objectivité apparente de ses premiers récits,
voire le prétendu réalisme de toute représentation tradi
tionnellement considérée comme figurative : en faisant
allusion à Cézanne peignant sa propre personnalité à
travers un objet prétexte, en utilisant l'ambiguïté du pré
sent, temps qui convient aussi bien à la description du
monde extérieur qu'à la narration autobiographique,
Giono abolit les frontières entre le réel et l'imaginaire
et, du même coup, entre l'objet et le sujet.
Tel est finale
ment le sens de l'ensemble de l'œuvre de Giono : la
naissance d'un monde insolite sinon fantastique coïncide
avec l'histoire (ou la légende) de la création littéraire.
D'où cet apparent paradoxe d'une fascination croissante
pour le narratif (Giono confiait, à propos du Bonheur
fou : «J'ai essayé de faire que chaque phrase raconte,
que chaque phrase soit en elle-même un récit complet et
qu'il y ait chaque fois des possibilités de s'arrêter sur
cette phrase et de voir ses prolongements romanesques
aussi bien dans une direction que dans l'autre»), liée à
un débordement perpétuel du récit, suspendu, inter
rompu, dont l'illusion est encore compromise par la dis
continuité spatiale, par un discours immense, l'omnipré
sence sous-jacente de l'auteur étant la rançon du besoin
irrépressible de conter.
Mais le roman n'est autre que le
rêve même du romancier : il est son autoportrait.
Cette
peinture « en négatif», où, comme le note finement
Giono, tout est décrit, sauf l'objet -qui apparaît ainsi
dans ce qui manque -, s'appliquerait avec une égale
pertinence à la multitude des récits hétérogènes qui
constituent l'ensemble des« chroniques », depuis la bio
graphie prétendue de l'écrivain américain dont Giono
venait de traduire Moby Dick (Pour saluer Melville,
1941) au «poème>> Fragments d'un paradis (1948),
sorte de journal de bord d'un navigateur fantastique.
Deux récits maritimes qui ne sont autres que le symbole
de l'aventure de l'écriture, le «portrait de l'artiste par
lui-même >> selon une formule chère à Giono..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- GRANDES ET INESTIMABLES CRONICQUES, CHRONIQUES GARGANTUINES de Rabelais (résumé & analyse)
- Le Hussard sur le toit (cycle), Giono (résumé & analyse)
- CHRONIQUES MARITALES Marcel Jouhandeau (résumé & analyse)
- Les Chroniques - Froissart (résumé & analyse)
- CHRONIQUES de Proust. (résumé & analyse) de Marcel Proust








