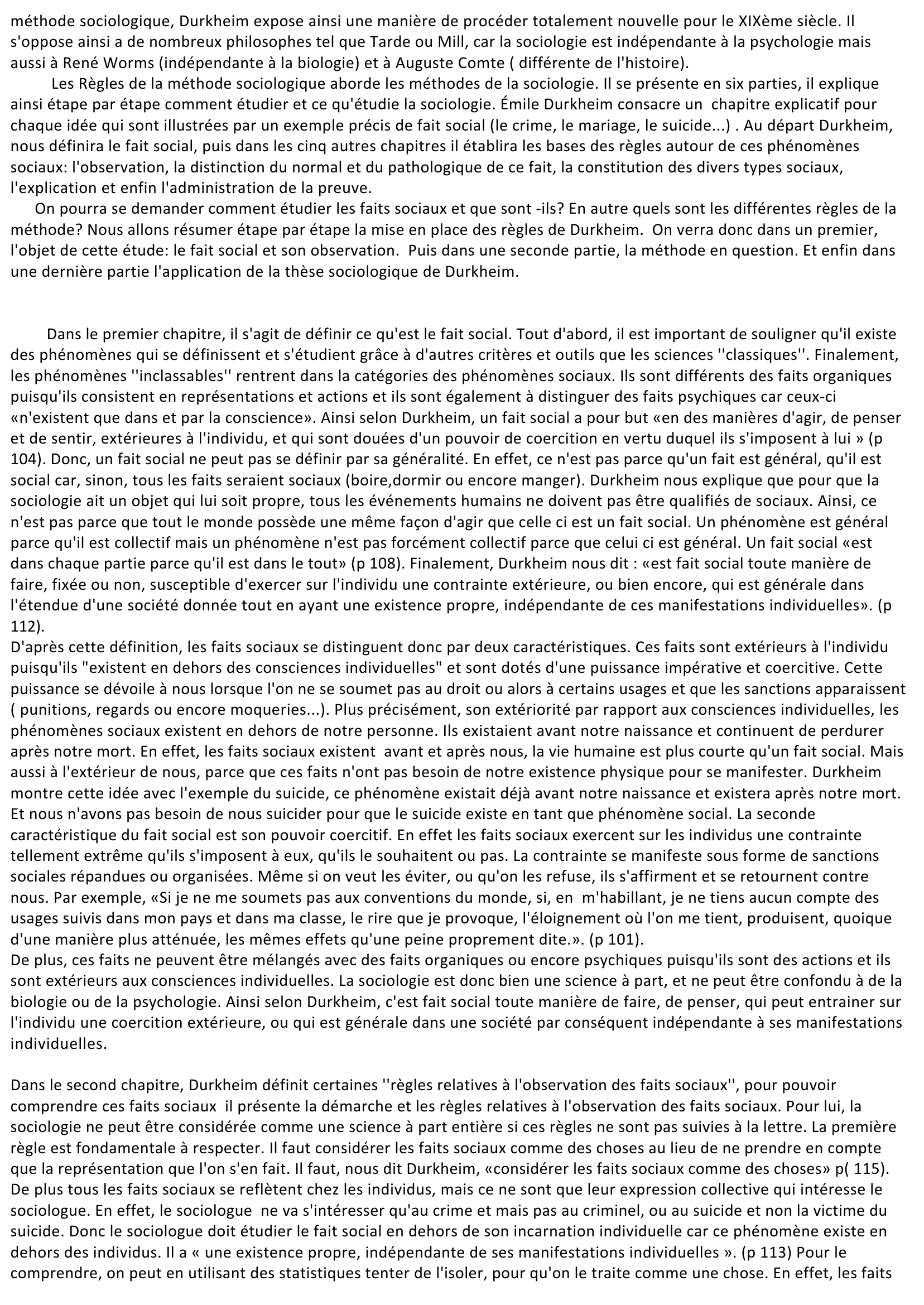Les règles de la méthodologie de Durkheim
Publié le 09/05/2012

Extrait du document
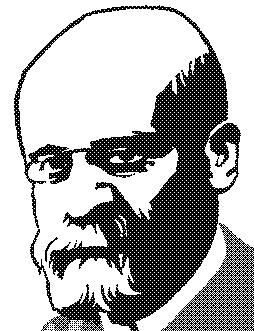
Émile Durkheim est un sociologue et philosophe français, né en 1858 à Épinal, dans une famille juive pratiquante. Celui ci est destiné à être rabbin mais il refuse cet avenir. Sa vocation pour l'enseignement se développe dans un contexte historique difficile, avec une France marquée par sa douloureuse défaite face aux Allemands en 1870, et engagée dans la voie difficile de l'industrialisation. Il étudie alors à l'École Normale Supérieure et en 1882 il obtient l'agrégation de philosophe et enseigne les sciences sociales à Bordeaux où il commence à rédiger ses oeuvres sociologiques. La sociologie, cette nouvelle matière, définie par Auguste Comte, se base sur le positivisme, ainsi toute loi est démontrée de manière logique et rationnelle par des expériences et des observations. Les sociologues étudient le fonctionnement de la société, et analysent les mécanismes en jeu dans les relations entre les individus et les divers groupes sociaux. Ainsi, de plus en plus d'étudiants rédigent leur thèse sur les travaux de Auguste Comte et de Herbert Spencer, sociologues de cette époque, et la sociologie connait une véritable apogée. De ce fait, devant cet enthousiasme grandissant, Durkheim décide de fixer certaines règles, définitions, des concepts indispensables à l'étude de ces phénomènes sociaux. Il écrit alors en 1894, les Règles de la méthode sociologique et publie une revue: l'Année Sociologique. Durkheim, n'est pas uniquement connu pour cette oeuvre, il publie également: De la division du travail social (1893), Le Suicide, étude de sociologie (1897), Représentations individuelles et représentations collectives (1898), L'éducation morale (1903), Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), l'Education et Sociologie (1922), Sociologie et Philosophie (1925), l'Evolution pédagogique en France (1938) et enfin la Science sociale et l'Action ( posthume 1970). Ses oeuvres établiront sa notoriété dans le domaine de la sociologie.
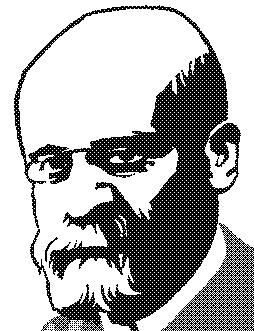
«
méthode sociologique, Durkheim expose ainsi une manière de procéder totalement nouvelle pour le XIXème siècle.
Ils'oppose ainsi a de nombreux philosophes tel que Tarde ou Mill, car la sociologie est indépendante à la psychologie maisaussi à René Worms (indépendante à la biologie) et à Auguste Comte ( différente de l'histoire).
Les Règles de la méthode sociologique aborde les méthodes de la sociologie.
Il se présente en six parties, il expliqueainsi étape par étape comment étudier et ce qu'étudie la sociologie.
Émile Durkheim consacre un chapitre explicatif pourchaque idée qui sont illustrées par un exemple précis de fait social (le crime, le mariage, le suicide...) .
Au départ Durkheim,nous définira le fait social, puis dans les cinq autres chapitres il établira les bases des règles autour de ces phénomènessociaux: l'observation, la distinction du normal et du pathologique de ce fait, la constitution des divers types sociaux,l'explication et enfin l'administration de la preuve.
On pourra se demander comment étudier les faits sociaux et que sont -ils? En autre quels sont les différentes règles de laméthode? Nous allons résumer étape par étape la mise en place des règles de Durkheim.
On verra donc dans un premier,l'objet de cette étude: le fait social et son observation.
Puis dans une seconde partie, la méthode en question.
Et enfin dansune dernière partie l'application de la thèse sociologique de Durkheim.
Dans le premier chapitre, il s'agit de définir ce qu'est le fait social.
Tout d'abord, il est important de souligner qu'il existedes phénomènes qui se définissent et s'étudient grâce à d'autres critères et outils que les sciences ''classiques''.
Finalement,les phénomènes ''inclassables'' rentrent dans la catégories des phénomènes sociaux.
Ils sont différents des faits organiquespuisqu'ils consistent en représentations et actions et ils sont également à distinguer des faits psychiques car ceux-ci«n'existent que dans et par la conscience».
Ainsi selon Durkheim, un fait social a pour but «en des manières d'agir, de penseret de sentir, extérieures à l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui » (p104).
Donc, un fait social ne peut pas se définir par sa généralité.
En effet, ce n'est pas parce qu'un fait est général, qu'il estsocial car, sinon, tous les faits seraient sociaux (boire,dormir ou encore manger).
Durkheim nous explique que pour que lasociologie ait un objet qui lui soit propre, tous les événements humains ne doivent pas être qualifiés de sociaux.
Ainsi, cen'est pas parce que tout le monde possède une même façon d'agir que celle ci est un fait social.
Un phénomène est généralparce qu'il est collectif mais un phénomène n'est pas forcément collectif parce que celui ci est général.
Un fait social «estdans chaque partie parce qu'il est dans le tout» (p 108).
Finalement, Durkheim nous dit : «est fait social toute manière defaire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure, ou bien encore, qui est générale dansl'étendue d'une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ces manifestations individuelles».
(p112).
D'après cette définition, les faits sociaux se distinguent donc par deux caractéristiques.
Ces faits sont extérieurs à l'individupuisqu'ils "existent en dehors des consciences individuelles" et sont dotés d'une puissance impérative et coercitive.
Cettepuissance se dévoile à nous lorsque l'on ne se soumet pas au droit ou alors à certains usages et que les sanctions apparaissent( punitions, regards ou encore moqueries...).
Plus précisément, son extériorité par rapport aux consciences individuelles, lesphénomènes sociaux existent en dehors de notre personne.
Ils existaient avant notre naissance et continuent de perdureraprès notre mort.
En effet, les faits sociaux existent avant et après nous, la vie humaine est plus courte qu'un fait social.
Maisaussi à l'extérieur de nous, parce que ces faits n'ont pas besoin de notre existence physique pour se manifester.
Durkheimmontre cette idée avec l'exemple du suicide, ce phénomène existait déjà avant notre naissance et existera après notre mort.Et nous n'avons pas besoin de nous suicider pour que le suicide existe en tant que phénomène social.
La secondecaractéristique du fait social est son pouvoir coercitif.
En effet les faits sociaux exercent sur les individus une contraintetellement extrême qu'ils s'imposent à eux, qu'ils le souhaitent ou pas.
La contrainte se manifeste sous forme de sanctionssociales répandues ou organisées.
Même si on veut les éviter, ou qu'on les refuse, ils s'affirment et se retournent contrenous.
Par exemple, «Si je ne me soumets pas aux conventions du monde, si, en m'habillant, je ne tiens aucun compte desusages suivis dans mon pays et dans ma classe, le rire que je provoque, l'éloignement où l'on me tient, produisent, quoiqued'une manière plus atténuée, les mêmes effets qu'une peine proprement dite.».
(p 101).
De plus, ces faits ne peuvent être mélangés avec des faits organiques ou encore psychiques puisqu'ils sont des actions et ilssont extérieurs aux consciences individuelles.
La sociologie est donc bien une science à part, et ne peut être confondu à de labiologie ou de la psychologie.
Ainsi selon Durkheim, c'est fait social toute manière de faire, de penser, qui peut entrainer surl'individu une coercition extérieure, ou qui est générale dans une société par conséquent indépendante à ses manifestationsindividuelles.
Dans le second chapitre, Durkheim définit certaines ''règles relatives à l'observation des faits sociaux'', pour pouvoircomprendre ces faits sociaux il présente la démarche et les règles relatives à l'observation des faits sociaux.
Pour lui, lasociologie ne peut être considérée comme une science à part entière si ces règles ne sont pas suivies à la lettre.
La premièrerègle est fondamentale à respecter.
Il faut considérer les faits sociaux comme des choses au lieu de ne prendre en compteque la représentation que l'on s'en fait.
Il faut, nous dit Durkheim, «considérer les faits sociaux comme des choses» p( 115).De plus tous les faits sociaux se reflètent chez les individus, mais ce ne sont que leur expression collective qui intéresse lesociologue.
En effet, le sociologue ne va s'intéresser qu'au crime et mais pas au criminel, ou au suicide et non la victime dusuicide.
Donc le sociologue doit étudier le fait social en dehors de son incarnation individuelle car ce phénomène existe endehors des individus.
Il a « une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles ».
(p 113) Pour lecomprendre, on peut en utilisant des statistiques tenter de l'isoler, pour qu'on le traite comme une chose.
En effet, les faits.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Emile DURKHEIM : « Les Règles de la méthode sociologique »
- RÈGLES DE LA MÉTHODE SOCIOLOGIQUE (LES), 1895. Émile Durkheim (résumé)
- RÈGLES DE LA MÉTHODE SOCIOLOGIQUE (Les) d’Émile Durkheim. Résumé et analyse
- Commentaire du texte de Emile Durkheim. Les règles de la méthode sociologique , Chapitre 5
- comment Durkheim construit il sa définition du fait social ? dans les règles de la méthode sociologique