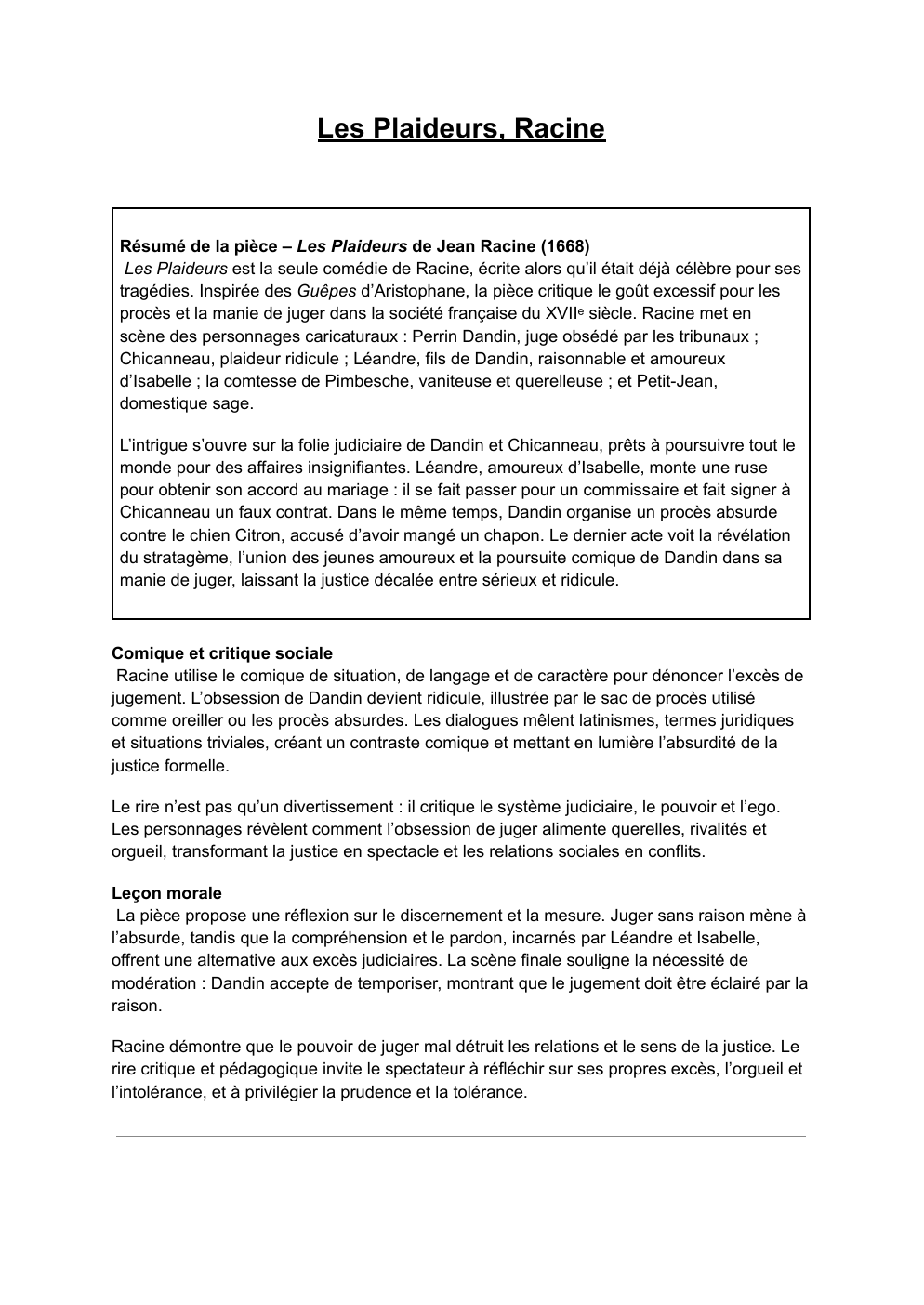Résumé de la pièce – Les Plaideurs de Jean Racine (1668)
Publié le 24/10/2025
Extrait du document
«
Les Plaideurs, Racine
Résumé de la pièce – Les Plaideurs de Jean Racine (1668)
Les Plaideurs est la seule comédie de Racine, écrite alors qu’il était déjà célèbre pour ses
tragédies.
Inspirée des Guêpes d’Aristophane, la pièce critique le goût excessif pour les
procès et la manie de juger dans la société française du XVIIᵉ siècle.
Racine met en
scène des personnages caricaturaux : Perrin Dandin, juge obsédé par les tribunaux ;
Chicanneau, plaideur ridicule ; Léandre, fils de Dandin, raisonnable et amoureux
d’Isabelle ; la comtesse de Pimbesche, vaniteuse et querelleuse ; et Petit-Jean,
domestique sage.
L’intrigue s’ouvre sur la folie judiciaire de Dandin et Chicanneau, prêts à poursuivre tout le
monde pour des affaires insignifiantes.
Léandre, amoureux d’Isabelle, monte une ruse
pour obtenir son accord au mariage : il se fait passer pour un commissaire et fait signer à
Chicanneau un faux contrat.
Dans le même temps, Dandin organise un procès absurde
contre le chien Citron, accusé d’avoir mangé un chapon.
Le dernier acte voit la révélation
du stratagème, l’union des jeunes amoureux et la poursuite comique de Dandin dans sa
manie de juger, laissant la justice décalée entre sérieux et ridicule.
Comique et critique sociale
Racine utilise le comique de situation, de langage et de caractère pour dénoncer l’excès de
jugement.
L’obsession de Dandin devient ridicule, illustrée par le sac de procès utilisé
comme oreiller ou les procès absurdes.
Les dialogues mêlent latinismes, termes juridiques
et situations triviales, créant un contraste comique et mettant en lumière l’absurdité de la
justice formelle.
Le rire n’est pas qu’un divertissement : il critique le système judiciaire, le pouvoir et l’ego.
Les personnages révèlent comment l’obsession de juger alimente querelles, rivalités et
orgueil, transformant la justice en spectacle et les relations sociales en conflits.
Leçon morale
La pièce propose une réflexion sur le discernement et la mesure.
Juger sans raison mène à
l’absurde, tandis que la compréhension et le pardon, incarnés par Léandre et Isabelle,
offrent une alternative aux excès judiciaires.
La scène finale souligne la nécessité de
modération : Dandin accepte de temporiser, montrant que le jugement doit être éclairé par la
raison.
Racine démontre que le pouvoir de juger mal détruit les relations et le sens de la justice.
Le
rire critique et pédagogique invite le spectateur à réfléchir sur ses propres excès, l’orgueil et
l’intolérance, et à privilégier la prudence et la tolérance.
Que penser de la manie de juger ?
Jean Racine, né en 1639 et mort en 1699 à Paris, est l’un des plus grands dramaturges du
XVIIᵉ siècle et une figure majeure du classicisme, aux côtés de Corneille et de Molière.
Formé à Port-Royal, haut lieu du jansénisme et de la rigueur morale, il y acquiert un goût
profond pour la pureté de la langue, la justesse du style et l’analyse fine des passions
humaines.
Membre de l’Académie française, Racine s’illustre avant tout dans la tragédie
avec Andromaque, Phèdre ou Bérénice, où il explore les tourments de l’âme et la fatalité
des destins.
Cependant, en 1668, il délaisse temporairement le registre tragique pour s’essayer, une
seule fois, à la comédie avec Les Plaideurs.
Cette œuvre singulière, inspirée des Guêpes
d’Aristophane, transpose dans la France de Louis XIV la satire que le poète grec adressait à
ses concitoyens : celle d’une société obsédée par les procès et la justice.
Racine modernise
cette critique en l’adaptant au monde judiciaire de son époque, alors marqué par une
prolifération des procédures et un goût excessif pour le jugement.
À travers des personnages caricaturaux tels que le juge Dandin ou le plaideur Chicanneau, il
tourne en dérision les travers d’une société où le plaisir de juger devient une véritable folie.
Les Plaideurs se présente ainsi comme une comédie de mœurs — qui dénonce les
ridicules sociaux — autant qu’une comédie de caractères, où l’obsession du jugement se
transforme en maladie universelle.
Si la pièce ne connut pas, lors de sa création, un grand succès populaire — le public
attendait une comédie plus vive et populaire à la manière de Molière ou Rabelais — elle fut
en revanche appréciée de Louis XIV, séduit par l’élégance du style et la mesure de la satire.
À mi-chemin entre la farce, par son comique de gestes et de situations, et la comédie
morale, par la réflexion qu’elle suscite, Les Plaideurs révèle une autre facette du génie
racinien : celle d’un auteur capable d’unir la finesse du langage classique à la vivacité du
comique.
les personnages:
● Dandin, vieux juge devenu fou de justice, incarne la manie de juger ;
● Léandre, son fils, représente la raison et l’amour, opposés à la folie paternelle ;
● Chicanneau, autre plaideur ridicule, illustre l’obsession du procès pour des causes
insignifiantes ;
● La comtesse de Pimbesche symbolise la vanité sociale attachée aux querelles
judiciaires ;
● et Petit Jean, le domestique, apporte le bon sens populaire face à la folie des
maîtres.
Tous ces personnages sont des types comiques inspirés de la comédie antique et
de la farce.
Ainsi, à travers cette satire du monde judiciaire, Racine ne se contente pas de divertir : il met
en lumière un travers intemporel de l’humanité — la manie de juger.
On peut alors se
demander : que penser de la manie de juger ?
Résumé par actes – Les Plaideurs de Jean Racine (1668)
Acte I – La manie de juger
La pièce s’ouvre sur la présentation de Perrin Dandin, un juge dévoré par sa passion du
tribunal.
Tellement obsédé par son métier, il veut juger tout le monde, tout le temps, au point
d’en perdre le sens commun.
Pour éviter le scandale, son fils Léandre charge son
domestique Petit-Jean et son ami L’Intimé de l’empêcher de sortir de chez lui.
Léandre
confie à L’Intimé qu’il est amoureux d’Isabelle, la fille du plaideur Chicanneau, un homme
tout aussi atteint par la folie des procès.
Pendant ce temps, Chicanneau rencontre la comtesse de Pimbesche, autre procédurière
qui multiplie les procès.
Après s’être plaints de leurs malheurs, ils se disputent et décident…
de s’assigner mutuellement en justice.
Ainsi, dès le premier acte, Racine installe un univers
absurde dominé par la manie judiciaire, où la procédure l’emporte sur la raison.
Acte II – Le faux procès et la supercherie
Pour aider Léandre à conquérir Isabelle, L’Intimé échafaude un stratagème.
Déguisé en
huissier, il apporte chez Chicanneau un soi-disant exploit judiciaire, mais en profite pour
glisser à la jeune fille un billet d’amour.
Chicanneau, croyant que ce document est officiel,
s’emporte et menace de procès.
Arrive alors un faux commissaire — Léandre lui-même —
qui, profitant de la confusion, fait signer à Chicanneau un contrat de mariage entre lui et
Isabelle.
Pendant ce temps, Perrin Dandin, frustré de ne pouvoir juger, se livre à un procès absurde
contre le chien Citron, accusé d’avoir mangé un chapon.
Cette scène, véritable parodie de
justice, illustre la critique racinienne d’un monde où le jugement devient un jeu, voire une
folie.
Acte III – Le triomphe du ridicule
Le dernier acte pousse la satire à son comble.
Le procès du chien Citron se déroule
comme une audience solennelle, où Dandin, Petit-Jean et L’Intimé jouent avec un sérieux
comique leurs rôles de juges et d’avocats.
Racine y tourne en dérision l’éloquence judiciaire
et la vanité des débats juridiques.
Finalement, Léandre et Isabelle révèlent la supercherie : le contrat signé par Chicanneau
n’était qu’un stratagème pour obtenir son accord au mariage.
D’abord furieux, Chicanneau
finit par accepter, d’autant que Léandre prend Isabelle sans dot.
Perrin Dandin, ravi de
pouvoir continuer à juger tout et n’importe quoi, bénit l’union et relaxe même le chien Citron.
I.
La manie de juger : source de comique et d’exagération
a) L’obsession ridicule de Dandin
● Dès la première scène, Racine installe le comique à travers le comportement
absurde de Perrin Dandin, un juge qui ne vit que pour juger.
Il arrive « avec un sac
de procès », objet grotesque qui symbolise sa manie et son incapacité à séparer sa
vie privée de sa fonction publique.
● Dans l’Acte I, scène 1, il proclame « Je suis juge et je veux juger », résumant à lui
seul sa folie.
L’obsession de Dandin devient telle qu’elle menace sa santé : dans
l’Acte I, scène 4, il déclare « Je veux être malade je ne dormirai point je veux aller
juger », montrant que son zèle dépasse le raisonnable et transforme sa passion en
danger pour lui-même.
● Petit-Jean, son domestique, finit par utiliser le sac....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Plaideurs, les [Jean Racine] - résumé et analyse.
- Les Plaideurs de Jean RACINE (Résumé & Analyse)
- THÉBAÏDE OU LES FRÈRES ENNEMIS (La) Jean Racine (résumé)
- IPHIGÉNIE de Jean Racine (résumé & analyse)
- BAJAZET Jean Racine - résumé de l'œuvre