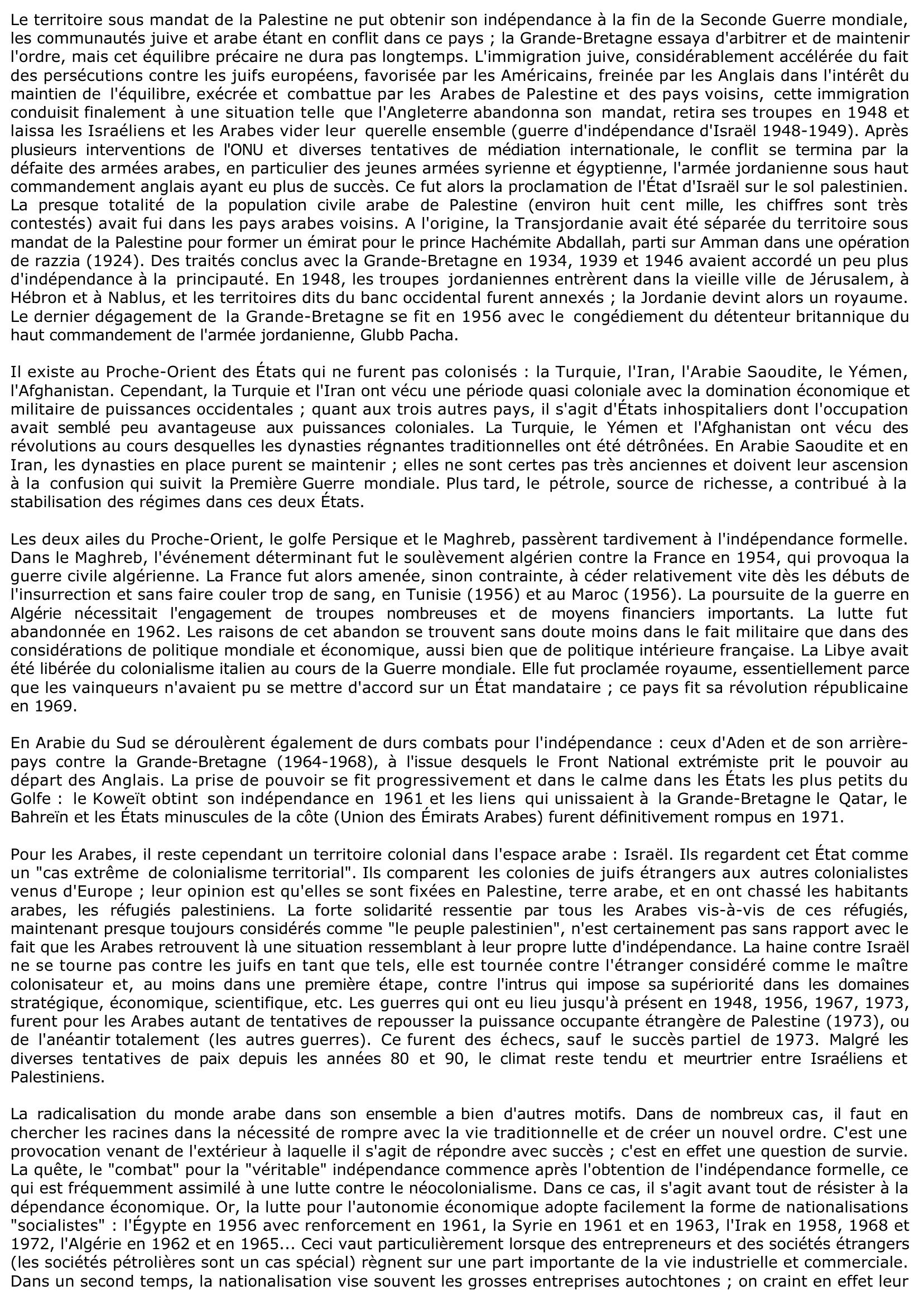Le Proche-Orient dans l'après-guerre (Histoire)
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
Le territoire sous mandat de la Palestine ne put obtenir son indépendance à la fin de la Seconde Guerre mondiale,les communautés juive et arabe étant en conflit dans ce pays ; la Grande-Bretagne essaya d'arbitrer et de maintenirl'ordre, mais cet équilibre précaire ne dura pas longtemps.
L'immigration juive, considérablement accélérée du faitdes persécutions contre les juifs européens, favorisée par les Américains, freinée par les Anglais dans l'intérêt dumaintien de l'équilibre, exécrée et combattue par les Arabes de Palestine et des pays voisins, cette immigrationconduisit finalement à une situation telle que l'Angleterre abandonna son mandat, retira ses troupes en 1948 etlaissa les Israéliens et les Arabes vider leur querelle ensemble (guerre d'indépendance d'Israël 1948-1949).
Aprèsplusieurs interventions de l'ONU et diverses tentatives de médiation internationale, le conflit se termina par ladéfaite des armées arabes, en particulier des jeunes armées syrienne et égyptienne, l'armée jordanienne sous hautcommandement anglais ayant eu plus de succès.
Ce fut alors la proclamation de l'État d'Israël sur le sol palestinien.La presque totalité de la population civile arabe de Palestine (environ huit cent mille, les chiffres sont trèscontestés) avait fui dans les pays arabes voisins.
A l'origine, la Transjordanie avait été séparée du territoire sousmandat de la Palestine pour former un émirat pour le prince Hachémite Abdallah, parti sur Amman dans une opérationde razzia (1924).
Des traités conclus avec la Grande-Bretagne en 1934, 1939 et 1946 avaient accordé un peu plusd'indépendance à la principauté.
En 1948, les troupes jordaniennes entrèrent dans la vieille ville de Jérusalem, àHébron et à Nablus, et les territoires dits du banc occidental furent annexés ; la Jordanie devint alors un royaume.Le dernier dégagement de la Grande-Bretagne se fit en 1956 avec le congédiement du détenteur britannique duhaut commandement de l'armée jordanienne, Glubb Pacha.
Il existe au Proche-Orient des États qui ne furent pas colonisés : la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Yémen,l'Afghanistan.
Cependant, la Turquie et l'Iran ont vécu une période quasi coloniale avec la domination économique etmilitaire de puissances occidentales ; quant aux trois autres pays, il s'agit d'États inhospitaliers dont l'occupationavait semblé peu avantageuse aux puissances coloniales.
La Turquie, le Yémen et l'Afghanistan ont vécu desrévolutions au cours desquelles les dynasties régnantes traditionnelles ont été détrônées.
En Arabie Saoudite et enIran, les dynasties en place purent se maintenir ; elles ne sont certes pas très anciennes et doivent leur ascensionà la confusion qui suivit la Première Guerre mondiale.
Plus tard, le pétrole, source de richesse, a contribué à lastabilisation des régimes dans ces deux États.
Les deux ailes du Proche-Orient, le golfe Persique et le Maghreb, passèrent tardivement à l'indépendance formelle.Dans le Maghreb, l'événement déterminant fut le soulèvement algérien contre la France en 1954, qui provoqua laguerre civile algérienne.
La France fut alors amenée, sinon contrainte, à céder relativement vite dès les débuts del'insurrection et sans faire couler trop de sang, en Tunisie (1956) et au Maroc (1956).
La poursuite de la guerre enAlgérie nécessitait l'engagement de troupes nombreuses et de moyens financiers importants.
La lutte futabandonnée en 1962.
Les raisons de cet abandon se trouvent sans doute moins dans le fait militaire que dans desconsidérations de politique mondiale et économique, aussi bien que de politique intérieure française.
La Libye avaitété libérée du colonialisme italien au cours de la Guerre mondiale.
Elle fut proclamée royaume, essentiellement parceque les vainqueurs n'avaient pu se mettre d'accord sur un État mandataire ; ce pays fit sa révolution républicaineen 1969.
En Arabie du Sud se déroulèrent également de durs combats pour l'indépendance : ceux d'Aden et de son arrière-pays contre la Grande-Bretagne (1964-1968), à l'issue desquels le Front National extrémiste prit le pouvoir audépart des Anglais.
La prise de pouvoir se fit progressivement et dans le calme dans les États les plus petits duGolfe : le Koweït obtint son indépendance en 1961 et les liens qui unissaient à la Grande-Bretagne le Qatar, leBahreïn et les États minuscules de la côte (Union des Émirats Arabes) furent définitivement rompus en 1971.
Pour les Arabes, il reste cependant un territoire colonial dans l'espace arabe : Israël.
Ils regardent cet État commeun "cas extrême de colonialisme territorial".
Ils comparent les colonies de juifs étrangers aux autres colonialistesvenus d'Europe ; leur opinion est qu'elles se sont fixées en Palestine, terre arabe, et en ont chassé les habitantsarabes, les réfugiés palestiniens.
La forte solidarité ressentie par tous les Arabes vis-à-vis de ces réfugiés,maintenant presque toujours considérés comme "le peuple palestinien", n'est certainement pas sans rapport avec lefait que les Arabes retrouvent là une situation ressemblant à leur propre lutte d'indépendance.
La haine contre Israëlne se tourne pas contre les juifs en tant que tels, elle est tournée contre l'étranger considéré comme le maîtrecolonisateur et, au moins dans une première étape, contre l'intrus qui impose sa supériorité dans les domainesstratégique, économique, scientifique, etc.
Les guerres qui ont eu lieu jusqu'à présent en 1948, 1956, 1967, 1973,furent pour les Arabes autant de tentatives de repousser la puissance occupante étrangère de Palestine (1973), oude l'anéantir totalement (les autres guerres).
Ce furent des échecs, sauf le succès partiel de 1973.
Malgré lesdiverses tentatives de paix depuis les années 80 et 90, le climat reste tendu et meurtrier entre Israéliens etPalestiniens.
La radicalisation du monde arabe dans son ensemble a bien d'autres motifs.
Dans de nombreux cas, il faut enchercher les racines dans la nécessité de rompre avec la vie traditionnelle et de créer un nouvel ordre.
C'est uneprovocation venant de l'extérieur à laquelle il s'agit de répondre avec succès ; c'est en effet une question de survie.La quête, le "combat" pour la "véritable" indépendance commence après l'obtention de l'indépendance formelle, cequi est fréquemment assimilé à une lutte contre le néocolonialisme.
Dans ce cas, il s'agit avant tout de résister à ladépendance économique.
Or, la lutte pour l'autonomie économique adopte facilement la forme de nationalisations"socialistes" : l'Égypte en 1956 avec renforcement en 1961, la Syrie en 1961 et en 1963, l'Irak en 1958, 1968 et1972, l'Algérie en 1962 et en 1965...
Ceci vaut particulièrement lorsque des entrepreneurs et des sociétés étrangers(les sociétés pétrolières sont un cas spécial) règnent sur une part importante de la vie industrielle et commerciale.Dans un second temps, la nationalisation vise souvent les grosses entreprises autochtones ; on craint en effet leur.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La guerre russo-japonaise: De la rivalité en Extrême-Orient à la guerre ouverte (Travaux Personnels Encadrés – HISTOIRE & CIVILISATION)
- La Guerre de Sept Ans (cours histoire)
- Cours d'histoire sur la seconde guerre mondiale
- L’HISTOIRE DES GENOCIDES DES JUIFS ET DES TSIGANES PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
- Epreuve d’Histoire - L’après guerre