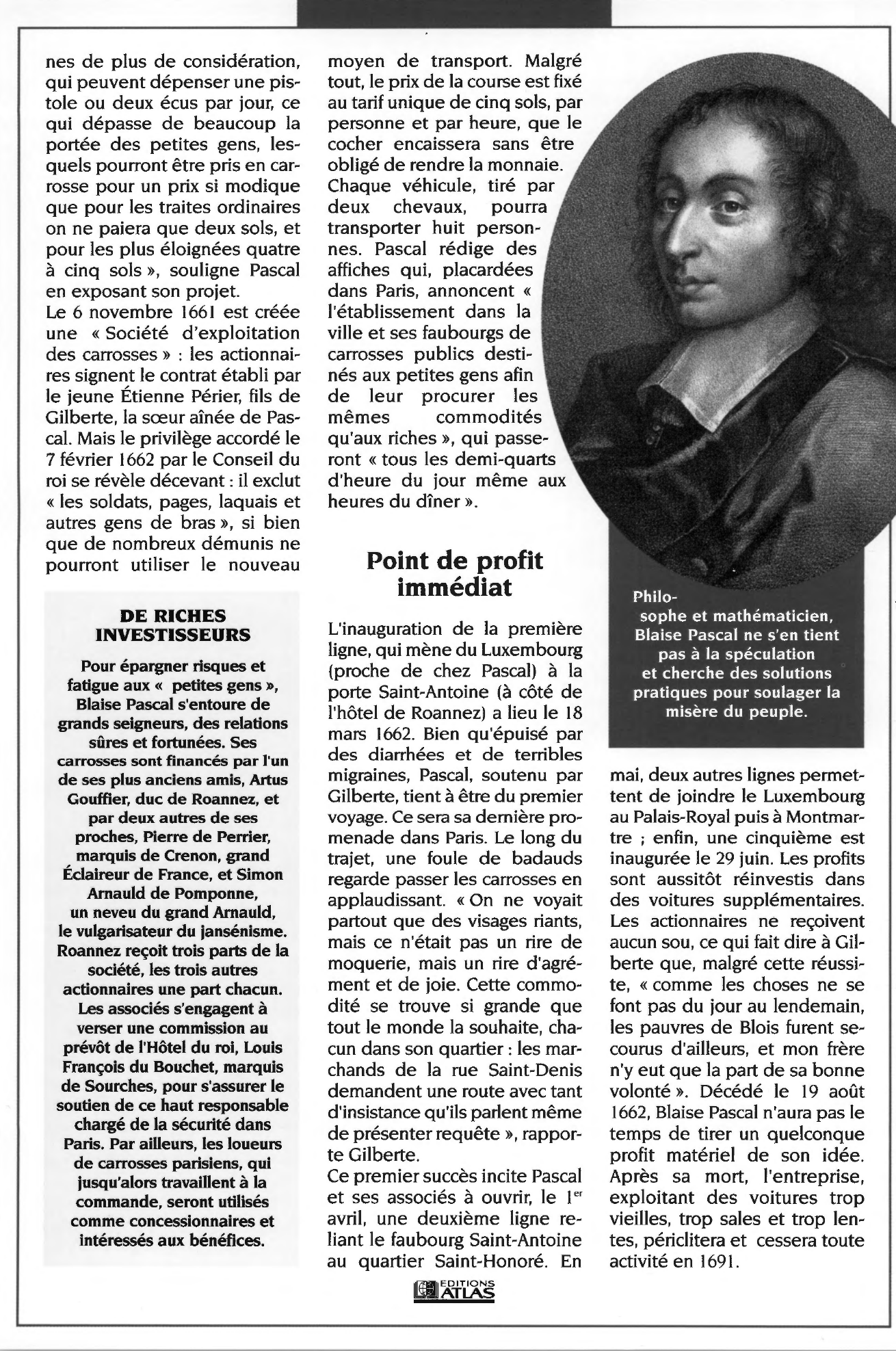Les carrosses de Blaise Pascal
Publié le 26/08/2013

Extrait du document

L'inauguration de la première ligne, qui mène du Luxembourg (proche de chez Pascal) à la porte Saint-Antoine (à côté de l'hôtel de Roannez) a lieu le 18 mars 1662. Bien qu'épuisé par des diarrhées et de terribles migraines, Pascal, soutenu par Gilberte, tient à être du premier voyage. Ce sera sa dernière promenade dans Paris. Le long du trajet, une foule de badauds regarde passer les carrosses en applaudissant. « On ne voyait partout que des visages riants, mais ce n'était pas un rire de moquerie, mais un rire d'agrément et de joie. Cette commodité se trouve si grande que tout le monde la souhaite, chacun dans son quartier : les marchands de la rue Saint-Denis demandent une route avec tant d'insistance qu'ils parlent même de présenter requête «, rapporte Gilberte.

«
nes de plus de considération,
qui peuvent dépenser une pis
tole ou deux écus par jour, ce
qui dépasse de beaucoup la
portée des petites gens, les
quels pourront être pris en car
rosse
pour un prix si modique
que pour les traites ordinaires
on ne paiera que deux sols, et
pour les plus éloignées quatre
à cinq sols», souligne Pascal
en exposant son projet.
Le 6 novembre 1661 est créée
une « Société d'exploitation
des carrosses >> : les actionnai
res
signent le contrat établi par
le jeune Étienne Périer, fils de
Gilberte, la sœur aînée de Pas
cal.
Mais le privilège accordé le
7 février 1662 par le Conseil du
roi se révèle décevant : il exclut
« les soldats, pages, laquais et
autres gens de bras», si bien
que de nombreux démunis ne
pourront utiliser le nouveau
DE RICHES
INVESTISSEURS
Pour épargner risques et
fatigue aux « petites gens »,
Blaise Pascal s' entoure de
grands seigneurs, des relations
sûres et fortunées.
Ses carrosses sont financés par l'un
de ses plus anciens amis, Artus Gouffier , duc de Roannez, et
par deux autres de ses
proches , Pierre de Perrier,
marquis de Crenon, grand Éclaireur de France, et Simon
Arnauld de Pomponne,
un neveu du grand Arnauld ,
le vulgarisateur du jansénisme .
Roannez
reçoit trois parts de la
société, les trois autres
actionnaires
une part chacun.
Les associés s'engagent
à
verser une commission au
prévôt de l'Hôtel du roi, Louis
François
du Bouchet, marquis
de Sourches, pour s'assurer le
soutien de ce haut responsable
chargé
de la sécurité dans
Paris .
Par ailleurs, les loueurs
de carrosses parisiens, qui
jusqu'alors travaillent à la
commande, seront utilisés
comme concessionnaires et
intéressés aux bénéfices.
moyen de transport .
Malgré
tout, le prix de la course est fixé
au
tarif unique de cinq sols , par
personne et par heure, que le
cocher encaissera sans être
obligé de rendre la monnaie .
Chaque véhicule,
tiré par
deux chevaux, pourra
transporter huit person
nes .
Pascal rédige des
affiches qui, placardées
dans Paris, annoncent «
l'établisseme nt dans la
ville et ses faubourgs de
carrosses publics desti
nés aux petites gens afin
de leur procurer les
mêmes co mmodités
qu'aux riches », qui passe
ront «tous les demi-quarts
d 'heure du jour même
heures du dîner >> .
Point de profit
immédiat
L'inauguration de la première
ligne, qui mène du Luxembourg
(proche
de chez Pascal) à la
porte Saint-Antoine (à côté de
l'hôtel de Roannez) a lieu le 18
mars 1662 .
Bien qu 'épuisé par
des diarrhées et de terribles
migraines, Pascal, soutenu par
Gilberte, tient à être du premier
voyage.
Ce sera sa dernière pro
menade dans Paris.
Le long du
trajet, une foule de badauds
regarde passer les carrosses en
applaudissant .
« On ne voyait
partout que des visages riants,
mais ce n'
était pas un rire de
moquerie, mais un rire d'agré
ment et de joie .
Cette commo
dité se trouve si grande que
tout le monde la souhaite, cha
cun dans son
quartier : les mar
chands
de la rue Saint-Denis
demandent une route avec tant
d'insistance qu'ils parlent même
de présenter requête », rappor
te Gilberte .
Ce premier succès incite Pascal
et ses associés à ouvrir, le I °'
avril.
une deuxième ligne re
liant le faubourg Saint-Antoine
au quartier Saint-Honoré .
En
EDITIONS ATLAS
mai, deux autres lignes permet
tent de joindre le Luxembourg
au Palais-Royal puis à Montmar
tre ; enfin, une cinquième est
inaugurée le 29 juin .
Les profits
so
nt aussitôt réinvestis dans
des voitures supplémentaires .
Les actionnaires
ne reçoivent
aucun sou, ce
qui fait dire à Gil
berte que, malgré cette réussi
te, «c omme les choses ne se
font pas du jour au lendemain,
les pauvres de Blois furent se
courus d'ailleurs, et mon frère
n'y eut que la part de sa bonne
volonté» .
Décédé le 19 août
1662, Blaise Pascal n'aura pas le
temps de tirer un quelconque
profit matériel de son idée.
Après sa mort, l'entreprise,
exploitant des voit ure s trop
vieilles, trop sales et trop len
tes, périclitera et cessera toute
activité en 1691.
0 ] "-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- blaise pascal ET LE NEZDE Cléopâtre
- Blaise PASCAL et le temps dans Pensées: Quel est le rapport entre l’Homme et le temps ?
- L’esprit géométrique chez Blaise PASCAL
- Traité du Triangle arithmétique de Blaise PASCAL
- PENSÉES de Blaise Pascal (résumé et analyse de l'oeuvre)