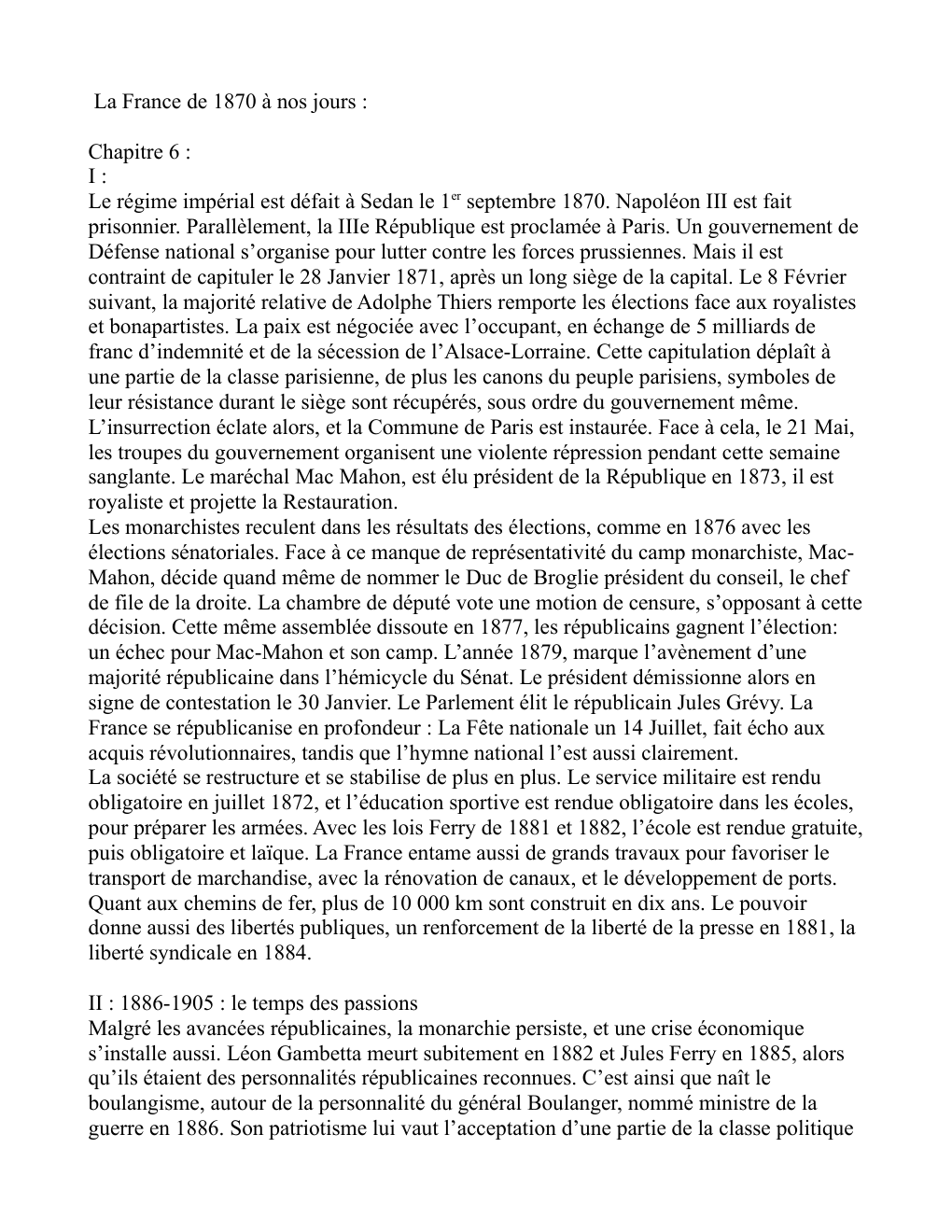Synthèse d'Histoire 1870-1990 - La France de 1870 à nos jours
Publié le 07/11/2025
Extrait du document
«
La France de 1870 à nos jours :
Chapitre 6 :
I:
Le régime impérial est défait à Sedan le 1er septembre 1870.
Napoléon III est fait
prisonnier.
Parallèlement, la IIIe République est proclamée à Paris.
Un gouvernement de
Défense national s’organise pour lutter contre les forces prussiennes.
Mais il est
contraint de capituler le 28 Janvier 1871, après un long siège de la capital.
Le 8 Février
suivant, la majorité relative de Adolphe Thiers remporte les élections face aux royalistes
et bonapartistes.
La paix est négociée avec l’occupant, en échange de 5 milliards de
franc d’indemnité et de la sécession de l’Alsace-Lorraine.
Cette capitulation déplaît à
une partie de la classe parisienne, de plus les canons du peuple parisiens, symboles de
leur résistance durant le siège sont récupérés, sous ordre du gouvernement même.
L’insurrection éclate alors, et la Commune de Paris est instaurée.
Face à cela, le 21 Mai,
les troupes du gouvernement organisent une violente répression pendant cette semaine
sanglante.
Le maréchal Mac Mahon, est élu président de la République en 1873, il est
royaliste et projette la Restauration.
Les monarchistes reculent dans les résultats des élections, comme en 1876 avec les
élections sénatoriales.
Face à ce manque de représentativité du camp monarchiste, MacMahon, décide quand même de nommer le Duc de Broglie président du conseil, le chef
de file de la droite.
La chambre de député vote une motion de censure, s’opposant à cette
décision.
Cette même assemblée dissoute en 1877, les républicains gagnent l’élection:
un échec pour Mac-Mahon et son camp.
L’année 1879, marque l’avènement d’une
majorité républicaine dans l’hémicycle du Sénat.
Le président démissionne alors en
signe de contestation le 30 Janvier.
Le Parlement élit le républicain Jules Grévy.
La
France se républicanise en profondeur : La Fête nationale un 14 Juillet, fait écho aux
acquis révolutionnaires, tandis que l’hymne national l’est aussi clairement.
La société se restructure et se stabilise de plus en plus.
Le service militaire est rendu
obligatoire en juillet 1872, et l’éducation sportive est rendue obligatoire dans les écoles,
pour préparer les armées.
Avec les lois Ferry de 1881 et 1882, l’école est rendue gratuite,
puis obligatoire et laïque.
La France entame aussi de grands travaux pour favoriser le
transport de marchandise, avec la rénovation de canaux, et le développement de ports.
Quant aux chemins de fer, plus de 10 000 km sont construit en dix ans.
Le pouvoir
donne aussi des libertés publiques, un renforcement de la liberté de la presse en 1881, la
liberté syndicale en 1884.
II : 1886-1905 : le temps des passions
Malgré les avancées républicaines, la monarchie persiste, et une crise économique
s’installe aussi.
Léon Gambetta meurt subitement en 1882 et Jules Ferry en 1885, alors
qu’ils étaient des personnalités républicaines reconnues.
C’est ainsi que naît le
boulangisme, autour de la personnalité du général Boulanger, nommé ministre de la
guerre en 1886.
Son patriotisme lui vaut l’acceptation d’une partie de la classe politique
républicaine à droite et à gauche.
Il souhaite aussi revoir la constitution de 1875.
Il
réunit ses partisan autour d’un slogan : « Dissolution, Révision, Constituante ».
Il
possède de nombreux soutiens comme lorsqu’il quitte le ministère, qui le pousserons dès
sa retraite à se présenter à une élection partielle
où il est largement élu.
Sa victoire fait craindre un coup d’état.
Mais il ne s’exécute pas,
et s’exile à Bruxelles.
Le boulangisme échoue aux élections suivantes.
En 1892, des scandales politico-financiers sont révélés.
La compagnie du canal de
Panama, donne de l’agent à des parlementaires français, dans l’intérêt de la compagnie.
La méfiance atteint le peuple français.
Les mouvement ouvriers reprennent, et des
attentats à la bombe ont lieu comme sur la Chambre des député en 1893 ou l’assassinat
du Président de la République Sadi Carnot, le 24 Juin 1894 par des militants anarchistes.
L’Église se rapproche de la République française : c’est le Ralliement de 1892, qui
encourage le ralliement des catholiques à la République.
Ce qui secoue et polarise le débat, c’est l’affaire Dreyfus qui débute en 1894.
Le
capitaine Alfred Dreyfus est condamné par le conseil de guerre pour espionnage, il est
juif, et sa culpabilité controversée, alimente l’antisémitisme.
Émile Zola, rédige une
lettre ouverte au président de la république Clemenceau dans L’aurore intitulée
« J’accuse...
» en Janvier 1898 qui accuse les autorités politiques et militaires de cacher
la vérité.
Au fur et à mesure de l’enquête, le débat publique change progressivement, car
l’affaire apparaît controversée.
Le gouvernement du nouveau président républicain modéré Émile Loubet essaye à tout
prix de mettre les nationalistes, l’Église catholique et l’armée.
L’Église française s’était
montrée très anti-dreyfusarde, le gouvernement de Loubet réduit l’influence de l’Église
dans l’enseignement scolaire notamment.
Les élections de 1902, sont favorables à la
gauche.
Émile Combes devenu chef du nouveau gouvernement continue la politique du
gouvernement Waldeck-Rousseau, en fermant plus de 3000 écoles catholiques, et
plusieurs congrégations religieuses expulsées.
Il y a même une rupture diplomatique
entre le Vatican et La France en 1904.
Et la séparation de l’Église et de l’État en
décembre 1905, marque la fin d’une alliance, la réquisitions des biens cléricaux dès
1906 engendrent une flambée de violence.
III.
1906-1914 : La république nationale
En 1906, Fallières succède à Loubet, de manière paisible, qui témoigne du climat de
prospérité qui commence à s’installer.George Clemenceau est président du Conseil.
Jean
Jaurès, le député socialiste, porte la cause sociale au parlement.
Les mouvements,
justement sociaux, se multiplient : les cheminots, le midi viticole en 1907, les vignerons
de Champagne en 1911… En 1906 un ministère du Travail est créé en 1906, un jour de
repos est donné : preuves de l’avancée sociale.
Plus tard, en 1910, c’est la retraite
ouvrière qui est mise en place.
La crise de Tanger en 1905 exacerbe les tensions entre les peuples allemands et français.
Raymond Poincaré qui est élu en 1913, Président de la République, grâce à l’alliance des
droites, incarne la fermeté diplomatique entre les deux pays.
A la veille de la Grande guerre, le pays compte moins de 40 millions d’habitants, son
taux de natalité diminue.
La société reste fermée à l'avènement des femmes dans les
affaires politiques : le suffrage universel est masculin.
Toutefois, certaines femme sont
reconnues, comme Marie Curie, qui obtient en 1911, grâce à ses travaux de recherches à
Paris.
Cette époque de pré-guerre est considérée comme la Belle-époque, celle de la
modernisation.
L'électricité, la bicyclette, la lecture, et le cinéma.
Même si les inégalités
entre citoyens sont financièrement prononcées, l’ascenseur social se met
progressivement en route.
Chapitre 7 :
Crise marocaine et guerre balkaniques
I.
les phases du conflit :
Des alliances militaires se construisent : la Triple Alliance en 1882 réunissant
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie.
Et la Triple Entente en 1907, avec la France,
le Royaume-Uni et la Russie.
Des alliances officieuses se greffent autour des deux blocs,
dont la Serbie avec la la Triple Entente.
Le 28 Juin 1914, l’archiduc François Ferdinand
héritier de l’empire d’Autriche-Hongrie est assassiné par un étudiant serbe.
Une crise
diplomatique éclate entre les deux nations.
Et l’Autriche-Hongrie attaque un mois plus
tard la Serbie.
Entraînant la Russie dans la guerre et en conséquence les deux alliances
militaires.
En effet, le 3 Août c’est l’Allemagne qui déclare la guerre à la France.
Les
armées allemandes attaquent la France à travers la Belgique, mais contenues par la
contre-attaque de la Marne du 6 au 9 Septembre, épargnant la capitale française.
Les
allemands reculent jusqu’à l’Aisne.
La guerre de mouvement laisse place au bout de
deux mois à une stabilisation pour une guerre de position.
Le front s’étend de la mer du
Nord jusqu’à la frontière Suisse.
Du côté du front Russe la guerre reste une guerre de
mouvement.
L’allié de l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie est rapidement mise en
difficulté par la Russie et la Serbie.
Le 1er Novembre 1914, la Turquie rejoint la Triple
Alliance.
La guerre de position se concrétise par des tranchées, creusée.
Elles permettent de se
protéger des tirs ennemis.
Et l’assaut devient difficile et très coûteux en hommes.
La
bataille de Verdun, en 1916, est un exemple de bataille des tranchées qui ne s’est pas
traduite par des gains territoriaux mais au prix de 700 000 morts et blessés.
La Bulgarie
en 1915 rejoint les forces de l’Entente, et l’Italie en 1915 et la Roumanie en 1916
rejoignent les Alliés.
Des nouveaux fronts s’ouvrent dans les Balkans et entre les
colonies occidentales.
Et la Serbie est battue par la capacité militaire de l’AutricheHongrie mêlée à celle de la Bulgarie.
Les Anglais repoussent les Turcs, moins forts.
En 1917, la France est touchée par une série de grève qui s’étend jusqu’aux usines
d’armement.
Le moral des troupes est en baisse surtout après l’offensive du chemin des
Dames qui a tourné à la catastrophe.
Des mutineries éclatent dans l’armée française mais
aussi dans l’armée russe.
La donne est également revue avec les révélations du
télégramme Zimmermann, qui est adressé à l’État Mexicain, qui demande une alliance
en échange de territoires américains.
Ce télégramme intercepté contribue à faire....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de révision du chapitre d’histoire : La France et la construction de nouveaux Etats (1848 à 1870).
- HISTOIRE LITTÉRAIRE DU SENTIMENT RELIGIEUX EN FRANCE DEPUIS LA FIN DES GUERRES DE RELIGION JUSQU’A NOS JOURS.
- Histoire : 1870-1879 en France
- Le père Elysée, aussi fameux prédicateur, a fait le même panégyrique devant mm des académies des sciences et des inscriptions. Louis Petit de Bachaumont, Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en France depuis 1762 jusqu'à nos jours
- La vie politique de la France de 1870 à 1914 (histoire)