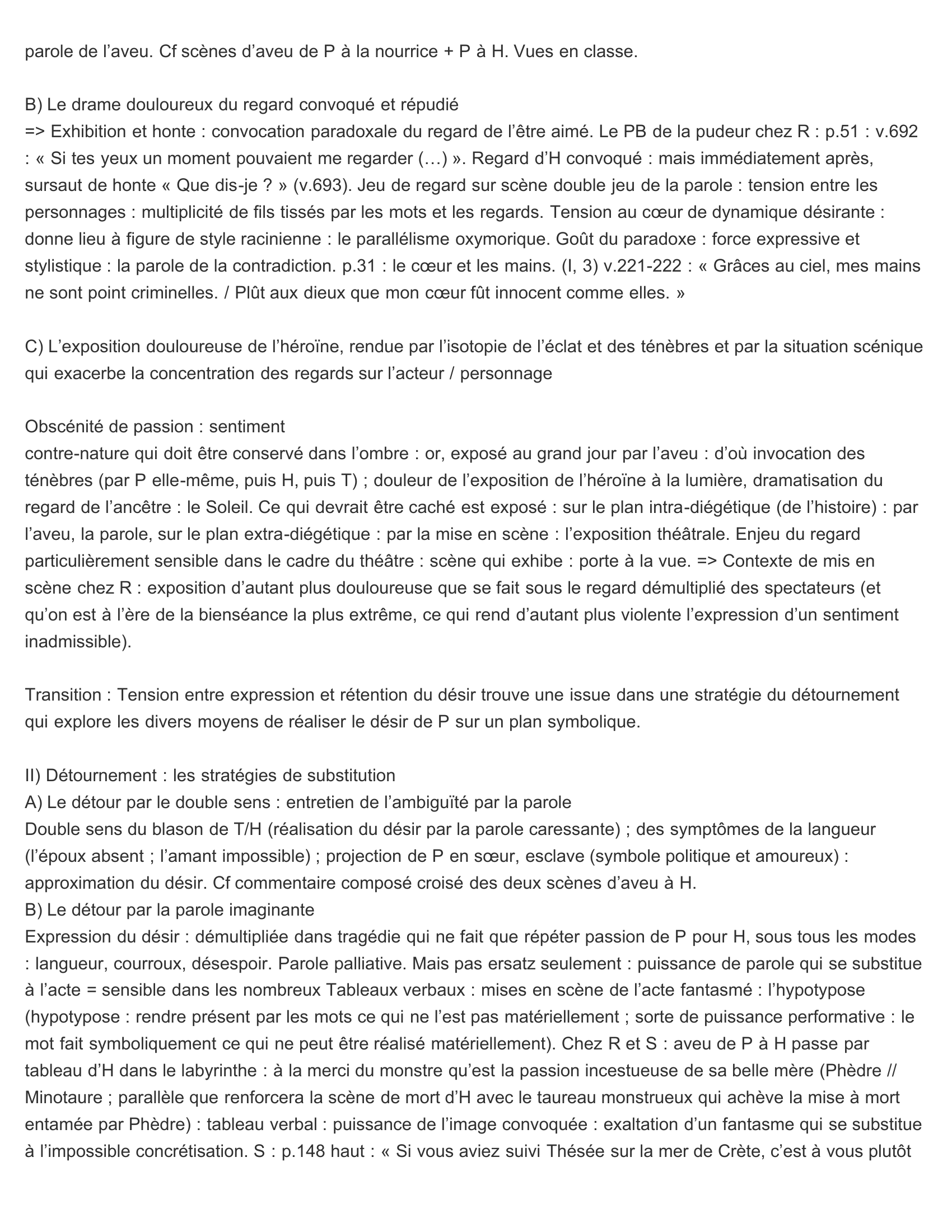Analyse père goriot
Publié le 11/09/2018

Extrait du document
dîner chez madame de Nucingen », un dîner d’ambitieux plus que d’amoureux, il n’est plus désigné par son prénom Eugène, il est Rastignac, et cela sonne dur, pour un dîner chez une femme désignée du nom de son mari banquier, et pas son nom d’amante, Delphine. Dîner chez elle dès ce soir-là, c’est renoncer à la juger, c’est accepter sa sècheresse de cœur, son ingratitude filiale, c’est donc la traiter en instrument d’un ambition. Parvenir en exploitant l’amour à des fins mercantiles : voilà Rastignac qui met en pratique les conseils exposés autrefois à Eugène par Vautrin.
Conclusion
Cette dernière page du roman est le point de rencontre des thèmes importants : une vie s’achève, une autre commence. Le thème fondamental du roman, l’égoïsme préféré et pratiqué au lieu de la générosité, reçoit ici son ultime et capitale expression : la mort même peut effacer le culte d’intérêt personnel dans les cœurs indifférents. La méconnaissance des bons et des grands sentiments a été poussée jusqu’aux extrêmes limites : Goriot est désavoué par tus, par ses filles absentes de son lit de mort et du cimetière, et aussi par le jeune homme, qui certes s’est occupé de lui affectueusement, mais qui va vivre selon les principes opposés aux siens.
Une ultime et décisive leçon. Face à la tombe, Eugène a scruté le fond des cœurs. La mort pathétique de père marque la fin de son éducation. Le voilà seul désormais face à la vie, en position d’adulte ; ses maîtres, ou ses inspirateurs, l’ont quitté : Mme de Beauséant retirée, Vautrin arrêté, Goriot mort. A lui de vivre en assumant un chois déjà largement engagé et renforcé par l’épisode final. Le destin du père Goriot aura contribué jusqu’au bout à l’apprentissage d’Eugène.
Les deux fils de l’intrigue se rejoignent au bord de la tombe de Goriot : celui du père dépouillé et celui du jeune homme ambitieux, cependant que la filiation plus discrète avec Vautrin s’affirme dans la décision d’utiliser Delphine, femme du banquier, à ses fins d’enrichissement.
«
parole de l’aveu.
Cf scènes d’aveu de P à la nourrice + P à H.
Vues en classe.
B) Le drame douloureux du regard convoqué et répudié
=> Exhibition et honte : convocation paradoxale du regard de l’être aimé.
Le PB de la pudeur chez R : p.51 : v.692
: « Si tes yeux un moment pouvaient me regarder (…) ».
Regard d’H convoqué : mais immédiatement après,
sursaut de honte « Que dis -je ? » (v.693).
Jeu de regard sur scène double jeu de la parole : tension entre les
personnages : multiplicité de fils tissés par les mots et les regards.
Tension au cœur de dynamique désirante :
donne lieu à figure de style racinienne : le parallélisme oxymorique.
Goût du paradoxe : force expressive et
stylistique : la parole de la contradiction.
p.31 : le cœur et les mains.
(I, 3) v.221-222 : « Grâces au ciel, mes mains
ne sont point criminelles.
/ Plût aux dieux que mon cœur fût innocent comme elles.
»
C) L’exposition douloureuse de l’héroïne, rendue par l’isotopie de l’éclat et des ténèbres et par la situation scénique
qui exacerbe la concentration des regards sur l’acteur / personnage
Obscénité de passion : sentiment
contre-nature qui doit être conservé dans l’ombre : or, exposé au grand jour par l’aveu : d’où invocation des
ténèbres (par P elle-même, puis H, puis T) ; douleur de l’exposition de l’héroïne à la lumière, dramatisation du
regard de l’ancêtre : le Soleil.
Ce qui devrait être caché est exposé : sur le plan intra -diégétique (de l’histoire) : par
l’aveu, la parole, sur le plan extra-diégétique : par la mise en scène : l’exposition théâtrale.
Enjeu du regard
particulièrement sensible dans le cadre du théâtre : scène qui exhibe : porte à la vue.
=> Contexte de mis en
scène chez R : exposition d’autant plus douloureuse que se fait sous le regard démultiplié des spectateurs (et
qu’on est à l’ère de la bienséance la plus extrême, ce qui rend d’autant plus violente l’expression d’un sentiment
inadmissible).
Transition : Tension entre expression et rétention du désir trouve une issue dans une stratégie du détournement
qui explore les divers moyens de réaliser le désir de P sur un plan symbolique.
II) Détournement : les stratégies de substitution
A) Le détour par le double sens : entretien de l’ambiguïté par la parole
Double sens du blason de T/H (réalisation du désir par la parole caressante) ; des symptômes de la langueur
(l’époux absent ; l’amant impossible) ; projection de P en sœur, esclave (symbole politique et amoureux) :
approximation du désir.
Cf commentaire composé croisé des deux scènes d’aveu à H.
B) Le détour par la parole imaginante
Expression du désir : démultipliée dans tragédie qui ne fait que répéter passion de P pour H, sous tous les modes
: langueur, courroux, désespoir.
Parole palliative.
Mais pas ersatz seulement : puissance de parole qui se substitue
à l’acte = sensible dans les nombreux Tableaux verbaux : mises en scène de l’acte fantasmé : l’hypotypose
(hypotypose : rendre présent par les mots ce qui ne l’est pas matériellement ; sorte de puissance performative : le
mot fait symboliquement ce qui ne peut être réalisé matériellement).
Chez R et S : aveu de P à H passe par
tableau d’H dans le labyrinthe : à la merci du monstre qu’est la passion incestueuse de sa belle mère (Phèdre //
Minotaure ; parallèle que renforcera la scène de mort d’H avec le taureau monstrueux qui achève la mise à mort
entamée par Phèdre) : tableau verbal : puissance de l’image convoquée : exaltation d’un fantasme qui se substitue
à l’impossible concrétisation.
S : p.148 haut : « Si vous aviez suivi Thésée sur la mer de Crète, c’est à vous plutôt.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le père Goriot : analyse de la 1ère partie du roman
- Analyse Le père Goriot
- PÈRE GORIOT (le). Roman d'Honoré de Balzac (résumé & analyse)
- Le Père Goriot (résumé & analyse), Balzac
- Le père GORIOT (résumé & analyse)