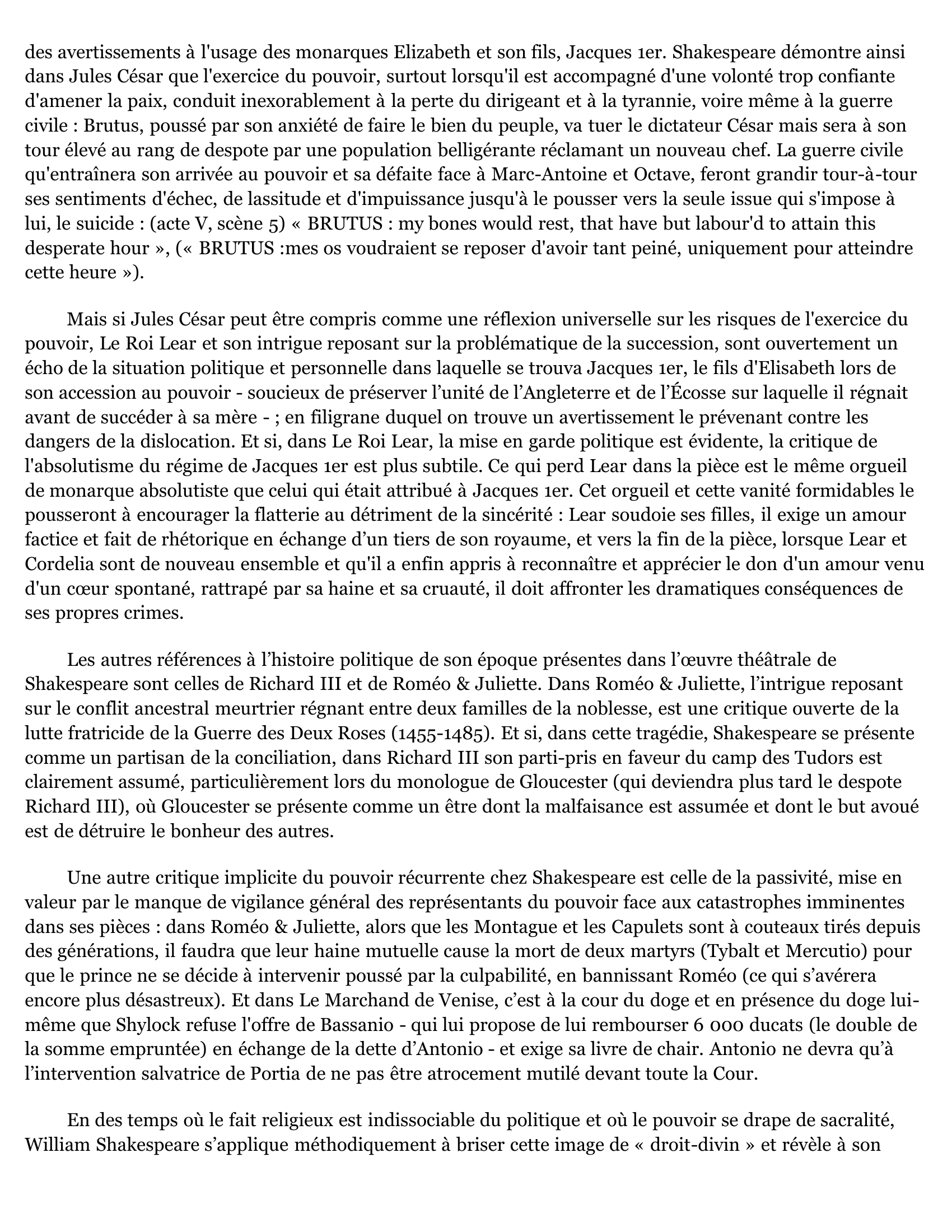Analyse Philosophique De L'oeuvre Shakespearienne
Publié le 11/09/2018
Extrait du document
Je crois que si, après des siècles, l'écrasement des héros tragiques de Shakespeare continue de soulever en nous une telle vague d'émotion, c'est parce que dans leur combat entre leur moi et le monde, ils refusent jusqu'à la mort de renoncer, et au moi, et au monde - parce qu'ils tombent du haut d'une plénitude presque atteinte et qu'au moment d'entrer dans la mort, ils conservent leurs exigences démesurées en face d'un monde acharné à les anéantir.
Conclusion
S'il est vrai comme nous l'avons démontré précédemment, que Shakespeare aurait eu des raisons très compréhensibles de chercher à camoufler son identité, il est important de signaler que les premières polémiques concernant son existence ont été formulées et s'inscrivent dans la tradition de siècles qui avaient, sur la création poétique, des idées qui ne sont plus les nôtres. En effet, il répugnait fortement aux érudits de ces siècles qu'un simple fils d'artisan ait pu écrire une telle œuvre de génie, rendre présents les passions et les soucis des monarques ou des aristocrates, se mouvoir par l'imagination dans le temps et l'espace et, surtout, réussir à incarner toute la conscience tragique de son siècle.
Cet élitisme étant (théoriquement) révolu, la relative obscurité des origines de Shakespeare ne devrait plus nous déranger en rien. Et, abstraction faite de l'argumentation précédente, il me plaît au contraire, qu'à l'aube des temps modernes surgissent ces créations d'un homme dont nous savons l'existence, mais dont nous ignorons les humeurs, les amours, les enjeux – créations où résonnent à l'unisson la voix collective d'une nation et les accents uniques d'une âme qui se livre totalement mais jamais en s'explorant, qui laisse deviner sa présence en rêvant pour nous à ce qui n'est pas elle.
«
des avertissements à l'usage des monarques Elizabeth et son fils, Jacques 1er.
Shakespeare démontre ainsi
dans Jules César que l'exercice du pouvoir, surtout lorsqu'il est accompagné d'une volonté trop confiante
d'amener la paix, conduit inexorablement à la perte du dirigeant et à la tyrannie, voire même à la guerre
civile : Brutus, poussé par son anxiété de faire le bien du peuple, va tuer le dictateur César mais sera à son
tour élevé au rang de despote par une population belligérante réclamant un nouveau chef.
La guerre civile
qu'entraînera son arrivée au pouvoir et sa défaite face à Marc-Antoine et Octave, feront grandir tour-à -tour
ses sentiments d'échec, de lassitude et d'impuissance jusqu'à le pousser vers la seule issue qui s'impose à
lui, le suicide : (acte V, scène 5) « BRUTUS : my bones would rest, that have but labour'd to attain this
desperate hour », (« BRUTUS :mes os voudraient se reposer d'avoir tant peiné, uniquement pour atteindre
cette heure »).
Mais si Jules César peut être compris comme une réflexion universelle sur les risques de l'exercice du
pouvoir, Le Roi Lear et son intrigue reposant sur la problématique de la succession, sont ouvertement un
écho de la situation politique et personnelle dans laquelle se trouva Jacques 1er, le fils d'Elisabeth lors de
son accession au pouvoir - soucieux de préserver l’unité de l’Angleterre et de l’Écosse sur laquelle il régnait
avant de succéder à sa mère - ; en filigrane duquel on trouve un avertissement le prévenant contre les
dangers de la dislocation.
Et si, dans Le Roi Lear, la mise en garde politique est évidente, la critique de
l'absolutisme du régime de Jacques 1er est plus subtile.
Ce qui perd Lear dans la pièce est le même orgueil
de monarque absolutiste que celui qui était attribué à Jacques 1er.
Cet orgueil et cette vanité formidables le
pousseront à encourager la flatterie au détriment de la sincérité : Lear soudoie ses filles, il exige un amour
factice et fait de rhétorique en échange d’un tiers de son royaume, et vers la fin de la pièce, lorsque Lear et
Cordelia sont de nouveau ensemble et qu'il a enfin appris à reconnaître et apprécier le don d'un amour venu
d'un cœur spontané, rattrapé par sa haine et sa cruauté, il doit affronter les dramatiques conséquences de
ses propres crimes.
Les autres références à l’histoire politique de son époque présentes dans l’œuvre théâtrale de
Shakespeare sont celles de Richard III et de Roméo & Juliette.
Dans Roméo & Juliette, l’intrigue reposant
sur le conflit ancestral meurtrier régnant entre deux familles de la noblesse, est une critique ouverte de la
lutte fratricide de la Guerre des Deux Roses (1455-1485).
Et si, dans cette tragédie, Shakespeare se présente
comme un partisan de la conciliation, dans Richard III son parti-pris en faveur du camp des Tudors est
clairement assumé, particulièrement lors du monologue de Gloucester (qui deviendra plus tard le despote
Richard III), où Gloucester se présente comme un être dont la malfaisance est assumée et dont le but avoué
est de détruire le bonheur des autres.
Une autre critique implicite du pouvoir récurrente chez Shakespeare est celle de la passivité, mise en
valeur par le manque de vigilance général des représentants du pouvoir face aux catastrophes imminentes
dans ses pièces : dans Roméo & Juliette, alors que les Montague et les Capulets sont à couteaux tirés depuis
des générations, il faudra que leur haine mutuelle cause la mort de deux martyrs (Tybalt et Mercutio) pour
que le prince ne se décide à intervenir poussé par la culpabilité, en bannissant Roméo (ce qui s’avérera
encore plus désastreux).
Et dans Le Marchand de Venise, c’est à la cour du doge et en présence du doge lui-
même que Shylock refuse l'offre de Bassanio - qui lui propose de lui rembourser 6 000 ducats (le double de
la somme empruntée) en échange de la dette d’Antonio - et exige sa livre de chair.
Antonio ne devra qu’à
l’intervention salvatrice de Portia de ne pas être atrocement mutilé devant toute la Cour.
En des temps où le fait religieux est indissociable du politique et où le pouvoir se drape de sacralité,
William Shakespeare s’applique méthodiquement à briser cette image de « droit-divin » et révèle à son.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dictionnaire philosophique PORTATIF. Ouvrage de François Marie Arouet, dit Voltaire (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- DE L’ESPRIT. Traité philosophique de Claude Adrien Helvétius (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- les contemplations d'Hugo (résumé et analyse de l'oeuvre)
- Analyse de texte - Aristote, Métaphysique: l'étonnement philosophique
- VOLEUR (le). Roman de Georges Darien (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)