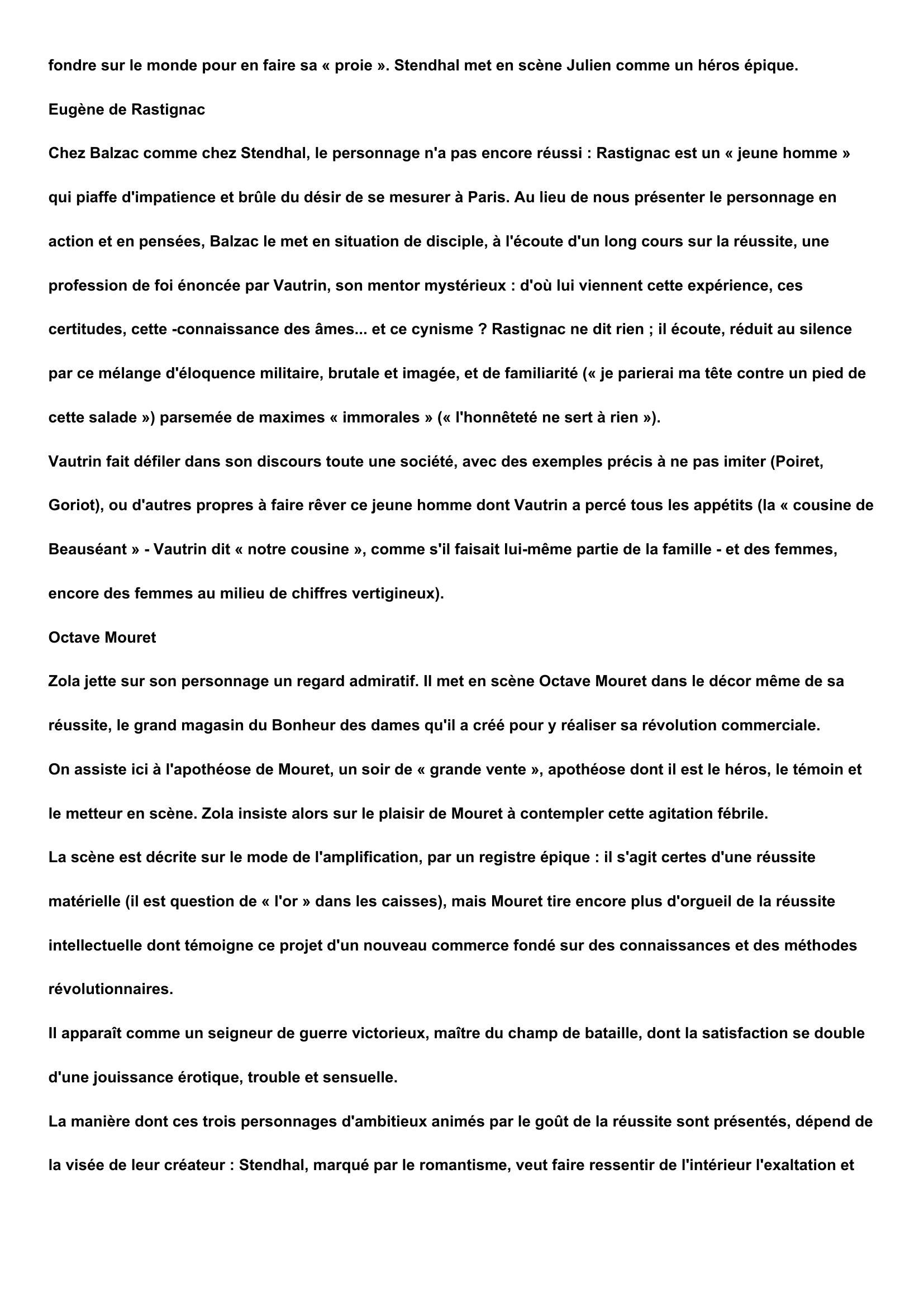balzac et zola et julien sorel
Publié le 04/11/2013

Extrait du document
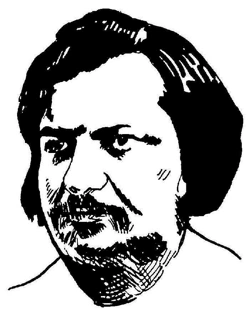
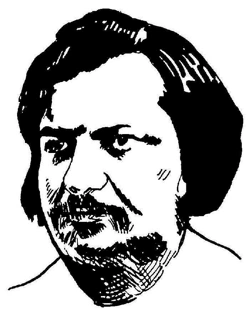
«
fondre sur le monde pour en faire sa « proie ».
Stendhal met en scène Julien comme un héros épique.
Eugène de Rastignac
Chez Balzac comme chez Stendhal, le personnage n'a pas encore réussi : Rastignac est un « jeune homme »
qui piaffe d'impatience et brûle du désir de se mesurer à Paris.
Au lieu de nous présenter le personnage en
action et en pensées, Balzac le met en situation de disciple, à l'écoute d'un long cours sur la réussite, une
profession de foi énoncée par Vautrin, son mentor mystérieux : d'où lui viennent cette expérience, ces
certitudes, cette connaissance des âmes...
et ce cynisme ? Rastignac ne dit rien ; il écoute, réduit au silence
par ce mélange d'éloquence militaire, brutale et imagée, et de familiarité (« je parierai ma tête contre un pied de
cette salade ») parsemée de maximes « immorales » (« l'honnêteté ne sert à rien »).
Vautrin fait défiler dans son discours toute une société, avec des exemples précis à ne pas imiter (Poiret,
Goriot), ou d'autres propres à faire rêver ce jeune homme dont Vautrin a percé tous les appétits (la « cousine de
Beauséant » - Vautrin dit « notre cousine », comme s'il faisait lui-même partie de la famille - et des femmes,
encore des femmes au milieu de chiffres vertigineux).
Octave Mouret
Zola jette sur son personnage un regard admiratif.
Il met en scène Octave Mouret dans le décor même de sa
réussite, le grand magasin du Bonheur des dames qu'il a créé pour y réaliser sa révolution commerciale.
On assiste ici à l'apothéose de Mouret, un soir de « grande vente », apothéose dont il est le héros, le témoin et
le metteur en scène.
Zola insiste alors sur le plaisir de Mouret à contempler cette agitation fébrile.
La scène est décrite sur le mode de l'amplification, par un registre épique : il s'agit certes d'une réussite
matérielle (il est question de « l'or » dans les caisses), mais Mouret tire encore plus d'orgueil de la réussite
intellectuelle dont témoigne ce projet d'un nouveau commerce fondé sur des connaissances et des méthodes
révolutionnaires.
Il apparaît comme un seigneur de guerre victorieux, maître du champ de bataille, dont la satisfaction se double
d'une jouissance érotique, trouble et sensuelle.
La manière dont ces trois personnages d'ambitieux animés par le goût de la réussite sont présentés, dépend de
la visée de leur créateur : Stendhal, marqué par le romantisme, veut faire ressentir de l'intérieur l'exaltation et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Rouge et le noir Sainte Beuve « Julien Sorel n’est qu’un petit monstre odieux »
- Le personnage de SOREL Julien de Stendhal
- le portrait de Julien Sorel
- Commentaire composé Julien Sorel
- Commentaire composé En quoi la singularité du personnage de Julien Sorel annonce-t-elle un parcours hors normes ? (Introduction et premier axe)