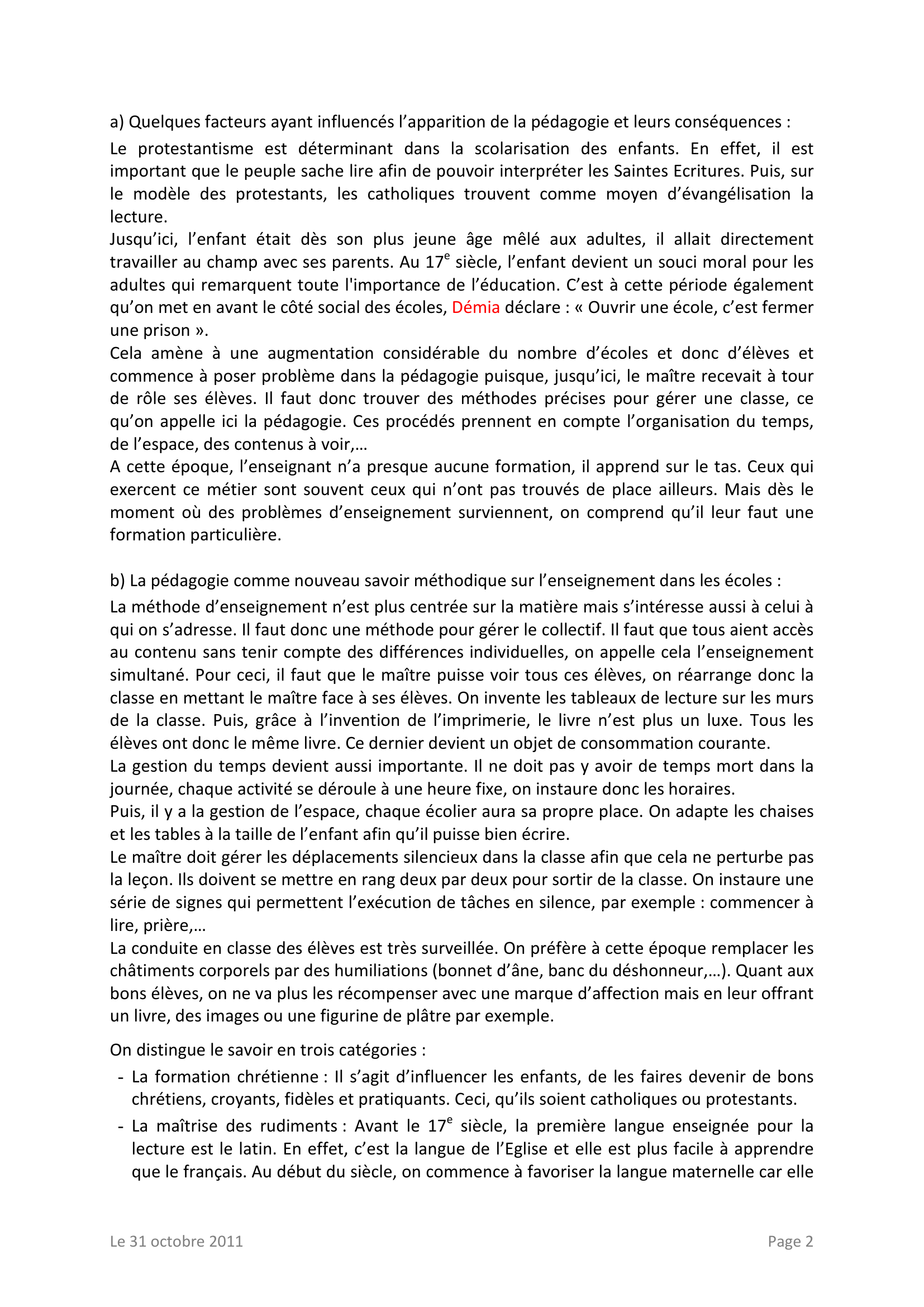Bohémiens en voyage Baudelaire commentaire
Publié le 25/09/2012

Extrait du document


«
Le 31 octobre 2011 Page 2
a) Quelques f acteurs ayant infl uencés l’apparition de la pédagogie et leurs conséquences :
Le protestantisme est déterminant dans la scolarisation des enfants.
En effet, il est
important que le peuple sache lire afin de pouvoir interpréter les Saintes Ecritures.
Puis , sur
le modèle des protestants, les catholiques trouvent comme moyen d’évangélisation la
lecture.
Jusqu’ici, l’enfant était dès son plus jeune âge mêlé aux adultes, il allait directement
travailler au champ avec ses parents.
Au 17
e siècle , l’enfant devient un souci moral po ur les
adultes qui remarquent toute l'importance de l’éducation.
C’est à cette période également
qu’on met en avant le côté social des écoles, Démia déclare : « Ouvrir une éc ole, c’est fermer
une prison ».
Cela amène à une augmentation considérable du nomb re d’écoles et donc d’élèves et
commence à poser problème dans la pédagogie puisque , jusqu’ici, le maître recevait à tour
de rôle ses élèves.
Il faut donc trouver des méthodes précises pour gérer une classe , ce
qu’on appelle ici la pédagogie.
Ces procédés prennent en compte l’organisation du temps,
de l’espace, des contenus à voir, …
A cette époque , l’enseignant n’a presque aucune formation, il apprend sur le tas.
Ceux qui
exercent ce métier sont souvent ceux qui n’ont pas trouvés de place ailleurs.
Mais dès le
moment où des problèmes d’enseignement surviennent, on comprend qu’il leur faut une
formation particulière.
b) La pédagogie comme nouveau savoir méthodique sur l’enseignement dans les écoles :
La méthode d’enseignement n’est plus centrée sur la matiè re mais s’intéresse aussi à celui à
qui on s’adresse.
Il faut donc une méthode pour gérer le collectif.
Il faut que tous aient accès
au contenu sans tenir compte des différences individuelles, on appelle cela l’enseignement
simultané.
Pour ce ci, il faut qu e le maître puisse voir tous ces élèves, on réarrange donc la
classe en mettant le maître face à ses élèves.
On invente les tableaux de lecture sur les murs
de la classe.
Puis , grâce à l’invention de l’imprimerie, le livre n’est plus un luxe.
Tous les
élèv es ont donc le même livre.
Ce dernier devient un objet de consommation courante.
La gestion du temps devient aussi importante.
Il ne doit pas y avoir de temps mort dans la
journée, chaque activité se déroule à une heure fixe, on instaure donc les horaires.
Puis , il y a la gestion de l’espace, chaque écolier aura sa propre place.
On adapte les chaises
et les tables à la taille de l’enfant afin qu’il puisse bien écrire.
Le maître doit gérer les déplacements silencieux dans la classe afin que cela ne perturbe pas
la leçon.
Ils doivent se mettre en rang deux par deux pour sortir de la classe.
On instaure une
série de signes qui permettent l’exécution de tâches en silence , par exemp le : commencer à
lire, prière,…
La conduite en classe des élèves est très surveill ée.
On préfère à cette époque remplacer les
châtiments corporels par des humiliations (bonnet d’âne, banc du déshonneur ,…).
Quan t aux
bons élèves, on ne va plus les récompenser avec une marque d’affection mais en leur offrant
un livre, des images ou une figurine de plâtre par exemple.
On distingue le savoir en trois catégories :
- La formation chrétienne : Il s’agit d’influencer les enfants, de les faires devenir de bons
chrétiens, croyants, fidèles et pratiquants.
Ceci, qu’ils soient catholiques ou protes tants.
- La maîtrise des rudiments : Avant le 17 e siècle, la première langue enseignée pour la
lecture est le latin.
En effet, c’est la langue de l’Eglise et elle est plus facile à apprendre
que le français.
Au début du siècle, on commence à favoriser la langue maternelle car e lle.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire rédigé de "L'invitation au voyage" de Charles Baudelaire
- L'invitation au voyage, Charles BAUDELAIRE ( commentaire ) .
- Charles BAUDELAIRE (1821-1867). « Bohémiens en voyage ». (Les Fleurs du mal)
- Baudelaire, commentaire composé sur L'invitation au Voyage
- Commentaire : « L'invitation au voyage » de Baudelaire.