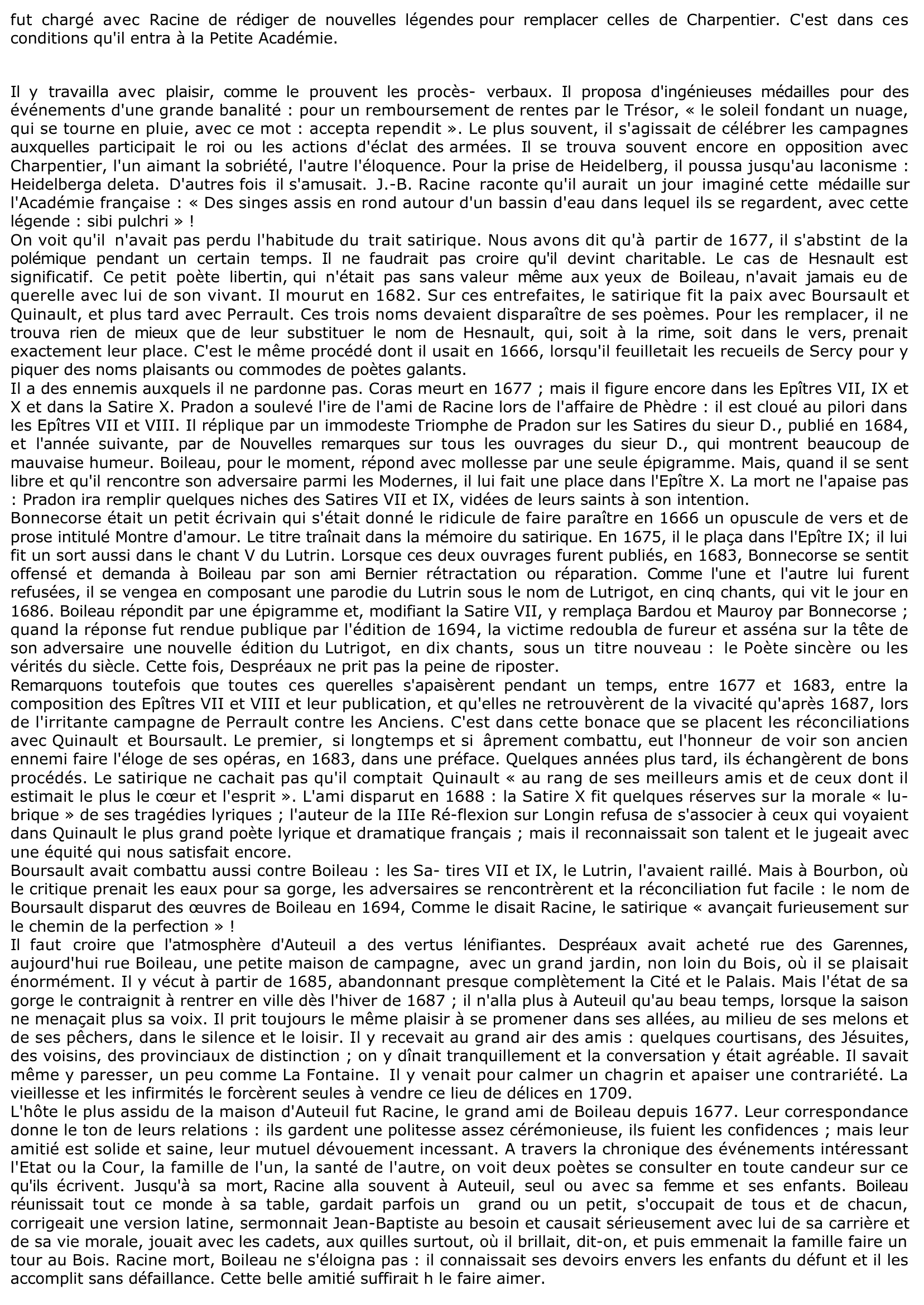BOILEAU: LE VIEIL HOMME
Publié le 27/06/2011

Extrait du document

Les historiens ont brossé un tableau flatteur de la vieillesse de Boileau. Ils montrent le critique entouré d'honneurs, admiré du public, doyen vénéré d'un corps d'élèves-poètes. Pascal, Corneille et Molière ont disparu ; La Rochefoucauld n'écrit plus, Racine s'est retiré du théâtre ; La Fontaine faiblit littérairement et moralement. Seul, Despréaux reste actif et grandit : loué par Bouhours et Ménage, classique déjà dans les collèges, il voit son Ode traduite en latin par un personnage comme Rollin ; ses adversaires ne comptent pas, un Carel de Sainte- Garde, un Pradon, un Bonnecorse ! Il entre vivant au Panthéon des lettres.

«
fut chargé avec Racine de rédiger de nouvelles légendes pour remplacer celles de Charpentier.
C'est dans cesconditions qu'il entra à la Petite Académie.
Il y travailla avec plaisir, comme le prouvent les procès- verbaux.
Il proposa d'ingénieuses médailles pour desévénements d'une grande banalité : pour un remboursement de rentes par le Trésor, « le soleil fondant un nuage,qui se tourne en pluie, avec ce mot : accepta rependit ».
Le plus souvent, il s'agissait de célébrer les campagnesauxquelles participait le roi ou les actions d'éclat des armées.
Il se trouva souvent encore en opposition avecCharpentier, l'un aimant la sobriété, l'autre l'éloquence.
Pour la prise de Heidelberg, il poussa jusqu'au laconisme :Heidelberga deleta.
D'autres fois il s'amusait.
J.-B.
Racine raconte qu'il aurait un jour imaginé cette médaille surl'Académie française : « Des singes assis en rond autour d'un bassin d'eau dans lequel ils se regardent, avec cettelégende : sibi pulchri » ! On voit qu'il n'avait pas perdu l'habitude du trait satirique.
Nous avons dit qu'à partir de 1677, il s'abstint de lapolémique pendant un certain temps.
Il ne faudrait pas croire qu'il devint charitable.
Le cas de Hesnault estsignificatif.
Ce petit poète libertin, qui n'était pas sans valeur même aux yeux de Boileau, n'avait jamais eu dequerelle avec lui de son vivant.
Il mourut en 1682.
Sur ces entrefaites, le satirique fit la paix avec Boursault etQuinault, et plus tard avec Perrault.
Ces trois noms devaient disparaître de ses poèmes.
Pour les remplacer, il netrouva rien de mieux que de leur substituer le nom de Hesnault, qui, soit à la rime, soit dans le vers, prenaitexactement leur place.
C'est le même procédé dont il usait en 1666, lorsqu'il feuilletait les recueils de Sercy pour ypiquer des noms plaisants ou commodes de poètes galants.Il a des ennemis auxquels il ne pardonne pas.
Coras meurt en 1677 ; mais il figure encore dans les Epîtres VII, IX etX et dans la Satire X.
Pradon a soulevé l'ire de l'ami de Racine lors de l'affaire de Phèdre : il est cloué au pilori dansles Epîtres VII et VIII.
Il réplique par un immodeste Triomphe de Pradon sur les Satires du sieur D., publié en 1684,et l'année suivante, par de Nouvelles remarques sur tous les ouvrages du sieur D., qui montrent beaucoup demauvaise humeur.
Boileau, pour le moment, répond avec mollesse par une seule épigramme.
Mais, quand il se sentlibre et qu'il rencontre son adversaire parmi les Modernes, il lui fait une place dans l'Epître X.
La mort ne l'apaise pas: Pradon ira remplir quelques niches des Satires VII et IX, vidées de leurs saints à son intention.Bonnecorse était un petit écrivain qui s'était donné le ridicule de faire paraître en 1666 un opuscule de vers et deprose intitulé Montre d'amour.
Le titre traînait dans la mémoire du satirique.
En 1675, il le plaça dans l'Epître IX; il luifit un sort aussi dans le chant V du Lutrin.
Lorsque ces deux ouvrages furent publiés, en 1683, Bonnecorse se sentitoffensé et demanda à Boileau par son ami Bernier rétractation ou réparation.
Comme l'une et l'autre lui furentrefusées, il se vengea en composant une parodie du Lutrin sous le nom de Lutrigot, en cinq chants, qui vit le jour en1686.
Boileau répondit par une épigramme et, modifiant la Satire VII, y remplaça Bardou et Mauroy par Bonnecorse ;quand la réponse fut rendue publique par l'édition de 1694, la victime redoubla de fureur et asséna sur la tête deson adversaire une nouvelle édition du Lutrigot, en dix chants, sous un titre nouveau : le Poète sincère ou lesvérités du siècle.
Cette fois, Despréaux ne prit pas la peine de riposter.Remarquons toutefois que toutes ces querelles s'apaisèrent pendant un temps, entre 1677 et 1683, entre lacomposition des Epîtres VII et VIII et leur publication, et qu'elles ne retrouvèrent de la vivacité qu'après 1687, lorsde l'irritante campagne de Perrault contre les Anciens.
C'est dans cette bonace que se placent les réconciliationsavec Quinault et Boursault.
Le premier, si longtemps et si âprement combattu, eut l'honneur de voir son ancienennemi faire l'éloge de ses opéras, en 1683, dans une préface.
Quelques années plus tard, ils échangèrent de bonsprocédés.
Le satirique ne cachait pas qu'il comptait Quinault « au rang de ses meilleurs amis et de ceux dont ilestimait le plus le cœur et l'esprit ».
L'ami disparut en 1688 : la Satire X fit quelques réserves sur la morale « lu-brique » de ses tragédies lyriques ; l'auteur de la IIIe Ré-flexion sur Longin refusa de s'associer à ceux qui voyaientdans Quinault le plus grand poète lyrique et dramatique français ; mais il reconnaissait son talent et le jugeait avecune équité qui nous satisfait encore.Boursault avait combattu aussi contre Boileau : les Sa- tires VII et IX, le Lutrin, l'avaient raillé.
Mais à Bourbon, oùle critique prenait les eaux pour sa gorge, les adversaires se rencontrèrent et la réconciliation fut facile : le nom deBoursault disparut des œuvres de Boileau en 1694, Comme le disait Racine, le satirique « avançait furieusement surle chemin de la perfection » !Il faut croire que l'atmosphère d'Auteuil a des vertus lénifiantes.
Despréaux avait acheté rue des Garennes,aujourd'hui rue Boileau, une petite maison de campagne, avec un grand jardin, non loin du Bois, où il se plaisaiténormément.
Il y vécut à partir de 1685, abandonnant presque complètement la Cité et le Palais.
Mais l'état de sagorge le contraignit à rentrer en ville dès l'hiver de 1687 ; il n'alla plus à Auteuil qu'au beau temps, lorsque la saisonne menaçait plus sa voix.
Il prit toujours le même plaisir à se promener dans ses allées, au milieu de ses melons etde ses pêchers, dans le silence et le loisir.
Il y recevait au grand air des amis : quelques courtisans, des Jésuites,des voisins, des provinciaux de distinction ; on y dînait tranquillement et la conversation y était agréable.
Il savaitmême y paresser, un peu comme La Fontaine.
Il y venait pour calmer un chagrin et apaiser une contrariété.
Lavieillesse et les infirmités le forcèrent seules à vendre ce lieu de délices en 1709.L'hôte le plus assidu de la maison d'Auteuil fut Racine, le grand ami de Boileau depuis 1677.
Leur correspondancedonne le ton de leurs relations : ils gardent une politesse assez cérémonieuse, ils fuient les confidences ; mais leuramitié est solide et saine, leur mutuel dévouement incessant.
A travers la chronique des événements intéressantl'Etat ou la Cour, la famille de l'un, la santé de l'autre, on voit deux poètes se consulter en toute candeur sur cequ'ils écrivent.
Jusqu'à sa mort, Racine alla souvent à Auteuil, seul ou avec sa femme et ses enfants.
Boileauréunissait tout ce monde à sa table, gardait parfois un grand ou un petit, s'occupait de tous et de chacun,corrigeait une version latine, sermonnait Jean-Baptiste au besoin et causait sérieusement avec lui de sa carrière etde sa vie morale, jouait avec les cadets, aux quilles surtout, où il brillait, dit-on, et puis emmenait la famille faire untour au Bois.
Racine mort, Boileau ne s'éloigna pas : il connaissait ses devoirs envers les enfants du défunt et il lesaccomplit sans défaillance.
Cette belle amitié suffirait h le faire aimer..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VIEIL HOMME (Le ).
- VIEIL HOMME ET LA MER (Le) [The Old Man and the Sea]. (résumé) Ernest Hemingway
- La Legende des Siecles Le soir, l'homme qui met de l'huile dans les lampes A son heure ordinaire en descendit les rampes; Là, mangé par les vers dans l'ombre de la mort, Chaque marquis auprès de sa marquise dort, Sans voir cette clarté qu'un vieil esclave apporte.
- Le vieil homme et la mer (extrait) Ernest Hemingway Quand il entra dans le petit port, les lumières de la Terrasse étaient éteintes et il comprit que tout le monde était couché.
- le vieil homme et la mer