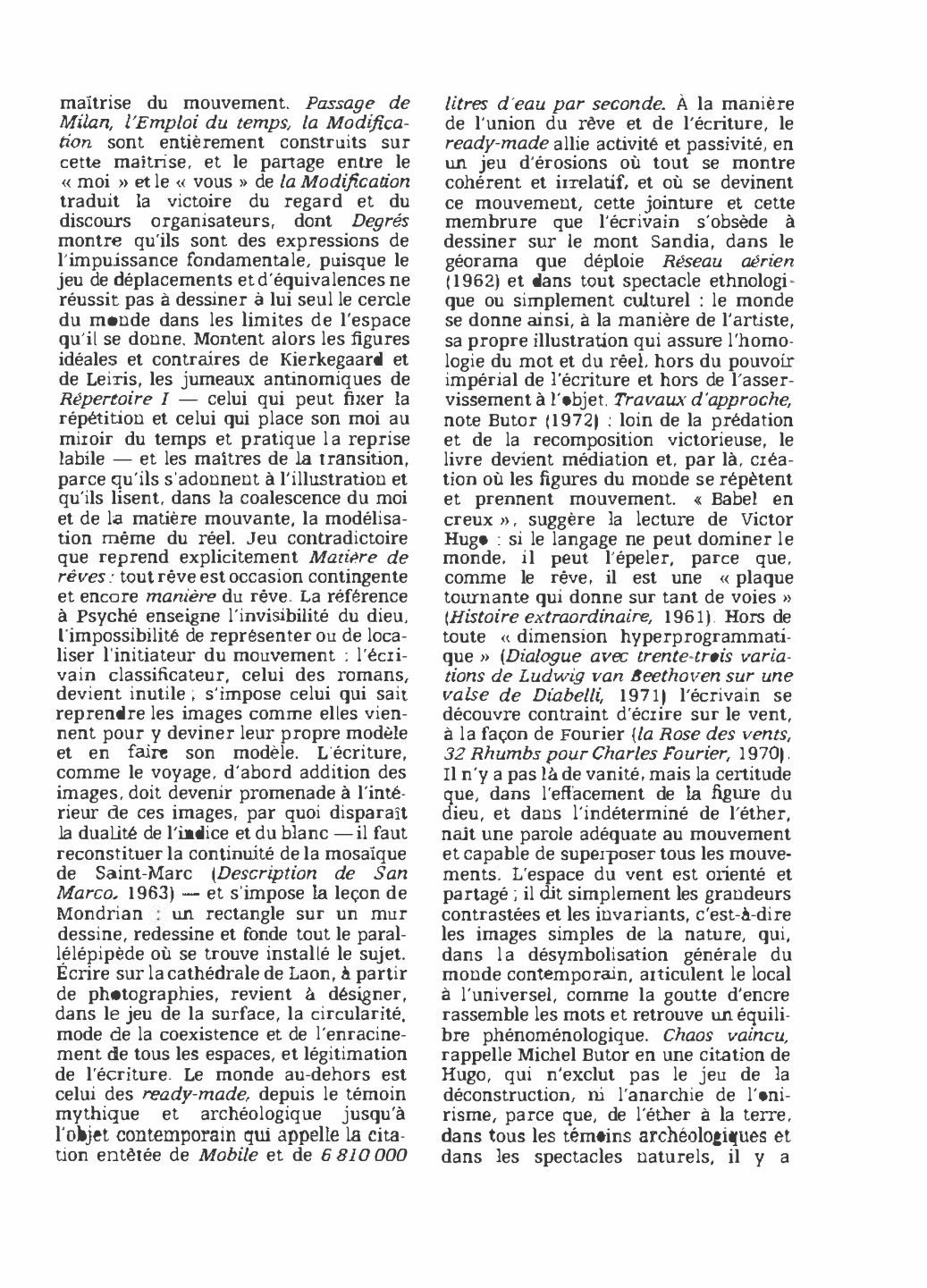BUTOR (Michel)
Publié le 18/02/2019

Extrait du document
BUTOR (Michel), écrivain français {Mons-en-Barœul 1926). «Pour moi, voyager c'est écrire et écrire c'est voyager >> : aveu de Butor est une des clés de son œuvre. Voyages à travers le monde et voyages dans l'écriture, parcours géographique et tracé graphique s'entremêlent constamment, tout langage étant lui-même un déplacement des « lignes». Chez lui, une structuration temporelle de l'espace croise une struc turation spatiale du temps. Son œuvre narrative se présente ainsi comme un traité de la transition — ainsi que l'attestent les titres des romans (Passage de Milan, 1954 ; l'Emploi du temps, 1956; la Modification, 1957; Degrés, 1960) et d'un scénario (Inttervalle, 1973) — qui a pour corollaire une méditation sur les site s (le Génie du lieu, 1958 ; Où, 1971 ; Boomerang, 1978). Entre ces deux pôles, recherche inlassable du passage et rappel de la pérennité des lieux, l'écrivain s'attache à composer les images de la vacance et de la mobilité maîtrisées (Mobile, 1962 ; Réseau aérien, 1962; 6 810 000 litres d'eau par seconde, 1965 ; la Rose des vents, 1970) : par le biais d'un encyclopédisme foisonnant, il défie cette réalité qui rend tout compte rendu impossible et toute structure insuffisante. Un double mouvement d'extraversion (Illustrations, 1964-1973) et d'introversion (Matière de rêves, 1975-1985) reporte sur l'être même de l'écrivain, considéré à la fois dans son face-à-face avec le réel et dans l'étendue de ses jeux fantasmatiques, les ambiguïtés d'une systématique initiale de la représentation, qui hésite entre l'herméneutique et la recension de l'ensemble du visible. Envois (1980), sorte de jour-nal intime, joue ainsi l'ubiquité du sujet contre la totalité donnée : les images de la vie personnelle, qui sont aussi les images du monde, attestent que le moi a été capable de voir en tout lieu et qu'il lui appartient seulement de présenter ce voir. L'écriture trouve sa nécessité dans l'exercice du << répertoire », exploration fragmentée à travers les lieux et le temps, saisis non plus comme des repères stables, mais comme des résidus de l'histoire de l'homme et de l'écrivain, livré au parcours maniériste du témoignage et des mots-blasons épars (Répertoire, I.V, 1960-1982) : un livres est toujours un << essai » (Essais sur les \"Essais\", 1968), tentative et épreuve, effort et relevé de l'expérience: L'ahan don de la pratique romanesque marque donc moins une réforme de l'imaginaire de Butor qu'une reprise des données initiales de son projet créateur suivant une logque qui évite désormais toute définition « totalitaire » des pouvoirs de l'écrivain (Portrait de l'artiste en jeune singe, 1967), car le monde est «autographe >> : toute chose avoue d'elle-même le trait qui la caractérise et se crée (ou se recrée) par cet aveu (Paysages de répons, 1968). Le rêve de soi qu'entretient l'écrivain fait, de la même manière, du monde personnel un monde autographe où, à travers les références oniriques et les fragments mythiques, l'écriture prend consistance et sens. Mais ce sens est instable et objet de toutes les falsifications : l'énigme du réel n'est pas tant énigme dans le réel que lacune dans l'instantané. Les romans procèdent ainsi d'une visée anaclastique (plier, replier, refléter, imager. reprendre, organiser) qui, sans doute, abolit le mensonge des reflets et des fausses ombres. mais maintient l'écrivain «hors image», puisqu'il se donne la maîtrise du mouvement. Passage de Milan, l'Emploi du temps, la Modification sont entièrement construits sur cette maîtrise, et le partage entre le « moi » et le « vous » de la Modification traduit la victoire du regard et du discours organisateurs, dont Degrés montre qu'ils sont des expressions de l'impuissance fondamentale, puisque le jeu de déplacements et d'équivalences ne réussit pas à dessiner à lui seul le cercle du monde dans les limites de l'espace qu'il se donne. Montent alors les figures idéales et contraires de Kierkegaard et de Leiris, les jumeaux antinomiques de Répertoire I — celui qui peut fixer la répétition et celui qui place son moi au miroir du temps et pratique la reprise labile — et les maîtres de la transition, parce qu'ils s'adonnent à l'illustration et qu'ils lisent, dans la coalescence du moi et de la matière mouvante, la modélisation même du réel. Jeu contradictoire que reprend explicitement Matière de rêves : tout rêve est occasion contingente et encore manière du rêve. La référence à Psyché enseigne l'invisibilité du dieu, l'impossibilité de représenter ou de localiser l'initiateur du mouvement : l'écrivain classificateur, celui des romans, devient inutile ; s'impose celui qui sait reprendre les images comme elles viennent pour y deviner leur propre modèle et en faire son modèle. L'écriture, comme le voyage, d'abord addition des images, doit devenir promenade à l'intérieur de ces images, par quoi disparaît la dualité de l'indice et du blanc — il faut reconstituer la continuité de la mosaïque de Saint-Marc (Description de San Marco, 1963} — et s'impose la leçon de Mondrian un rectangle sur un mur dessine, redessine et fonde tout le parallélépipède où se trouve installé le sujet. Écrire sur la cathédrale de Laon, à partir de photographies, revient à désigner, dans le jeu de la surface, la circularité, mode de la coexistence et de l'enracinement de tous les espaces, et légitimation de l'écriture. Le monde au-dehors est celui des ready-made, depuis le témoin mythique et archéologique jusqu'à l'objet contemporain qui appelle la citation entêtée de Mobile et de 6 810 000 litres d'eau par seconde. À la manière de l'union du rêve et de l'écriture, le ready-made allie activité et passivité, en un jeu d'érosions où tout se montre cohérent et irrelatif, et où se devinent ce mouvement, cette jointure et cette membrure que l'écrivain s'obsède à dessiner sur le mont Sandia, dans le géorama que déploie Réseau aérien ( 1962} et dans tout spectacle ethnologique ou simplement culturel : le monde se donne ainsi, à la manière de l'artiste, sa propre illustration qui assure l'homologie du mot et du rêel, hors du pouvoir impérial de l'écriture et hors de l'asservissement à l'objet. Travaux d'approche, note Butor ( 1972) : loin de la prédation et de la recomposition victorieuse, le livre devient médiation et, par là, création où les figures du monde se répètent et prennent mouvement. \"Babel en creux\", suggère la lecture de Victor Hugo : si le langage ne peut dominer le monde, il peut l'épeler, parce que, comme le rêve. il est une «plaque tournante qui donne sur tant de voies >> Histoire extraordinaire, 1961}. Hors de toute « dimension hyperprogrammati-que >> (Dialogue avec trente-trois variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Dabelli, 1971) l'écrivain se découvre contraint d'écrire sur le vent, à la façon de Fourier (la Rose des vents, 32 Rhumbs pour Charles Fourier, 1970). Il n'y a pas là de vanité, mais la certitude que, dans l'efacement de la fifigur'e du dieu, et dans l'indéterminé de l'éther, naît une parole adéquate au mouvement et capable de superposer tous les mouvements. L'espace du vent est orienté et partagé ; il dit simplement les grandeurs contrastées et les invariants, c'est-à-dire les images simples de la nature, qui, dans la désymbolisation générale du monde contemporan, articulent le local à l'universel, comme la goutte d'encre rassemble les mots et retrouve un équilibre phénoménologique. Chaos vaincu, rappelle Michel Butor en une citation de Hugo, qui n'exclut pas le jeu de la déconstruction, ni l'anarchie de l'onirisme, parce que, de l'éther à la terre, dans tous les témoins archéologiques et dans les spectacles naturels, il y a
«
maîtrise
du mouvement.
Passage de
Miltm, l'Emploi du temps, la Modifica
tion sont entièrement construits sur
cette maîtrise, et le partage entre le
« moi » et le « vous >> de la Modification
traduit la victoire du regard et du
discours organisateurs, dont Degrés
montre qu'ils sont des expressions de
l'impuissance fondamentale, puisque le
jeu de déplacements et d'équivalences ne
réussit pas à dessiner à lui seul le cercle
du monde dans les limites de l'espace
qu'il se donne.
Montent alors les figures
idéales et contraires de Kierkegaard et
de Leiris, les jumeaux antinomiques de
Répertoire I - celui qui peut fixer la
répétition et celui qui place son moi au
miroir du temps et pratique la reprise
labile -et les maîtres de la transition,
parce qu'ils s'adonnent à l'illustration et
qu'ils lisent, dans la coalescence du moi
et de la matière mouvante, la modélisa
tion même du réel.
Jeu contradictoire
que reprend explicitement Matière de
rêves : tout rêve est occasion contingente
et encore manière du rêve.
La référence
à Psyché enseigne l'invisibilité du dieu,
l'impossibilité de représenter ou de loca
liser l'initiateur du mouvement : l'écri
vain classificateur, celui des romans,
devient inutile ; s'impose celui qui sait
reprendre les images comme elles vien
nent pour y deviner leur propre modèle
et en faire son modèle.
L'écriture,
comme le voyage, d'abord addition des
images, doit devenir promenade à l'inté
rieur de ces images, par quoi disparaît
la duahté de l'indice et du blanc -il faut
reconstituer la continuité de la mosaîque
de Saint-Marc (Description de San
Marco, 1963}-et s'impose la leçon de
Mondrian un rectangle sur un mur
dessine, redessine et fonde tout le paral
lélépipède où se trouve installé le sujet.
Écrire sur la cathédrale de Laon, à partir
de photographies, revient à désigner,
dans le jeu de la surface, la circularité,
mode de la coexistence et de 1 'enracine
ment de tous les espaces, et légitimation
de l'écriture.
Le monde au-dehors est
celui des ready-made, depuis le témoin
mythique et archéologique jusqu'à
l'objet contemporain qui appelle la cita
tion entêtée de Mobile et de 6 810 ooo litres
d'eau par seconde.
À la manière
de l'union du rêve et de l'écriture, le
ready-made allie activité et passivité, en
un jeu d'érosions où tout se montre
cohérent et irrelatif, et où se devinent
ce mouvement, cette jointure et cette
membrure que l'écrivain s'obsède à
dessiner sur le mont Sandia, dans le
géorama que déploie Réseau aérien
( 1962} et dans tout spectacle ethnologi
que ou simplement culturel : le monde
se donne ainsi, à la manière de l'artiste,
sa propre illustration qui assure l'homo
logie du mot et du rêel, hors du pouvoir
impérial de l'écriture et hors de l'asser
vissement à l'objet.
Travaux d'approche,
note Butor ( 1972) : loin de la prédation
et de la recomposition victorieuse, le
livre devient médiation et, par là, créa
tion où les figures du monde se répètent
et prennent mouvement.
>, suggère la lecture de Victor
Hugo : si le langage ne peut dominer le
monde, il peut l'épeler, parce que,
comme le rêve.
il est une «plaque
tournante qui donne sur tant de voies >>
(Histoire extraordinaire, 1961}.
Hors de
toute « dimension hyperprogrammati
que >> (Dialogue avec trente-trois varia
tions de Ludwig van Beethoven sur une
valse de Diabelli, 1971) l'écrivain se
découvre contraint d'écrire sur le vent,
à la façon de Fourier (la Rose des vents,
32 Rhumbs pour Charles Fourier, 1970) .
Il n'y a pas là de vanité, mais la certitude
que, dans l'effacement de la figure du
dieu, et dans l'indéterminé de l'éther,
naît une parole adéquate au mouvement
et capable de superposer tous les mouve
ments.
L'espace du vent est orienté et
partagé ; il dit simplement les grandeurs
contrastées et les invariants, c'est-à-dire
les images simples de la nature, qui,
dans la désymbolisation générale du
monde contemporain, articulent le local
à l'universel, comme la goutte d'encre
rassemble les mots et retrouve un équili
bre phénoménologique.
Chaos vaincu,
rappelle Michel Butor en une citation de
Hugo, qui n'exclut pas le jeu de la
déconstruction, ni l'anarchie de l'oni
risme, parce que, de l'éther à la terre,
dans tous les témoins archéologiques et
dans les spectacles naturels, il y a.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EMPLOI DU TEMPS (L') de Michel Butor (résumé & analyse)
- MODIFICATION (la), de Michel Butor
- DEGRÉS de Michel Butor
- Emploi DU TEMPS (l') de Michel Butor
- MODIFICATION (La) de Michel Butor (résumé)