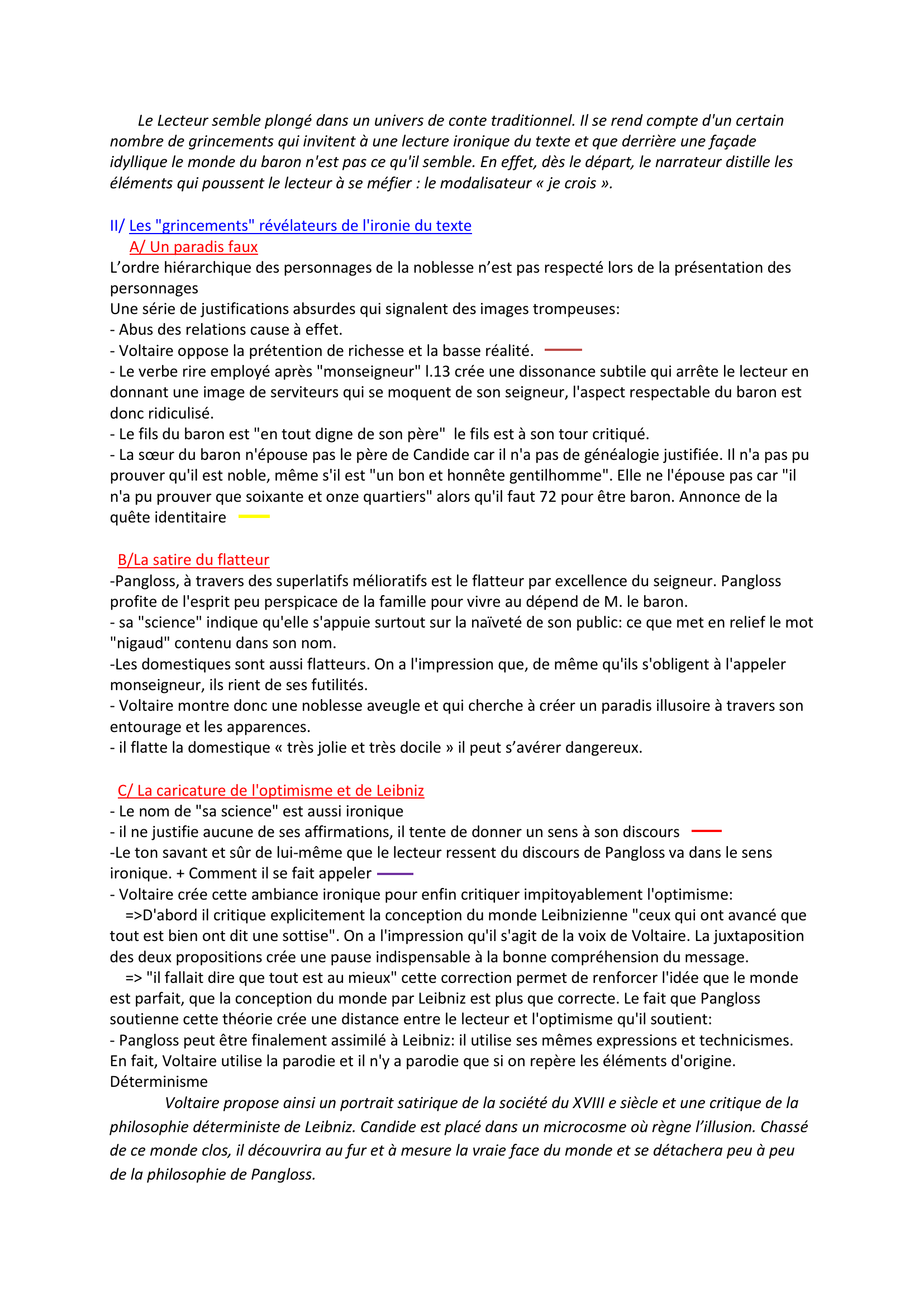Candide, Voltaire, chapitre 1 (commentaire)
Publié le 18/06/2012
Extrait du document

Au XVIIIe siècle, la France et l’Europe sont inscrites dans une perspective de changement. En effet, l’association de la montée des contestations et de la volonté d’amélioration de la condition humaine amène à l’apparition d’une pensée philosophique : les Lumières. Les philosophes entendent éclairer le peuple et le sortir de l’obscurantisme, en d’autres termes, ils s’engagent à répandre le savoir et favoriser l’exercice de la raison contre les ténèbres de l’ignorance et du despotisme. E. Kant résume leur projet en une expression qu’il emprunte à Horace : « sapere aude ! « qui signifie « ose connaitre ! «. Aussi, le conte philosophique connait son épanouissement à cette époque. Il s’inscrit dans la longue tradition du conte dont il constitue un avatar moderne. Ainsi, il est basé sur une histoire fictive, s’inspirant de la structure d’un conte traditionnel afin de transmettre des idées à concept philosophique. Voltaire écrit Candide, conte philosophique, dans lequel il dénonce sans relâche les injustices, les inégalités et l’intolérance de la société du XVIIIe siècle. L’extrait que nous étudierons constitue l’incipit du conte, annonçant la quête identitaire de Candide, personnage éponyme.

«
Le Lecteur semble plongé dans un univers de conte traditionnel.
Il se rend compte d'un certain
nombre de grincements qui invitent à une lecture ironique du text e et que derrière une façade
idy llique le monde du baron n'est pas ce qu'il semble.
En effet, dès le départ, le narrateur distille les
éléments qui poussent le lecteur à se méfier : le modalisateur « je crois ».
II/ Les "grincements" révélateurs de l'ironie du texte
A / Un parad is faux
L’ordre hiérarchique des personnages de la noblesse n’est pas respecté lors de la présentation des
personnages
Une série de justifications absurdes qui signalent des images trompeuses:
- Abus des relations cause à effet.
- Voltaire oppose la prétention de richesse et la basse réalité .
- Le verbe rire employé après "monseigneur" l.13 crée une dissonance subtile qui arrête le lecteur en
donnant une image de serviteurs qui se moquent de son seigneur, l'aspect respectable du baron est
donc ridicul isé.
- Le fils du baron est "en tout digne de son père" le fils est à son tour critiqué.
- La sœur du baron n'épouse pas le père de Candide car il n'a pas de généalogie justifiée.
Il n'a pas pu
prouver qu'il est noble, même s'il est "un bon et honnête gentilhomme".
Elle ne l'épouse pas car "il
n'a pu prouver que soixante et onze quartiers" alors qu'il faut 72 pour être baron.
Annonce de la
quê te identitaire
B /La satire du flatteur
-Pangloss, à travers des superlatifs mélioratifs est le flatteur par excellence du seigneur.
Pangloss
profite de l'esprit peu perspicace de la famille pour vivre au dépend de M.
le baron.
- sa "science" indique qu'ell e s'appuie surtout sur la naïveté de son public : ce que met en relief le mot
"nigaud" contenu dans son nom.
- Les domestiques sont aussi flatteurs .
On a l'impression que, de même qu'ils s'obligent à l'appeler
monseigneur, ils rient de ses futilités.
- Voltaire montre donc une noblesse aveugle et qui cherche à créer un paradis illusoire à travers son
entourage et les apparences .
- il flatte la domestique « très jolie et très docile » il peut s’avérer dangereux.
C/ La caricature de l'optimisme et de Leibniz
- Le nom de "sa science" est aussi ironique
- il ne justifie aucune de ses affirmations, il tente de donner un sens à son discours
- Le ton savant et sûr de lui -même que le lecteur ressent du discours de Pangloss va dans le sens
ironique.
+ Comment il se fait appeler
- Voltaire crée cette ambiance ironique pour enfin critiquer impitoyablement l'optimisme:
=>D'abord il critique explicitement la conception du monde Leibnizienne "ceux qui o nt avancé que
tout est bien ont dit une sottise".
On a l'impression qu'il s'agit de la voix de Voltaire.
La juxtaposition
des deux propositions crée une pause indispensable à la bonne compréhension du message.
=> "il fallait dire que tout est au mieux " cette correction permet de renforcer l'idée que le monde
est parfait , que la conception du monde par Leibniz est plus que correcte.
Le fait que Pangloss
soutienne cette théorie crée une distance entre le lecteur et l'optimisme qu'il soutient:
- Pangloss peut être finalement assimilé à Leibniz: il utilise ses mêmes expressions et technicismes.
En fait, Voltaire utilise la parodie et il n'y a parodie que si on repère les éléments d'origine.
Déterminisme
Voltaire propose ainsi un portrait satirique de la so ciété du XVIII e siècle et une critique de la
philosophie déterministe de Leibniz.
Candide est placé dans un microcosme où règne l’illusion.
Chassé
de ce monde clos, il découvrira au fur et à mesure la vraie face du monde et se détachera peu à peu
de la philosophie de Pangloss..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire (commentaire)
- Commentaire chapitre 3 de Candide de Voltaire
- Commentaire de Candide Voltaire chapitre 3
- Commentaire du chapitre 1 de Candide de Voltaire
- Commentaire littéraire de Candide de Voltaire, Chapitre 3