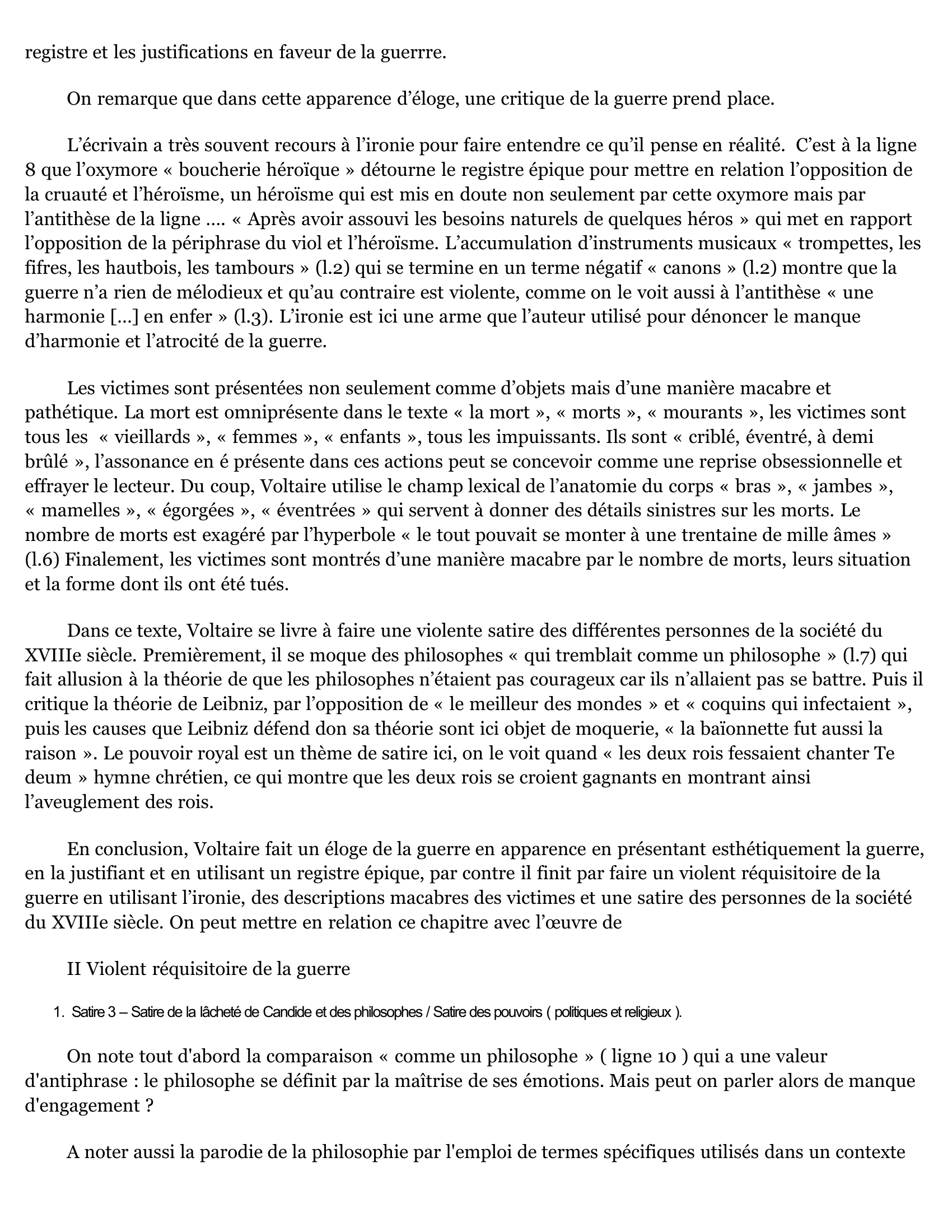Candide, Voltaire, Chapitre 3. Commentaire.
Publié le 29/09/2018

Extrait du document

qui en fait voir ironiquement le caractère inadapté et décalé : « meilleur des mondes » est prouvé par un carnage, « la raison suffisante » qui est le principe leibnizien, est employé de manière comique, « des effets et des causes » est associé à la baïonnette. ( Voltaire a toujours considéré la guerre comme l’incarnation de l’existence du mal sur terre ; Candide y est donc très vite confronté dès qu’il quitte la château ).
L’accent est mis sur l’individualité et non sur la communauté qui régit les pouvoirs en place : voir le pronom indéfini « chacun », le déterminant possessif « son ». Les rois n’œuvrent pas pour l’intérêt commun ni pour le bien du peuple. A noter aussi les approximations quant au nombre de victimes « à peu près », « environ ». Il n’y a pas de considération pour le peuple.
Enfin, la religion est au service de la guerre, qui cautionne, encourage les troupes, voir « Te Deum ». Ce sont des actions qui vont à l’encontre des préceptes religieux « aimer son prochain ».
En conclusion, Voltaire fait un éloge de la guerre en apparence en présentant esthétiquement la guerre, en la justifiant et en utilisant un registre épique, par contre il finit par faire un violent réquisitoire de la guerre en utilisant l’ironie, des descriptions macabres des victimes et une satire des personnes de la société du XVIIIe siècle. On peut mettre en relation ce chapitre avec l’œuvre de
II Violent réquisitoire de la guerre
1. Satire 3 - Satire de la lâcheté de Candide et des philosophes / Satire des pouvoirs ( politiques et religieux ).
On note tout d’abord la comparaison « comme un philosophe » ( ligne 10 ) qui a une valeur d’antiphrase : le philosophe se définit par la maîtrise de ses émotions. Mais peut on parler alors de manque d’engagement ?
A noter aussi la parodie de la philosophie par l’emploi de termes spécifiques utilisés dans un contexte

«
registre et les justifications en faveur de la guerrre.
On remarque que dans cette apparence d’éloge, une critique de la guerre prend place.
L’écrivain a très souvent recours à l’ironie pour faire entendre ce qu’il pense en réalité.
C’est à la ligne
8 que l’oxymore « boucherie héroïque » détourne le registre épique pour mettre en relation l’opposition de
la cruauté et l’héroïsme, un héroïsme qui est mis en doute non seulement par cette oxymore mais par
l’antithèse de la ligne ….
« Après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros » qui met en rapport
l’opposition de la périphrase du viol et l’héroïsme.
L’accumulation d’instruments musicaux « trompettes, les
fifres, les hautbois, les tambours » (l.2) qui se termine en un terme négatif « canons » (l.2) montre que la
guerre n’a rien de mélodieux et qu’au contraire est violente, comme on le voit aussi à l’antithèse « une
harmonie […] en enfer » (l.3).
L’ironie est ici une arme que l’auteur utilisé pour dénoncer le manque
d’harmonie et l’atrocité de la guerre.
Les victimes sont présentées non seulement comme d’objets mais d’une manière macabre et
pathétique.
La mort est omniprésente dans le texte « la mort », « morts », « mourants », les victimes sont
tous les « vieillards », « femmes », « enfants », tous les impuissants.
Ils sont « criblé, éventré, à demi
brûlé », l’assonance en é présente dans ces actions peut se concevoir comme une reprise obsessionnelle et
effrayer le lecteur.
Du coup, Voltaire utilise le champ lexical de l’anatomie du corps « bras », « jambes »,
« mamelles », « égorgées », « éventrées » qui servent à donner des détails sinistres sur les morts.
Le
nombre de morts est exagéré par l’hyperbole « le tout pouvait se monter à une trentaine de mille âmes »
(l.6) Finalement, les victimes sont montrés d’une manière macabre par le nombre de morts, leurs situation
et la forme dont ils ont été tués.
Dans ce texte, Voltaire se livre à faire une violente satire des différentes personnes de la société du
XVIIIe siècle.
Premièrement, il se moque des philosophes « qui tremblait comme un philosophe » (l.7) qui
fait allusion à la théorie de que les philosophes n’étaient pas courageux car ils n’allaient pas se battre.
Puis il
critique la théorie de Leibniz, par l’opposition de « le meilleur des mondes » et « coquins qui infectaient »,
puis les causes que Leibniz défend don sa théorie sont ici objet de moquerie, « la baïonnette fut aussi la
raison ».
Le pouvoir royal est un thème de satire ici, on le voit quand « les deux rois fessaient chanter Te
deum » hymne chrétien, ce qui montre que les deux rois se croient gagnants en montrant ainsi
l’aveuglement des rois.
En conclusion, Voltaire fait un éloge de la guerre en apparence en présentant esthétiquement la guerre,
en la justifiant et en utilisant un registre épique, par contre il finit par faire un violent réquisitoire de la
guerre en utilisant l’ironie, des descriptions macabres des victimes et une satire des personnes de la société
du XVIIIe siècle.
On peut mettre en relation ce chapitre avec l’œuvre de
II Violent réquisitoire de la guerre
1 .
Satire 3 – Satire de la lâcheté de Candide et des philosophes / Satire des pouvoirs ( politiques et religieux ).
On note tout d'abord la comparaison « comme un philosophe » ( ligne 10 ) qui a une valeur
d'antiphrase : le philosophe se définit par la maîtrise de ses émotions.
Mais peut on parler alors de manque
d'engagement ?
A noter aussi la parodie de la philosophie par l'emploi de termes spécifiques utilisés dans un contexte.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire (commentaire)
- Commentaire chapitre 3 de Candide de Voltaire
- Commentaire de Candide Voltaire chapitre 3
- Commentaire du chapitre 1 de Candide de Voltaire
- Commentaire littéraire de Candide de Voltaire, Chapitre 3