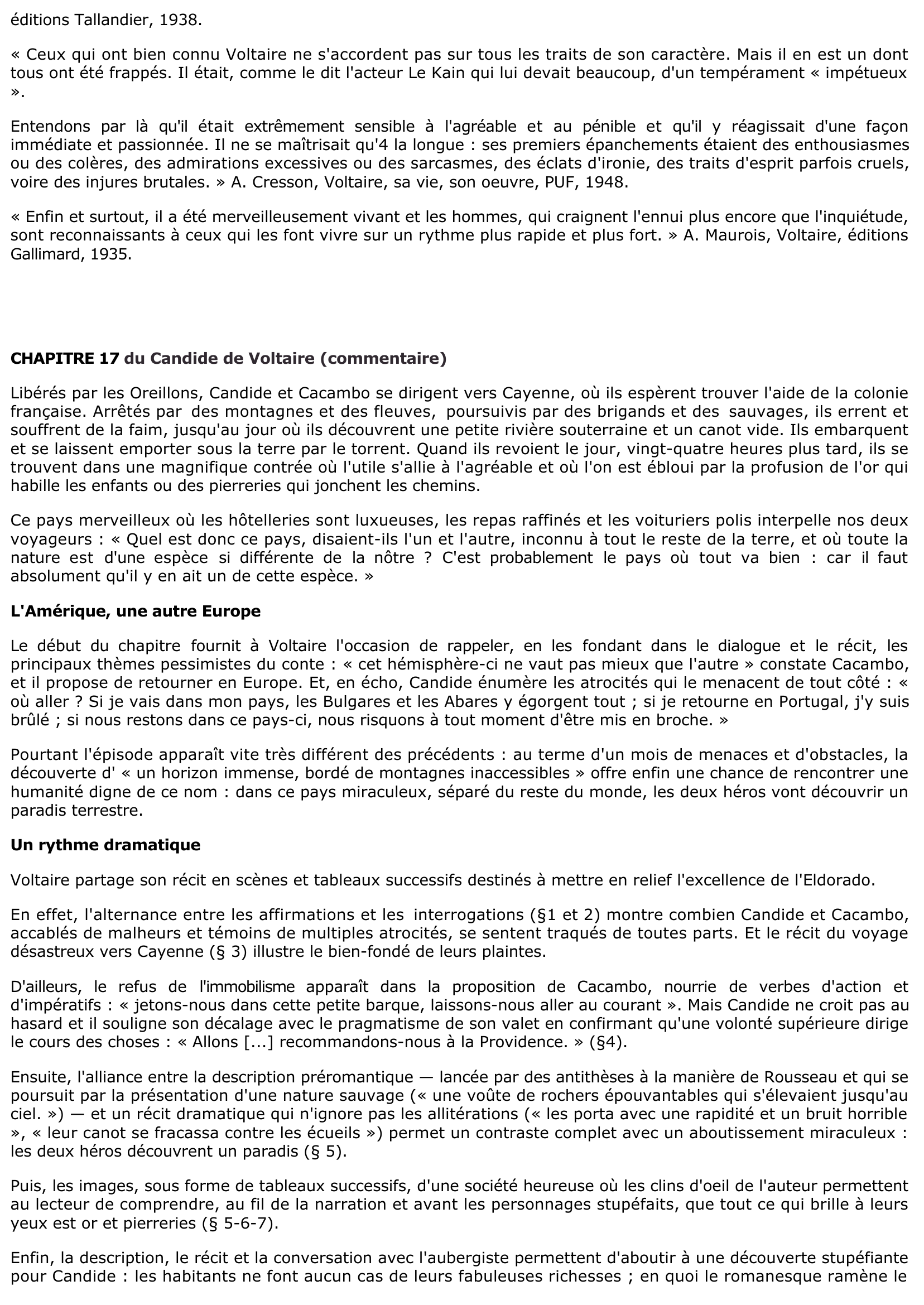CHAPITRE 17 du Candide de Voltaire (commentaire)
Publié le 22/02/2012
Extrait du document


«
éditions Tallandier, 1938.
« Ceux qui ont bien connu Voltaire ne s'accordent pas sur tous les traits de son caractère.
Mais il en est un donttous ont été frappés.
Il était, comme le dit l'acteur Le Kain qui lui devait beaucoup, d'un tempérament « impétueux».
Entendons par là qu'il était extrêmement sensible à l'agréable et au pénible et qu'il y réagissait d'une façonimmédiate et passionnée.
Il ne se maîtrisait qu'4 la longue : ses premiers épanchements étaient des enthousiasmesou des colères, des admirations excessives ou des sarcasmes, des éclats d'ironie, des traits d'esprit parfois cruels,voire des injures brutales.
» A.
Cresson, Voltaire, sa vie, son oeuvre, PUF, 1948.
« Enfin et surtout, il a été merveilleusement vivant et les hommes, qui craignent l'ennui plus encore que l'inquiétude,sont reconnaissants à ceux qui les font vivre sur un rythme plus rapide et plus fort.
» A.
Maurois, Voltaire, éditionsGallimard, 1935.
CHAPITRE 17 du Candide de Voltaire (commentaire)
Libérés par les Oreillons, Candide et Cacambo se dirigent vers Cayenne, où ils espèrent trouver l'aide de la coloniefrançaise.
Arrêtés par des montagnes et des fleuves, poursuivis par des brigands et des sauvages, ils errent etsouffrent de la faim, jusqu'au jour où ils découvrent une petite rivière souterraine et un canot vide.
Ils embarquentet se laissent emporter sous la terre par le torrent.
Quand ils revoient le jour, vingt-quatre heures plus tard, ils setrouvent dans une magnifique contrée où l'utile s'allie à l'agréable et où l'on est ébloui par la profusion de l'or quihabille les enfants ou des pierreries qui jonchent les chemins.
Ce pays merveilleux où les hôtelleries sont luxueuses, les repas raffinés et les voituriers polis interpelle nos deuxvoyageurs : « Quel est donc ce pays, disaient-ils l'un et l'autre, inconnu à tout le reste de la terre, et où toute lanature est d'une espèce si différente de la nôtre ? C'est probablement le pays où tout va bien : car il fautabsolument qu'il y en ait un de cette espèce.
»
L'Amérique, une autre Europe
Le début du chapitre fournit à Voltaire l'occasion de rappeler, en les fondant dans le dialogue et le récit, lesprincipaux thèmes pessimistes du conte : « cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux que l'autre » constate Cacambo,et il propose de retourner en Europe.
Et, en écho, Candide énumère les atrocités qui le menacent de tout côté : «où aller ? Si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Abares y égorgent tout ; si je retourne en Portugal, j'y suisbrûlé ; si nous restons dans ce pays-ci, nous risquons à tout moment d'être mis en broche.
»
Pourtant l'épisode apparaît vite très différent des précédents : au terme d'un mois de menaces et d'obstacles, ladécouverte d' « un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles » offre enfin une chance de rencontrer unehumanité digne de ce nom : dans ce pays miraculeux, séparé du reste du monde, les deux héros vont découvrir unparadis terrestre.
Un rythme dramatique
Voltaire partage son récit en scènes et tableaux successifs destinés à mettre en relief l'excellence de l'Eldorado.
En effet, l'alternance entre les affirmations et les interrogations (§1 et 2) montre combien Candide et Cacambo,accablés de malheurs et témoins de multiples atrocités, se sentent traqués de toutes parts.
Et le récit du voyagedésastreux vers Cayenne (§ 3) illustre le bien-fondé de leurs plaintes.
D'ailleurs, le refus de l'immobilisme apparaît dans la proposition de Cacambo, nourrie de verbes d'action etd'impératifs : « jetons-nous dans cette petite barque, laissons-nous aller au courant ».
Mais Candide ne croit pas auhasard et il souligne son décalage avec le pragmatisme de son valet en confirmant qu'une volonté supérieure dirigele cours des choses : « Allons [...] recommandons-nous à la Providence.
» (§4).
Ensuite, l'alliance entre la description préromantique — lancée par des antithèses à la manière de Rousseau et qui sepoursuit par la présentation d'une nature sauvage (« une voûte de rochers épouvantables qui s'élevaient jusqu'auciel.
») — et un récit dramatique qui n'ignore pas les allitérations (« les porta avec une rapidité et un bruit horrible», « leur canot se fracassa contre les écueils ») permet un contraste complet avec un aboutissement miraculeux :les deux héros découvrent un paradis (§ 5).
Puis, les images, sous forme de tableaux successifs, d'une société heureuse où les clins d'oeil de l'auteur permettentau lecteur de comprendre, au fil de la narration et avant les personnages stupéfaits, que tout ce qui brille à leursyeux est or et pierreries (§ 5-6-7).
Enfin, la description, le récit et la conversation avec l'aubergiste permettent d'aboutir à une découverte stupéfiantepour Candide : les habitants ne font aucun cas de leurs fabuleuses richesses ; en quoi le romanesque ramène le.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire (commentaire)
- Commentaire chapitre 3 de Candide de Voltaire
- Commentaire de Candide Voltaire chapitre 3
- Commentaire du chapitre 1 de Candide de Voltaire
- Commentaire littéraire de Candide de Voltaire, Chapitre 3