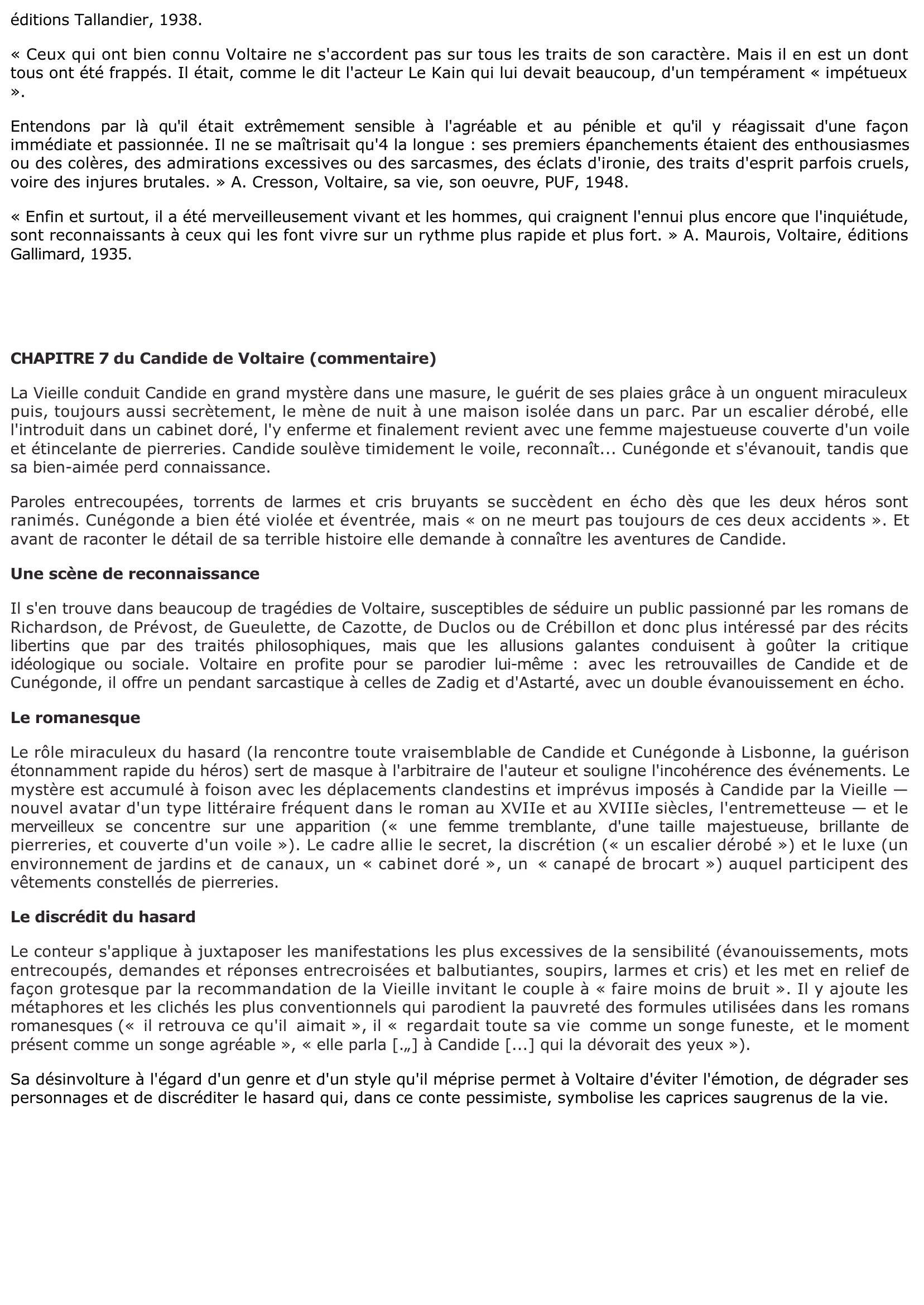CHAPITRE 7 du Candide de Voltaire (commentaire)
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
«
éditions Tallandier, 1938.
« Ceux qui ont bien connu Voltaire ne s'accordent pas sur tous les traits de son caractère.
Mais il en est un donttous ont été frappés.
Il était, comme le dit l'acteur Le Kain qui lui devait beaucoup, d'un tempérament « impétueux».
Entendons par là qu'il était extrêmement sensible à l'agréable et au pénible et qu'il y réagissait d'une façonimmédiate et passionnée.
Il ne se maîtrisait qu'4 la longue : ses premiers épanchements étaient des enthousiasmesou des colères, des admirations excessives ou des sarcasmes, des éclats d'ironie, des traits d'esprit parfois cruels,voire des injures brutales.
» A.
Cresson, Voltaire, sa vie, son oeuvre, PUF, 1948.
« Enfin et surtout, il a été merveilleusement vivant et les hommes, qui craignent l'ennui plus encore que l'inquiétude,sont reconnaissants à ceux qui les font vivre sur un rythme plus rapide et plus fort.
» A.
Maurois, Voltaire, éditionsGallimard, 1935.
CHAPITRE 7 du Candide de Voltaire (commentaire)
La Vieille conduit Candide en grand mystère dans une masure, le guérit de ses plaies grâce à un onguent miraculeuxpuis, toujours aussi secrètement, le mène de nuit à une maison isolée dans un parc.
Par un escalier dérobé, ellel'introduit dans un cabinet doré, l'y enferme et finalement revient avec une femme majestueuse couverte d'un voileet étincelante de pierreries.
Candide soulève timidement le voile, reconnaît...
Cunégonde et s'évanouit, tandis quesa bien-aimée perd connaissance.
Paroles entrecoupées, torrents de larmes et cris bruyants se succèdent en écho dès que les deux héros sontranimés.
Cunégonde a bien été violée et éventrée, mais « on ne meurt pas toujours de ces deux accidents ».
Etavant de raconter le détail de sa terrible histoire elle demande à connaître les aventures de Candide. COMMENTAIRE
Une scène de reconnaissance
Il s'en trouve dans beaucoup de tragédies de Voltaire, susceptibles de séduire un public passionné par les romans deRichardson, de Prévost, de Gueulette, de Cazotte, de Duclos ou de Crébillon et donc plus intéressé par des récitslibertins que par des traités philosophiques, mais que les allusions galantes conduisent à goûter la critiqueidéologique ou sociale.
Voltaire en profite pour se parodier lui-même : avec les retrouvailles de Candide et deCunégonde, il offre un pendant sarcastique à celles de Zadig et d'Astarté, avec un double évanouissement en écho.
Le romanesque
Le rôle miraculeux du hasard (la rencontre toute vraisemblable de Candide et Cunégonde à Lisbonne, la guérisonétonnamment rapide du héros) sert de masque à l'arbitraire de l'auteur et souligne l'incohérence des événements.
Lemystère est accumulé à foison avec les déplacements clandestins et imprévus imposés à Candide par la Vieille —nouvel avatar d'un type littéraire fréquent dans le roman au XVIIe et au XVIIIe siècles, l'entremetteuse — et lemerveilleux se concentre sur une apparition (« une femme tremblante, d'une taille majestueuse, brillante depierreries, et couverte d'un voile »).
Le cadre allie le secret, la discrétion (« un escalier dérobé ») et le luxe (unenvironnement de jardins et de canaux, un « cabinet doré », un « canapé de brocart ») auquel participent desvêtements constellés de pierreries.
Le discrédit du hasard
Le conteur s'applique à juxtaposer les manifestations les plus excessives de la sensibilité (évanouissements, motsentrecoupés, demandes et réponses entrecroisées et balbutiantes, soupirs, larmes et cris) et les met en relief defaçon grotesque par la recommandation de la Vieille invitant le couple à « faire moins de bruit ».
Il y ajoute lesmétaphores et les clichés les plus conventionnels qui parodient la pauvreté des formules utilisées dans les romansromanesques (« il retrouva ce qu'il aimait », il « regardait toute sa vie comme un songe funeste, et le momentprésent comme un songe agréable », « elle parla [.„] à Candide [...] qui la dévorait des yeux »).
Sa désinvolture à l'égard d'un genre et d'un style qu'il méprise permet à Voltaire d'éviter l'émotion, de dégrader sespersonnages et de discréditer le hasard qui, dans ce conte pessimiste, symbolise les caprices saugrenus de la vie..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 19 de Candide de Voltaire (commentaire)
- Commentaire chapitre 3 de Candide de Voltaire
- Commentaire de Candide Voltaire chapitre 3
- Commentaire du chapitre 1 de Candide de Voltaire
- Commentaire littéraire de Candide de Voltaire, Chapitre 3