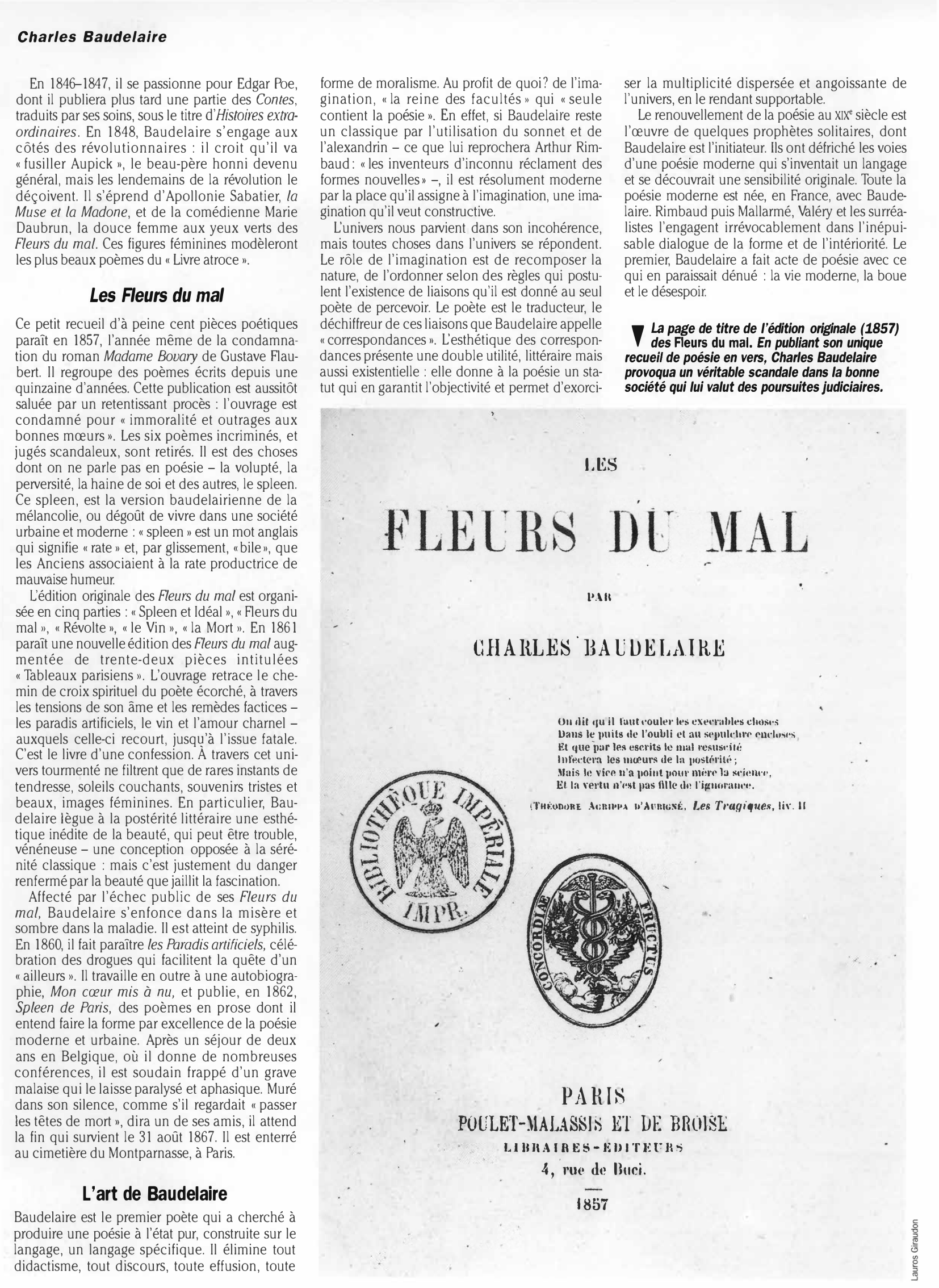CHARLES BAUDELAIRE
Publié le 04/02/2019
Extrait du document

Les Fleurs du mal
Ce petit recueil d’à peine cent pièces poétiques paraît en 1857, l’année même de la condamnation du roman Madame Bovary de Gustave Flaubert. Il regroupe des poèmes écrits depuis une quinzaine d’années. Cette publication est aussitôt saluée par un retentissant procès : l’ouvrage est condamné pour « immoralité et outrages aux bonnes mœurs ». Les six poèmes incriminés, et jugés scandaleux, sont retirés. Il est des choses dont on ne parle pas en poésie - la volupté, la perversité, la haine de soi et des autres, le spleen. Ce spleen, est la version baudelairienne de la mélancolie, ou dégoût de vivre dans une société urbaine et moderne : « spleen » est un mot anglais qui signifie « rate » et, par glissement, «bile», que les Anciens associaient à la rate productrice de mauvaise humeur.
L’édition originale des Fleurs du mal est organisée en cinq parties : « Spleen et Idéal », « Fleurs du mal », « Révolte », « le Vin », « la Mort ». En 1861 paraît une nouvelle édition des Fleurs du mal augmentée de trente-deux pièces intitulées « Tableaux parisiens ». L’ouvrage retrace le chemin de croix spirituel du poète écorché, à travers les tensions de son âme et les remèdes factices -les paradis artificiels, le vin et l’amour charnel -auxquels celle-ci recourt, jusqu’à l’issue fatale. C’est le livre d’une confession. À travers cet univers tourmenté ne filtrent que de rares instants de tendresse, soleils couchants, souvenirs tristes et beaux, images féminines. En particulier, Baudelaire lègue à la postérité littéraire une esthétique inédite de la beauté, qui peut être trouble, vénéneuse - une conception opposée à la sérénité classique : mais c’est justement du danger renfermé par la beauté que jaillit la fascination.
Affecté par l’échec public de ses Fleurs du mal, Baudelaire s’enfonce dans la misère et sombre dans la maladie. Il est atteint de syphilis. En 1860, il fait paraître les Paradis artificiels, célébration des drogues qui facilitent la quête d’un « ailleurs ». Il travaille en outre à une autobiographie, Mon cœur mis à nu, et publie, en 1862, Spleen de Paris, des poèmes en prose dont il entend faire la forme par excellence de la poésie moderne et urbaine. Après un séjour de deux ans en Belgique, où il donne de nombreuses conférences, il est soudain frappé d’un grave malaise qui le laisse paralysé et aphasique. Muré dans son silence, comme s’il regardait « passer les têtes de mort », dira un de ses amis, il attend la fin qui survient le 31 août 1867. Il est enterré au cimetière du Montparnasse, à Paris.
L’art de Baudelaire
Baudelaire est le premier poète qui a cherché à produire une poésie à l’état pur, construite sur le langage, un langage spécifique. Il élimine tout didactisme, tout discours, toute effusion, toute
forme de moralisme. Au profit de quoi? de l’imagination, «la reine des facultés» qui «seule contient la poésie ». En effet, si Baudelaire reste un classique par l’utilisation du sonnet et de l’alexandrin - ce que lui reprochera Arthur Rimbaud : « les inventeurs d’inconnu réclament des formes nouvelles» -, il est résolument moderne par la place qu’il assigne à l’imagination, une imagination qu’il veut constructive.
L’univers nous parvient dans son incohérence, mais toutes choses dans l’univers se répondent. Le rôle de l’imagination est de recomposer la nature, de l’ordonner selon des règles qui postulent l’existence de liaisons qu’il est donné au seul poète de percevoir. Le poète est le traducteur, le déchiffreur de ces liaisons que Baudelaire appelle « correspondances ». L’esthétique des correspondances présente une double utilité, littéraire mais aussi existentielle : elle donne à la poésie un statut qui en garantit l’objectivité et permet d’exorci-
Lauros Giraudon
ser la multiplicité dispersée et angoissante de l’univers, en le rendant supportable.
Le renouvellement de la poésie au xixe siècle est l’œuvre de quelques prophètes solitaires, dont Baudelaire est l’initiateur. Ils ont défriché les voies d’une poésie moderne qui s’inventait un langage et se découvrait une sensibilité originale. Toute la poésie moderne est née, en France, avec Baudelaire. Rimbaud puis Mallarmé, Valéry et les surréalistes l’engagent irrévocablement dans l’inépuisable dialogue de la forme et de l’intériorité. Le premier, Baudelaire a fait acte de poésie avec ce qui en paraissait dénué : la vie moderne, la boue et le désespoir.
▼ La page de titre de l'édition originale (1857) des Fleurs du mal. En publiant son unique recueil de poésie en vers, Charles Baudelaire provoqua un véritable scandale dans la bonne société qui lui valut des poursuites judiciaires.

«
Charles
Baudelaire
En 1846- 1847, il se passionne pour Edgar Fbe,
dont il publiera plus tard une partie des Contes,
traduits par ses soins, sous le titre d'Histoires extra
ordinaires.
En 1848, Baudelaire s'engage aux
côtés des révolutionnaires : il croit qu'il va
«fusiller Aupick », le beau-père honni devenu
général, mais les lendemains de la révolution le
déçoivent.
Il s'éprend d'Apollonie Sabatier, la
Muse et la Madone, et de la comédienne Marie
Daubrun, la douce femme aux yeux verts des
Fleurs du mal.
Ces figures féminines modèleront
les plus beaux poèmes du « Livre atroce ».
Les Fleurs du mal
Ce petit recueil d'à peine cent pièces poétiques
paraît en 1857 , l'année même de la condamna
tion du roman Madame Bovary de Gustave Flau
bert.
Il regroupe des poèmes écrits depuis une
quinzaine d'années.
Cette publication est aussitôt
saluée par un retentissant procès : l'ouvrage est
condamné pour « immoralité et outrages aux
bonnes mœurs ».
Les six poèmes incriminés, et
jugés scandaleux, sont retirés.
Il est des choses
dont on ne parle pas en poésie -la volupté, la
perversité, la haine de soi et des autres, le spleen.
Ce spleen, est la version baudelairienne de la
mélancolie, ou dégoût de vivre dans une société
urbaine et moderne : «spleen , est un mot anglais
qui signifie «rate •• et, par glissement, «bile>>, que
les Anciens associaient à la rate productrice de
mauvaise humeur.
L'édition originale des Fleurs du mal est organi
sée en cinq parties : «Spleen et Idéal ••, «Fleurs du
mal ••, «Révolte», «le Vin>>, «la Mort>> .
En 1861
paraît une nouvelle édition des Fleurs du mal aug
mentée de trente-deu x pièces intitulées
«Tableaux parisiens>>.
L'ouvrage retrace le che
min de croix spirituel du poète écorché, à travers
les tensions de son âme et les remèdes factices -
les paradis artificiels, le vin et l'amour charnel -
auxquels celle-ci recourt, jusq�'à l'issue fatale.
C'est le livre d'une confession.
A travers cet uni
vers tourmenté ne filtrent que de rares instants de
tendresse, soleils couchants, souvenirs tristes et
beaux, images féminines.
En particu lier, Bau
delaire lègue à la postérité littéraire une esthé
tique inédite de la beauté, qui peut être trouble,
vénéneuse -une conception opposée à la séré
nité classique : mais c'est justement du danger
renfermé par la beauté que jaillit la fascination.
Affecté par l'échec public de ses Fleurs du
mal, Baudelaire s'enfonce dans la misère et
sombre dans la maladie.
Il est atteint de syphilis.
En 1860, il fait paraître les Paradis artificiels, célé
bration des drogues qui facilitent la quête d'un
«ailleurs>> .
Il travaille en outre à une autobiogra
phie, Mon cœur mis à nu, et publie, en 1862 ,
Spleen de Paris, des poèmes en prose dont il
entend faire la forme par excellence de la poésie
moderne et urbaine.
Après un séjour de deux
ans en Belgique, où il donne de nombreuses
conférences, il est soudain frappé d'un grave
malaise qui le laisse paralysé et aphasique.
Muré
dans son silence, comme s'il regardait «passer
les têtes de mort ••, dira un de ses amis, il attend
la fin qui survient le 31 août 1867.
Il est enterré
au cimetière du Montparnas se, à Paris.
L'art de Baudelaire
Baudelaire est le premier poète qui a cherché à
produire une poésie à l'état pur, construite sur le
langage, un langage spécifique.
Il élimine tout
didactisme, tout discours, toute effusion, toute forme
de moralisme.
Au profit de quoi? de l'ima
gination, «la reine des facultés •• qui «seule
contient la poésie».
En effet, si Baudelaire reste
un classique par l'utilisation du sonnet et de
l'alexandrin -ce que lui reprochera Arthur Rim
baud: «les inventeurs d'inconnu réclament des
formes nouvelles •• -, il est résolument moderne
par la place qu'il assigne à l'imagination, une ima
gination qu'il veut constructive.
L'univers nous parvient dans son incohérence,
mais toutes choses dans l'univers se répondent.
Le rôle de l'imagination est de recomposer la
nature, de l'ordonner selon des règles qui postu
lent l'existence de liaisons qu'il est donné au seul
poète de percevoir.
Le poète est le traducte ur, le
déchiffreur de ces liaisons que Baudelaire appelle
«co rrespondan ces».
L'esthétique des correspon
dances présente une double utilité, littéraire mais
aussi existentielle : elle donne à la poésie un sta
tut qui en garantit l'objectivité et permet d'exorci-
LES
l'A Il ser
la multiplicité dispersée et angoissante de
l'univers, en le rendant supportable.
Le renouvellement de la poésie au XIX' siècle est
l'œuvre de quelques prophètes solitaires, dont
Baudelaire est l'initiateur.
Ils ont défriché les voies
d'une poésie moderne qui s'inventait un langage
et se découvrait une sensibilité originale.
Toute la
poésie moderne est née, en France, avec Baude
laire.
Rimbaud puis Mallarmé, Valéry et les surréa
listes l'engagent irrévocablement dans l'inépui
sable dialogue de la forme et de l'intériorité.
Le
premier , Baudelaire a fait acte de poésie avec ce
qui en paraissait dénué : la vie moderne, la boue
et le désespoir
' La page de titre de l'édition originale (1857)
des Aeurs du mal.
En publiant son unique
recueil de poésie en vers, Charles Baudelaire
provoqua un véritable scandale dans la bonne
société qui lui valut des poursuites judiciaires.
CHARLES.
BAU DELAII:t.E
On rlit •lu 'il l'uut t•oule•· lo!S cxeOUI' lllÎ:l'C 13 st·ien•·•·,
Et la wrln •l'l!st JlliS fille tlnl'igno•·aut•c.
('l'n>:ono>RE At:nlw� u'Aun�t:NÉ, l.es 1'ragique.�.
li\·.
Il
PAlU�
POULET-MALASSI� ET DE BROlSE
LJUHAIRES-HUITE�HS
4, .l'ue de Buci.
1857.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Le poison, Charles Baudelaire
- LL3 Lecture linéaire Allégorie Charles Baudelaire
- Fiche de révision Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire (1857)
- Etude linéaire - Spleen et Idéal, Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire