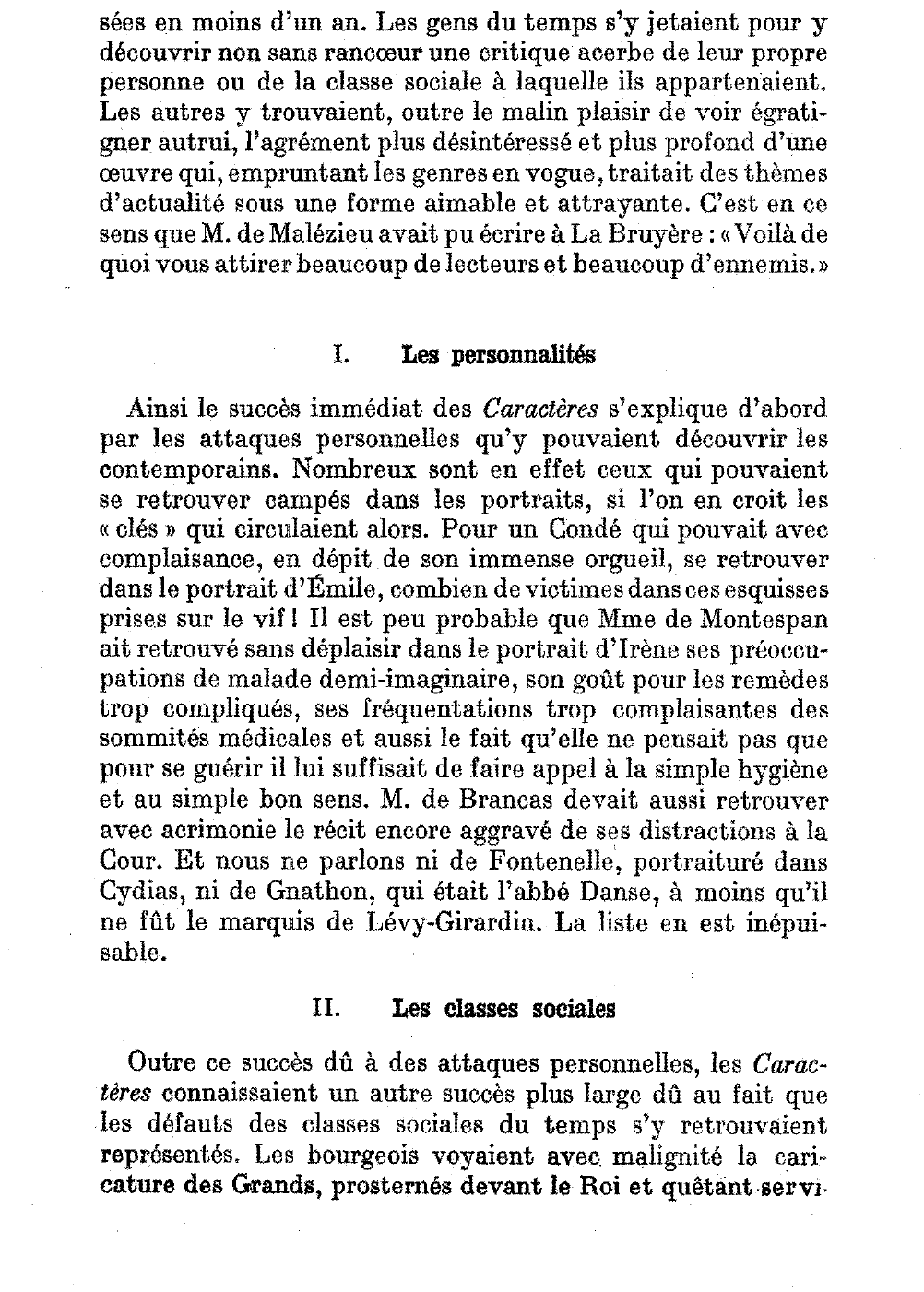Comment vous expliquez-vous le succès que connurent en leur temps Les Caractères de La Bruyère ?
Publié le 18/07/2012

Extrait du document

... les deux classes sociales s'accordent dans la haine féroce qu'elles éprouvent contre les financiers : et leur haine se satisfait à voir la peinture de ces gens sans pitié qui font la loi grâce à leur fortune, tel ce Champagne qui sans hésitation «signe un ordre qu'on lui présente, qui ôterait le pain à toute une province si l'on n'y remédiait«, et s'arrogent les «plus grands noms « et «les terres les mieux titrées avec leurs ...
châteaux et leurs maisons antiques >>.

«
144 La Bruyère
sées en moins d'un an.
Les gens du temps s'y jetaient pour y
découvrir non sans rancœur une critique acerbe de leur propre
personne ou de
la classe sociale à laquelle ils appartenaient.
Les autres y trouvaient, outre le malin plaisir de voir
égrati·
gner autrui, l'agrément plus désintéressé et plus profond d'une
œuvre qui,
empruntant les genres en vogue, traitait des thèmes
d'actualité sous une forme aimable
et attrayante.
C'est en ce
sens que M.
de Malézieu avait pu écrire à La Bruyère : «Voilà de
quoi vous
attirer beaucoup de lecteurs et beaucoup d'ennemis.))
I.
Les personnalités
Ainsi le succès immédiat des Caractères s'explique d'abord
par les attaques personnelles qu'y pouvaient découvrir les
contemporains.
Nombreux sont en effet ceux qui pouvaient
se
retrouver campés dans les portraits, si l'on en croit les
qui circulaient alors.
Pour un Condé qui pouvait avec
complaisance, en dépit de son immense orgueil, se retrouver
dans le portrait d'Émile, combien de victimes dans ces esquisses
prises sur le vif
1 Il est peu probable que Mme de Montespan
ait retrouvé sans déplaisir dans le portrait d'Irène ses préoccu
pations de malade demi·imaginaire, son goût pour les remèdes
trop compliqués, ses fréquentations trop complaisantes des
sommités médicales
et aussi le fait qu'elle ne pensait pas que
pour se guérir
il lui suffisait de faire appel à la simple hygiène
et au simple bon sens.
M.
de Brancas devait aussi retrouver
avec acrimonie le récit encore aggravé de ses distractions à
la
Cour.
Et nous ne parlons ni de Fontenelle, portraituré dans
Cydias, ni de Gnathon, qui
était l'abbé Danse, à moins qu'il
ne
fût le marquis de Lévy-Girardin.
La liste en est inépui
sable.
II.
Les classes sociales
Outre ce succès dû à des attaques personnelles, les Carac
tères connaissaient un autre succès plus large dû au fait que
les défauts des classes sociales
du temps s'y retrouvaient
représentés.
Les bourgeois voyaient avec malignité la
cari
cature des Grands, prosternés devant le Roi et quêta.nt ·Servi..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pour quelles raisons les Caractères de La Bruyère ont-ils eu tant de succès en leur temps ? Pour quelles raisons nous intéressent-ils aujourd'hui encore ?
- "La liberté n'est pas oisiveté; c'est un usage libre du temps, c'est le choix du travail et de l'exercice. Etre libre, en un mot, n'est pas ne rien faire, c'est être seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait point. Quel bien en ce sens que la liberté!" La Bruyère, Les Caractères. Qu'en pensez-vous ?
- « Je le tiens, disait de La Bruyère un critique moderne, pour l'homme le plus intelligent du XVIIe siècle. Il est, de tous les écrivains de ce temps-là, celui qui, revenant au monde, aurait le moins d'étonnements. » En vous appuyant sur la connaissance que vous avez du livre des « caractères », vous essaierez de préciser ce qui, s'il revenait au monde, aujourd'hui, étonnerait le moins La Bruyère.
- LE TEMPS ET LA LIBERTÉ "La liberté n'est pas oisiveté ; c'est un usage libre du temps." La Bruyère, Les Caractères, 1688. Commentez cette citation.
- Dissertation : D'après votre lecture des caractères de La Bruyère et d’autres moralistes que vous avez lus, peut-on dire que “tous les hommes se valent”, ou émerge t’il des différences entre les personnes et les caractères ? Vous développerez vos impressions de lecture en vous appuyant sur des exemples précis.