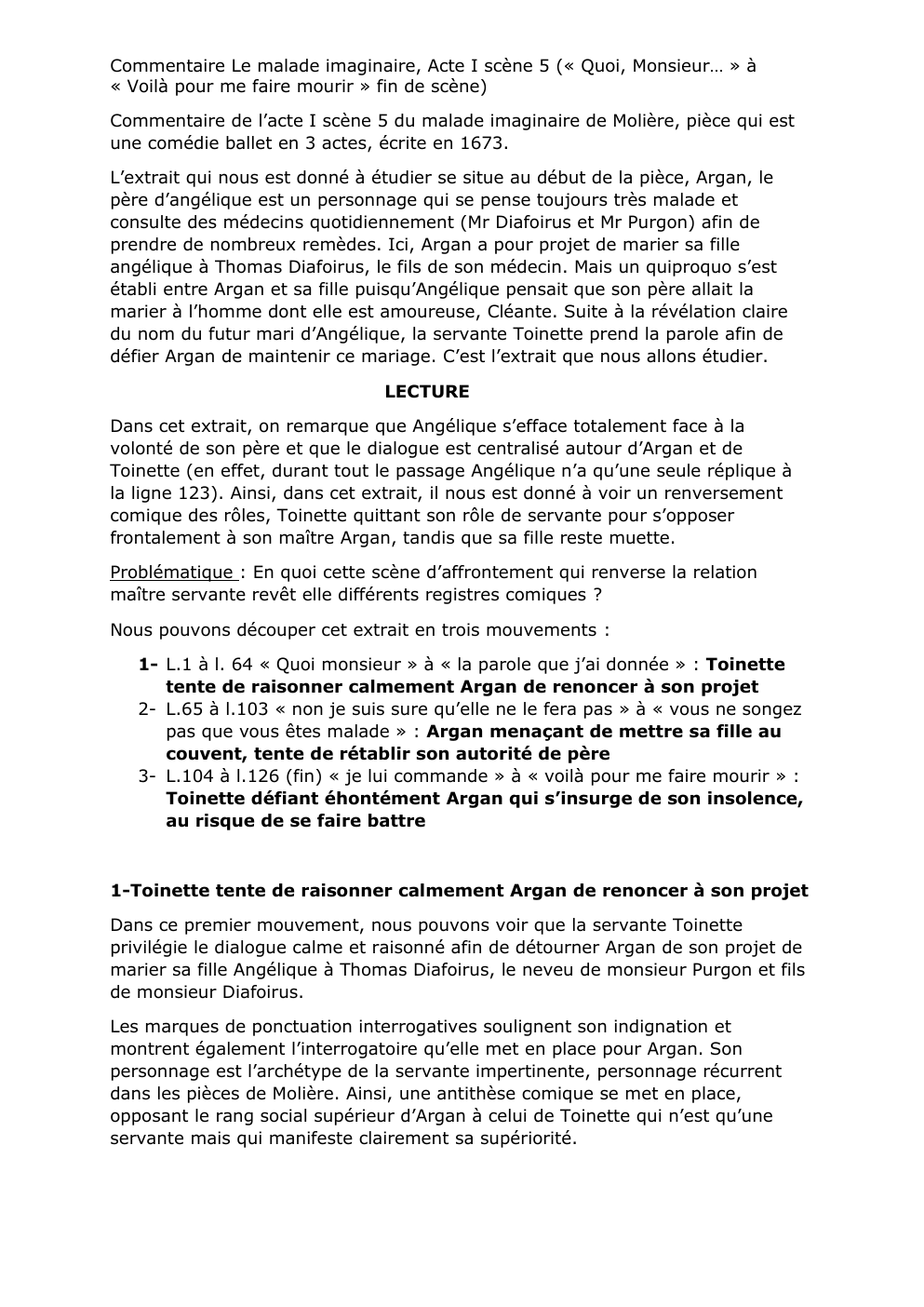Commentaire Le malade imaginaire, Acte I scène 5 (« Quoi, Monsieur… » à « Voilà pour me faire mourir » fin de scène)
Publié le 24/12/2022
Extrait du document
«
Commentaire Le malade imaginaire, Acte I scène 5 (« Quoi, Monsieur… » à
« Voilà pour me faire mourir » fin de scène)
Commentaire de l’acte I scène 5 du malade imaginaire de Molière, pièce qui est
une comédie ballet en 3 actes, écrite en 1673.
L’extrait qui nous est donné à étudier se situe au début de la pièce, Argan, le
père d’angélique est un personnage qui se pense toujours très malade et
consulte des médecins quotidiennement (Mr Diafoirus et Mr Purgon) afin de
prendre de nombreux remèdes.
Ici, Argan a pour projet de marier sa fille
angélique à Thomas Diafoirus, le fils de son médecin.
Mais un quiproquo s’est
établi entre Argan et sa fille puisqu’Angélique pensait que son père allait la
marier à l’homme dont elle est amoureuse, Cléante.
Suite à la révélation claire
du nom du futur mari d’Angélique, la servante Toinette prend la parole afin de
défier Argan de maintenir ce mariage.
C’est l’extrait que nous allons étudier.
LECTURE
Dans cet extrait, on remarque que Angélique s’efface totalement face à la
volonté de son père et que le dialogue est centralisé autour d’Argan et de
Toinette (en effet, durant tout le passage Angélique n’a qu’une seule réplique à
la ligne 123).
Ainsi, dans cet extrait, il nous est donné à voir un renversement
comique des rôles, Toinette quittant son rôle de servante pour s’opposer
frontalement à son maître Argan, tandis que sa fille reste muette.
Problématique : En quoi cette scène d’affrontement qui renverse la relation
maître servante revêt elle différents registres comiques ?
Nous pouvons découper cet extrait en trois mouvements :
1- L.1 à l.
64 « Quoi monsieur » à « la parole que j’ai donnée » : Toinette
tente de raisonner calmement Argan de renoncer à son projet
2- L.65 à l.103 « non je suis sure qu’elle ne le fera pas » à « vous ne songez
pas que vous êtes malade » : Argan menaçant de mettre sa fille au
couvent, tente de rétablir son autorité de père
3- L.104 à l.126 (fin) « je lui commande » à « voilà pour me faire mourir » :
Toinette défiant éhontément Argan qui s’insurge de son insolence,
au risque de se faire battre
1-Toinette tente de raisonner calmement Argan de renoncer à son projet
Dans ce premier mouvement, nous pouvons voir que la servante Toinette
privilégie le dialogue calme et raisonné afin de détourner Argan de son projet de
marier sa fille Angélique à Thomas Diafoirus, le neveu de monsieur Purgon et fils
de monsieur Diafoirus.
Les marques de ponctuation interrogatives soulignent son indignation et
montrent également l’interrogatoire qu’elle met en place pour Argan.
Son
personnage est l’archétype de la servante impertinente, personnage récurrent
dans les pièces de Molière.
Ainsi, une antithèse comique se met en place,
opposant le rang social supérieur d’Argan à celui de Toinette qui n’est qu’une
servante mais qui manifeste clairement sa supériorité.
Commentaire Le malade imaginaire, Acte I scène 5 (« Quoi, Monsieur… » à
« Voilà pour me faire mourir » fin de scène)
On peut noter l’utilisation de l’adjectif « burlesque » à la l.1 qui renvoie à un
aspect méta théâtral.
En effet, à travers le personnage de Toinette, Molière
confirme le registre comique de la pièce et l’inscrit dans une dimension populaire
de comédie des mœurs, comme peuvent en attester l’utilisation par Argan
d’adjectifs injurieux comme « coquine » et « impudente » à la l.4 et l.20-21 qui
relèvent du comique farcesque.
Toinette use du vocabulaire de la raison et de la bienveillance afin rationner
Argan comme on peut le voir l.8-9 « sang-froid » « s’il-vous-plaît » ou l.17-18
« répondre doucement » « mettez la main à la conscience ».
Elle l’invite
également à se calmer l.6 avec « tout doux », ce qui est assez comique puisque
c’est elle qui a initié la querelle.
A cela, Argan lui oppose une argumentation
basée sur SA raison (l.10), mais ce mariage n’est basé que sur ses propres
intérêts comme en témoignent l’utilisation répétée de la première personne
(l.11) et les déterminants possessifs à la première personne (« me voyant
infirme » l.10, « ma maladie » l.11, « me sont nécessaires » l.14), ce qui traduit
un égoïsme important de la part d’Argan.
Le comique de cette scène s’amplifie par la suite, notamment avec la répétition
l.20 dans la réplique d’Argan « si je suis malade ? si je suis malade » permettant
d’accentuer le caractère colérique d’Argan, ce à quoi Toinette répond, non sans
ironie : « Oui… pensez ».
Ici, on peut y voir une polyphonie du mot « malade »
puisqu’outre les nombreux maux dont pense souffrir Argan, Toinette l’accuse ici
d’autres maladies telles que la folie et la pathophobie.
Cette double énonciation
renforce la complicité naissante entre Toinette et le lecteur.
Par la suite, Toinette use d’un vocabulaire plus affectif en se plaçant en tant
qu’amie (l.31) et en lui offrant un conseil (l.32).
La réplique d’Argan demandant
à connaître ce conseil crée un effet d’attente chez le lecteur, qui est comblé par
une réplique brève et frontale de Toinette lui proposant purement et simplement
de renoncer à ce mariage, ce qui a pour effet d’augmenter la capacité comique
de la scène puisque Argan et le lecteur s’attendait certainement à un réel conseil
et non pas à une réplique aussi cinglante.
Par la suite, nous sommes en présence de 6 répliques s’enchainant en
stichomythies, ce qui augmente le rythme du récit et par la même occasion la
tension présente entre les personnages, ce qui crée encore un effet d’attente
chez le lecteur, une attente du conflit qui est généralement synonyme de
comique farcesque.
Ces stichomythies sont également marquées par des jeux de
répétitions (« raison », « consentira », « fille ») et l’emploi impertinent du futur
de l’indicatif par Toinette (« n’y consentira point » l.36) afin de montrer qu’elle
est certaine de l’échec du projet d’Argan, ce qui accentue encore plus l’aspect
comique de l’échange.
Toinette tente ensuite de ridiculiser l’homme qu’Argan a choisi pour sa fille en
créant un rythme ternaire par l’utilisation d’une anaphore l.41-42 sur le nom
Diafoirus.
A cela, Argan rétorque par des arguments relevant du matérialisme
comme en témoigne le vocabulaire monétaire qu’il emploie « parti plus
avantageux » l.43, « héritier » l.45, « huit mille bonne livres de rente » l.48)
Commentaire Le malade imaginaire, Acte I scène 5 (« Quoi, Monsieur… » à
« Voilà pour me faire mourir » fin de scène)
exposant son caractère vénal, en opposition à Toinette qui privilégie les
sentiments d’Angélique.
Le comique de la scène est encore souligné par la réflexion de Toinette l.49 qui
se permet de se moquer ouvertement des médecins.
L’utilisation de nouvelles stichomythies permet encore une fois d’augmenter le
rythme du récit la tension entre les personnages, d’autant plus que dans ce
passage, Argan laisse éclater son orgueil en usant de phrases performatives (« je
veux » l.57 et l.63) mettant en place un comique de caractère.
Ainsi, dans ce mouvement on voit que Toinette se substitue totalement à
Angélique qui reste muette face à son père par peur de contrarier ses volontés.
L’absence de retenue de Toinette permet un échange comique basé sur le non
respect des types des personnages et révèle le caractère colérique et orgueilleux
d’Argan qui va tenter de rétablir son autorité dans le second mouvement.
2- Argan menaçant de mettre sa fille au couvent, tente de rétablir son
autorité de père
Bien que Toinette apparaisse comme supérieure sur le plan de la parole grâce à
sa maitrise du discours, Argan reste supérieur sur le plan social et veut le faire
savoir.
Ainsi, dans ce second mouvement, Argan se montre menaçant, en employant le
futur de l’indicatif (« forcerai » l.66, « fera » l.68, « mettrai » l.68).
Il souhaite
également réasseoir son autorité paternelle en chosifiant Angélique, puisqu’il se
réfère à elle par l’utilisation du pronom « elle » (l.68) ou « la /l’y » (l.66-68).
Le
fait de discuter du destin d’Angélique sans l’inclure dans la discussion et de parler
d’elle comme si elle n’était pas présente alors qu’elle est juste à coté ajoute
également une dimension comique à la scène.
Ce second mouvement contient également un long passage stichomythique allant
de la l.66 à la l.89, créant un rythme très rapide, des répliques cinglantes,
augmentant encore la tension entre les personnages et donc l’attente du lecteur
de la scène de conflit qui correspond à l’apogée du comique farcesque.
Les
répliques brèves et vives de Toinette visent à déstabiliser et à décrédibiliser
Argan.
Pour....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Malade Imaginaire: Acte 3 Scène 10 - Molière - commentaire
- analyse linéaire Molière - Texte 1 : Acte II scène 5 (extrait du Malade Imaginaire)
- Analyse linéaire Acte 1 scène 1 Le malade imaginaire : monologue d’Argan
- La scène XII de l’acte III du malade imaginaire de Molière
- Scène XII de l'acte III du malade imaginaire de Molière